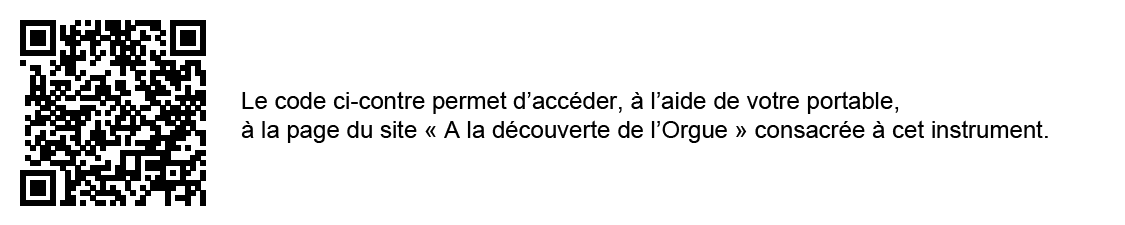Goldbach-Altenbach, l'orgue Besserer, le 25/07/2020.
Goldbach-Altenbach, l'orgue Besserer, le 25/07/2020.Cet orgue a été construit par Jules Besserer en 1927, et ce fut certainement son dernier instrument neuf. Il est malheureusement plus en bon état. Et pourtant, il ne manque pas d'intérêt, et mériterait vraiment un relevage. Malheureusement, la terrible désinformation portant sur la traction pneumatique a gravement pénalisé les orgues de cette époque, et, comme d'autres, il a été gravement sous-évalué. A découvrir, donc.
Historique
On sait qu'il n'y avait pas d'orgue à Goldbach-Altenbach en 1840. Un premier instrument y est attesté en 1868 par la présence d'un organiste. [Barth] [IHOA]
En 1883, Heinrich Koulen vint faire un entretien. [IHOA] [ValleeStAmarin]
D'après le témoignage de l'abbé Victor Hentz, cet orgue "était jusqu'alors, un instrument de discorde, plutôt que d'harmonie". L'expression peut évoquer soit une source de conflits, soit des prestations musicales calamiteuses. Il est probable qu'elle soit à prendre dans le second sens. La menuiserie fut confiée à un artisan de Goldbach, Simon Peter du Blanschen. Les travaux ont été achevés le 25/10/1883. [ValleeStAmarin]
En 1906, Joseph Antoine Berger fit une réparation. [IHOA] [ValleeStAmarin]
L'orgue a été fortement dégradé vers 1916, par faits de guerre. [IHOA]
1925 (instrument actuel)
Historique
En 1925, Jules Besserer posa un bel orgue, esthétiquement situé à l'articulation entre le post-romantique et le néo-classique. [NAlsacien]
Le Nouvel Alsacien a consacré deux articles à l'événement. Le premier, daté du 09/05/1925, fait état d'une réception ("Prüfung") par trois organistes (malheureusement non nommés), le jeudi précédent, soit le 07/05/1925. L'article est très élogieux, l'auteur parlant d'une œuvre somptueuse ("Prachtwerk") de "Jules Besserer de Leymen près de Bâle". [NAlsacien]
Le second article, daté du 26/05/1925 présente surtout le nouvel orgue comme une preuve de la résilience de Goldbach après le conflit mondial. L'instrument y est décrit comme ayant 24 registres sur deux claviers et une pédale complète, et doté d'une console indépendante permettant à l'organiste de voir l'autel. [NAlsacien]
Une inscription au crayon, sur un montant de la boîte expressive, indique que Besserer est revenu le 20/03/1929, peut-être pour poser un ventilateur électrique. (Une des lignes est difficilement lisible.) Curieusement, la signature est : "Besserer fils et père, facteur d'orgues" : le fils est Jean Jules Besserer, né en 1906. Ce dernier n'avait jusqu'ici pas été référencé comme facteur d'orgues. [Visite]
Quelques dommages de guerres ont dû être réparés en 1946. [IHOA]
En 1953, Curt Schwenkedel et P. Huguin firent des travaux. [IHOA]
Une page des archives Schwenkedel donne la composition (la même que l'actuelle), et les travaux à faire : 8 tuyaux de façade sont à réparer. Et Curt Schwenkedel propose l'électrification de la traction. En 1953, il n'était déjà plus à l'aise avec la pneumatique (pourtant maîtrisée à la perfection par son père Georges, qui, sûrement, ne se déplaçait plus aussi loin). Curt note qu'il faut faire "comme à Village-Neuf", et qu'il s'agit du même système. En effet, à Village-Neuf, il y avait un autre orgue de Besserer, construit en 1924.
Heureusement, la transmission resta intacte. Mais au moins 2 jeux ont été modifiés, sans qu'on ne soit sûr qu'ils l'ont été en 1953 :
- L'Aeoline a été remplacée par une Quinte-flûte 2'2/3.
- La Voix humaine 8' a été remplacée par un Prestant (!)
Indépendamment de quand et par qui elles ont été faites, ces transformations sont regrettables : qui peut avoir le cœur de supprimer un Aeoline et une Voix humaine (surtout quand on connaît le prix de ce jeu) par quelque chose d'aussi quelconque (et si peu symphonique) qu'un Prestant, et une Quinte 2'2/3 ? Il s'agit d'une vraie et profonde altération au style de l'instrument.
L'instrument a été livré à Robert Kriess en 1986. [Visite]
C'est une inscription figurant sous celle de 1929 qui relate les faits (plus certains détails révélateurs...) : "Kriess 1986 Molsheim".
Caractéristiques instrumentales

Console indépendante face à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos placés en ligne au-dessus du second clavier, et repérés par des porcelaines de couleur blanche pour le grand-orgue, rose pour le récit, et jaune pour la pédale. Claviers blancs.
Commande des accouplements et tirasses par dominos, dotés de porcelaines bicolores.
Appel des aides à la registration par 7 pistons placés sous le premier clavier : "P.", "MF.", "FF.", "T.", et "A." (annulateur). Un peu plus loin : "FR. Comb" et "A." pour la combinaison libre. Les pistons des annulateurs sont noirs, et les autres beige. La combinaison libre se programme par de petites touches placées au-dessus des dominos. Les accouplements et tirasses sont donc programmables.
Deux touches analogues, mais rouges, sont placés à droite du premier clavier, et commandent l'annulation des anches et le trémolo, qui était indispensable à l'origine car l'orgue était doté d'une Voix humaine.
Les seules commandes à pied sont les deux pédales basculantes pour l'expression du récit et le cxrescebdo.
Il n'y a pas de plaque d'adresse (ce qui rend de la destruction - volontaire - de celle de Pfetterhouse encore plus préjudiciable).
Certains éléments de cette console, en particulier les dominos, ressemblent beaucoup à ceux des orgues de Joseph Rinckenbach de la même période. Les touches de la combinaison libre, par contre, sont totalement différentes. De plus, les consoles Rinckenbach, plus "françaises" d'inspiration, ont plus de commandes à pied.
Pneumatique tubulaire, notes et jeux.
Sommiers à membranes. Ils sont diatoniques, en "M", pour les trois plans sonores. La pédale est derrière le grand-orgue, et la boîte du récit au fond.
 Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.
Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.(Tout à gauche, on distingue des tuyaux de pédale. Le grand-orgue commence
après les renforts métalliques. De gauche (pédale) à droite (façade) :
la Mixture à 3 rangs, la Tierce, le Nasard, le Flageolet,
le Bourdon 8' (tout en bois), le Principal 4', la grande Flûte harmonique 8' en bois,
le Bourdon 16' (tout en bois), et la Montre 8'.
 Une vue du récit depuis l'arrière de l'instrument.
Une vue du récit depuis l'arrière de l'instrument.Evidemment, constater que la première chape (où devrait se trouver une anche)
est occupée par un "petit jeu" n'est pas de bon augure,
surtout quand on aperçoit les plaquettes destinées à réduire la perce...
Au premier plan, l'absurde 2'2/3 qui remplace la Voix humaine.
Derrière (donc en allant vers l'avant de l'instrument) : le Basson-Hautbois,
la Flûte traverse 4', le Quintaton 8'. Le reste des jeux n'est pas visible ici.
La disposition est diatonique en "M".
L'élément central en bois est le mécanisme de tirage de jeux.

La localité compte moins de 300 habitants, et la présence d'un pareil instrument de musique est, en soi, une chose extraordinaire ! (Et ce n'est pas récent : en 1926, à l'époque de la construction de l'orgue Besserer, il n'y avait que 283 habitants.) Face à ce fait extraordinaire, constater que cet orgue est à l'abandon est réellement désespérant.
Si on peut comprendre qu'une aussi petite communauté n'ait pas les ressources nécessaires à l'entretien d'une telle merveille, on peut quand même s'étonner de voir, dans une vallée voisine, à environ 25km de là, des sommes délirantes allouées à la "restauration" d'un soit-disant chef d'œuvre du 18ème. (Qui, jusqu'à preuve du contraire n'a jamais donné satisfaction tout au long de son histoire.) Il n'est certes pas rare que l'argent vienne à manquer ; mais quand on constate qu'en même temps il coule à flots un peu plus loin, c'est là que les choses deviennent choquantes.
Le cliché délétère prétendant que tout ce qui est du 18ème est génial, et tout ce qui est d'après 1870 peut être abandonné ou détruit, continue décidément de faire des ravages. L'orgue Besserer de Goldbach-Altenbach a une histoire à raconter : celle de la résilience après 14-18 ("Und neues Leben blüht aus den Ruinen"). Et un potentiel musical énorme, avec ses composantes post-symphoniques devenues tellement rares. Ces beaux tuyaux muets, cette belle console, agencés avec tant de soin, qui ont été acquis grâce à tant d'efforts, témoignant de prodiges de conception et de motivation : ils méritent mieux que l'abandon.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
- [Nalsacien] , 11/05/1925,27/05/1925
-
[IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 65b
La date de 1927 paraît fausse, puisque la presse relate sa réception en 1925
-
[ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 125
C'est aussi 1927 qui est donnée comme année de construction
- [AMS189Z96] , p. 2900
- [ValleeStAmarin] Gilles Sifferlen : "La vallée de Saint-Amarin, notes historiques et descriptives", 1908, vol. 4, p. 60
-
[Mathias] F.X. Mathias : "Compte rendu du Congrès d'orgue tenu à l'Université de Strasbourg, 5-8 mai 1932.", éditions Sostralib, p. 69
299b. Goldbach Besserer, 1927, sommier pneu., traction pneu., soufflerie électr.
-
[Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 201
GOLDBACH, Kt. Thann. - Seit 1802 Pf., im J. 1840 ohne O., Liste. - Doch kam eine bald darauf, denn Koulen reparierte 1883 die O., qui était un instrument de discorde, für 3.100 Fr. Grosse Rep. 1907, Berger von Rufach. Gilles SIFFERLIN, La vallée de St-Amarin, livre IV (Goldbach-Geishausen), Strassbg 1908, 60. - Besserer 1927. MATHIAS 69.
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
IM68006315
![]() Localisation :
Localisation :