 Burnhaupt-le-Haut, l'orgue Georges Schwenkedel, 1932.
Burnhaupt-le-Haut, l'orgue Georges Schwenkedel, 1932.La maison Schwenkedel de Strasbourg-Koenigshoffen est presque aussi connue que les établissements Roethinger : c'est l'une des principales manufactures d'orgues alsaciennes du 20ème siècle. Sa notoriété est surtout due à l'accueil fait aux orgues néo-baroques de Curt par les publications spécialisées entre 1960 et 1975. Au cours de cette période, la maison Schwenkedel était vraiment "en phase" avec la mode, et recueillait toutes les louanges dévolues aux "bons élèves". Mais la maison Schwenkedel présente un autre visage, beaucoup plus méconnu, et encore plus passionnant. De 1924 à 1955, Georges, le père de Curt, organier visionnaire et doué, résistait à sa façon au le mouvement "néo-classique", qui voulait transformer tous les orgues en de grandes machines "à tout jouer". Georges Schwenkedel avait un style à lui. Il l'exprima, on le verra, dès ses premiers opus ; même si ses orgues ont évolué, n'a jamais changé ses "fondamentaux", en 30 ans. Il était fidèle aux principes structurants de l'orgue romantique : harmonisations toutes progressives, privilégiant les mélanges et la dynamique, présence de fondamentales, consoles confortables dotées d'accessoires facilitant la registration et la communication avec d'autres exécutants, compositions "orchestrales" permettant des registrations originales. Et idéaux pour l'improvisation.
L'entreprise fonctionna de 1924 à 1975. Ce n'est donc pas une institution séculaire. Mais son bilan est considérable : il nous fait considérer d'un oeil nouveau ces années 1920-30, dont la plupart des aspects sont méconnus. Une époque fascinante et terrifiante à la fois, où l'Europe, traumatisée par le premier conflit mondial, connaissait une sorte de désinhibition qui lui fit concevoir à la fois le meilleur et le pire. Le pire finit par l'emporter, et la seconde moitié du 20ème siècle considéra que toutes les créations de "l'entre-deux-guerres" étaient responsables de l'inacceptable. Et l'Alsace, en plus, renia sa période Allemande (1871-1918)... comme si elle avait quoi que ce soit à voir avec l'Occupation de 39-45. Ce n'est qu'avec le 21ème siècle naissant que l'on a retrouvé le courage de regarder la première moitié du 20ème, en la considérant non comme la période d'incubation d'un mal mortel, mais celle où les survivants d'un monde miné par les nationalismes ont imaginé, chacun dans son domaine, des solutions novatrices.
(Jean-)Georges Schwenkedel (17/09/1885 - 03/03/1958)
Georges Schwenkedel est né à Laichingen (D, entre Stuttgart et Ulm) en 1885. Il reçu sa formation initiale en Allemagne et en Suisse, chez Weigle, Klais (Bonn), Walcker (Ludwigsburg) et Goll (Luzern). C'est donc en tant que facteur d'orgue déjà accompli qu'il entra chez Roethinger, en 1921. Bien que ce fut la maison alsacienne "la plus en vue" à l'époque, il n'y resta pas longtemps : dès 1924, il rejoignit Zann à Bischheim. Mais il souhaitait avant tout se mettre à son compte, chose qu'il fit la même année, lorsqu'il fonda son entreprise à Koenigshoffen (1 chemin du Cuivre).
Georges, qui portait toujours une blouse blanche lorsqu'il s'affairait dans les orgues, avait acquis une vision très personnelle du "néo-classicisme". Sensibilisé aux arguments esthétiques avancés par la Réforme alsacienne de l'Orgue (Emile Rupp, promus par Albert Schweitzer et "mis en tuyaux" par Roethinger), il affirma son style dès les premiers opus, en pratiquant une évolution du romantisme très personnelle. [JMStusssi] [MGiroud]
Curt (Kurt) Schwenkedel (15/05/1914 - 10/1988)
Son fils Curt est né à Luzern (CH), probablement quand son père travaillait chez Goll, ce qui tend à faire croire que Georges y est resté assez longtemps. Curt effectua tout naturellement sa formation initiale chez son père, puis alla se perfectionner chez Gonzalez (Châtillon) et Metzler (Zurich). [MGiroud]
Pour situer le style, en 1933, Metzler construisit le très néo-classique orgue de l'église réformée de Maur (CH) (II/P 19+3j, grand-orgue fondé sur un Quintaton 16' doté de trois 8' puis une Mixture 5-6 rangs, récit expressif avec Trompette harmonique, Sesquialtera et Cymbale, Basson 16' comme seule anche de pédale). Dès 1958, Metzler acheva l'orgue de la cathédrale de Schaffhausen (III/P 45j, positif de dos, Trompette en chamade, Rauschpfeife 6 rangs et Mixture de pédale).
Curt était un fort bon musicien, qui fut élève au Conservatoire de Strasbourg, où il obtint un prix en 1935. Et il n'était pas seulement attiré par la musique d'orgue, puisqu'il assistait régulièrement au festival de Bayreuth... en camping. [JMStusssi] [MGiroud]
Curt accéda à la Maîtrise de facture d'orgues en 1957, une année avant la mort de son père. Il prit alors la direction de la maison strasbourgeoise, en la tournant rapidement vers des couleurs "néo-baroques". [MGiroud]
Curt Schwenkedel considérait Georges Lhôte comme son successeur potentiel. Le plus grand instrument construit par Curt 1963 se trouve à Toul (1963-66 IV/P 63 j.), et son "rayonnement géographique" est évidemment bien plus étendu que celui de son père. La maison Schwenkedel a fermé ses portes en 1974, suite à de graves difficultés financières, après avoir livré environ 200 opus (160 en 1960).
 D'Aspach (1924) à Reiningue (1932) : l'apogée du post-romantisme
D'Aspach (1924) à Reiningue (1932) : l'apogée du post-romantisme
On a trouvé la trace d'un premier travail de Georges Schwenkedel dès 1923, pour le compte de Roethinger à Neudorf, St-Aloyse : c'est lui qui a harmonisé l'instrument reconstruit sur la base du Koulen 1888 (pour lequel la transmission Schmoele-Mols avait donné du fil à retordre, dans tous les sens de l'expression). Un article publié par "Caecilia" en 1923, présente Schwenkedel, ce nouvel acteur de l'orgue alsacien, comme "formé en Suisse française".
 1924 : Aspach (région d'Altkirch), St-Laurent
1924 : Aspach (région d'Altkirch), St-Laurent
Instrument actuel.
Georges Schwenkedel construisit cet instrument (II/P 17j) pour le compte de Zann (qui ferma son entreprise en 1925). C'est pourquoi certaines sources lui refusent son numéro d'opus 1 (c'est en quelque sorte l'opus 0). Malheureusement, cet orgue historique est aujourd'hui abandonné, victime d'une chose électronique. [IHOA:p28a,227a] [ITOA:2p11]
 1925 : Heiligenstein (région de Barr), St-Jean-Baptiste
1925 : Heiligenstein (région de Barr), St-Jean-Baptiste
Endommagé par faits de guerre en novembre 1944. Remplacé par Georges Emile Walther (1960).
Cet instrument est parfois appelé "Opus 1" (peut-être parce que celui d'Aspach a été construit par Schwenkedel pour le compte de Zann). Daté de 1925, il a été construit après Aspach, par Schwenkedel qui s'était mis à son compte. C'est donc le premier orgue de la maison, et le deuxième instrument neuf de Georges Schwenkedel. Seuls des éléments de soufflerie semblent avoir été conservés. [IHOA:p75a] [ITOA:3p250] [PMSSTIEHR:p440-1]
 1926 : Cernay, Eglise protestante Orgue de tribune
1926 : Cernay, Eglise protestante Orgue de tribune
Instrument actuel.
Cet instrument est aujourd'hui muet, mais à l'évidence de grande qualité. Ce qui n'a pas été emporté ou écrasé en 1976 est dans un très bel état de conservation, et en témoigne sans laisser de doute. Ce grand instrument de louange, silencieux et blessé, a conservé toute sa dignité et son aura. Il n'est pas mort. Il est tout à fait permis de rêver d'entendre à nouveau, un jour, sa Flûte harmonique et ses autres jeux chanter comme en 1926. [IHOA:p45b] [ITOA:2p69] [PMSLINK:p242] [MerklinJurine:p1,22] [PMSSTIEHR:p421,425] [Barth:p171]
 1926 : Bantzenheim (région d'Illzach), St-Michel
1926 : Bantzenheim (région d'Illzach), St-Michel
Remplacé par Christian Guerrier (1982).
Après avoir fait affaire avec des facteurs un peu "atypiques" (Rabiny, Herbuté), la localité s'adressa à un "grand" de la facture d'orgue, même s'il était assurément dans sa jeunesse. On ne connaît plus grand-chose de cet instrument, issu de la tradition Roethinger / Koulen. Des éléments du buffet précédent furent repris, et l'exigeante composition impliquait d'une belle maîtrise, tant du point de vue des sommiers que de la transmission. En 1982, la tuyauterie a été "reprise" pour construire un orgue neuf, recoupée et bien sûr complètement réharmonisée. Les bouches arquées de la Soubasse sont un souvenir émouvant de l'orgue Schwenkedel de la belle époque. [IHOA:p31a] [ITOA:2p21] [PMSAEA69:p230-1]
En juin 1926, Schwenkedel avait proposé un orgue neuf de 8 jeux à Eberbach. Mais on préféra demander à Jules Besserer de greffer un second clavier à l'orgue de salon alors utilisé. Peu de conséquences pour nous : l'instrument a été détruit en 1945. Toujours en 1926, il y eut un travail d'envergure à Haguenau, église protestante.
 1926 : Baldenheim (région de Marckolsheim), Eglise protestante
1926 : Baldenheim (région de Marckolsheim), Eglise protestante
Détruit par faits de guerre en 1945. Remplacé par Georges Schwenkedel (1948).
L'affaire avait été plus ou moins conclue alors que Schwenkedel travaillait encore chez Zann. L'opus 5 de 13 jeux a été détruit durant la guerre de 1939-1945. Il y eut ensuite un second orgue Georges Schwenkedel, posé en 1948 (l'opus 90). Doté 9 jeux seulement, il fut démonté, et déménagé à Wolfisheim (i.e. l'actuelle église protestante). Mais il n'y a jamais été remonté. [IHOA:p30a] [ITOA:3p19]
 1926 : Andolsheim, Eglise protestante
1926 : Andolsheim, Eglise protestante
Remplacé par Christian Guerrier (1980).
L'opus 7 avait été logé dans un buffet Bergäntzel, élargi pour l'occasion. Les années 80 crurent qu'il était de leur devoir de le démolir pour y construire un simili-baroque bien comme-il-faut. Cela ne rendit en rien l'orgue Bergäntzel, et le Schwenkedel fut à son tour perdu. [IHOA:p27a] [ITOA:2p9]
L'opus 8 était en fait un travail sur l'orgue J.A. Silbermann/ C. Sauer/ M. Wetzel / Dalstein Haerpfer de Strasbourg. Peut-être pas ce que Schwenkedel fit de mieux ; mais l'accès aux tribunes prestigieuses était bien sûr un élément déterminant pour les carrières des facteurs.
 1927 : Walheim (région d'Altkirch), St-Martin
1927 : Walheim (région d'Altkirch), St-Martin
Remplacé par Christian Guerrier (1972).
Il ne restait pas grand chose du petit orgue Callinet 1848 après les pillages de la 1ère guerre mondiale. Aussi, ce fut en fait un orgue neuf que Georges Schwenkedel livra ici. Mais l'instrument était malheureusement logé dans le buffet Callinet... et il n'en fallut pas plus pour le condamner, plus tard, à la "restauration" (comprendre : destruction et remplacement de la partie instrumentale par du néo-baroque mécanique neuf) (1972). L'inventaire de 1986 commente pudiquement le sinistre : "Tuyauterie : de récupération de Schwenkedel, retaillée et réharmonisée". Dans les années 2010, il était question d'un projet pour rendre à Walheim un orgue de qualité. Malheureusement, il est peu probable qu'on puisse rêver d'y revoir un instrument égalant en charme et en poésie de l'opus 9 de Georges Schwenkedel. (On sait bien qu'à défaut de "Silbermann", Callinet est plus "vendeur" que Schwenkedel, au moins pour quelques années encore. On fera donc probablement du "simili-Callinet", c'est à la mode.) Mais ne désespérons pas trop vite : on a connu de belles surprises. [IHOA:p214b] [ITOA:2p471]
 1927 : Munster, Eglise protestante
1927 : Munster, Eglise protestante
Remplacé par Curt Schwenkedel (1954).
L'opus 10 était la reconstruction d'un orgue Walcker qui avait été démonté pendant la première Guerre mondiale et stocké (on sait ce que cela signifie) à Colmar, puis Illkirch. Après la quasi reconstruction de l'édifice, on trouva... un plafond sous les voûtes, et, en clair, plus de place pour l'orgue. Les architectes qui se moquent du patrimoine, c'est malheureusement très courant. Georges Schwenkedel réussit tout de même (et grâce à la pneumatique, il faut le souligner) à construire un instrument post-symphonique remarquable (encore assez proche de Walcker ; il était doté d'une Harmonica 8' au récit). Il a malheureusement été fortement altéré en 1954 par Curt Schwenkedel, puis été remplacé. [IHOA:p122a] [ITOA:2p293-4] [YMParisAlsace:p65-7] [AORM:p20] [PMSCALL:p352] [PMSSTIEHR:p645-9] [Barth:p270]
 1927 : Oberhoffen-sur-Moder (région de Bischwiller), Eglise lutherienne St-Michel
1927 : Oberhoffen-sur-Moder (région de Bischwiller), Eglise lutherienne St-Michel
Détruit par faits de guerre, avec l'église, fin 1944. Remplacé par Ernest Muhleisen (1956).
La composition de l'opus 11 (parfois 10), disparu, est connue. Lui aussi était doté d'une Harmonica 8' au récit. Cela prouve l'attachement qu'avait Schwenkedel pour la facture romantique germanique. Il est fort dommage que cet instrument, qui semble très original, ait été perdu. [IHOA:p132a] [ITOA:4p462]
 1928 : Largitzen (région de Hirsingue), St-Georges
1928 : Largitzen (région de Hirsingue), St-Georges
Instrument actuel.
Une photo d'Édouard Schloesslen à la console de son orgue en 2013. L'opus 12 est un instrument très attachant, à la personnalité forte, et un merveilleux instrument de musique. Il a, de plus, une grande valeur historique : c'est le seul survivant jouable de la production de Schwenkedel entre 1926 et Metzeral (opus 21) : deux autres existent encore mais sont muets ; tous les autres ont été victimes soit des guerres soit de la mode "néo-baroque" (ou de la désinformation qui sévissait au sujet des transmissions pneumatiques). Celui d'Aspach-le-Haut (opus 16) devait beaucoup lui ressembler (pour éviter toute confusion : il ne s'agit pas d'Aspach "tout court" - près d'Altkirch). Les deux instruments ont eu une genèse commune, et c'est à Largitzen qu'il faut aller pour imaginer comment sonnait l'orgue d'Aspach-le-Haut. [IHOA:p98b] [ITOA:2p208] [Barth:p244] [PMSCALL:p364]
 1928 : Rimbach-Zell (région de Guebwiller), Sts-Pierre-et-Paul
1928 : Rimbach-Zell (région de Guebwiller), Sts-Pierre-et-Paul
Remplacé par Fischer+Krämer (vers 1990).
Le numéro d'opus (15) était partagé avec l'orgue construit pour le couvent du Neuenberg. En 1986, il était encore presque authentique, avec une magnifique composition symphonique. La partie instrumentale a été remplacée, "avec réemploi d'une partie de la tuyauterie précédente". Depuis, l'instrument n'a plus qu'un manuel et une composition standardisée qui est à la fois désespérante, et absurde dans le contexte. [IHOA:p149a] [ITOA:2p372] [SchwenkedelAB:1p28] [SchwenkedelNB:1926-1927,1927-1929p1530,1622-5] [Schwenkedel1934:p2] [PMSCALL:p296-7] [Mathias:p61] [Barth:p309-310]
Remplacé par Ernest Muhleisen (1964), déménagé à Griesbach-le-Bastberg, église protestante.
La maison Muhleisen s'est toujours efforcée de ne pas démolir les orgues du passé : l'orgue Schwenkedel qu'il fallait remplacer en 1964 a été transféré à Griesbach-le-Bastberg. Malheureusement, il a finalement été tellement modifié (Cymbale, mutations...) qu'on peut parler de reconstruction, et l'instrument post-romantique paraît tout de même définitivement perdu. Le numéro d'opus (15) était partagé avec celui de Rimbach-Zell. [Schwenkedel1931:p2] [Schwenkedel1934:p2] [SchwenkedelAB:1p27] [SchwenkedelNB:1p44] [IHOA:p67a,85a] [ITOA:3p289] [ITOA:3p79] [Barth:p204,230]
 1928 : Aspach-le-Haut (région de Thann), St-Barthélemy
1928 : Aspach-le-Haut (région de Thann), St-Barthélemy
Remplacé par Christian Guerrier (1980).
L'opus 16 a été conçu en même temps que celui de Largitzen (opus 12) : il était prévu que les deux instruments soient semblables. Celui-ci a eu moins de chance : endommagé durant la seconde guerre mondiale, il a été réparé par Curt Schwenkedel en 1954. L'instrument avait alors 26 jeux sur 2 claviers de 56 notes et une pédale de 30. En 1980, Christian Guerrier construisit un orgue neuf dans le buffet de 1928, en "recyclant" bon nombre de jeux Schwenkedel, qui constituèrent l'essentiel de la tuyauterie. Le bilan est sans appel : il suffit de comparer les deux compositions. [IHOA:p28b] [ITOA:2p13] [Barth:p142]
 1929 : Illfurth (région d'Altkirch), St-Martin
1929 : Illfurth (région d'Altkirch), St-Martin
Remplacé par Christian Guerrier (1971).
La magnifique buffet Callinet du lieu a abrité l'opus 19 de Schwenkedel. Mais, sûrement parce qu'il ne "s'accordait pas au buffet", on décida de le remplacer en 1970. Bilan de l'opération : une partie instrumentale avec Cymbale 2-3 rangs et Sesquialtera qui, objectivement, "s'accorde" encore moins au buffet... Quant à la console "pragmatique années 70" qui surgit de ce magnifique buffet, elle fait vraiment peine à voir, et on se demande bien avec quoi elle s'accorde. [IHOA:p83a] [ITOA:2p176]
En 1928, il y eut une quasi-reconstruction de l'orgue Sauer d'Eckbolsheim, mais ce travail ne semble pas avoir été considéré comme un orgue neuf. De toutes façons, l'instrument a été "re-silbermanisé" depuis.
 1929 : Metzeral (région de Munster), Eglise protestante
1929 : Metzeral (région de Munster), Eglise protestante
Instrument actuel.
Ce bel opus 21, ainsi que celui de Largitzen (et ce qui reste de l'orgue du couvent du Neuenberg) sont les seuls témoins jouables parmi les 22 premiers orgues neufs construits par Schwenkedel. Deux existent encore, mais sont actuellement muets. Tous les autres ont été détruits. L'instrument de Metzeral est logé dans un buffet "Art nouveau" (Jugendstil) qui lui sied à merveille. [IHOA:p111b] [ITOA:2p239]
 1929 : Bernwiller (région de Cernay), St-Jean
1929 : Bernwiller (région de Cernay), St-Jean
Instrument actuel.
Bernwiller a su garder son bel orgue Schwenkedel (opus 23), qui est logé dans un buffet néo-classique de Gudtmann et Ruthmann de Logelbach ; l'instrument a même été relevé en 2013. On y trouve plusieurs jeux très particuliers de Georges Schwenkedel, avec leur dénomination spécifique. (Musiziergedeckt, Nachthörnlein, Harpe éolienne...) [IHOA:p35b] [ITOA:2p33] [Barth:p151]
 1929 : Hartmannswiller (région de Soultz-Haut-Rhin), St-Blaise
1929 : Hartmannswiller (région de Soultz-Haut-Rhin), St-Blaise
Instrument actuel.
Malgré le lourd tribut payé aux guerres, on trouve dans la patrie d'Augustin Zeiger un orgue d'une importance historique considérable : l'opus 24, qui a été gardé entièrement authentique. Il a bénéficié d'un relevage en 2013 par Sébastien Fohrer. Ici, c'est un buffet "néo-renaissance" qui a été choisi. [IHOA:p74a] [ITOA:2p142] [Barth:p215-6] [PMSCALL:p48,158-9] [FJungk:p6]
De 1929 date aussi la reconstruction (sur deux claviers) du petit orgue Wetzel de Traenheim (sans numéro d'opus). Dans les années 70, on ne se posait pas de question sur la qualité des instruments "à bout de souffle" (lire : à entretenir). On "mécanisait". L'orgue actuel n'est certes pas mauvais, mais il est loin d'avoir la poésie et le charme d'un de ces Schwenkedel du début des années 1930. Et ce n'est plus non plus un Wetzel.
 1930 : Bisel (région de Hirsingue), St-Colomban
1930 : Bisel (région de Hirsingue), St-Colomban
Instrument actuel.
Bisel, 1930 : l'opus 25 fut muni d'un positif de dos ! Il eut un tel succès que Seppois-le-Bas (opus 28), Durlinsdorf (opus 40), Spechbach-le-Bas (opus 41) et Reiningue (opus 46) voulurent un instrument analogue. C'est une façon toute particulière d'aborder le néo-classique : le positif de dos est joué sur le même manuel que le récit, et, pour que l'édifice sonore ne soit pas "écrasé" par ce clavier, il est composé tout en finesse, avec 4 jeux seulement (à Bisel et Seppois : Quintaton 8', Montre 4', Cor de nuit 2', le tout est complété par un Cromorne). Ces quatre instruments sont absolument remarquables, à bien des points de vue. Plus tard, beaucoup ont essayé de les imiter (généralement sans succès, car tombant dans le piège de remplir le positif de "petits jeux"). [IHOA:p39b] [ITOA:2p42] [PMSRHW:p79]
 1930 : Leimbach (région de Thann), St-Blaise
1930 : Leimbach (région de Thann), St-Blaise
Remplacé par Christian Guerrier (1981).
Seul le buffet (Boehm) de l'opus 26 existe encore. Il fut endommagé en 1941, réparé par Curt Schwenkedel en 1961, et finalement remplacé en 1981 (par un orgue à son tour remplacé dès 1999). [IHOA:p100b] [ITOA:2p217] [Barth:p245] [Caecilia:2001-02p30-1] [AORM:01/2002p9-10]
L'orgue qui se trouve actuellement à Mulhouse, Ste-Jeanne-d'Arc est parfois attribué à Schwenkedel. Toutefois, il vient d'Illzach (institut des aveugles) et ne semble pas avoir été modifié par Schwenkedel au point de pouvoir être considéré comme un orgue neuf. Le mystère de sa provenance exacte mériterait d'être élucidé, car il a l'ait d'être un instrument très intéressant.
 1930 : Seppois-le-Bas (région de Hirsingue), St-Maurice
1930 : Seppois-le-Bas (région de Hirsingue), St-Maurice
Instrument actuel.
L'opus 28 est le deuxième de la "tétralogie" Schwenkedel avec positif de dos : les autres sont Bisel (1930), Durlinsdorf (1932) et Reiningue (1932). Un instrument remarquable, sur le plan historique, esthétique (le somptueux buffet de Rudmann et Guthmann), et surtout musical. [IHOA:p172b] [ITOA:2p418] [PMSRHW:p144-6] [Barth:p78,339]
 1931 : Rimbach-près-Guebwiller (région de Guebwiller), Eglise de l'Epiphanie
1931 : Rimbach-près-Guebwiller (région de Guebwiller), Eglise de l'Epiphanie
Instrument actuel.
Nous plaçons ici (bien que l'inventaire technique le date de 1936) le malheureux opus 31, aujourd'hui à l'abandon. [IHOA:p148b] [ITOA:2p370] [Barth:p309] [PMSCALL:p281]
 1931 : Siegen (région de Seltz), St-Laurent
1931 : Siegen (région de Seltz), St-Laurent
Remplacé par René Schwartz (1973).
L'histoire de l'orgue de Siegen est particulièrement triste : perdre un orgue post-romantique pour le voir remplacé par un instrument "néo-baroque" de qualité est parfois acceptable, mais là... La console fut retirée dans les années 1960 pour laisser place à un harmonium (l'orgue était probablement muet parce que les membranes, qui sont des pièces d'usure, n'avaient jamais été remplacées). En 1973, toujours au lieu de remplacer ces membranes, on se lança dans une dispendieuse "ré-mécanisation". Il faut bien avouer que le résultat, après 1973, est totalement désespérant... [IHOA:p174a] [ITOA:4p636] [AMS189Z95:1929-1932p1389-90] [AMS189Z94:1p1198] [PMSSTIEHR:p712-3] [Barth:p341]
 1931 : Sondernach (région de Munster), Eglise protestante
1931 : Sondernach (région de Munster), Eglise protestante
Instrument actuel.
Cet instrument a été récemment (2013) relevé. Son buffet est clairement néo-gothique (c'est l'un des derniers), le rendant fort différent de ses contemporains de style néo-classique ou néo-renaissance à tourelles semi-hexagonales. L'instrument parait malheureusement avoir été endommagé en 1983 (Cymbale au grand-orgue). [IHOA:p175a] [ITOA:2p423]
 1931 : Manspach (région de Dannemarie), St-Léger
1931 : Manspach (région de Dannemarie), St-Léger
Instrument actuel.
Dans son magnifique buffet néo-renaissance, l'opus 34 est resté totalement authentique. Les tourelles hexagonales seront revues à Steinbach ou à Rimbach-près-Guebwiller, mais ici, le buffet est doté d'une partie centrale pyramidale fort originale. Spillflöte au grand-orgue, Aeoline, Nachthörnlein et Trompette harmonique au récit : voici les belles années 30 ! [IHOA:p171a] [ITOA:2p231] [Barth:p112,323]
En 1931 commença à s'opérer un changement profond le monde de la facture alsacienne, comme l'illustre le projet pour renouveler l'orgue de Mutzig. Quatre facteurs étaient en lice
- - Roethinger, appuyé par Martin Mathias, expert de l'évêché,
- - Joseph Rinckenbach, pour qui les affaires allaient déjà très mal,
- - Franz Heinrich Kriess (qui n'était plus soutenu par Adolph Gessner depuis 1919),
- - et Georges Schwenkedel.
 1931 : Mutzig (région de Molsheim), St-Maurice
1931 : Mutzig (région de Molsheim), St-Maurice
Instrument actuel.
L'opus 35 est l'une des merveilles de l'orgue alsacien. Un des seuls 3-claviers (III/P 34+4j) de Georges Schwenkedel, qui "éclaire" d'un jour nouveau ses compositions plus réduites. Le positif (intérieur) est néo-classique, et le Cornet complet, décomposable, est l'élément constitutif (en plus des principaux) du grand-orgue. Pour la composante "romantique française" : Hautbois, Trompette harmonique et Clairon au récit (plus un Plein-jeu). Pour la partie post-romantique : Trompette au grand-orgue, Cymbale-tierce, Flûte conique. [IHOA:p124a] [ITOA:3p411] [PMSCS68:p27] [PMSAM81:p88-102] [PMSSTIEHR:p127-8] [Barth:p62,187,405]
 1931 : Orbey (région de Lapoutroie), Les Basses-Huttes, Ste-Catherine
1931 : Orbey (région de Lapoutroie), Les Basses-Huttes, Ste-Catherine
Instrument actuel.
Autre exemple de collaboration entre Schwenkedel et la maison Rudmann et Guthmann. L'opus 36 n'a pas de Spillflöte, mais un Cornet progressif. [IHOA:p138a] [ITOA:2p326] [Barth:p77,292] [Rupp:p332]
 1931 : Grentzingen (région de Hirsingue), St-Martin-de-Tours
1931 : Grentzingen (région de Hirsingue), St-Martin-de-Tours
Instrument actuel.
Partie instrumentale classée Monument Historique (17/11/2015).
L'opus 37 est logé dans un buffet provenant de l'ancien couvent de Luppach. Au récit, Musiziergedackt 4', Ocarina 2' et Trompette harmonique sont au programme, mais pas de Spillflöte au grand-orgue. La pédale comporte un Gros Nasard. [IHOA:p66b] [ITOA:2p126] [PMSSUND1985:p205-14] [Barth:p203]
 1931 : Strasbourg, Eglise luthérienne de la Croix
1931 : Strasbourg, Eglise luthérienne de la Croix
Instrument actuel.
L'opus 38 (II/P 11+5j) présente la particularité d'avoir un grand-orgue composé autour d'un Cornet de 3 rangs complet et décomposable. La boîte expressive est en façade. [IHOA:p190b] [ITOA:4p691]
 1932 : Neuhof (région de Strasbourg), Eglise protestante du Stockfeld
1932 : Neuhof (région de Strasbourg), Eglise protestante du Stockfeld
Instrument actuel.
L'opus 42 est la reconstruction d'un instrument monté par un certain Beerhalter, 1894, qui était lui-même la reconstruction d'un Martin Wetzel de 1854. En 1929, on disait l'orgue complètement vermoulu et prêt à s'effondrer tout entier. Schwenkedel réussit toutefois à réutiliser des jeux Wetzel. L'instrument a été relevé en 1993. [IHOA:p194b] [ITOA:4p724]
En 1931, il y eut des reconstructions à Huttendorf et Wittersdorf (pas de numéro d'Opus).
 1932 : Burnhaupt-le-Haut (région de Cernay), St-Boniface
1932 : Burnhaupt-le-Haut (région de Cernay), St-Boniface
Instrument actuel.
Partie instrumentale classée Monument Historique (18/12/1992).
La "star" des orgues Schwenkedel, et, avec Reiningue, probablement l'apogée de la grande maison strasbourgeoise. C'est un peu ce qu'Erstein est à Roethinger : une profession de foi organistique, qui, lorsqu'on la reçoit, donne envie de (re-)découvrir les autres. Ces orgues ne sont absolument pas néo-classiques (c'est même tout le contraire) : ils représentent une évolution spécifique du romantisme. [IHOA:p44b] [ITOA:2p64-5] [Barth:p168] [AORM:p15-6] [PMSCALL:p323-5]
 1932 : Offwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
1932 : Offwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
Remplacé par Ernest Muhleisen (1958).
L'opus 39 était la reconstruction sur deux manuels (et évidemment en pneumatique) d'un petit orgue Stiehr-Mockers qui avait déjà "beaucoup vécu". Le Pays de Hanau eut beaucoup à souffrir des guerres, et, en 1945, l'orgue a été gravement endommagé lors d'un bombardement (la mutilation du buffet a parfois été injustement attribuée à Schwenkedel, mais c'est un fait de guerre, et pas une opération volontaire.) En 1957-58, la partie instrumentale a été reconstruite par Ernest Muhleisen. Les sommiers (qui avaient été exposés à l'eau) ont dû être remplacés. Il était temps de repartir sur des bases saines, et Offwiller donna au début du 21ème siècle une des rares occasions de créer un instrument neuf. [IHOA:p137a] [ITOA:4p474-5]
 1932 : Durlinsdorf (région de Ferrette), Sts-Pierre-et-Paul
1932 : Durlinsdorf (région de Ferrette), Sts-Pierre-et-Paul
Instrument actuel.
Le troisième de la fameuse "tétralogie" des orgues Georges Schwenkedel à positif de dos (commencée à Bisel et Seppois-le-Bas, et qui se poursuivra à Reiningue). Cet opus 40 est légèrement différent de ses prédécesseurs et s'apparente fortement à celui de Reiningue. [IHOA:p53b] [ITOA:2p99] [Barth:p183]
 1932 : Spechbach-le-Bas (région d'Altkirch), St-Augustin
1932 : Spechbach-le-Bas (région d'Altkirch), St-Augustin
Instrument actuel.
Ce n'est pas Georges Schwenkedel qui fut à l'origine de la disparition de l'orgue Callinet du lieu (dont le buffet abrite l'orgue actuel), mais bel et bien les réquisitions (et pillages) de la première Guerre mondiale. Le fait que le positif de dos ait été conservé est cohérent avec la pensée de Georges Schwenkedel (Bisel, Seppois-le-Bas, Durlinsdorf, Reiningue), qui, décidément, était un visionnaire. Le positif de dos de Spechbach fut d'ailleurs composé comme celui du fameux quatuor, sans "petits jeux" écrasants. L'orgue de Spechbach est un précieux témoin de cette approche originale du mouvement néo-classique. Espérons qu'il ne se trouvera jamais personne pour oser imposer de remplacer ce petit bijou par du "simili-Callinet" ! (Rappelons-le, il n'y a pas un seul tuyau Callinet dans cet orgue, qui est juste une merveille des années 30.) [IHOA:p178a] [ITOA:2p433]
 1932 : Reiningue (région de Wittenheim), St-Laurent et St-Romain
1932 : Reiningue (région de Wittenheim), St-Laurent et St-Romain
Instrument actuel.
La redécouverte de l'oeuvre de Georges Schwenkedel doit beaucoup à Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun, qui inaugurèrent l'orgue de Reiningue en 2004 après le relevage exemplaire mené par Richard Dott. Ils y enregistrèrent aussi un disque comprenant des oeuvres de Mozart, William Boyce et J.S. Bach. C'est le quatrième d'une "tétralogie" d'orgues avec positif de dos, les trois autres étant Bisel, Seppois-le-Bas et Durlinsdorf. Ces quatre positifs de dos spécifiques n'ont rien à voir avec leurs analogues néo-classiques : ils sont composés de 4 jeux seulement : un Bourdon ou un Quintaton 8', un Principal 4', un 2' doux (Cor de nuit ou Occarina, c'est à dire Flûte conique) et un Cromorne. Pas de quoi "écraser" le reste comme dans la quasi-totalité des orgues néo-classiques munis d'un positif de dos. Ils sont joués sur le second clavier (celui du récit), et ces orgues à "3-claviers" (du point de vue des plans sonores) n'en ont que 2 à la console. Le positif de dos de la "tétralogie" de Schwenkedel trouve probablement sa source dans l'aspect des buffets, mais s'inspire plutôt (paradoxalement) des Fernwerk, ces claviers placés dans une tour ou un transept pour donner un effet d'éloignement. Nous avons ici un Fernwerk "à l'envers", c'est-à-dire offrant à quelques jeux une proximité surprenante avec l'auditoire. [IHOA:p144b] [ITOA:2p349-50] [OrgueEnAlsace:p17]
En 1932, Georges Schwenkedel reconstruisit le curieux orgue Stiehr tardif (1875, mais doté d'un positif de dos !) de Weitbruch. Il conserva les sommiers du grand-orgue et de la pédale, et préserva autant que possible le matériel Stiehr... tant et si bien que son travail fut éliminé en 1976. Adieu, récit expressif avec Voix céleste, Flûte traversière et Trompette en boîte, qu'on avait jugé inutiles en 1875, utiles en 1932, inutiles en 1972... Pourquoi ne peut-on pas tout simplement laisser en place ce qui est réussi, plutôt que de "coller aux modes" ?
 De Reiningue (1932) à la retraite de Georges (1955) : la difficile résistance au néo-classique
De Reiningue (1932) à la retraite de Georges (1955) : la difficile résistance au néo-classique
 1933 : Luemschwiller (région d'Altkirch), St-Christophe
1933 : Luemschwiller (région d'Altkirch), St-Christophe
Instrument actuel.
Dans son superbe buffet néo-classique, l'opus 44 est un autre digne représentant de cette magnifique lignée d'orgues post-romantiques. Le buffet, construit en style néo-classique est bien de 1932. L'inauguration eut lieu le 28/05/1933, et on peut lire que Curt, le fils de Georges Schwenkedel joua à cette occasion la Toccata en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Cet instrument est resté authentique. [IHOA:p105b] [ITOA:2p225] [PMSRHW:p23-7] [Barth:p248]
 1933 : Pfaffenheim (région de Rouffach), St-Martin
1933 : Pfaffenheim (région de Rouffach), St-Martin
Remplacé par Hubert Brayé (2015).
L'opus 47 était la reconstruction d'un orgue des frères Callinet, 1839, démonté, fortement modifié et remonté en 1894, et dégradé en 1917. En 1931, Georges Schwenkedel nota la composition pour le réparer, mais au cours des 2 années suivantes, on se décida pour un orgue neuf, à loger dans le "buffet-coffre". La partie instrumentale a été classée en 2000 (!), et la suite ne fait donc pratiquement aucun doute... [IHOA:p140b] [ITOA:2p337] [PMSCALL:p178-9] [PMSAEABUSSY:p151,147-66]
 1933 : Cannes (06) St-Honorat
1933 : Cannes (06) St-HonoratSchwenkedel ne travaillait pas qu'en Alsace. L'opus 48 fut un orgue pour Cannes. En 1965, il fut transféré en tribune (et dépouillé du buffet qu'il avait fort probablement à l'origine). [OrguesPACA]
 1933 : Courtavon (région de Ferrette), Sts-Jacques-et-Christophe
1933 : Courtavon (région de Ferrette), Sts-Jacques-et-Christophe
Instrument actuel.
L'opus 49 est la reconstruction d'un Wetzel de 1865 (qui avait un petit positif de dos). Malheureusement, plutôt que d'entretenir le bel orgue Schwenkedel, quelqu'un (probablement à qui on avait seriné que "le pneumatique ne vaut rien", qu'il faut "le reconstruire en mécanique" ou encore qu'il "est impossible à réparer") décida d'acheter une chose électronique. Depuis, des projets ont été imaginés (y-compris le retour d'un positif de dos), mais ne semblent pas avoir été concrétisés. Il faut espérer que, tout simplement, on parvienne un jour à relever l'orgue Schwenkedel : Flûte harmonique 8', Trompette harmonique et Cromorne au récit (Cor anglais au grand-orgue !), Gros Nasard à la pédale, cet instrument a tout pour faire rêver. [IHOA:p49b] [ITOA:2p92] [PMSRHW:p196] [PCHR:p396]
 1934 : Elsenheim (région de Marckolsheim), St-Jacques Majeur
1934 : Elsenheim (région de Marckolsheim), St-Jacques Majeur
Détruit par faits de guerre en 1934. Remplacé par Curt Schwenkedel (1959).
On ne sait pas grand-chose de l'opus 51, si ce n'est qu'il fut achevé en 1934, avait 20 jeux, et occupait probablement le buffet de l'orgue précédent (Callinet/Wetzel). Il fut détruit en 1945. [IHOA:p56a] [ITOA:3p152] [PMSRHW:p237-42] [PMSAEA69:p164-169]
Le numéro d'opus 52 fut attribué à une opération de déménagement/modification de l'orgue Stiehr vendu par Offendorf (entreposé à Eckbolsheim) et installé à Saulxures. Probablement pas ce que Schwenkedel fit de mieux...
 1934 : Strasbourg, Couvent des Dominicains
1934 : Strasbourg, Couvent des Dominicains
Instrument actuel.
Inscrit autour de la rosace située au fond de la tribune, cet instrument est resté authentique. Curt Schwenkedel y fit en 1947 une adjonction originale : deux jeux situés dans le choeur (deux Flûtes), constituant un "Fernwerk", et joués depuis le 1er clavier. Ces deux jeux ont toutefois été débranchés depuis. [Vogeleis:p59,204,619,641-2] [Barth:p353] [IHOA:p186a] [ITOA:4p689-90]
 1933 : Steinbach (région de Cernay), St-Morand
1933 : Steinbach (région de Cernay), St-Morand
Instrument actuel.
Cet instrument a malheureusement été fortement dénaturé et réharmonisé en 1964, et ne peut être considéré comme un orgue de Georges Schwenkedel authentique. Il fut relevé en 2001, mais malheureusement la réparation des errements de 1964 n'était pas au programme. [IHOA:p178b-9a] [ITOA:2p437]
 1934 : Osthouse (région d'Erstein), St-Barthélemy
1934 : Osthouse (région d'Erstein), St-Barthélemy
Remplacé par Yves Koenig (1993).
Il s'agissait de reconstruire sur deux manuels un petit Martin Wetzel (1855) qui avait déjà été transformé par Franz Xaver Kriess. L'instrument a été à nouveau reconstruit par la suite, et il ne reste rien de l'opus 54 de Schwenkedel. [IHOA:p139a] [HOIE:p256-7] [PMSRHW:p217] [ITOA:4p484] [Caecilia:1994-3p30]
 1934 : Schoenbourg (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante
1934 : Schoenbourg (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante
Remplacé par Gaston Kern (1987).
Le petit (II/P 12j) orgue de Schoenbourg n'occupait pas de buffet ancien (c'était le premier orgue du lieu), et il était doté d'une jolie composition romantique. Mais, étant "pneumatique", on n'avait pas besoin d'autre prétexte, dans les années 80, pour le remplacer, à grands frais, par un orgue "mécanique". L'opus 55 est donc définitivement perdu. [IHOA:p168a] [ITOA:4p613]
 1934 : Strasbourg, Chapelle protestante de l'hôpital civil
1934 : Strasbourg, Chapelle protestante de l'hôpital civil
Remplacé par Gaston Kern (1974).
L'opus 56 consistait à reconstruire sur 2 manuels un orgue Koulen / Dalstein-Haerpfer. Il n'en reste rien. [IHOA:p188a-b] [ITOA:4p694] [PMSRHW:p227]
 1935 : Flaxlanden (région de Mulhouse), St-Sébastien
1935 : Flaxlanden (région de Mulhouse), St-Sébastien
Instrument actuel.
L'instrument actuel est traditionnellement attribué aux Verschneider, mais c'est plutôt un (très beau) Schwenkedel. L'opus 57 a été relevé en 1995 par Christian Guerrier. [IHOA:p60b] [ITOA:2p114] [AORM:p22-3] [PMSAS84:p187-93] [PMSSTIEHR:p739] [PMSAS82:p224]
 1934 : Burnhaupt-le-Bas (région de Cernay), Sts-Pierre-et-Paul
1934 : Burnhaupt-le-Bas (région de Cernay), Sts-Pierre-et-Paul
Instrument actuel.
Le buffet est cette fois de la maison Brutschi. De 1968 à 1981, on utilisa principalement un curieux orgue de choeur, puis le "grand" fut redécouvert et relevé. Quatre 8' au grand-orgue, Occarina, "Grosse" Flûte harmonique 8', Trompette solo au récit, II/I 16' 8' 4', Plein-jeu 3 rangs en boîte, Quinte 5"1/3 à la pédale : c'est un digne représentant de ce style inimitable. [IHOA:p44b] [ITOA:2p62]
 1930 : Hirtzbach (région de Hirsingue), St-Maurice
1930 : Hirtzbach (région de Hirsingue), St-Maurice
Instrument actuel.
Longtemps muet, cet instrument qui a fort probablement un énorme potentiel semble avoir retrouvé un avenir. Un appel d'offres très prometteur a été lancé. C'est l'un des projets les plus enthousiasmants actuellement en cours en Alsace. Hirtzbach (III/34) est l'un des seuls 3-claviers de Georges Schwenkedel. [IHOA:p78b] [ITOA:2p158] [Barth:p78,223] [PMSCALL:p170-2] [Masevaux1963:p57-60]
 1935 : Rombach-le-Franc (région de Ste-Marie-aux-Mines), Ste-Rosalie
1935 : Rombach-le-Franc (région de Ste-Marie-aux-Mines), Ste-Rosalie
Instrument actuel.
Cet instrument, placé à fleur de tribune, a été relevé en 2009. Le Cornet (complet et de 3 rangs) est au récit ; pas de Mixture. Il est doté d'une magnifique console en bois naturellement marbré, et des dominos (ainsi qu'une disposition) "façon Burnhaupt". Cornet complet au récit, Quinte 5'1/3 à la pédale. [IHOA:p151b] [ITOA:2p380] [PMSCALL:p320-1] [Barth:p312]
 1936 : Brumath, Eglise protestante
1936 : Brumath, Eglise protestante
Remplacé par Haerpfer-Erman (1988).
Qu'elle est belle, la console (conservée à la tribune) de l'opus 61 ! Cet instrument devait être exceptionnel, à la fois par la qualité de ses timbres (l'essentiel de Stiehr ayant été conservé), par ses innombrables possibilités, et la puissance de ses 31 jeux dédoublés par les octaves graves et aiguës. La partie instrumentale a été classée par arrêté du 08/05/1973. Entre 1986 et 1987, l'orgue a été restauré dans son état d'origine (Stiehr, 1810, avec au moins une Cymbale et pas mal de notes de pédale en plus) par la Manufacture Haerpfer de Boulay, suivant les préconisations de la Commission Supérieure des Monuments Historiques. [IHOA:p43b] [ITOA:3p88-9]
 1936 : Gertwiller (région de Barr), Eglise protestante
1936 : Gertwiller (région de Barr), Eglise protestante
Remplacé par Antoine Bois (2001).
L'opus 64 était la reconstruction d'un petit orgue Stiehr déjà modifié par Joseph Stiehr lui-même puis par Robert Weibel. L'instrument fut par la suite re-reconstruit. [IHOA:p64b] [ITOA:3p196] [PMSSTIEHR:p233-6]
 1936 : Saverne, Chapelle de l'Hôtital civil
1936 : Saverne, Chapelle de l'Hôtital civil
Instrument actuel.
Le petit opus 65 est plus néo-classique qu'à l'habitude (Tierce au récit). [IHOA:p164b] [ITOA:4p587] [SchwenkedelAB:1p85] [SchwenkedelNB:1932-1939p4322-3] [Mathias:p49] [Barth:p329]
 1936 : Blotzheim (région de Huningue), Couvent des Spiritains
1936 : Blotzheim (région de Huningue), Couvent des Spiritains
Instrument actuel.
Voici un "mini-Schwenkedel" (I/P 4j), mais pour lequel rien n'a été réalisé "au rabais". L'instrument est logé dans un magnifique buffet en noyer, richement décoré de sculptures. La façade est en étain, et le manuel, constitué de jeux de 68 notes, permet de faire usage d'octaves aiguës réelles. Clavier de 56 notes et deux jeux expressifs, la pédale dispose d'un jeu propre (Soubasse). [IHOA:p40b] [ITOA:2p48] [PMSSUND1981:p182]
 1936 : Valdoie (90)
1936 : Valdoie (90)On trouve à Valdoie un orgue Schwenkedel, qui a malheureusement été très bricolé en 1964, et nécessiterait un relevage complet. Console de type "Burnhaupt-le-Haut". Cet opus franc-comtois est doté d'un Euphone à anches libres. La composition paraît avoir été fortement "néo-baroquisée" (ce qui expliquerait son quasi-abandon par la suite) :
 1936 : Thonon-les-Bains (74) (Vongy), Notre-Dame du Léman
1936 : Thonon-les-Bains (74) (Vongy), Notre-Dame du LémanL'édifice est absolument exceptionnel, avec des ogives rappelant un peu Gaudi. L'orgue Schwenkedel a été béni le 11/11/1936. MMK y toucha malheureusement en 1965, ce qui lui coûta sa console. Un autre entretien a été mené par Micolle & Valentin (Villeurbanne) en 1989. Cornet au récit (avec le Jeu de Tierce) et basse acoustique de 32' sont au programme. Quelques jours après sa ré-inauguration, l'orgue échappa de peu à l'incendie qui détruisit la toiture de l'église (21/01/1990). Bâché pendant presque un an, il a été remis en voix, et c'est aujourd'hui Olivier Bernard qui l'entretient (Villeurbanne). [AmisLeman] [Wikipedia]
Après cela, il faut espérer que plus personne, jamais, nulle part, n'osera dire qu'une transmission pneumatique est moins robuste qu'une mécanique...
 1937 : Molsheim, Eglise protestante
1937 : Molsheim, Eglise protestante
Instrument actuel.
L'opus 66 existe encore. Il est jouable et offre encore les chamantes couleurs sonores élaborées par son créateur. Mais il est à l'abandon. Gageons que, comme ailleurs, quelqu'un a oublié de dire que les membranes des sommiers pneumatiques sont des pièces d'usure que l'on doit remplacer tous les 30 ans. [ITOA:3p392] [IHOA:p115a]
 1937 : Ligsdorf (région de Ferrette), St-Georges
1937 : Ligsdorf (région de Ferrette), St-Georges
Remplacé par Christian Guerrier (1998).
Il ne reste de cet instrument (opus 68) que de beaux éléments de la tuyauterie de l'orgue actuel, reconstruit par Christian Guerrier en 1998. [IHOA:p103a] [ITOA:2p222] [Caecilia:1999-2p27] [PMSSUND1983:p142-6]
 1939 : Jebsheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante
1939 : Jebsheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante
Détruit par faits de guerre en 1945. Remplacé par Curt Schwenkedel (1957).
L'opus 70 avait 12 jeux, et était logé dans un buffet de Jean-Daniel Cräner, 1741. Après sa destruction en 1945, cet instrument fut remplacé par l'opus 134 de la maison Schwenkedel (sans buffet du tout). [IHOA:p87a] [ITOA:2p182] [PMSRHW:p207] [AS1975:p142-8]
 1940 : Nice (6) Ste-Jeanne-d'Arc
1940 : Nice (6) Ste-Jeanne-d'ArcCet instrument a été agrandi en 1950 par la maison MMK, puis livré à Gonzalez qui l'a "croisé" avec le Harrisson de l'église anglicane en 1968. [OrguesPACA]
 1941 : Oberbronn (région de Niederbronn-les-Bains), St-Etienne
1941 : Oberbronn (région de Niederbronn-les-Bains), St-Etienne
Instrument actuel.
Livré pendant la guerre, cet opus 73 est resté authentique. La traction est électrique, et il y a une curiosité : le 16' manuel est au récit, et pas au grand-orgue. [IHOA:p130b] [ITOA:4p453]
 1942 : Niedersteinbach (région de Wissembourg), St-Gall
1942 : Niedersteinbach (région de Wissembourg), St-Gall
Instrument actuel.
Pour un orgue construit à cette époque, l'opus 74 a plutôt fier allure. Pas de 16' manuel malgré l'accouplement en octaves graves (II/P 12j). Voix céleste, Quintaton 4', Trompette au récit : pas une ombre de néo-classique. Ni emprunt, ni extension. Ce qui en fait un instrument "années 40", c'est surtout la transmission électrique et l'absence de buffet. Pour faire oublier cette contrainte imposée par les années "minimalistes", on s'amuse avec les lignes dessinées par les tuyaux. Ici, cette disposition est plutôt réussie. On la retrouvera à Bartenheim. [IHOA:p129a] [ITOA:3p445] [PMSSTIEHR:p532]
 1942 : Strasbourg, Cité de la Musique Salle 3-27
1942 : Strasbourg, Cité de la Musique Salle 3-27
Disparu. Remplacé par Marcel Garnier (1977).
Le conservatoire de Strasbourg a été muni d'une bonne dizaine d'orgues au cours de son histoire. Le grand orgue néo-baroque de la salle de concert de la place de la république n'était pas le premier Schwenkedel : un mystérieux petit instrument de 3 jeux sur 2 manuels a été construit pendant la guerre, et a rapidement disparu ensuite ; c'était l'opus 76. [SchwenkedelAB:2p1251] [IHOA:p184b-5a]
Le travail pour Bettlach, assurément pas l'un des plus glorieux effectués par la maison de Strasbourg-Koenigshoffen, consistait à ajouter un récit (en gardant le positif de dos) à l'orgue Joseph Callinet, 1844, du lieu. La transmission fut électrifiée... car le récit et le positif devaient partager le même clavier à la console (II+I/P 29j). Ce n'était assurément pas une bonne idée. La traction de l'opus 79 tomba en panne le jour de l'inauguration (30/05/1943), et l'orgue Callinet eut un bien triste centenaire. Il fallut attendre 1989 pour lui redonner sa cohérence.
 1942 : La Robertsau (région de Strasbourg), Chapelle du cimetière Grand orgue
1942 : La Robertsau (région de Strasbourg), Chapelle du cimetière Grand orgue
Instrument actuel.
L'opus 80 est à transmission mécanique, et il est vraiment très spécifique, l'orgue et la console étant placés dans un local surplombant et attenant à la chapelle. Le son passe dans le sanctuaire par une baie. L'effet délivré à la console est assez quelconque, mais, en bas, on découvre toute la qualité de l'harmonisation de cet instrument. C'est un "orgue d'enterrements", certes, mais il est très réussi et d'une grande valeur. D'ailleurs, les funérailles ne méritent-elle pas des composantes de grande valeur ? Est-il digne, en ces moments, de présenter aux familles un "electrium" synthétique surmonté de fleurs artificielles ? [IHOA:p185a] [ITOA:4p681]
 1943 : Mertzwiller (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel
1943 : Mertzwiller (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel
Remplacé par Gaston Kern (2001).
A Mertzwiller, on trouve un très bel orgue de 2001 ; l'instrument qui l'a précédé était attribué à Stiehr/Schwenkedel. Il y avait effectivement un orgue Stiehr dans l'ancienne église. En 1937, on décida d'agrandir l'édifice, mais malheureusement, ce n'était vraiment pas le moment... L'orgue Stiehr a été démonté par Adolphe Blanarsch et la nouvelle église inaugurée sans orgue le 29/05/1939. Les pièces de l'orgue Stiehr ont été entreposées et plus ou moins cachées pour échapper à d'éventuelles réquisitions. Dans la tourmente, une bonne partie fut perdue. C'est le cas du buffet Stiehr (en chêne, évidemment) : personne ne sait ce qu'il est devenu. De 1942 à 1944, Georges Schwenkedel construisit un orgue neuf (son opus 86) en réutilisant deux sommiers de Stiehr, ainsi que presque toute la tuyauterie du grand-orgue. L'orgue fut livré... en caisses. Après une première installation partielle, les sommiers ont été endommagés lors de l'offensive de Janvier 1945. L'orgue ne fut évidemment réparé et achevé qu'après la fin des hostilités. Il fonctionna à Pâques 1946, et fut béni à la Pentecôte de la même année. C'était un grand instrument (II/P 33j), constitué de deux corps séparés (la tribune est étroite en son centre en raison de la présence de la maçonnerie du clocher), sans réel buffet, mais probablement plein de possibilités. On préféra, en 2001, construire un orgue neuf. [IHOA:p111a] [ITOA:3p375] [PMSSTIEHR:p346]
 1944 : Huningue, Christ-Roi
1944 : Huningue, Christ-Roi
Remplacé par Pierre Bois (1991).
Il s'agit d'une grande machine (II/P 38+2j), résolument néo-classique. Claviers de 5 octaves, transmission électrique. Le positif de dos est un grand Cornet décomposé de 6 rangs, auquel vient s'ajouter un Salicional et un Cromorne. Voix céleste et Cymbale au récit, Cornet à la pédale. Le numéro d'opus (81) semble être partagé avec l'orgue d'Orbey. [IHOA:p82a] [ITOA:2p171] [PMSCALL:p300] [AHuningue95:p35-9]
 1945 : Orbey (région de Lapoutroie), St-Urbain
1945 : Orbey (région de Lapoutroie), St-Urbain
Remplacé par Antoine Bois (1998).
Ce travail - assurément pas un orgue neuf - était l'agrandissement d'un orgue Stiehr "tardif" (1869). Le numéro d'opus (81) semble être partagé avec Huningue. Il s'agissait d'ajouter 7 jeux au récit, de passer la pédale à 25 à 30 notes (sommiers neufs), ajouter les tirasses, et doter le grand-orgue d'une machine Barker. La nouvelle console était indépendante (face à la nef), avec des claviers de 56 notes (mais seulement 54 parlantes) une mécanique à équerres et un tirage des jeux pneumatique (pour offrir des combinaisons et un crescendo). La composition, bien sûr, était néo-classique, mais probablement plus par "héritage du passé" que par volonté de suivre la mode. En 1988 et 1998, Antoine Bois reconstruisit à nouveau l'instrument, pour se rapprocher de l'esthétique de 1869 (II/P 30j). [IHOA:p138a] [ITOA:2p325] [PMSLINK:p228-9] [PMSSTIEHR:p621-4]
Le travail pour Sierentz en 1946 reçut pour numéro d'opus (82). Il s'agissait d'ajouter un clavier à cet orgue qui n'en avait qu'un. L'orgue a été reconstruit en 2014.
En 1946, il y eut aussi un travail à Ottwiller.
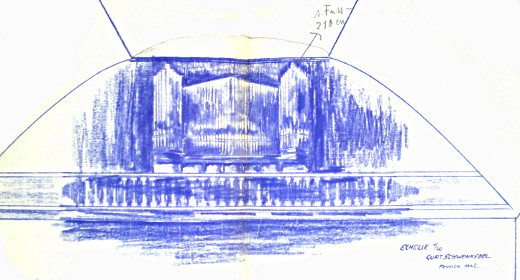 1947 : Neudorf (région de Strasbourg), Foyer protestant
1947 : Neudorf (région de Strasbourg), Foyer protestant
Orgue disparu.
L'opus 89 a disparu dans les années 2000. L'édifice a été transformé en hôtel. [IHOA:p194a] [ITOA:4p721] [PMSRHW:p227]
 1948 : Baldenheim (région de Marckolsheim), Eglise protestante
1948 : Baldenheim (région de Marckolsheim), Eglise protestante
Disparu à Wolfisheim. Remplacé par Muhleisen (1964).
Pour remplacer l'opus 5 de 13 jeux (1926) détruit durant la guerre de 1939-1945, il y eut ici un second orgue Georges Schwenkedel, posé en 1948, l'opus 90. Doté 9 jeux seulement, il fut démonté et déménagé à Wolfisheim (i.e. l'actuelle église protestante). Mais il n'y a jamais été remonté, et a disparu. [IHOA:p30a] [ITOA:3p19]
 1947 : Fislis (région de Ferrette), St-Léger
1947 : Fislis (région de Ferrette), St-Léger
Instrument actuel.
L'opus 93 est la reconstruction d'un orgue de Valentin Rinkenbach dont des tuyaux en bois étaient vermoulus. [IHOA:p60b] [ITOA:2p113] [PMSRHW:p118-9] [PMSSUND1985:p221]
 1947 : Illzach, Eglise protestante
1947 : Illzach, Eglise protestante
Remplacé par Hubert Brayé (2005).
De nombreuses maisons ont conservé le numéro d'opus 100 pour un instrument exceptionnel (en prenant pour cela quelques libertés avec la chronologie). Ce ne fut pas le cas pour Schwenkedel (qui atteint ce chiffre, il est vrai, dans l'immédiat après-guerre où les projets réellement valorisants n'étaient pas légion). Le numéro d'opus 100 fut donc donné à cette "pragmatique" transformation d'un orgue Dalstein-Haerpfer. Sûrement pas la meilleure réalisation sortie des ateliers de Koenigshoffen. L'instrument a, depuis, été remanié à deux reprises. [IHOA:p84a-b] [ITOA:2p178]
 1948 : Uberach (région de Niederbronn-les-Bains), St-Wendelin
1948 : Uberach (région de Niederbronn-les-Bains), St-Wendelin
Remplacé par Gaston Kern (1992).
Ce travail (partageant le numéro d'opus 94 avec l'orgue de Bourtzwiller) consistait à reconstruire le petit orgue Stiehr qui était venu en 1871 de Marienthal. A ce propos, il s'avère que Schwenkedel était l'un de ceux qui respectait le plus les instruments anciens dans ce genre d'opérations. Appelé pour ajouter un récit et une console indépendante en 1946, il trouva beaucoup de tuyaux neufs, mais une composition globalement respectée. Les travaux demandés furent les suivants : réalisation d'un récit expressif de 9 jeux, en y plaçant la Gambe 8', la Flûte 4' et la Doublette de Stiehr. Le "manuel", devenu grand-orgue, perdit les 3 jeux précédents, ainsi que sa Trompette. Une console indépendante fut posée, en transformant la mécanique du clavier et de la pédale (équerres). Le récit, neuf, était pneumatique, sur sommiers à cônes. Les tuyaux qui n'étaient pas de Stiehr (essentiellement des basses, et la façade) ont été refaits, et la pédale logiquement complétée de 18 à 30 notes. Georges Schwenkedel était sûrement l'un des moins radicaux lors de ce que l'on appela plus tard les "pneumatisations", et donc l'un de ceux qui respectaient le plus les instruments anciens. C'est grâce à cela que l'orgue d'Uberach est encore un vrai Stiehr, depuis son retour à la traction mécanique en 1993. Il n'a d'ailleurs de nouveau plus qu'un manuel. [IHOA:p207b] [ITOA:4p794] [PMSCS61:p61-2] [PMSSTIEHR:p330-1] [SchwenkedelNB:1946-1953p4569-71] [Marienthal1962:p6,25] [Caecilia:1993-4p30] [Barth:p368-369]
 1948 : Niederbronn-les-Bains, Eglise protestante
1948 : Niederbronn-les-Bains, Eglise protestante
Remplacé par Alfred Kern (1970).
L'opus 95 était la reconstruction de l'orgue Louis Geib, 1807 / Heinrich Koulen, 1886 du lieu (les sommiers et la console étaient de Koulen). La composition, très néo-classique, proposait un grand Cornet au grand-orgue, et pas moins de 7 rangs de Mixtures aux claviers. Le récit était doté d'un Cornet décomposé de 6 rangs, avec Larigot. Le tout fut à nouveau reconstruit dans l'esprit "néo-baroque" en 1970. [IHOA:p127a] [ITOA:3p433-4] [PMSSTIEHR:p611] [HOIE:p184-5] [PMSCS61:p62] [PMSCS65:p21] [HIOB:p285]
En 1948, Schwenkedel travailla à Village-Neuf, essentiellement pour électrifier la traction installée par Besserer en 1924.
 1949 : Bartenheim (région de Sierentz), St-Georges
1949 : Bartenheim (région de Sierentz), St-Georges
Instrument actuel.
Pour remplacer son orgue Martin et Joseph Rinckenbach détruit lors de l'incendie de l'église le 21/07/1934, Bartenheim dut attendre l'après-guerre. Georges Schwenkedel posa en 1949 un bel orgue obéissant aux critères esthétiques de l'époque. Le résultat fut un instrument de qualité, sûrement bien au-dessus de la moyenne des instruments de l'immédiat après-guerre. Il fut modifié en 1980 : au grand-orgue, le Salicional a été remplacé par une Doublette et le Cor anglais par une Trompette, au récit, le Basson/Hautbois par une Voix humaine. [IHOA:p32a] [ITOA:2p22-3]
 1949 : Strasbourg, St-Jean
1949 : Strasbourg, St-Jean
Remplacé par Curt Schwenkedel (1967).
Il s'agissait d'un orgue temporaire. [IHOA:p189b-189a] [ITOA:4p695-6] [LORGUE:138p46-9] [PMSAEA85:p231-2] [PMSCS72:p23-4] [CMAVS98:p108-12] [ArchSilb:p513-4] [Rupp:p333-4] [Mathias:p34] [Barth:p355,434b-435a]
 1950 : Bourtzwiller (région de Mulhouse), St-Antoine
1950 : Bourtzwiller (région de Mulhouse), St-Antoine
Instrument actuel.
C'est un grand instrument (III/P 40j) résolument néo-classique, et qu'on ne peut pas qualifier d'authentique. [IHOA:p42a] [ITOA:2p268]
 1950 : Friedolsheim (région de Hochfelden), St-Denis
1950 : Friedolsheim (région de Hochfelden), St-Denis
Remplacé.
L'opus 95 fut reçu le 12/03/1950 par Fernand Rich. Nous ne reviendrons pas ici sur cette nouvelle et désolante page noire de l'orgue alsacien (2018). Pour faire simple, la tuyauterie a été vendue (une aubaine pour l'acheteur, sûrement conscient de sa valeur), le reste du cadavre est, semble-t-il, toujours sur place. Cet orgue authentiquement alsacien, discrédité par les experts, a été "remplacé" par une chose "nordique" de récupération. L'Alsace sert à présent pour le "recyclage" de l'Europe. [IHOA:p62a] [ITOA:3p182]
 1951 : Thann, Temple réformé
1951 : Thann, Temple réformé
Instrument actuel.
Voici l'époque des dernières concessions de Schwenkedel au néo-classicisme : la Trompette est à présent au grand-orgue, le "récit" est doté, comme seule anche, d'un Cromorne "diamètre unique" et de Mutations (coniques : Nasard et Tierce). Ce second manuel, même s'il est expressif et donc intérieur, est donc plutôt un positif. Cette évolution continuera pour faire de ces claviers des "Brustwerks" (positifs pectoraux) expressifs, puisque, pratiquement dépourvus de jeux graves, ils sont de dimensions réduites et peuvent donc être placés juste au-dessus de la console. Il n'y a plus de 16' manuel, une Cymbale au second clavier, et, surtout, plus aucun jeu harmonique. Pour l'anche 16' de pédale, Schwenkedel a adopté une solution voisine des fameux "Tuba 16'" de Koulen. L'opus 104 a été fort bien préservé. [IHOA:p205b] [ITOA:2p451] [PMSWEG:p290]
En 1951, il y eut aussi des travaux à l'orgue Roethinger de Mulhouse.
 1952 : Reiningue (région de Wittenheim), Abbaye de l'Oelenberg Grand orgue
1952 : Reiningue (région de Wittenheim), Abbaye de l'Oelenberg Grand orgue
Instrument actuel.
L'opus 105 est une pure merveille, dans un cadre exceptionnel. C'est un orgue qui fait aimer les orgues. [ITOA:2p351] [Orgelbauerei1909:p12-4] [Barth:p289-90] [IHOA:p136a]
 1952 : Neuf-Brisach, St-Louis
1952 : Neuf-Brisach, St-Louis
Remplacé par Alfred Kern (1982), déménagé à Colmar, Ste-Marie.
L'opus 108 été déménagé à Colmar, Ste-Marie en 1982. [LR1907:p83] [IHOA:p125a] [ITOA:2, 4p300, 728] [ArchSilb:p90, 277, 318] [ArsOrgani:31/2p90-93] [PMSBUSSY:p149-151] [Barth:p274] [PMSBERGANTZEL:p259 et planche avant 228]
 1953 : Still (région de Molsheim), Institut des aveugles
1953 : Still (région de Molsheim), Institut des aveugles
En 1953, Schwenkedel livra deux orgues pour l'institut des aveugles. Le premier, l'opus 102 fut un petit (II/4) orgue d'exercice. [IHOA:p180b] [ITOA:4p653]
 1953 : Still (région de Molsheim), Institut des aveugles
1953 : Still (région de Molsheim), Institut des aveugles
Le second orgue livré à l'institut des aveugles était une machine tout à fait extraordinaire. L'opus 104, inauguré le 31/05/1954 constitua en 1986 l'une des pages les plus surprenantes de l'inventaire des orgues d'Alsace. C'était une tentative pour aller "jusqu'au bout" de la logique des emprunts et extensions. Un "Grand cornet X" (10 rangs), côtoyait un Cornet V, un Cornettino IV, une Rauschpfeife IV, un Carillon III, une Sesquialtera II, une Spillflöte II, une Rauschquinte II et un Terzian II... On disposait en fait d'un certain nombre de rang, que les diverses combinaisons associaient comme prévu par la théorie. Evidemment, les différents rangs ne pouvaient pas être harmonisés de façon spécifique pour chaque type de Mixture ainsi assemblée. C'était donc plus un cas d'école - une machine d'enseignement - qu'un orgue opérationnel de 61 jeux.
Le projet était dû à l'abbé Raymond Geredis. Dans don article, il précise que "l'instrument [a été] spécialement conçu pour l'école de musique spécialisée pour Aveugles", qu'un Clairon est prévu au Grand-orgue, un Principal 2' et une Mixture à la Pédale, et que "tout ce qui pouvait servir de l'orgue précédent de la maison Rinckenbach a été réutilisé". Schwenkedel, même lorsqu'il musardait et tâtait du surréaliste (ce qui est quand même un peu le cas ici), ne pouvait s'empêcher de bien faire. Et on pourrait croire qu'une pareille machine doit être très fragile. En fait, cet orgue fournit de bons et loyaux services durant 50 ans, quand la Musique tenait une place importante à l'Institut. Il était joué par Antoine Heusser. Depuis 1995, l'orgue de Still était muet. Il fut repris par l'Association Musicale du Saulnois, qui projette de le remonter dans l'église de Bellange (près de Château-Salins). L'orgue Schwenkedel devrait être utilisé dans le cadre d'un festival et d'une école de musique. Tant mieux pour Château-Salins, tant pis pour l'Alsace, qui a perdu un bel élément de son patrimoine. [IHOA:p180b] [ITOA:4p653]
 1953 : Biesheim (région de Neuf-Brisach), St-Jean-Baptiste
1953 : Biesheim (région de Neuf-Brisach), St-Jean-Baptiste
Instrument actuel.
Cet orgue, reçu le 22/11/1953, est une création assez exceptionnelle, qui peut être considéré comme un certain aboutissement de l'esthétique néo-classique. Il ne manque pratiquement rien à l'opus 111 (Voix céleste, Flûte octaviante, Basson 16', Trompette et Hautbois au récit, mais aussi Trompette et Fourniture 4 rgs au grand-orgue, et batterie d'anches complète à la pédale), et il donne accès à la quasi-totalité du répertoire pour orgue. Console de type "Burnhaupt", mais électrique. (Et donc avec un voltmètre !) [IHOA:p36b] [ITOA:2p38] [PMSRHW:p19-20]
 1954 : Benfeld, St-Laurent
1954 : Benfeld, St-Laurent
Instrument actuel.
L'opus 103 est radicalement différent de celui de Still. Il y a 29 jeux réels (III/P 29+4j), et, fait révélateur, il est dépourvu d'accouplements à l'octave (bien que la transmission électrique l'aurait permis). L'instrument contient beaucoup de tuyaux de l'instrument de Joseph Rinckenbach, qui fut malheureusement endommagé pendant la deuxième guerre mondiale. [IHOA:p33b-4a] [ITOA:3p29] [PMSSTIEHR:p534-9] [PMSDBO1974:p132] [Barth:p148-9]
 1952 : Neufrange (67), institut St-Joseph
1952 : Neufrange (67), institut St-JosephL'opus 114 était plutôt d'un orgue d'occasion. Il a été construit sur la base des sommiers de l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach de Still (institut des aveugles). Six jeux de l'opus 129 de la maison d'Ammerschwihr ont été réutilisés (Montre, Prestant et Fourniture du grand-orgue, Bourdon 8' du récit, Soubasse et Flûte 8' de la pédale). Huit jeux neufs et un d'occasion ont servi au complément. Le pauvre instrument, certes pas "homogène" mais ayant au moins l'intérêt de former un tout cohérent, fut littéralement massacré dans les années 1970 par greffe d'une console d'occasion, et l'introduction de tout un fatras de Sesquialtera, Cymbale, Larigot, etc... La pauvre chose mutilée trouva refuge en 2002 à Metz-Queleu, mais n'a bien sûr plus aucun intérêt historique... sauf sa triste histoire, et son joli buffet. [IOLMO:Mo-Sap1518-21]
 1954 : Horbourg-Wihr (région d'Andolsheim), Eglise de l'Assomption de la B.V.M.
1954 : Horbourg-Wihr (région d'Andolsheim), Eglise de l'Assomption de la B.V.M.
Instrument actuel.
L'opus 116 est un exercice de style : aller jusqu'au bout de la logique des emprunts et extensions (II/P 4+24j), un peu comme à l'institut des aveugles de Still. [IHOA:p81a] [ITOA:2p164]
 1954 : Weitbruch (région de Haguenau), St-Gall
1954 : Weitbruch (région de Haguenau), St-Gall
Instrument actuel.
L'opus 118 concerna d'importants travaux sur un orgue Xavier Stiehr (1872) que Kriess avait doté d'une transmission pneumatique en 1924. [IHOA:p217b] [ITOA:4p833]
 1954 : Uttenhoffen (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
1954 : Uttenhoffen (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
Instrument actuel.
L'église d'Uttenhoffen est réputée être la plus petite d'Alsace. Alsace oblige, elle est quand même dotée d'un orgue. Un orgue avec deux manuels et une "pédale indépendante", comme le soulignait parfois l'Orgue parisien de la fin 19ème, s'étonnant qu'on puisse trouver une chose pareille "en province". L'orgue de la plus petite église d'Alsace dispose aussi d'un jeu de 16'. C'est l'opus 120 de Georges Schwenkedel, qui a été construit en 1954, pour remplacer un premier orgue détruit par la guerre. [IHOA:p209a] [ITOA:4p802]
 1954 : Strasbourg, Eglise réformée du Bouclier
1954 : Strasbourg, Eglise réformée du Bouclier
Remplacé par Alfred Wild (1988).
La maison Schwenkedel a pratiquement reconstruit cet orgue Link... car il fallait absolument "de l'électrique". A l'opposé de certains facteurs qui ont apposé leur plaque sur des instruments à peine modifiés, la plaque d'adresse stipulait fort modestement : "Electrification réharmonisation - G. SCHWENKEDEL et FILS - Année 1954". Avec le recul, certainement pas ce que la maison Schwenkedel a fait de mieux...
 1955 : Aubure (région de Ste-Marie-aux-Mines), St-Jacques Majeur
1955 : Aubure (région de Ste-Marie-aux-Mines), St-Jacques Majeur
Instrument actuel. Remplacé par une chose élctronique.
L'orgue d'Aubure existe toujours (numéro d'opus, 113, partagé avec la clinique Ste-Barbe à Strasbourg). C'est un grand positif de dos en balustrade de la tribune. Mais, dans la région de Ste-Marie-aux-Mine si riche en orgues, Aubure fait exception : on y a cédé, en 2003, à la facilité et aux sirènes du "numérique". [IHOA:p29a] [ITOA:2p15] [PMSCALL:p151] [SchwenkedelNB:1932-1939p4267] [SchwenkedelDO:1,3,5p2805,3124,3399] [Mathias:p69] [Barth:p138,142]
 1955 : Strasbourg, Clinique Ste-Barbe
1955 : Strasbourg, Clinique Ste-Barbe
Orgue disparu vers 2000.
Le numéro d'opus (opus 113) confirme que cette reconstruction (avec une traction électrique) de l'orgue Koulen 1891 était considérée comme la création d'un orgue neuf. Il est vrai qu'on est passé de II/8 à II/P 18j. Ce fut, dit-on, le dernier travail de Georges Schwenkedel. [IHOA:p182b] [ITOA:4p658]
En 1955 eut lieu un des rares travaux fortement critiquables imputables à la maison Schwenkedel, à Zillisheim (église du collège épiscopal) : la quasi-destruction de l'opus 95 de Martin et Joseph Rinckenbach.
Il était temps de faire des choix. La maison Schwenkedel avait porté haut les couleurs d'un post-romantisme poétique et coloré, direct héritier des conseils de Schweitzer et de Rupp. Georges avait courageusement proposé une approche originale du néo-classique, plus proche des vallées de la Suisse que des sirènes de "l'orgue nordique" (une chose mal définie, mais qui devait être géniale, vu que les tous autres avaient l'air de savoir ce que c'est). Il prit sa retraite, sûrement rassuré par les perspectives d'un marché florissant. Il ne savait pas qu'avec l'accélération délirante des "30 glorieuses", il ne restait à l'entreprise qu'il avait créée que 20 ans à vivre... mais quelles 20 années !
 De Sand (1955) à Mulhouse, St Fridolin (1961) : le néo-classique et les premiers néo-baroques
De Sand (1955) à Mulhouse, St Fridolin (1961) : le néo-classique et les premiers néo-baroques
La situation pour Curt Schwenkedel était schématiquement la suivante : 10 ans après la fin du conflit, la maison Rinckenbach d'Ammerschwihr, le "concurrent naturel" avait disparu. Joseph Rinckenbach, en manque de successeur et surtout de réseaux dans cette "France moderne", avait fini par s'épuiser. Dans le Haut-Rhin, Christian Guerrier connaissait un franc succès, malgré son approche "pragmatique" de la mécanique (ce n'était pas grave : à l'époque, du moment que c'était mécanique, c'était génial). A Strasbourg, la maison Muhleisen avait 10 ans, et pratiquait un retour au techniques du 18ème plein de sincérité, vu qu'Ernest avait eu une révélation en renouvelant l'orgue de l'église protestante St-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. Mais sans jamais tomber dans l'excès. A Sarre-Union, Jean-Georges Koenig aussi pratiquait la transmission mécanique avec sincérité : il y était parfaitement à l'aise. Alfred Kern, après des débuts un peu surprenants (opus 1 à Strasbourg, 1957), allait bientôt révéler l'étendue de son talent, mais en 55, ceci n'était pas connu. Il n'y avait donc qu'une solution viable pour Curt Schwenkedel : le néo-baroque "poussé" (Marcussen/Zachariassen ; ou Jürgen Ahrend qui en 1954 posa son Opus 1), déjà pratiqué avec zèle.
Le style néo-baroque était prêt : il restait à obtenir l'adhésion des "petits" organistes et du public. (On verra qu'on décida par la suite de s'en passer.)
Curt, dans son atelier, avait encore besoin de 3 à 5 ans pour affirmer un style et constituer ses réseaux, mais il savait probablement déjà où il allait. S'ouvre alors une période de transition, où Curt est au pouvoir, et Georges à la retraite, mais toujours là.
 1955 : Sand (région de Benfeld), St-Martin
1955 : Sand (région de Benfeld), St-Martin
Instrument actuel.
Cet orgue fut donc a priori construit sans Georges. La reconstruction d'un orgue Stiehr endommagé durant le conflit mondial fut l'opus 124 de la maison de Koenigshoffen ; l'inauguration eut lieu le 30/01/1955. La plaque d'adresse porte l'année de construction : 1954. Georges Schwenkedel avait estimé que le buffet Stiehr était récupérable. Mais les "marottes" des années 50 faisaient encore loi, l'instrument resta dépourvu buffet. Il est complètement néo-classique. [IHOA:p162b] [ITOA:4p572] [PMSSTIEHR:p601-4] [PMSSTIEHR75:p362]
 1954 : Munster, Eglise protestante
1954 : Munster, Eglise protestante
Remplacé par Georges Frédéric Walther (1985).
De 1954 date la malheureuse transformation de l'Opus 10 de Georges (1927) par Curt Schwenkedel. Pour y ajouter un positif de dos... Le tout a été reconstruit par la maison Muhleisen, en 1985, en mécanique, mais en échappant à la tyrannie du néo-baroque alors omniprésent ; ce qui a finalement donné un des instruments les plus marquants de la région, bien qu'il soit affublé d'un Larigot. [IHOA:p122a] [ITOA:2p293-4] [YMParisAlsace:p65-7] [AORM:p20] [PMSCALL:p352] [PMSSTIEHR:p645-9] [Barth:p270]
 1954 : Palaiseau (91) N.D. De Pitié
1954 : Palaiseau (91) N.D. De PitiéIl s'agit d' un ancien orgue de salon, l'opus 125 (II/P 11+14j), construit pour Jean-Marie Brouet, le directeur de l'usine Arthur Martin de Révin (Ardennes). Après les quelques années d'errance caractéristique de l'histoire des orgues de salon, l'instrument fut installé à Puteaux, où il fut inauguré lors de la fête de la musique de l'an 2000. [Deondino]
 1955 : Algolsheim (région de Neuf-Brisach), Eglise protestante
1955 : Algolsheim (région de Neuf-Brisach), Eglise protestante
Instrument actuel.
L'opus 126 est encore résolument néo-classique (Trompette et Tierce au récit, deux accouplements à l'octave). [IHOA:p24b] [ITOA:2p1]
 1955 : Chalampe (région d'Illzach), St-Wendelin
1955 : Chalampe (région d'Illzach), St-Wendelin
Instrument actuel.
Emprunts et extensions sont encore au programme pour l'opus 128 : le grand-orgue et la pédale ne sont constitués que de deux rangs : l'un de Principaux, commençant au 8', et de 80 notes, produit la Montre, le Prestant et la Doublette. L'autre est constitué de Flûtes, commençant au 16' (coniques dans les dessus), de 80 notes aussi. Il produit la Soubasse, le Bourdon et la Flûte. [IHOA:p46a] [ITOA:2p70] [SchwenkedelAB:2p1306]
 1956 : Mietesheim (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise mixte
1956 : Mietesheim (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise mixte
Instrument actuel.
Les sommiers sont toujours à cônes, électriques, mais l'opus 123 est muni d'un positif de dos. C'est la disparition des récits expressifs qui s'amorce ici. [IHOA:p112b] [ITOA:3p376]
 1956 : Holtzwihr (région d'Andolsheim), St-Martin
1956 : Holtzwihr (région d'Andolsheim), St-Martin
Instrument actuel.
L'opus 130 a fait l'objet de choix audacieux. Il est en fait constitué de deux orgues : la partie principale est placée en nid d'hirondelle. C'est un 2 claviers / pédalier avec récit expressif, dont l'expression est commandée pneumatiquement. Un orgue de choeur, indépendant, est situé au-dessus de l'entrée de la chapelle ; il peut être joué depuis la console du grand (sur le clavier du bas et le pédalier). [IHOA:p81a] [ITOA:2p161-2] [PMSBERGANTZEL:p247-8] [Barth:p226]
 1956 : Sarralbe (57), église luthérienne
1956 : Sarralbe (57), église luthérienneC'est la reconstruction d'un orgue d'Adrian Spamann. La tuyauterie est de Schwenkedel (commandée chez Laukhuff) et les sommiers de Spamann. [IOLMO:Mo-Sap1881-2]
 1856 : Penne-d'Agenais (47)
1856 : Penne-d'Agenais (47)La basilique Notre-Dame de Peyragude abrite un petit orgue Schwenkedel (I 11j) disposé en tribune. La tuyauterie est disposée hors buffet, mais le soubassement est soigné, et comprend même des culots de tourelles. [OrguesAquitaine]
 1957 : Grussenheim (région d'Andolsheim), Ste-Croix
1957 : Grussenheim (région d'Andolsheim), Ste-Croix
Instrument actuel.
L'opus 122 aussi, est encore complètement néo-classique. [LORGUE:1959-4, n°92p128] [IHOA:p67b] [ITOA:2p127]
 1957 : Wickerschwihr (région d'Andolsheim), St-Jacques Majeur
1957 : Wickerschwihr (région d'Andolsheim), St-Jacques Majeur
Instrument actuel.
Avec l'opus 132 Curt Schwenkedel fit sa première tentative d'harmonisation "à Plein-vent", qui connut un fort succès dans les années 1960. L'instrument a donc déjà sa place dans l'histoire de la facture d'orgues ! Construit autour d'une structure en béton en forme de chevalet, l'instrument est en quelque sorte l'expression ultime du refus du buffet. [IHOA:p219b] [ITOA:2p481] [Marienthal1962:p26]
 1957 : Jebsheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante
1957 : Jebsheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante
Instrument actuel.
L'opus 134 remplace l'opus 70 détruit pendant la guerre. Pas de buffet, la traction est électrique et le second clavier est expressif et porte la Trompette (mais il est totalement dépourvu de jeux romantiques). [IHOA:p87a] [ITOA:2p182] [PMSRHW:p207] [AS1975:p142-8]
 1957 : Dornach (région de Mulhouse), Ste-Thérèse
1957 : Dornach (région de Mulhouse), Ste-Thérèse
Instrument actuel.
L'opus 135 reçut l'un des premier jeux "Italiens" (un Principal de large taille, idéal pour commencer Frescobaldi ; d'où son nom), qui seront très à la mode dans les années 1960. Le reste est néo-classique, avec une batterie d'anches complète au récit... mais la Trompette peut être empruntée au grand-orgue. [IHOA:p52b] [ITOA:2p271]
 1957 : Witternheim (région de Benfeld), St-Sébastien
1957 : Witternheim (région de Benfeld), St-Sébastien
Instrument actuel.
Pour l'opus 137, pas de "Principal italien", mais une Flûte 4' conique. Or, le "Gemshorn 4'", c'est une couleur qui rappelle le début du siècle. [IHOA:p224b,29b] [ITOA:4p877] [PMSSTIEHR:p696-7,715] [Barth:p114,391,427]
 1957 : Colmar, Hôpital départemental
1957 : Colmar, Hôpital départemental
Instrument actuel.
Laurent Steinmetz a laissé en 1984 une inscription dans cet orgue, indiquant que c'est déjà lui qui l'avait harmonisé en 1957. [IHOA:p48a] [SchwenkedelDO:4p3221,3245-6]
 1957 : Sausheim (région d'Illzach), St-Laurent
1957 : Sausheim (région d'Illzach), St-Laurent
Remplacé par Georges Frédéric Walther (2005).
Ce grand (III/P 25+7j) instrument existe toujours (en tribune). On y trouve un Principal italien 8'. Son entretien étant devenu problématique, et on préféra (avec succès) s'orienter vers la construction d'un orgue neuf, placé dans le chœur. Mais la grande chose néo-classique est toujours là, avec sa Flûte 16' en vue. Personne n'a eu le coeur de la démonter. Heureusement. C'est une jolie sculpture muette, et, qui sait, dans quelques années... [IHOA:p164a] [ITOA:2p413]
 1957 : Hombourg (région d'Illzach), St-Nicolas
1957 : Hombourg (région d'Illzach), St-Nicolas
Instrument actuel.
La nature exacte de cette transformation reste à cerner. Mais la plaque Schwenkedel a été apposée à la console.
En 1957, il y eut aussi une intervention à Hagenthal-le-Bas. Un petit orgue Schwenkedel fut aussi installé à Haguenau, mais il était probablement déjà d'occasion.
 1958 : Friesen (région de Hirsingue), Sts-Pierre-et-Paul
1958 : Friesen (région de Hirsingue), Sts-Pierre-et-Paul
Remplacé par Ivo et Boris Garnier (2012).
L'opus 127 (120 selon certaines sources) a été démonté en 2012. Sa console (accompagnée, comme elle est électrique, d'éléments de la transmission) devrait prochainement reprendre du service, en servant à redonner vie à l'orgue d'Altkirch, St-Morand. [IHOA:p62a] [ITOA:2p119] [Barth:p196]
 1958 : Bischoffsheim (région de Rosheim), Couvent des Rédemptoristes
1958 : Bischoffsheim (région de Rosheim), Couvent des Rédemptoristes
Instrument actuel.
Parmi les souvenirs laissés par une pratique quasi-hebdomadaire de cet instrument pendant plusieurs années (fin des années 1990) figure celui de claviers couverts de rosée en hiver (due à l'humidité du lieu) ; le fait de savoir que la transmission est électrique donne quelques sueurs froides (qui elles-même ne contribuent pas à faire évoluer l'hygrométrie dans le bon sens). Craintes infondées, toutefois. Les autres souvenirs son bons : c'est un petit instrument très attachant, auquel il ne manque vraiment qu'un buffet. Mais bon, il est né sans... [LORGUE:1959-4, n°92p128] [IHOA:p37b,215a] [ITOA:3p58] [PMSCS68:p23-9] [PMSCALL:p90,92] [PMSSTIEHR:p442-3] [Barth:p154]
 1958 : Schirrhein (région de Bischwiller), St-Nicolas
1958 : Schirrhein (région de Bischwiller), St-Nicolas
Remplacé par Yves Koenig (1996).
On pourrait penser que cet opus 141 (qui est encore un "dommages de guerre") était "à bout" dans les années 1990 (selon l'expression consacrée). Ce serait mal connaître la qualité des orgues Schwenkedel : en 1995, lors de la fourniture d'un orgue neuf pour Schirrhein, le Schwenkedel a été revendu à Ploëmel, dans le Morbihan. Il y coule des jours heureux, et se trouve particulièrement mis en valeur. Le déménagement et le remontage ont été effectués par Bernard Andrault, avec le concours de l'Association des Amis de l'Orgue de Ploëmel. Il a été inauguré le 03/06/1996 par Christine Riskine-Guiguen, qui y a même enregistré un CD. [Caecilia:1996/4p29-30] [IHOA:p167a-b] [ITOA:4p606]
 1958 : Lutterbach (région de Wittenheim), Sacré-Coeur
1958 : Lutterbach (région de Wittenheim), Sacré-Coeur
Instrument actuel.
Une des interventions les plus contestables de la maison Schwenkedel. Malgré sa taille (III/P 45+3j), l'opus 143 n'efface pas le souvenir de son prestigieux prédécesseur (l'opus 110 de Martin et Joseph Rinckenbach). De pareilles transformations n'étaient pas justifiées par les dégâts dus à la guerre : plusieurs devis d'ampleurs différentes attestent qu'une réparation eut été possible. En particulier, la perte du buffet Boehm s'est révélée désastreuse. Suite au projet mené en 2020-2021 par Sébastien Braillon, c'est devenu un instrument assez extraordinaire. Si bien qu'on ne regrette plus grand chose. [Orgelbauerei1909:p17-18] [IHOA:p106a] [ITOA:2p227] [Lutterbach1958:p19-22] [PMSSUND1987:p261] [Barth:p250-251]
 1958 : Brunstatt (région de Mulhouse), Ste-Odile
1958 : Brunstatt (région de Mulhouse), Ste-Odile
Instrument actuel.
Avec son Cromorne "baladeur" (il peut être joué au grand-orgue, au positif ou à la pédale), l'opus 139 est encore néo-classique (il est doté d'un récit expressif et d'une Voix céleste), mais la composition de son positif annonce le néo-baroque "hard" alors en gestation. [IHOA:p44a] [ITOA:2p59]
 1958 : Uhrwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
1958 : Uhrwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
Instrument actuel.
Le second manuel de l'opus 145, composé comme un positif Silbermann (sauf les deux 4'), n'a plus de "récit" que le nom. Et surtout, la transmission est mécanique (à équerres et balanciers) et les sommiers à gravures. Les dominos aussi ont disparu (même si le tirage des jeux est électrique) : ils ont été remplacés par des balles de golf... A Urhwiller, une page a été tournée. [LORGUE:1959-4, n°92p128] [IHOA:p208a] [ITOA:4p798]
 1958 : La Montagne-Verte (région de Strasbourg), Eglise protestante St-Jean
1958 : La Montagne-Verte (région de Strasbourg), Eglise protestante St-Jean
Instrument actuel.
Exactement dans la même tendance que celui d'Uhrwiller, l'opus 147 est à transmission mécanique (sommiers à gravures). Il va encore plus loin dans le néo-baroque naissant : on assiste au retour du positif de dos et des consoles réellement en fenêtre. [LORGUE:1959-4, n°92p128] [IHOA:p192b] [ITOA:4p715]
En 1958 eut lieu la quasi-reconstruction de l'orgue Callinet d'Issenheim (en néo-classique). Mais presque en même temps - la réalité est souvent plus complexe que les schémas - il y eut une opération que l'on peut qualifier de restauration, au sens propre, à Zinswiller. (Probablement une des premières ; jusque là, le mot voulait dire "remplacement de l'intérieur par du neuf".) L'orgue Stiehr y a été rétabli dans son état de 1875 (sauf l'étendue de pédale) ! Curt Schwenkedel prouvait qu'on pouvait faire avancer la facture d'orgues sans forcément éliminer son héritage. On entrait dans une période où l'on ne pouvait plus envoyer un orgue à la chaudière que s'il appartenait à la génération précédente (lire : s'il avait été construit après 1870).
En mars 1958, aussi, s'éteint Georges Schwenkedel.
Face à la figure d'Edmond-Alexandre Roethinger, ce "capitaine d'industrie" par excellence, Georges Schwenkedel représente, quelque part, l'artiste issu du peuple. Il s'était tenu éloigné des "réseaux" du monde musical et probablement surtout du snobisme élitiste qui y régnait (voir la revue "L'orgue" de ces années-là). Finalement, son seul réel concurrent sur le plan du charme et des harmonisations fut Joseph Rinckenbach. Ce type de concurrence "équitable" pousse chacun a devenir meilleur. Sans le "challenge" venant d'Ammerschwihr, forcément, tout devenait à la fois plus facile et moins passionnant.
 1959 : Oberlauterbach (région de Seltz), St-Sixte
1959 : Oberlauterbach (région de Seltz), St-Sixte
Instrument actuel.
L'opus 151 dispose encore d'un second clavier expressif et d'accouplements à l'octave. Mais la composition confirme le rejet total, à la fin des années 50, des jeux romantiques. [LORGUE:1959-4, n°92p128] [IHOA:p132a] [ITOA:4p463] [PMSSTIEHR:p243-4]
 1959 : Mulhouse, Eglise évangélique lutherienne
1959 : Mulhouse, Eglise évangélique lutherienne
Instrument actuel.
Avec l'opus 154, Curt montre ce qu'il sait faire avec des moyens limités (II/P 8+11j), et qu'il porte autant d'attention aux "petits" orgues qu'aux 3-claviers. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [ITOA:2p281]
 1959 : Elsenheim (région de Marckolsheim), St-Jacques Majeur
1959 : Elsenheim (région de Marckolsheim), St-Jacques Majeur
Instrument actuel.
L'opus 155 porte la plaque "C. SCHWENKEDEL". Curt remplace donc l'opus 51 de son père, qui avait été détruit en 1945. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [IHOA:p56a] [ITOA:3p152] [PMSRHW:p237-42] [PMSAEA69:p164-169]
 1959 : Strasbourg, Couvent Marie-Réparatrice
1959 : Strasbourg, Couvent Marie-Réparatrice
Instrument actuel.
Cet orgue est aujourd'hui muet. Michel Chapuis a joué un grand rôle dans sa conception. Deux Cymbales, cinq mutations, un Cromorne. Seul "atavisme" apparent : l'Unda maris (l'ondulant des positifs romantiques). Mais ce n'en est pas un : ce jeu deviendra même une marque de modernité d'une branche du néo-baroque (placé dans un Brustwerk expressif). Transmission électrique (Schwenkedel) avec des sommiers à membranes de Roethinger. [LORGUE:1959-4, n°92p128] [IHOA:p198a] [ITOA:4p754]
 1959 : Bischholtz (région de Bouxwiller), Eglise protestante
1959 : Bischholtz (région de Bouxwiller), Eglise protestante
Instrument actuel.
L'opus 157 est doté d'un positif de dos, et même d'un (timide) buffet, mais la transmission est électrique. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [IHOA:p38a] [ITOA:3p56]
 1959 : Revin (08) Orgue de salon chapelle St-Eloi
1959 : Revin (08) Orgue de salon chapelle St-EloiCet instrument fut transféré à Soucieu-en-Jarest en 1986. Il y a été installé par des bénévoles et harmonisé par Micolle et Valentin de Lyon. Michel Jurine y a travaillé fin 2009 et début 2010 pour installer une transmission numérique. L'inauguration a eu lieu les 24 et 25/04/2010 [LORGUE:1965-4, n°116p177] [OrguesRA] [Rhône:IIp295-7]
 1959 : Bennwihr (région de Kaysersberg), St-Pierre-et-Paul
1959 : Bennwihr (région de Kaysersberg), St-Pierre-et-Paul
Instrument actuel.
Semblant sortir du mur avec ses rangées de tuyaux de différents jeux, cet orgue (II/P 15+4j) est un rectangle bleu et métallique dans une église toute blanche. La console est située contre le mur opposé, et elle est donc électrique. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [IHOA:p34a] [ITOA:2p28]
En 1959 il y eut aussi d'importants travaux à Kientzheim (68), Colmar, St-Joseph, Les Fontenelles (25), Keskastel, Koenigshoffen, Pierrefontaine (25), Pfaffenheim, Petit-Landau. [LORGUE:1959-4, n°92p128]
 1960 : Waldersbach (région de Schirmeck), Eglise protestante
1960 : Waldersbach (région de Schirmeck), Eglise protestante
Instrument actuel.
C'est un drôle de petit instrument, plus ou moins récupéré et de provenance inconnue. Mais Schwenkedel le mit en voix. Il a été harmonisé à plein-vent. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [IHOA:p213b,39a,167a-b] [ITOA:3p21] [Marienthal1962:p26]
 1960 : Epinal (88)
1960 : Epinal (88)Pour remplacer un instrument détruit en mai 1944, Curt Schwenkedel réalisa un grand (IV/P 34+18j) instrument néo-classique doté de 4 claviers (dont 3 expressifs) de 61 notes. Il a été harmonisé par Laurent Steinmetz et inauguré le 08/05/1960. La transmission est électro-pneumatique. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [OrguesVosges]
 1960 : Périgueux (24) Centre hospitalier
1960 : Périgueux (24) Centre hospitalierCe petit instrument (II/0P 6j) dépourvu de buffet a la particularité d'avoir un 16' manuel pour 6 jeux seulement. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [OrguesAquitaine]
 1960 : Colmar, Ecole de musique 1/3
1960 : Colmar, Ecole de musique 1/3
Instrument actuel.
Cet orgue "de conservatoire" (version travail, pas audition) a été harmonisé à plein-vent. Sa composition témoigne de la façon d'enseigner à l'époque : un positif constitué d'un Cornet décomposé (jeu de Tierce complet), une anche "douce" en 4' à la pédale, et ce curieux grand-orgue : Bourdon 8', Prestant, Cymbale 3 rgs (1/2') ! [LORGUE:1960-4, n°96p132] [IHOA:p47b] [ITOA:2p88]
 1960 : Cornimont (88)
1960 : Cornimont (88)La composition (III/P 32+3j) est due à Gaston Litaize, et l'opération à coûté à Cornimont un magnifique buffet de Nicolas Jeanpierre, qui a failli être présenté à l'exposition universelle de 1867. L'orgue de 1960 est doté d'un récit expressif et d'une transmission électromécanique. Il est donc encore plutôt néo-classique. Mais déjà la presse s'enthousiasme pour cet orgue "baroque", "unique dans la région" (ça va pas durer...). L'instrument a été inauguré le 23/07/1961, mais avait déjà servi lors de la messe de minuit 1960. Il a fallu le réharmoniser dans les années 1990 tant les Mixtures étaient tranchantes. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [IOLVO:p207-11]
En 1960 furent aussi signalés d'importants travaux à Ungersheim, Rombach-le-Franc, Andolsheim?, Biblisheim, Dessenheim?, Gumbrechtshoffen, Herbitzheim, l'église protestante du Port du Rhin à Strasbourg, Leimbach, Maiche (25) Séminaire (II-17), Reims (51) S-Jacques (I-9), Saales?, Westhalten, [LORGUE:1960-4, n°96p132]
 1960 : Mulhouse, St-Fridolin
1960 : Mulhouse, St-Fridolin
Instrument actuel.
Claviers de 61 notes, sommiers à cônes, transmission électrique, Aeoline et Voix céleste, Tierce et Cymbale : c'est en quelque sorte le chant du cygne du néo-classique. Malheureusement, c'est un orgue Friedrich Goll qui fut perdu dans cette reconstruction, mais il en reste le buffet et une bonne partie de la tuyauterie, plutôt bien conservés. [LORGUE:1960-4, n°96p132] [IHOA:p120a] [ITOA:2p259]
 D'Illhaeusern (1961) à Colmar (1975) : le triomphe du néo-baroque
D'Illhaeusern (1961) à Colmar (1975) : le triomphe du néo-baroque

Une publicité pour la maison Schwenkedel datant du début des années 60 montre que l'orthographe à retenir pour "Curt" est bien avec un "C" (et non un "K"). On y voit aussi représenté un artisan de la renaissance construisant un positif rappelant celui de la Dame à la Licorne. Dire que quelques années auparavant, les facteurs mettaient surtout en avant des "systèmes" brevetés innovants ! Les années 60, c'était en effet le début de l' "historicisme" : bientôt, la seule mesure de la qualité d'un orgue allait être son âge. C'était facile : plus l'orgue était vieux, meilleur était le son. Un orgue du 18ème était donc forcément génial. Le "syndrome Stradivarius" s'appliquait à la facture d'orgues, comme si les artisans d'un "âge d'or" avaient détenu des recettes secrètes, oubliées quand on a inventé la vis et la scie circulaire. Donc, pour "bien faire", il fallait que le neuf ressemble - au moins sur le papier - à un instrument du 18ème siècle. Or, en facture d'orgue classiques française, les "recettes secrètes" sont dans le Dom Bedos. Et dans le Dom Bedos, les sommiers sont à gravures.
1961
 1961 : Illhaeusern (région de Ribeauvillé), Sts-Pierre-et-Paul
1961 : Illhaeusern (région de Ribeauvillé), Sts-Pierre-et-Paul
Instrument actuel.
Transmission à équerres, sommiers à gravures : le pas est franchi. Mais construire un orgue "façon 18ème" sur cette tribune (où le manque de hauteur est flagrant) était un vrai défi : l'orgue "baroque" a besoin de place en hauteur, pas en largeur. On n'est donc pas encore tout à fait à utiliser les "techniques" du 18ème : la mécanique est un aluminium, la tuyauterie est pour partie en spotted et cuivre. Le réservoir à charge flottante : faut-il y voir un compromis entre les solides (mais "très 19ème") plis parallèles et les "top-baroques" (mais capricieux) soufflets cunéiformes ? En tous cas, en 1961, et à Illhaeusern commence, avec la maison Schwenkedel, une nouvelle page de l'orgue alsacien. [LORGUE:1962-1, n°101p25] [IHOA:p83b] [ITOA:2p177] [PMSRHW:p206] [PMSCALL:p363] [Barth:p229,403]
 1961 : Kembs (région de Sierentz), St-Jean-Baptiste
1961 : Kembs (région de Sierentz), St-Jean-Baptiste
Instrument actuel.
Le buffet, en sapin, date de 1842, et il n'y avait donc pas besoin de grandes théories pour munir l'instrument neuf d'un positif de dos. Mécanique à équerres et tirage de jeux électrique. Il y avait une Ranquette 16' au grand-orgue à l'origine, mais elle n'a pas survécu aux lois de la Sélection Naturelle. De fait, Curt Schwenkedel a eu une période "anches allemandes", et ce néo-baroque n'est pas un néo-Couperin. Douçaine et Chalumeau à la pédale. [LORGUE:1963-1, n°105p36] [IHOA:p88b] [ITOA:2p191]
 1961 : Mulhouse, St-Jean-Bosco
1961 : Mulhouse, St-Jean-Bosco
Instrument actuel.
Cet instrument (II/P 24j) est résolument néo-baroque (buffet à caissons). A nouveau, voici une Unda-maris dans un second clavier expressif. Le reste de ce plan sonore est composé comme un positif classique. Trompette et Clairon au grand-orgue, Bombarde à la pédale (les anches "allemandes" n'étaient donc pas un dogme). [LORGUE:1962-1, n°101p25] [IHOA:p120b] [ITOA:2p261]
 1961 : Neuve-Eglise (région de Villé), St-Nicolas
1961 : Neuve-Eglise (région de Villé), St-Nicolas
Instrument actuel.
Grand-orgue "de dos", console indépendante, sommiers à gravures sous 40mm de pression, Larigot, Principal "italien" 4' à la pédale : la datation n'a presque pas besoin de confirmation. L'instrument a été inauguré le 16/07/1961. [LORGUE:1962-1, n°101p25] [SchwenkedelDO:4p3222-3,3291] [IHOA:p126a] [ITOA:3p419] [PMSSTIEHR:p722] [Barth:p275] [Mathias:p53] [Marienthal1962:p26]
 1961 : Rittershoffen (région de Soultz-sous-Forêts), Eglise protestante
1961 : Rittershoffen (région de Soultz-sous-Forêts), Eglise protestante
Instrument actuel.
Cette fois, à part la console indépendante, plus aucune concession au néo-baroque, pleinement théorisé et assumé : sommiers à gravures, mécanique suspendue, Sesquialtera et Principal 1' au grand-orgue, un seul timide 8' (bouché - tout comme le 4') au second clavier (un écho), Principal italien 4' à la pédale. [IHOA:p149b] [ITOA:4p530] [SchwenkedelNB:1926-1927p1496,1566] [SchwenkedelNB:1932-1939p4317-9] [Mathias:p56] [Barth:p310] [Mathias:p52] [Horning:p199]
 La plaque d'adresse en 1961.
La plaque d'adresse en 1961.1962
 1962 : Marienthal (région de Haguenau), Notre-Dame
1962 : Marienthal (région de Haguenau), Notre-Dame
Instrument actuel.
Un sommet dans son genre, et une "figure" de l'orgue alsacien. Voici l' "orgue nordique" qui fait son entrée : buffet à cloisons/caissons, tourelles de pédale, "Werkprincip". Le tout se fait avec tambours et trompettes (en chamade...), mais, en fait, avec 44 jeux pas-si-nordiques-que-ça (dont la Voix humaine du Silbermann de Strasbourg, St-Thomas). C'est l'un des orgues les plus marquants de Curt Schwenkedel, avec Strasbourg, St-Jean (1967), Toul (1966), Solesmes (1967) et Seltz (1968). [LORGUE:1963-1, n°105p36] [IHOA:p108a] [ITOA:3p238-9] [Marienthal1962:p6-21] [PMSSTIEHR:p638-41]
 1962 : Staffelfelden (région de Cernay), Sts-Pierre-et-Paul (Rossalmend)
1962 : Staffelfelden (région de Cernay), Sts-Pierre-et-Paul (Rossalmend)
Instrument actuel.
Un mini Marienthal (II/P 11+2j), de style néo-baroque "pointu" (sans concession) avec Sesquialtera au positif intérieur non-expressif, et Trompette en chamade au grand-orgue. [LORGUE:1966-4, n°120p157] [IHOA:p178b] [ITOA:2p436]
 1962 : Rouffach, Chapelle catholique de l'hôpital
1962 : Rouffach, Chapelle catholique de l'hôpital
Instrument actuel.
Il s'agissait de reconstruire un orgue Kriess de 1908, qui avait une belle composition romantique (II/P 11j). Bien que les vertus thérapeutiques des Cymbales 3 rangs restent à prouver, l'orgue de 1908 - authentique sauf la façade - riche de sept 8', a été remplacé par cet instrument néo-baroque neuf beaucoup plus petit (II/P 7j). [IHOA:p156b] [ITOA:2p387] [Barth:p317,424]
Le courant "néo-baroque" montrait son principal travers : faire table rase du passé, et s'imposer comme "pensée unique". Ici, les dégâts furent limités, mais la vague néo-baroque a remplacé beaucoup d'instruments pleins de possibilités (certes modestes mais aptes à susciter des vocations) par des "orgues d'accompagnement" neufs à un seul manuel. On se demanda ensuite pourquoi on ne trouve plus d'organistes.
 1962 : Dieffenbach-au-Val (région de Villé), St-Laurent
1962 : Dieffenbach-au-Val (région de Villé), St-Laurent
Instrument actuel. Orgue remplacé par une chose électronique.
La baroquisation (II/0P 6j) de cet orgue Franz Xaver Kriess (1933) signa finalement son arrêt de mort. [LORGUE:1962-1, n°101p25] [IHOA:p51b] [ITOA:3p117] [SchwenkedelDO:6p3540] [Barth:p179] [Mathias:p53]
 1962 : Hilsenheim (région de Marckolsheim), St-Martin
1962 : Hilsenheim (région de Marckolsheim), St-Martin
Instrument actuel.
La ré-apparition (en force) des jeux coniques est aussi caractéristique de l'époque, tout comme l'usage du cuivre pour certains tuyaux. Cet instrument est doté d'un grand Cornet posté (au second clavier). Au "récit", on trouve une Unda maris et des anches "courtes" en 16' 8', 4'. Sesquialtera, Trompette et Clairon au grand-orgue. Fourniture de pédale. [LORGUE:1963-1, n°105p36] [IHOA:p78a] [ITOA:3p256] [HOIE:p102] [PMSSTIEHR:p447-52]
Cela illustre le fait que Curt avait trouvé de puissants appuis.
 1962 : Royan (17) Temple
1962 : Royan (17) TempleC'est un orgue néo-classique, sans buffet, placé au sol dans un coin de l'édifice. [LORGUE:1962-1, n°101p25] [Temples]
 1960 : Harskirchen (région de Sarre-Union), Eglise protestante
1960 : Harskirchen (région de Sarre-Union), Eglise protestante
Instrument actuel.
Dans ce magnifique buffet de Johann Georg Geib qui vient de la Hofkirche de Saarbrücken, Curt Schwenkedel posa un curieux instrument néo-classique : sommiers à membranes (Link ?), mais Fourniture 6 rangs au grand-orgue (fondé sur deux 8' seulement) et Sesquialtera au récit expressif. La pédale est dépourvue de 8'. [LORGUE:1962-1, n°101p25] [IHOA:p74a] [ITOA:3p243] [HOIE:p124-5] [PMSLINK:p242-3] [SchwenkedelDO:6p3464-6,3486-8,3514-5] [Barth:p215]
 1962 : Wimmenau (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante
1962 : Wimmenau (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante
Instrument actuel.
Harmonisation à plein-vent, transmission mécanique, sommiers à gravures, buffets "à caissons" (dont un positif de dos), le tout commandé depuis une console en fenêtre : l'orgue néo-baroque a défini son "standard". [LORGUE:1962-1, n°101p25] [IHOA:p221a] [ITOA:4p854] [Barth:p387] [Marienthal1962:p26]
 1962 : Songeons (60)
1962 : Songeons (60)C'est une "reconstruction" (II/P 14+1j), sur la base d'un orgue mi-19ème. [LORGUE:1963-1, n°105p36] [OrguesEnOise:p213-5]
En 1962 furent aussi signalés d'importants travaux à Bordeaux (33) St-Michel (III-41) , Epinal (88) St-Maurice (III-37), Feldkirch, Philippsbourg (67 ?), Le Pissoux (25) (I-10), Schaffhouse? (67), Tournay (65) Abbaye N.D., et une première intervention à Soultz-Haut-Rhin. [LORGUE:1962-1, n°101p25]
1963
 1963 : Mulhouse, Ecole de musique
1963 : Mulhouse, Ecole de musique
Instrument actuel.
Ce petit orgue destiné à l'enseignement fait partie d'une petite série dont on retrouve d'autres exemplaires au collège de Landser (1965) et Triembach-au-Val (1974). La composition (grand-orgue: Bourdon 8', Montre 4', Cymbale 3, positif: Quintaton 8', Doublette, Tierce, pédale: Bourdon 16' étendu en 8') est révélatrice du répertoire enseigné dans les années 60. Et de celui qu'on ne pouvait pas y enseigner... Il est noté "1963" mais semble plus tardif. Noter la Tierce sans Nasard. [LORGUE:1969-4, n°132p179] [IHOA:p120b] [ITOA:2p285]
 1963 : Strasbourg, Eglise protestante du Port du Rhin
1963 : Strasbourg, Eglise protestante du Port du Rhin
Instrument actuel.
C'est un orgue réalisé de façon pragmatique avec des moyens limités et des éléments de récupération. Un instrument pas vraiment significatif sur le plan technique, mais qui vient nous apprendre que Curt Schwenkedel acceptait des missions pas forcément très prestigieuses, où il n'y avait probablement pas grand-chose à gagner. [IHOA:p184b] [ITOA:4p697]
 1963 : Versailles (78) Ecole Ste-Genevève
1963 : Versailles (78) Ecole Ste-GenevèveIl s'agit d'un orgue neuf, (II-27). [LORGUE:1963-1, n°105p36]
 1963 : Amiens (80) St-Jacques
1963 : Amiens (80) St-JacquesC'est un assez grand instrument (III/P 30j), dessiné par Georges Lhôte. [OrguesPicardie] [LORGUE:1963-1, n°105p36]
 1963 : St-Wandrille (76) Abbaye bénédictine (Fontenelle)
1963 : St-Wandrille (76) Abbaye bénédictine (Fontenelle)Il s'agirait d'une réparation ou d'une reconstruction. En 1976 un orgue neuf fut construit par la maison Haerpfer-Hermann. [LORGUE:1963-1, n°105p36]
 1963 : Villeurbanne (69)
1963 : Villeurbanne (69)C'est un petit (II/0P 7j) orgue neuf. [LORGUE:1964-4, n°112p131] [Rhône:IIp342-3]
En 1963 furent aussi signalés d'importants travaux à Mulhouse (Ste-Marie-Auxiliatrice), Aiguillon (Lot-et-Garonne), à la chapelle catholique de l'hôpital de Brumath (Stephansfeld), et à la chapelle protestante de l'hôpital de Rouffach. [LORGUE:1963-1, n°105p36]
 1964 : Strasbourg, Conservatoire Salle de concert
1964 : Strasbourg, Conservatoire Salle de concert
Instrument déménagé à Strasbourg, St-Etienne.
En 2015, l'orgue était toujours enfermé dans l'édifice de la place de la République. C'était un instrument assez extraordinaire. Savoir que depuis toutes ces années, il était toujours là, dans l'ombre, muet fantôme ayant connu les plus grands, laissait songeur, quand on passait par la place arborée de magnolias. Dans le temps, inaccessible car réservé aux grandes auditions, inaccessible ensuite pour des raisons assez incompréhensibles... "Inaccessible" aura été le maître-mot de ce grand Schwenkedel, qui a pourtant suscité pas mal de vocations. Mais, en 2016, le Fantôme des Magnolias est revenu hanter les anciens (mauvais) élèves du Conservatoire ! Pour les Scrooge avares de travail et de technique, il est le symbole de la musique du passé, de la musique d'aujourd'hui, et de la musique de demain, qui toutes réclamment leur dû. Il est effrayant et magnifique à la fois. Celui qui fut si longtemps le vaisseau amiral de l'orgue d'Alsacien est aujourd'hui déployé dans la nef de Strasbourg, St-Etienne... où il a trouvé trouvé son parfait écrin. [IHOA:p184b] [ITOA:4p677-9] [Rupp:p307-8] [Caecilia:1964-4p149]
1964
 1964 : Sentheim (région de Masevaux), Chapelle de la Maison St-Jean
1964 : Sentheim (région de Masevaux), Chapelle de la Maison St-Jean
Instrument actuel.
Un instrument qui ne manque pas d'allure, dans son buffet tout en angles (II/P 8+1j). On trouve dans l'orgue l'inscription : "Harmonisation Laurent Steinmetz janvier 1964". Il y a un Brustwerk, mais il n'est pas expressif (8', 4', 1'). [LORGUE:1964-4, n°112p131] [ITOA:2p417] [IHOA:p173b]
 1964 : Zillisheim (région de Mulhouse), Petite chapelle du Collège épiscopal
1964 : Zillisheim (région de Mulhouse), Petite chapelle du Collège épiscopal
Instrument actuel.
Un Ripieno ! (Plein-jeu de tradition italienne). Quand on lui laissait de la liberté, Curt Schwenkedel savait être inventif et sortir des sentiers battus. Un commentaire, dans les années 80, fut : "Cet orgue se trouve en dehors de toute tradition alsacienne"... Assez désespérant, il faut le reconnaître : comment comptait-on favoriser une vitalité artistique en discréditant toute initiative qui ne consiste pas à "refaire" du Stiehr ou du Callinet ? Heureusement que Curt Schwenkedel préférait l'écoute de Frescobaldi à celle des commentateurs. D'ailleurs, il récidiva à Landser l'année suivante. [LORGUE:1965-4, n°116p177] [IHOA:p227b] [ITOA:2p504]
 1964 : Drusenheim (région de Bischwiller), St-Matthieu
1964 : Drusenheim (région de Bischwiller), St-Matthieu
Instrument actuel.
Cet instrument est représentatif d'une tendance "adoucie" du néo-baroque, autorisant une console indépendante, et un second clavier expressif (avec Unda maris !). Il se distingue de ses contemporains, car... il est beau. Le buffet est orné de claires-voies, mais elles ne sont pas d'origine ; en fait, l'orgue a été embelli par la suite. On y retrouve quand même les "tendances" chères à Curt Schwenkedel dans les années 60 : tuyaux en cuivre et traits "germaniques du nord" : anche douce à la pédale, Sesquialtera au grand-orgue. Et treize rangs de Mixtures. [LORGUE:1964-4, n°112p131] [IHOA:p53a] [ITOA:3p128-9]
 1964 : Rittershoffen (région de Soultz-sous-Forêts), St-Gall
1964 : Rittershoffen (région de Soultz-sous-Forêts), St-Gall
Instrument actuel.
Inauguré le 20/12/1964 par Roger Seiter, cet instrument, particulièrement bien mis en valeur sur place, est entouré d'une "aura" caractéristique des orgues de cette époque, où la musique d'église devint "participative" et où l'orgue alla rejoindre son public. Trompette en chamade et Sesquialtera au grand-orgue, Larigot "2rgs" (i.e. 1'1/3 + Sifflet 1' pour faire "petit Plein-jeu") et Douçaine 16' au récit, Principal italien 4' à la pédale : c'est un instrument caractéristique de l'orgue de Curt Schwenkedel. Espérons qu'il sera conservé en l'état pendant des décennies. [LORGUE:1964-4, n°112p131] [IHOA:p149b] [ITOA:4p530]
 1964 : Strasbourg, Ecole normale protestante
1964 : Strasbourg, Ecole normale protestante
Instrument déménagé à Steinsoultz, St-Nicolas.
Il s'agit d'un orgue de 6 jeux (5 manuels, tous coupés en basses+dessus) et une Soubasse. Quand l'Orgue fut chassé de l'école normale, celui-ci fut d'abord envoyé en 1972 à Guebwiller St-Léger (où se déroulait à l'époque une opération calamiteuse pour notre patrimoine). L'instrument était doté d'un buffet muni de volets. Ayant purgé sa peine à St-Léger, il fut finalement adopté à Steinsoultz, et logé dans le joli buffet rococo de l'orgue Jacque Besançon de Gundolsheim. Un néo-baroque dans un buffet baroque, pourquoi pas... [LORGUE:1964-4, n°112p131] [IHOA:p186b,68b,73a]
 1964 : Nice (06) St-Paul
1964 : Nice (06) St-PaulUn orgue neuf, (II-24) à l'origine, qui passa à III/P 33j (+Zimbelstern) en 1989. [LORGUE:1964-4, n°112p131] [Wakamba]
 1964 : Faverney (70) Séminaire
1964 : Faverney (70) SéminaireC'est un orgue neuf (II-11) fut posé dans le séminaire, qui a fermé en 1967. [LORGUE:1964-4, n°112p131]
 1964 : Bains-sur-Oust (35)
1964 : Bains-sur-Oust (35)Neuf, et de même taille (II-7) que le précédent. [LORGUE:1964-4, n°112p131]
 1964 : Sarralbe (57), maison St-Joseph
1964 : Sarralbe (57), maison St-JosephCet instrument a été inauguré le 25/10/1964. [LORGUE:1964-4, n°112p131] [IOLMO:Mo-Sap1883-4]
 1964 : Neufchâteau (88)
1964 : Neufchâteau (88)A l'église St-Nicolas de Neufchâteau se trouve un instrument originellement construit par Jean Treuillot en 1684. Le buffet, assez extraordinaire, est de Christophe II Jacquin, sculpteur à Neufchâteau. Il y eut plusieurs "restaurations" (on sait ce que cela veut dire), et l'orgue a de plus été endommagé pendant la seconde Guerre mondiale. On demanda à Curt Schwenkedel, de reconstruire l'instrument "dans l'esprit néo-baroque". Inauguré le 11/10/1964 par Gaston Litaize qui le qualifia de "l'un, pour ne pas dire le plus réussi du département des Vosges", l'instrument "fit un carton". Il faut dire qu'avec des claviers de 53 notes (CD-f''', donc sans Do# grave), 26 jeux dont deux Cymbales, une Fourniture de pédale, le Larigot de rigueur, une traction des notes et des jeux mécaniques, et l'harmonisation par Laurent Steinmetz en plein-vent, il avait tout pour faire tomber en pâmoison tous les commentateurs de l'époque. [LORGUE:1964-4, n°112p131] [http://patrimoine90.com] [OrguesVosges] [IOLVO:p419-24]
 1964 : Bordeaux (33) St-Augustin
1964 : Bordeaux (33) St-AugustinC'était un orgue neuf, de 13 jeux réels et deux extensions, à traction électrique, placé en tribune au fond de la nef. Il a été cannibalisé en 1979 au profit de l'orgue de choeur (Pesce, Pau) pour construire "un instrument d'esthétique allemande beaucoup plus important", dans un "buffet dans l'esprit des orgues nordiques". Le tout doté sagement de deux Cymbales (au cas où l'une des deux tomberait en panne ; et en un tel cas de "faute double", le Brustwerk était toujours muni d'une Quinte 1'1/3 et d'un Sifflet). Il a été finalement remplacé en 1994, car, aussi incroyable que cela puisse paraître, il avait été déclaré dans un "état déplorable" vers 1992. C'est sûrement mieux ainsi. Le résultat final fut (évidemment), un orgue "Allemagne du Nord 17ème" de plus. [LORGUE:1965-4, n°116p177] [OrguesAquitaine] [IOAQU:2p74-5]
 1964 : 3 orgues d'étude
1964 : 3 orgues d'étudeAprès avoir (re-)construit le plus réussi des orgues des Vosges, la maison Schwenkedel réalisa trois orgues d'études. [LORGUE:1964-4, n°112p131]
Enfin, de 1964 datent d'importants travaux à Fréland, Schnersheim, Steinbach et St-Pierre-Bois. [LORGUE:1964-4, n°112p131]
1965
 1965 : Scheibenhard (région de Lauterbourg), St-Georges
1965 : Scheibenhard (région de Lauterbourg), St-Georges
Instrument actuel.
Dans son buffet à caissons "avec grands chanfreins", l'instrument ne manque pas d'allure, surtout après l'ère de buffets "option zéro". L'orgue Stiehr du lieu (1866) avait été détruit par faits de guerre en 1940, et l'église reconstruite en 1962. Larigot 2 rangs dans un Brustwerk expressif. [LORGUE:1965-4, n°116p177] [IHOA:p166a] [ITOA:4p594]
A l'époque, on accompagnait généralement l'installation de ces instruments d'un discours "Allemagne du nord". Ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, on disait que ces orgues étaient "im französischen Barock-Stil" ("dans le style baroque français").
 1965 : Landser (région de Sierentz), Collège
1965 : Landser (région de Sierentz), Collège
Instrument actuel.
Dans la série initiée à l'école de musique de Mulhouse,c'est un peu le jumeau de celui de la petite chapelle du Collège épiscopal de Zillisheim (1964). C'est donc ici la version "Ripieno". La série s'achèvera à Triembach-au-Val (1974). [LORGUE:1965-4, n°116p177] [IHOA:p98b] [ITOA:2p205]
 1965 : Paris (75) Orgue de salon
1965 : Paris (75) Orgue de salonC'est peut-être celui qui est allé à Nice, St-Paul, comme orgue de choeur (II/P 11+3j). [LORGUE:1965-4, n°116p177] [Wakamba]
 1965 : Le Saulchoir-Etiolles (91) Frères Prêcheurs
1965 : Le Saulchoir-Etiolles (91) Frères PrêcheursUn orgue neuf de 8 jeux. [LORGUE:1965-4, n°116p177]
 1965 : Palaiseau (91) Temple
1965 : Palaiseau (91) TempleUn orgue neuf de 8 jeux. [LORGUE:1965-4, n°116p177] [http://temples.free.fr]
En 1965, il y eut plusieurs orgues de salon : pour Colmar (68) (II-4), Paris (75) (deux de II-4) et Avolseim (67) (II-4). D'importants travaux ont été réalisés à Crastatt (et en firent un orgue particulièrement réussi). [LORGUE:1965-4, n°116p177]
1966
 1966 : Sigolsheim (région de Kaysersberg), Sts-Pierre-et-Paul
1966 : Sigolsheim (région de Kaysersberg), Sts-Pierre-et-Paul
Instrument actuel.
Cette localité fut vraiment marquée par l'Histoire, et le l'orgue actuel est une belle preuve de résilience : là où la guerre a tout détruit, on a su reconstruire, sûrement un peu pour refuser que revienne un Noël comme celui de 1944. L'édifice est doté d'une ambiance peu commune, et cet instrument néo-baroque avec sa sévère façade en cuivre y est particulièrement adapté. On est à coup sûr plus près de Nuremberg que de Mayerling... [LORGUE:1965-4, n°116p177] [IHOA:p174b] [ITOA:2p422-3]
 1966 : Ribeauvillé, Couvent de la Providence
1966 : Ribeauvillé, Couvent de la Providence
Instrument actuel.
En 1966 périt ce qui fut probablement l'un des plus beaux orgues d'Alsace. L'Opus 100 de Martin et Joseph Rinckenbach, le "Jubiläumsorgel der Firma" commandé en 1905 fut reçu le 02/05/1907. Ce devait être un instrument magnifique, et il a fait l'objet de toutes les attentions de la maison d'Ammerschwihr : la console en bois sculpté - une vraie splendeur - était tournée vers la nef, et le buffet néo-gothique à couper le souffle avait été fourni par le célèbre Théophile Klem de Colmar. Après les chamboulements de 1966 en est sorti un orgue pas vraiment mauvais, mais qui, affublé des marottes "nordiques" des années 60 (Sesquialtera, Rauschpfeife, Mixture 5-7 rangs rien qu'au grand-orgue, le reste à l'avenant) ne peut que faire regretter amèrement le précédent. La vilaine console avec ses airs d'orgue électronique américain donne froid dans le dos quand on a vu à quoi ressemblait celle de l'opus 100. Quant au buffet de Klem, il a été conservé, mais "néo-renaissancisé". Sûrement la page la plus noire de la maison Schwenkedel. On ne peut vraiment que souhaiter qu'un jour l'opus 100 de Rinckenbach soit restauré. [LORGUE:1966-4, n°120p157] [IHOA:p147b] [ITOA:2p356-7] [LR1907:p150-1]
 1966 : Toul (54) Cathédrale
1966 : Toul (54) CathédraleToul, dans le coeur de nombreux organistes de l'est de la France, c'est avant tout la tribune de Joseph Oury (1852-1949), qui y tint les orgues Dupont/Blési pendant 62 ans, jusqu'à leur totale destruction, le 20 juin 1940. L'instrument était logé dans ce qui était probablement un des plus beaux buffets de France, et, pour Oury, il était irremplaçable. Curt Schwenkedel travailla avec Philippe Hartmann à l'orgue de choeur, puis obtint le marché pour construire un grand orgue de tribune en mai 1960. Mais, pour le placer en tribune, il fallut attendre que cette dernière fut construite. L'orgue Schwenkedel a été inauguré par Gaston Litaize le 23/06/1963. Le buffet a été dessiné par Georges Lhôte. Quatre manuels et 60 jeux en mécanique, à l'époque, seul un petit nombre de (très) grands facteurs savaient le faire. Ce fut un tour de force technique. Il a été relevé en 2002 par Jean-Baptiste Gaupillat. [SiteJBG] [LORGUE:Avril 1966, n118p62-5] [IOLMM:p410-20]
 1966 : Etretat (76)
1966 : Etretat (76)C'est un orgue de 14 jeux. [LORGUE:1966-4, n°120p157] [http://orgues-normandie.com/]
 1966 : Novel (74) St-Louis
1966 : Novel (74) St-LouisC'est un instrument plutôt important, à 3 manuels et 26 jeux. Il est pour partie peint en rouge, et muni d'un "Fernwerk de dos" (lire : un positif de dos placé très loin de la console). [MGabriel] [LORGUE:1966-4, n°120p157]
 1966 : Colmar (68)
1966 : Colmar (68)Un orgue d'étude assez conséquent (7 jeux), doté de 3 manuels. [LORGUE:1966-4, n°120p157]
 1966 : Les Fins (25)
1966 : Les Fins (25)Cet orgue (II/P 13j) a la particularité d'avoir son grand-orgue en balustrade, et un récit expressif. (Et muni d'une Trompette !) [LORGUE:1968-1, n°125p40] [http://www.orgues-et-vitraux.ch]
 Les Fins. Curt Schwenkedel, 1966.
Les Fins. Curt Schwenkedel, 1966.Photo de C.-A. Schleppy
1967
 1967 : Kindwiller (région de Niederbronn-les-Bains), St-Laurent
1967 : Kindwiller (région de Niederbronn-les-Bains), St-Laurent
Instrument actuel.
Cet instrument plutôt original, a remplacé en 1967, l'orgue Martin Rinckenbach du lieu, qui avait été détruit le 02/02/1945. Ce qu'il a de remarquable, c'est son buffet, triangulaire et muni d'une Trompette en Chamade en cuivre. La composition, de taille limitée (II/P 9+1j) ne permet pas beaucoup de fantaisies, mais le second clavier, tout simplement un écho constitué d'un Cornet 5 rangs dont le 8' est décomposable, et enrichit considérablement le répertoire. [LORGUE:1968-1, n°125p40] [LR1907:p83] [IHOA:p91b] [ITOA:3p305]
 1967 : Strasbourg, St-Jean
1967 : Strasbourg, St-Jean
Instrument actuel.
Un des plus grands orgues de Strasbourg (4 manuels), et probablement le plus impressionnant par son ambiance et ses possibilités. Depuis la nef, son austère buffet ne lui rend pas service, loin s'en faut. Le néo-baroque, lorsqu'il croise sur son chemin une dose de poésie, produit de belles choses. Rappelons que là aussi, c'est la guerre qui avait détruit l'instrument précédent. Curt Schwenkedel a pu s'exprimer sans contrainte, et réaliser un instrument rendant vraiment hommage à la tribune du grand Marie-Joseph Erb, qui a officié à St-Jean pendant 58 ans. [LORGUE:1966-4, n°120p157] [IHOA:p189b-189a] [ITOA:4p695-6] [LORGUE:138p46-9] [PMSAEA85:p231-2] [PMSCS72:p23-4] [CMAVS98:p108-12] [ArchSilb:p513-4] [Rupp:p333-4] [Mathias:p34] [Barth:p355,434b-435a]
 1967 : Wasserbourg (région de Munster), St-Michel
1967 : Wasserbourg (région de Munster), St-Michel
Instrument actuel.
Cet instrument a été reconstruit, sur la base d'un Valentin Rinkenbach, pour être doté de deux manuels. "Sur le papier", rien de bien enthousiasmant, mais sur place, quelle belle surprise ! On y découvre un instrument cohérent, robuste, et surtout d'une étonnante qualité musicale. Surement plus libre qu'à l'habitude, Curt Schwenkedel put exprimer son génie... loin des media. [LORGUE:1968-1, n°125p40] [IHOA:p217a] [ITOA:2p473] [PMSRHW:p28] [Barth:p379]
 1967 : Paris (75)
1967 : Paris (75)C'est un orgue d'enseignement plutôt conséquent (III-21), conçu par Jean Langlais et Gaston Litaize et construit pour l'association Valentin Haüy. L'Institution des jeunes aveugles avait ouvert une classe d'orgue dès 1826. Mais dans les années 2010, les choses ont bien changé... la fondation voulut se débarrasser de son orgue. [LORGUE:1968-1, n°125p40]
Il a été installé à la cathédrale de Créteil, où, malgré l'ampleur du projet, on a donc jugé qu'un orgue d'occasion était bien suffisant ! C'est bien révélateur de l'intérêt minimal porté à l'orgue par ceux même qui devraient aujourd'hui être ses plus grands soutiens. Un orgue neuf pour Créteil (où on se flatte de promouvoir l'art contemporain) eut au moins donné du vrai travail à un facteur, et montré ce que sait faire l'époque contemporaine, plutôt que de "récupérer" un orgue des années 60 qui fait vraiment "ringard" dans ce contexte. Espérons que l'on trouvera à l'avenir un peu plus d'ambition pour l'orgue de Créteil. [94Citoyens]
 1967 : Enchenberg (57)
1967 : Enchenberg (57)C'est un orgue pratiquement neuf, mais réutilisant des éléments Verschneider-Krempf. [LORGUE:1968-1, n°125p40]
L'orgue 1868 a été condamné car son (magnifique) buffet néo-gothique allait masquer un vitrail tout neuf destiné à la rosace... Comme il avait été endommagé par la guerre, on sauta sur le prétexte et on le déclara évidemment "détruit". L'exemple type des erreurs commises dans les années 1960, et, qui, à la longue, font détester le "néo-baroque", non pas pour ce qu'il est, mais pour les dégâts qu'il a infligés au patrimoine. Résultat : la belle église d'Enchenberg (pour laquelle un Verschneider était l'orgue idéal) est affublée d'un lourd, "moderne", et anguleux assemblage de chêne et de contreplaqué, aux proportions fort disgracieuses (on dirait qu'il a été écrasé...). A la lecture de la belle composition d'avant le désastre, on se dit qu'il y a dû y avoir beaucoup d'oreilles fort surprises par la Sesquialtera et la Cymbale de bataille (1/2', 3 rangs, 6 reprises). Onze rangs de Principaux, et un seul de 8'. Il est probable qu'à l'époque, beaucoup ont fait semblant d'être contents. Aux autres, on a dû expliquer un truc au sujet de l'esthétique "Nordique germanique du nord de l'Allemagne au 17ème"... comme d'habitude. [IOLMO:p479-82]
 1967 : Solesmes (72)
1967 : Solesmes (72)Evidemment la "grande affaire" des années 60 : remplacer le Gonzalez de 1934. On ne reviendra pas dessus ici, mais l'instrument figura longtemps sur les publicités de Schwenkedel. [LORGUE:1968-1, n°125p40]
 1967 : Marseille (13)
1967 : Marseille (13)Il s'agissait d'un orgue de 7 jeux, neuf, destiné à la maison de l'Oeuvre de Jeunesse 'Les Iris' (OJJA). Dès 1973, il a été déménagé à Saint-Cassien par René Rénevier. [LORGUE:1968-1, n°125p40] [OpenPaca]
 1967 : Varennes-sur-Allier (3)
1967 : Varennes-sur-Allier (3)Un orgue neuf de 12 jeux pour la maison provinciale des Frères Maristes. "En 1948, épris de bel canto, Fr. Robert Guglielmetti et Fr. Grivel lancent une chorale. [...] avec l'appui d'un bel harmonium de 22 jeux et 2 claviers, acheté aux Pères Trappistes de Sept-Fons. Bien entraîné, le groupe de choristes - chemise blanche, cravate bleue - se produit à la cathédrale de Moulins, au théâtre de Vichy, avec "A Coeur Joie" de César Geoffray. Un harmonium, c’est bien, mais... on peut toujours rêver ! Les Frères anciens combattants offrent spontanément leur retraite pour financer l’achat d’un orgue. Fr. Hilaire Détraz, Provincial, s'adresse, en 1964, à la maison Schwenkedel de Strasbourg... L'éxécution du projet demande du temps. En octobre 1967 est inauguré un orgue de 8 jeux, complété en 1970 par 4 jeux supplémentaires." [LORGUE:1968-1, n°125p40] [PresenceMariste]
Une histoire autrement plus enthousiasmante que ce qui se pratique actuellement dans certaines cathédrales...
 1967 : Villeneuve-lès-Béziers (34)
1967 : Villeneuve-lès-Béziers (34)Cet orgue de 25 jeux fut le premier instrument harmonisé par Jean-Marie Tricoteaux. [LORGUE:1968-1, n°125p40] [JMTricoteaux]
 1967 : Delle (90)
1967 : Delle (90)Cet orgue remplaçait un Merklin-Schütze de 1862 condamné car on avait décidé de démolir sa tribune. Le Schwenkedel fut inauguré 17/12/1967 par Georges Robert. Son buffet est pratiquement identique à celui de Scheibenhard, mais dispose d'une chamade en cuivre (en cas de conflit). A Delle, le "hard-néobarock" lassa rapidement : l'instrument dispose aujourd'hui de 21 jeux assagis : Antoine Bois l'a complété, restructuré (12 jeux modifiés) et réharmonisé dans les années 1990. [LORGUE:1968-1, n°125p40] [http://www.orgalie.com/] [http://patrimoine90.com/]
 1967 : Still (67)
1967 : Still (67)Il y eut des travaux sur le curieux orgue Georges Schwenkedel de l'institut des aveugles. L'instrument est aujourd'hui à Bellange (près de Château-Salins). [LORGUE:1968-1, n°125p40]
Et de 1967 datent aussi plusieurs orgues de salon : pour Haguenau (67) (II-4), Roanne (42) (II-4) ainsi que 6 orgues d'études (II-1). Des réparations ont été effectuées à Guebwiller, Notre-Dame. [LORGUE:1968-1, n°125p40]
 Delle. Curt Schwenkedel, 1967.
Delle. Curt Schwenkedel, 1967.Photo de C.-A. Schleppy
1968
 1968 : Artzenheim (région d'Andolsheim), St-Jacques-Majeur
1968 : Artzenheim (région d'Andolsheim), St-Jacques-Majeur
Instrument actuel.
Comme on l'a déjà vu à Drusenheim ou Rittershoffen, le style néo-baroque revient parfois un peu à ses origines néo-classiques : le second clavier est expressif, et abrite parfois même une Unda maris et une Trompette de récit. En contrepartie, et pour ne pas s'attirer les foudres des théoriciens de "l'orgue nordique", on remplissait ce qui reste de la boîte expressive avec de petits jeux (Sesquialtera, Doublette, Cymbale) et une Ranquette 16'. Et on pouvait ajouter, comme ici, une "Rauschpfeiffe" 3 rangs à la pédale. Mais la recette était bonne, et peut donner des orgues fort sympathiques. Intègre, cohérent et authentique, l'orgue d'Artzenheim est un témoin d'une grande valeur d'une époque enthousiaste. Son buffet, malgré le style "minimaliste" de rigueur pour la boiserie, est très réussi. De plus, il n'a pas son prédécesseur sur la conscience (Claude-Ignace Callinet / Joseph Rinckenbach) puisque qu'il avait (vraiment) été détruit en 1945 (et l'église n'a pu être restaurée qu'en 1951). [LORGUE:1968-1, n°125p40] [IHOA:p27b] [ITOA:2p10]
 1968 : Muespach-le-Haut (région de Ferrette), St-Georges
1968 : Muespach-le-Haut (région de Ferrette), St-Georges
Instrument actuel.
Les années 1960 se distinguaient par une "approche pragmatique" du patrimoine. Il y avait là-bas un joli buffet 19ème, contenant un orgue disposant d'un Salicional, d'une Gambe et d'une Aéoline. La partie instrumentale fut impitoyablement démolie, mais pour le buffet, on eut probablement quelques scrupules, et on décida de le garder. Quand on découvrit qu'il fallait une console à l'orgue néo-baroque, pas de problème : on affubla le joli buffet d'une épouvantable console frontale, de pur style "meuble de cuisine des années 1960", avec des claviers noirs (pour faire 18ème ?). Ce magnifique buffet mériterait vraiment une partie instrumentale en cohérence. [LORGUE:1968-4, n°128p178] [IHOA:p117a] [ITOA:2p254]
 1968 : Seltz, St-Etienne
1968 : Seltz, St-Etienne
Instrument actuel.
Seltz, c'est le pays de la maison Stiehr-Mockers, donc un des "pôles" alsaciens de la facture d'orgues, comme Ammerschwihr ou Rouffach. Mais si à Ammerschwihr, il y a bien un Rinckenbach, et à Rouffach un Callinet, il n'y a plus de Stiehr à Seltz. Bien sûr, il y en avait un dans le temps : il datait de 1837, mais a brûlé avec l'église gothique le 28/05/1940 lors d'un duel d'artillerie. Reconstruire un orgue à Seltz était donc une grande responsabilité confiée à Curt Schwenkedel. Il avait déjà fourni un orgue provisoire en 1945, constitué du buffet de l'ancien orgue de Bischmisheim (D, près de Saarbrücken), d'un sommiers à gravures de récupération, et de 5 jeux. L'orgue de 1968, avec ses tourelles de pédale "nordiques", son "Werkprinzip" (la structure du buffet respecte l'agencement intérieur) revendique haut et fort - tant qu'à faire - toutes les caractéristiques de son époque. Pas d' "historicisme". Le message est clair : on n'a pas cherché à reconstruire, mais à tourner la page. Mais, et c'est heureux, on s'orienta vers la version "néo-baroque adouci" dotée d'un Brustwerk expressif avec Unda maris, Trompette et Douçaine. Schwenkedel fut à la hauteur du défi, et Seltz peut continuer à être très fière de ses orgues. [LORGUE:1968-4, n°128p178] [IHOA:p172a] [ITOA:4p629]
 1968 : La Montagne-Verte (région de Strasbourg), Sacré-Coeur
1968 : La Montagne-Verte (région de Strasbourg), Sacré-Coeur
Instrument actuel.
Si a Seltz, Schwenkedel pratiqua un néo-baroque "adouci" par un Brustwerk expressif, à la Montagne-Verte, on opta pour la version "pointue" : positif de dos avec Sesquialtera et Larigot 2 rangs. La pédale, avec ses anches "Allemagne du nord" emporte 5 jeux sur 16. L'harmonisation, évidemment "à plein vent", fut elle aussi sans compromis. Mais il y a une console indépendante, preuve qu'on ne voulait pas "faire du 18ème" et que ce néo-baroque "pointu" est bien un style en soi. [LORGUE:1968-4, n°128p178] [IHOA:p192b,192a] [ITOA:4p715] [LORGUE:128p188,178]
 vers 1965 : Lille, Dominicains
vers 1965 : Lille, DominicainsOn peut ici parler de l'orgue construit pour les Dominicains de Lille, presque jumeau de celui du conservatoire de Mulhouse (II/P 7+1j). A l'origine, l'instrument n'avait pas de Principal 8' (B8, P4, PJ 3 rgs ; B8 Quintaton 4', Sifflet ; S16 et B8 en extension). Bernard Cogez y a apporté des modifications révélatrices : Montre 8' à la place de la Flûte à cheminée du 1er clavier (octave grave en Bourdon), Doublette à la place du Sifflet, et Plein-jeu passant de 3 à 2-3 rangs. [Lilorg]
 1968 : St-Donat (26)
1968 : St-Donat (26)C'était l'orgue du Centre Musical International Jean-Sébastien Bach. Il a été complété en 1971 (III/P 35j). C'est aujourd'hui l'instrument utilisé pour le festival "Bach en Drôme des collines". L'instrument est un "néo-baroque" fortement spécialisé 18ème (avec tourelles de pédale et positif de dos ; Sesquialtera et grand Cornet). Deux Cymbales, deux Quintes 1'1/3, et une Mixture de pédale qui côtoie des anches douces Fagott/Dulzian/Chalumeau. Le Brustwerk est expressif. Parrainé par Marie-Claire Alain (qui l'a fait un peu "assagir" en 1999), c'est évidemment une "figure" de l'orgue en Rhône-Alpes. [OrguesRA] [LORGUE:1968-4, n°128p178] [LORGUE:1971-4, n°140p200]
 1968 : Paris (75) Orchestre Kuentz
1968 : Paris (75) Orchestre KuentzUn petit orgue (I/0P 4j) pour l'orchestre Kuentz. [LORGUE:1968-4, n°128p178]
 1968 : Port-Marly (78)
1968 : Port-Marly (78)Il s'agissait de reconstruire un orgue Didier Lorrain (1903). C'est donc un néo-classique néo-baroquisé. [LORGUE:1968-4, n°128p178]
 1968 : Paris (75) St-Eloi
1968 : Paris (75) St-EloiDans un édifice de style "industriel" combinant poutrelles métalliques et tôle ondulée fut posé un orgue (II/P 15+8j) avec Sesquialtera, Cymbale, mais aussi Quintaton (pour fonder le grand-orgue) et Gambe. Le second clavier est expressif. [LORGUE:1969-4, n°132p179] [http://www.patrimoine-histoire.fr/]
 1968 : Tokyo (JP)
1968 : Tokyo (JP)Il fut un temps où fournir un orgue pour le Japon était un must (les autres facteurs majeurs sont passés par là). Et puis, cela faisait plaisir aux édiles, quand on déclarait avec solennité et un grand geste que l'on exportait des orgues "jusqu'au Japon". L'instrument, lui, n'était pas très grand (II-18). [LORGUE:1969-4, n°132p179]
En 1968 furent aussi signalés des travaux à Breitenau, Fouchy, Montbéliard (25), Luçon (85) (Cathédrale), Chenne-Vières-sur-Marne (94), Gresswiller et Durmenach (ces deux dernières, comme celle de Fouchy, furent assez malheureuses). [LORGUE:1968-4, n°128p178] [LORGUE:1969-4, n°132p179]
1969
 1969 : Pfastatt (région de Wittenheim), Eglise évangélique mennonite
1969 : Pfastatt (région de Wittenheim), Eglise évangélique mennonite
Instrument actuel.
Inauguré le 09/11/1969 , c'est un néo-baroque "assagi" avec Brustwerk expressif abritant une Unda maris et une Trompette. Pour le buffet, on retrouve un style analogue à Hilsenheim ou Rittershoffen, église protestante que l'on vit apparaître en 1961 à Illhaeusern. Les caissons ont succédé aux simples alignements de tuyaux disposés sur un soubassement, comme cela se faisait dans les années 1950. La transition s'était faite à l'opus 157 de Schwenkedel, à Bischholtz (1959). [LORGUE:1969-4, n°132p179] [IHOA:p141a]
 1970 : Neudorf (région de Strasbourg), Clinique Ste-Odile
1970 : Neudorf (région de Strasbourg), Clinique Ste-Odile
Instrument actuel.
Encore un petit néo-baroque "pointu", sans concession, dans un buffet rectangulaire minimaliste. Il est issu de la série commencée à l'école de musique de Mulhouse, et que l'on retrouve à la petite chapelle du Collège épiscopal de Zillisheim (1964), au collège de Landser (1965), ou à Triembach-au-Val (1974). [LORGUE:1970-4, n°136p204-5] [IHOA:p194a] [ITOA:4p722]
 1969 : St-Florentin (89)
1969 : St-Florentin (89)[LORGUE:1969-4, n°132p179]Un orgue neuf (II-20). [http://www.saint-florentin.fr]
 1969 : Diessenhoffen (CH) Eglise protestante
1969 : Diessenhoffen (CH) Eglise protestanteUn grand orgue neuf (III-34). [LORGUE:1970-4, n°136p204-5]
 1969 : Belfort (90) St-Christophe
1969 : Belfort (90) St-ChristopheDe 1969 date l'agrandissement de l'orgue de Belfort. [LORGUE:1970-4, n°136p204-5] [FChapelet]
 1970 : Soultz-Haut-Rhin, St-Maurice
1970 : Soultz-Haut-Rhin, St-Maurice
Instrument actuel.
Partie instrumentale classée Monument Historique (1991).
Et c'est aussi en 1969 que Schwenkedel effectua une autre tranche de modifications de l'orgue de Soultz-Haut-Rhin. [LORGUE:1970-4, n°136p204-5]
 1969 : Epauvillers (CH)
1969 : Epauvillers (CH)Il y eut aussi des travaux en Suisse, qui fournit donc pas mal de travail à Schwenkedel en 1969. Et ce malgré la concurrence : sa notoriété était bonne. [LORGUE:1970-4, n°136p204-5]
1970
 1970 : Breitenbach (région de Villé), St-Gall
1970 : Breitenbach (région de Villé), St-Gall
Instrument actuel.
Cet instrument, impressionnant et très réussi, est aussi très "typé". Il est venu remplacer un petit orgue Voit post-romantique de 6 jeux. Le changement fut donc... radical. [LORGUE:1970-4, n°136p204-5] [IHOA:p42b] [ITOA:3p82] [PMSDBO1973:p121-6] [Barth:p106,164]
1971
 1971 : Marienthal (région de Haguenau), Marienthal Salle Léon IX
1971 : Marienthal (région de Haguenau), Marienthal Salle Léon IX
Instrument actuel.
Ce petit instrument est issu d'un concept original, qui sera repris à Walbourg : le buffet se décompose en tiers : en bas le soubassement, renfermant le soufflet et le ventilateur, au milieu l'étage du sommier, en haut la tuyauterie. Cette dernière se dévoile grâce à des portes s'ouvrant en accordéon. A noter, le double accouplement II/I et I/II. C'est dû au fait que le premier clavier... n'a pas de 8' ! [LORGUE:1971-4, n°140p200] [IHOA:p108a] [ITOA:3p239]
 1971 : Strasbourg, Cité de la Musique Salle 3-24
1971 : Strasbourg, Cité de la Musique Salle 3-24
Instrument actuel.
Le second Schwenkedel du conservatoire de la place de la République était évidemment beaucoup plus petit (II/P 9j) que celui de la salle de concert . Il est aujourd'hui installé à la Cité de la Musique de Strasbourg. Il fait partie de la série commencée à l'école de musique de Mulhouse, et que l'on retrouve à la petite chapelle du Collège épiscopal de Zillisheim (1964), au collège de Landser (1965), à la clinique Ste-Odile de Neudorf ou à Triembach-au-Val (1974). [LORGUE:1969-4, n°132p179] [OrguesJP] [IHOA:p184b] [ITOA:4p680]
 1971 : Paris (75) St-Thomas d'Aquin
1971 : Paris (75) St-Thomas d'AquinC'est la reconstruction du Clicquot. [LORGUE:1971-4, n°140p200] [FChapelet]
 1971 : Herrlisheim (région de Bischwiller), St-Arbogast
1971 : Herrlisheim (région de Bischwiller), St-Arbogast
Instrument actuel.
C'est un autre représentant de la belle lignée Drusenheim / Rittershoffen / Artzenheim. Ici, le grand-orgue est doté d'une Mixture 4-6 rangs et d'une Trompette en chamade. Le Brustwerk est expressif, mais ne contient que des jeux "baroques français", dont un Cromorne et un Larigot 2 rangs (1'1/3 + 1'). La dotation "nordique" apparaît surtout à la pédale, avec pédale avec une Rauschpfeife 3 rangs et une Douçaine. [LORGUE:1971-4, n°140p200] [IHOA:p76b] [ITOA:3p254]
1972
 1972 : Walbourg (région de Woerth), Oratoire du séminaire
1972 : Walbourg (région de Woerth), Oratoire du séminaire
Instrument actuel.
Ce petit orgue pour l'oratoire de Walbourg est presque jumeau de celui de la salle Léon IX à Marienthal. Il y a 2 manuels malgré le nombre limité de jeux (le second avec un dessus de Bourdon - la basse est empruntée au premier et... une Ranquette 16' coupée en Basse+Dessus). Une tirasse en 4' (II/P 4') permet de jouer la Ranquette en 8'. [LORGUE:1971-4, n°140p200] [IHOA:p213b] [ITOA:4p815]
1973
 1973 : Masevaux, St-Martin Choeur
1973 : Masevaux, St-Martin Choeur
Instrument actuel.
L'orgue de choeur de Masevaux est l'un des plus réussis des instruments alsaciens de la seconde moitié du 20 ème siècle. C'est un "grand" orgue de choeur, puisqu'il est muni d'un positif de dos (il est logé sur sa propre tribune, bâtie contre le mur gauche du choeur. En 1973, on commençait enfin à se préoccuper du fait que les orgues manquaient cruellement de fondamentales. Aussi, le grand-orgue de cet instrument a été muni, dans les aigus, d'une Montre 8' double. Il est vrai qu'elle doit supporter une Mixture 4 à 6 rangs. L'instrument délivre une polyphonie extrêmement lisible, et ses performances dans les pièces contrapuntiques sont exceptionnelles. [IHOA:p109a] [ITOA:2p234]
 1973 : Fort-Louis (région de Bischwiller), St-Louis
1973 : Fort-Louis (région de Bischwiller), St-Louis
Instrument actuel.
L'instrument ne manque pas d'allure, mais il illustre bien la dérive des théoriciens de l'époque, que l'on a beaucoup de mal à suivre aujourd'hui : deux Bourdons de 8' servent de fondamentale pour 10 jeux... Pas de Principal ni de Flûte en 8', et le seul 16' est bien sûr la Soubasse de pédale. Le Wyrmberg n'est pas loin... [IHOA:p61a] [ITOA:4p896]
 1973 : Paris (75) Annonciation (Passy)
1973 : Paris (75) Annonciation (Passy)Un instrument plutôt important (III/P 27+2j). Buffet à caissons en tulipe, positif de dos, et récit expressif. [Temples]
 1973 : Urt (64) Abbaye Notre-Dame de Belloc
1973 : Urt (64) Abbaye Notre-Dame de BellocCet instrument, doté d'une Régale en chamade n'a pas de clavier expressif, et abrite deux Cymbales et la Sesquialtera de rigueur. Mais pas de Principal 8'. C'est donc du néo-baroque "pointu" et sans concession. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été réharmonisé en 2014 par Bertrand Cattiaux et Jean-Marie Tricoteaux. L'inauguration a eu lieu le 15/02/2015 par Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim, Franck Besingrand et soeur Marie-Véronique Ruyssen. Un orgue plutôt chanceux et bien entouré, donc ! [OrguesAquitaine]
1974
 1974 : Triembach-au-Val (région de Villé), St-Christophe
1974 : Triembach-au-Val (région de Villé), St-Christophe
Instrument actuel.
Rien de bien original, puisqu'on avait déjà vu ce modèle à plusieurs reprises. [IHOA:p206b] [ITOA:4p791] [SchwenkedelNB:1946-1953p4532-3,4543] [PMSSTIEHR:p344] [Barth:p367] [Mathias:p54]
 1974 : Cathédrale de Boulogne-sur-Mer (62)
1974 : Cathédrale de Boulogne-sur-Mer (62)De 1970 à 1974 fut construit un autre Schwenkedel célèbre, celui de la cathédrale de Boulogne. Il avait deux manuels à l'origine. En 1975, il a été monté par Gerd Mayer et harmonisé par Jean-Marie Tricoteaux, puis inauguré par Philippe Lefebvre. Il a été muni d'un troisième manuel en 1992 par Bernard Aubertin (on y trouve un Suavial 8'). [Cicchero:p232]
1975
 1975 : Colmar, Collégiale St-Martin Choeur
1975 : Colmar, Collégiale St-Martin Choeur
Instrument actuel.
Le "chant du cygne" fut ce bel orgue de choeur. On peut se demander pourquoi, face à un orgue de tribune "idéal pour le répertoire d'Allemagne du Nord des 17ème et 18ème siècles" on ressentit le besoin d'avoir un orgue de choeur "idéal pour le répertoire d'Allemagne du Nord des 17ème et 18ème siècles". La réponse tient dans la date de construction : les années 70 souffraient d'un tel intégrisme que "faire autre chose" était tout simplement impensable. C'est dommage, car on devine que Curt Schwenkedel était capable de prodiges dans toutes sortes de styles. L'orgue de tribune, on le sait, causa la destruction d'un des plus beaux instruments d'Alsace (pour un instrument certes prestigieux et réussi, mais dont il existe des dizaines de semblables, alors que le précédent était une pièce unique et irremplaçable). Cet orgue de choeur n'a pas de prédécesseur sur la conscience, mais une "aura" vraiment inimitable. La maison Schwenkedel a donc fini en toute beauté. [Vogeleis:p781] [IHOA:p49a] [ITOA:2p74-5] [ColmarStMartin1979:pC4]
Style et façon
L'ombre de Marcussen ?
Un personnage marquant pour l'Orgue entre 1945 et 1970 est Sybrand Zachariassen (1900-1960). Ce facteur visionnaire poussa Marcussen & Søn vers le néo-baroque avec un talent et un succès époustouflants. Du coup, l'Europe entière décida de se Schnitgeriser à marche forcée. Mais, à n'en point douter, et malgré tout le baratin "Allemagne du nord 17ème-18ème" (servi à toutes les sauces pendant 40 ou 50 ans), c'était bien de Marcussen neufs que rêvait le monde de l'Orgue des années 60-80. On voulait du "Werkprinzip", des plans sonores parfaitement découpés et des attaques au rasoir.
Mais pour Curt, une autre inspiration évidente - puisqu'il y a été formé en partie - fut Metzler.
Des orgues d'interprètes-professeurs
L'orgue rêvé de la période néo-baroque n'est absolument pas une reconstruction d'instruments "classiques nordiques". Il est encore moins réellement "historique" (au service duquel se met son organiste ; et pas le contraire, ce qui est ici l'objectif). D'ailleurs, les vrais orgues nordiques du 17ème servaient essentiellement à accompagner le chant et à improviser sur les Psaumes. Ce n'étaient pas des orgues de répertoire. Le néo-baroque est donc bien loin de vouloir rejoindre son prétendu modèle, car il est clairement un orgue optimisé pour un répertoire. Neuf, "moderne", fiable, il est conçu pour et par des organistes "leaders", afin d'être entièrement à leur service, valoriser leur jeu et permettre à leur virtuosité de s'exprimer.
Il s'agissait aussi de disposer d'orgues permettant un enseignement axé sur l'interprétation de compositeurs tels que Heinrich Scheidemann, Samuel Scheidt ou d'autres disciples de Jan Pieterszoon Sweelinck. Il en résulte une "spécialisation" extrêmement poussée de ces instruments.
En Alsace
Sur le plan local, les concurrents étaient Roethinger, Koenig, Muhleisen et Alfred Kern. Haerpfer-Ermann dans une moindre mesure. De toutes façons, après guerre, avec l'aide des experts diocésaux, les facteurs alsaciens avaient soigneusement verrouillé le marché.
Roethinger
La vieille maison Roethinger a été le porte-drapeaux de la Réforme alsacienne de l'Orgue, puis prospéra avec le néo-classique. Après Edmond-Alexandre, elle a été tenue par Max puis André. Elle n'entra dans le néo-baroque, on le sait, qu'à reculons. Passait encore s'il s'agissait de construire des Mixtures 6 ou 7 rangs propres à éclater n'importe quel vitrail blindé. Même le "Plein-vent" n'était après tout qu'une technique d'harmonisation (enquiquinante certes, mais qui ne portait pas tellement à conséquence). Tout ceci était acceptable. Mais de là à construire des abrégés comme au 18 ème siècle... Si les derniers orgues de la maison peuvent donner le change, il est sûr que la maison Roethinger ne fit pas grand chose pour promouvoir le style. Car elle avait le sien (Ste-Madeleine à Strasbourg). Un style qui puisait dans les racines néo-classiques et même post-romantiques. Avant que Max ne trouve ses limites, la maison put continuer à s'exprimer grâce aux experts diocésaux, qui, avec une grande lucidité, soutenaient les initiatives allant dans le sens d'un style local.
Koenig
On peut en dire pratiquement autant au sujet de la maison de Sarre-Union. Mais en plus, grâce à une culture plus "Dom Bedos", les néo-baroques de Koenig étaient sincèrement des instruments qui se rapprochaient de la tradition 18 ème. En matière artistique, rien ne vaut une motivation authentique : la mécanique, à Sarre-Union, ce n'était pas pour faire joli sur le devis, et les plein-jeux étaient conçus pour l'office, pas pour les profs d'orgue... Pour le théoricien qui voulait du Marcussen, il valait mieux s'adresser ailleurs.
Muhleisen
La maison Muhleisen reste celle à laquelle se sont justement adressés ceux qui avaient senti, après 1970, le danger de l'uniformisation. C'est à dire ceux qui, justement, ne voulaient pas que *tous* les orgues de la création soient néo-baroques. L'histoire personnelle d'Ernest Muhleisen permet d'imaginer un homme ayant compris que l'adhésion inconditionnelle à un système ou une doctrine n'amène au mieux qu'à l'impasse. L'entreprise continua à cultiver la diversité.
Schwenkedel
Curt Schwenkedel pouvait compter sur les frères Steinmetz, Georges Lhôte, puis Jean-Marie Tricoteaux (et d'autres encore). Il était particulièrement bien placé pour répondre à la demande d'un néo-baroque "sans concession". Avec tant de compétences à son service, Schwenkedel transforma en instruments de musique exceptionnels les jolies théories des "cracks" de l'orgue. Mais surtout, contrairement à son père, Curt "adressait" un marché au moins national, et même plus large. Avec Marienthal (1962), Sentheim (1964), Toul (1966), Strasbourg
St-Jean (1967), Solesmes (1967) et Seltz (1968), la maison signa certains des plus beaux orgues de l'époque.
Pour les "petits" instruments, le bilan est plus mitigé : les grands instruments "pour pros" (au-delà de 25 jeux) sont plein de possibilités, généralement aidés par une acoustique flatteuse, et souvent bien entretenus. Mais quand il s'agit avant tout d'accompagner des chants, de trouver une entrée, un offertoire et une sortie avec les moyens d'un organiste amateur, les 8 "petits jeux" aux griffes acérées (sur 12) ne sont pas toujours sortables. On tourne en rond et on finit par faire tout le temps la même chose, surtout que les 2 ou 3 anches "de combat" sont la plupart du temps désaccordées.
Le public
Finalement, le grand oublié de la mouvance "néo-baroque" fut bien le public. Pas celui des concerts d'élite, féru de "Baroque nordique". Mais celui des dimanches. Essayons d'imaginer ce que pensaient les fidèles, habitués au "vieil orgue détruit pendant la guerre" (15 ans plus tard ; certaines destructions se font à retardement) ou "pneumatique-à-bout-de-souffle", quand ils voyaient débarquer l'orgue "moderne". Par exemple, à Breitenbach, l'orgue précédent avait été fourni par la maison Heinrich Voit und Söhne (1892). C'était un petit instrument de 6 jeux, probablement tout en distinction (comme les autres orgues ornés de cette plaque d'adresse) : manuel de 54 notes, avec Principal 8', Flûte 8', Dolce 8', Octave 4', Mixture et Pédale de 24 notes, et une Soubasse. "Provisoire" à l'origine, cet instrument a servi fidèlement pendant 78 ans ; et fut impitoyablement éliminé pour cause de Doctrine. Après : Cymbale 4 rangs en embuscade dans un positif de dos (avec le Cornet décomposé, une Montre 4' et un Cromorne) et un Plein-jeu 5-6 rangs au grand-orgue. Et des claviers noirs pour "faire genre", mais totalement déplacés dans une console indépendante. On conçoit aisément qu'il valait mieux, face au public et en tant qu'avocat de l'Orgue en général, disposer d'un discours bien rôdé sur "l'Esthétique de Allemagne du Nord nordique au 17 ème et sa Synthèse avec le Style Classique Français". On ne pouvait même pas avancer le traditionnel "le pneumatique, ça vaut rien ; votre orgue était à bout de souffle ; il n'en valait pas la peine", car le Voit était... mécanique !
Néo-baroque 'adouci' à Brustwerk expressif
C'est sûrement pour cela que Schwenkedel pratiqua deux versions du "néo-baroque". Sans vouloir trop schématiser (et quand on dit ça, c'est toujours qu'on va le faire), outre le "néo-hardbarock" ("pointu" ; muni d'un positif non expressif, et ne disposant que de jeux "nordiques 17 ème"), il put construire de nombreux instruments dotés d'un second clavier pectoral (Brustwerk) expressif, avec une Unda maris et d'une Trompette "de récit". Notons que c'est exactement la même recette qui fit le succès de certains Roethinger (Munchhouse, Ostheim, et le "dernier" et plus célèbre : Schiltigheim).
Chez Schwenkedel, ce néo-baroque "adouci", finalement encore un peu inspiré par le néo-classique, est très représenté : Marienthal, Hilsenheim, Drusenheim, Rittershoffen (St-Gall), Strasbourg, Artzenheim, Seltz, Pfastatt. La plupart de ces instruments sont très réussis.

Néo-baroque 'pointu' sans concession
D'autres orgues sont, par contre, "à fond" dans la logique néo-baroque : Illhaeusern (1961, qui a montré la voie), Rittershoffen (protestant), Staffelfelden, Sigolsheim, Kindwiller, La Montagne-Verte, Breitenbach, Herrlisheim.

L'héritage des Schwenkedel
 Rittershoffen, St Gall, 1964
Rittershoffen, St Gall, 1964Ceux qui considèrent le mode de traction comme la caractéristique principale d'un instrument à tuyaux (voir unique, comme dans l'expression "un orgue pneumatique de Roethinger") se souviennent que la maison Schwenkedel a construit un orgue à transmission mécanique en 1942 : à la grand orgue de La Robertsau. (Presque en même temps qu'Ernest Muhleisen à Pfulgriesheim, mais après Vondrasek à Graufthal, 1936). Mais le néo-baroque n'est pas qu'une question de transmission mécanique, de sommiers à gravures, de compositions "nordiques", de "plein-vent" et de matériaux nouveaux servant à construire des orgues prétendument "18ème". C'est ben sûr un peu tout cela à la fois.
Que restera-t-il du néo-baroque dans trente ans ? On commence à trouver, surtout dans certains pays, des dizaines d'instruments de ce style, d'occasion, bradés à "prix cassé". La mode, quand elle est forte et pousse à l'exagération, se détourne avec vigueur de ce qu'elle a adoré... Il faudra donc prendre soin d'éviter les excès contraires, en se mettant enfin à respecter tous les styles. Spécialisés dans un répertoire très ciblé (17ème, 18ème Buxtehudien), ces instruments ne satisfont même pas (plus) les puristes de "l'orgue pour Bach". De plus, ceux qui sont dénués de tout clavier expressif souffrent d'un lourd handicap pour l'accompagnement : les 8 pieds ne sont pas suffisants, et dès que l'on en rajoute, les "petits jeux" sont tellement forts qu'il y a intérêt a disposer d'au moins 30 choristes et/ou d'une assemblée conséquente. (Ce qui est de plus en plus rare...) C'est plutôt gênant vu que cela représente 90% de leur usage.
D'un autre côté, à une époque de forte mobilité, disposer d'instruments "pointus" qui excellent dans un style donné n'est pas une mauvaise chose. Encore faut-il qu'ils ne soient pas *tous* du même style... Entre la kyrielle de néo-baroques construis entre 1960 et 2010 et les pauvres instruments romantiques atrocement "baroquisés" (et qu'il faudra bien restaurer un jour), ce style a été (et reste) trop omniprésent. Paradoxalement, au fur et à mesure que certains seront remplacés par des instruments moins "extrêmes", ceux qui resteront vont perdre leur côté "cuisine internationale" et gagneront en valeur.
Nous ne reviendrons pas sur la fin de la maison Schwenkedel en tant qu'entreprise (même 40 ans après, c'est encore trop tôt). Les ateliers ont fermé en 1975, et les harmonistes de la maison ont pendant quelque temps "continué dans la tradition". Parfois avec succès, mais pas toujours. On vit émerger entre 1975 et 1980 des instruments qui, même pour un amateur d'orgue enthousiaste et tolérant, sont de vrais repoussoirs.
Ce sont donc les magnifiques orgues post-romantiques de la maison Schwenkedel qui vont probablement en constituer l'héritage le plus marquant. Des instruments originaux comme Hartmannswiller, Bisel, Seppois-le-Bas, Mutzig, Durlinsdorf. Et bien entendu les deux prodiges de Burnhaupt-le-Haut et Reiningue. Il y a eu des post-romantiques jusqu'en 1952 (abbaye de l'Oelenberg), et on va probablement trouver d'autres "pépites" dans les prochains temps. Et Georges Schwenkedel, luttant longtemps contre le "néo-classique", permit à son fils Curt d'entreprendre une rupture franche, et donc d'entrer dans le néo-baroque sans traîner du "legacy". Ce qui laissa une oeuvre originale, pleine de qualités et d'une grande valeur.
 Rimbach-près-Guebwiller, église de l'Epiphanie, 1931. Photo prise en Août 2012.
Rimbach-près-Guebwiller, église de l'Epiphanie, 1931. Photo prise en Août 2012.Il reste que cet héritage est, au moins en partie, gravement menacé : l'orgue de l'église protestante de Cernay (1926) est privé d'une bonne moitié de sa tuyauterie. Celui de Rimbach-près-Guebwiller tombait littéralement en ruine il y a quelques années. Ceux de l'église protestante de Molsheim et d'Aubure sont à l'abandon : on dirait que personne dans leur entourage n'est conscient de leur valeur. Au dernières nouvelles, l'orgue de Valdoie (90), sûrement à l'origine au niveau de celui de Burnhaupt, était dans un état désastreux. Il faut dire qu'il a été totalement défiguré en 1964. Il est temps de songer à aider de façon significative les communautés ou localités qui vont prendre à coeur de sauvegarder ce patrimoine.

Georges Schwenkedel restera un des facteurs alsaciens les plus doués. Son imagination contribua au progrès de tous, et la poésie de ses jeux ne se limite pas au choix de leur nom. Ces noms (Ocarina, Flûte pastorale, Spillflöte...) étaient finalement une sincère signature apposée sur une réussite musicale. Il savait faire beaucoup avec peu, ce qui sera, qu'on le veuille ou non, une caractéristique de notre prochaine modernité. Le monde de la musique lui doit beaucoup, et en prend peu à peu conscience.
 Revers du pendentif de Durlinsdorf (1932).
Revers du pendentif de Durlinsdorf (1932).Webographie :
- [OrguesPACA] http://www.arcada-paca.com/ : Inventaire des orgue en PACA, 1998 ; "orgue06.pdf".
- [Orgalie] http://www.orgalie.com/ :
- [Deondino] http://deondino.perso.neuf.fr/ :
- [OrguesRA] http://orgues-en-rhonalpe.weebly.com/ :
- [OrguesVosges] http://vosges.orgues.free.fr/ :
- [OrguesAquitaine] http://orgue-aquitaine.fr/ : Connu aussi sous le nom "Adora"
- [OrguesPicardie] http://orguespicardie.weebly.com/ :
- [Lilorg] http://www.lilorg.fr/ :
- [Wikipedia] http://fr.wikipedia.org/ :
- [Wakamba] http://wakamba.voila.net/ :
- [OpenPaca] http://opendata.regionpaca.fr/ :
- [PresenceMariste] http://www.presence-mariste.fr/ :
- [JMTricoteaux] http://www.tricoteaux.com/ :
- [Temples] http://temples.free.fr/ :
- [MGabriel] http://michele-gabriel.chez-alice.fr/ :
- [94Citoyens] http://94.citoyens.com/ :
- [SiteJBG] http://pipeorgan.fr/Site JBG/ :
- [OrguesJP] http://orguesjp.blogspot.fr/ :
- [FChapelet] http://frederic.chapelet.free.fr/ :
- [AmisLeman] http://www.amis-nd-leman.fr/ :
Sources et bibliographie :
- [MGiroud] 'Curt Schwenkedel (1914-1988)' dans la 'Revue des Facteurs d'orgues français' du 1988
- [CASchleppy] C.-A. Schleppy : e-mail du 08/09/2015.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM
- [LORGUE] "L'orgue, technique, esthétique, histoire. Revue trimestrielle"
- [IOLVO] Christian Lutz et Paul Farinez : "Orgues de Lorraine, Vosges", éditions ASSECARM / Serpenoise, 1991
- [IOLMM] Christian Lutz et René Depoutot : "Orgues de Lorraine, Meurthe-et-Moselle", éditions ASSECARM / Serpenoise, 1990
- [IOLME] Christian Lutz : "Orgues de Lorraine, Meuse"
- [IOLMO] Christian Lutz et François Ménissier : "Orgues de Lorraine, Moselle"
- [IOAQU] Bernard Lummeaux et François-Xavier Benusiglio : "Orgues en Aquitaine", éditions ADAMA-Edisud, 1989
- [IOOISE] Arsène Bedois, Marcel Degrutere et Christine Dogny : , éditions ASSECARM, 1989
- [IOLYON] Pierre-Marie et Michèle Guéritey : , éditions Comp'Act, 1992
-
[MSevestre] Michel Sevestre :
Recherches documentaires
-
[ECorde] Eric Cordé :
Documents
-
[JMStussi] Jean-Marc Stussi :
Documents