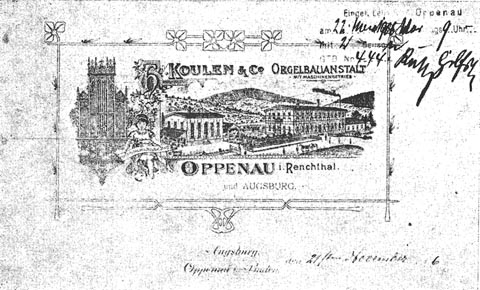 Le papier à entête de Koulen installé à Oppenau.
Le papier à entête de Koulen installé à Oppenau.Il montre... l'orgue de la cathédrale de Strasbourg.
Heinrich Koulen (Waldfeucht, 23/06/1845 - Augsbourg 14/03/1919) était originaire d'Heinsberg en Allemagne ; son père Wilhelm (1801–1885) était facteur d'orgues. Après un passage à Aachen, il fut l'élève de Joseph Merklin à Paris. Il s'installa à Strasbourg en 1871.
Il commença par des séjours provisoires, s'installant au 35 Faubourg de Pierre à Strasbourg en 1873. [GSagot]
Après avoir construit, à partir de 1874, plusieurs instruments romantiques à traction mécanique (la plupart de taille assez limitée), il passa à la transmission pneumatique dès 1885, et en fut donc l'un des pionniers. Même après de premières réalisations en pneumatique, il continua à réaliser des orgues à sommiers mécaniques, soit à gravures, soit à cônes.
Les systèmes de transmission étaient au centre des préoccupations techniques de l'époque. Il y avait des tâtonnements. Elève de Merklin, Koulen aurait probablement préféré l'électricité. En 1887, Koulen acheta la licence Schmoele-Mols (électro-pneumatique - Merklin en avait acquis la licence exclusive pour la France en 1884). Mais la faiblesse des électro-aimants et l'indisponibilité de "secteur" (donc la nécessité d'utiliser et de charger des accumulateurs) rendait cette technique difficile à mettre en pratique. Les systèmes pneumatiques, eux, nécessitent des réglages fins (que bien peu de facteurs savaient faire), et, encore à leur balbutiements, ils étaient très fragiles. Cela finit par causer beaucoup de tort à Koulen : beaucoup se souviennent aujourd'hui des défauts de ses transmissions, mais bien peu de ses qualités d'harmoniste.
 Avant 1885 (période 100% mécanique)
Avant 1885 (période 100% mécanique)
Il semble que le premier travail de Koulen en Alsace soit la réparation de l'orgue Claude-Ignace Callinet, 1853, d'Artzenheim en 1872 (cet instrument a été détruit en 1945).
 1874 : Westhoffen (région de Wasselonne), Eglise protestante
1874 : Westhoffen (région de Wasselonne), Eglise protestante
Remplacé par Dalstein-Haerpfer (1912).
Le buffet Koulen constitue la partie centrale du buffet actuel (on pourrait croire à du Merklin...). Il reste une quinzaine de jeux Koulen dans l'instrument (Dalstein-Haerpfer) actuel.
 1875 : Mackenheim (région de Marckolsheim), St-Etienne
1875 : Mackenheim (région de Marckolsheim), St-Etienne
Remplacé par Max et André Roethinger (1950).
Vu les dimensions du buffet, cet instrument n'a probablement jamais eu 56 jeux, mais plutôt 26... Le buffet a été conservé en 1950, et c'est donc celui de l'instrument actuel.
Heinrich Koulen plaça une soufflerie à Bischoffsheim en 1876, et fit à cette occasion un relevage et une légère modification de la composition du grand Stiehr.
 1878 : Ostwald (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Oswald
1878 : Ostwald (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Oswald
Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (vers 1919).
 1878 : Kunheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante
1878 : Kunheim (région d'Andolsheim), Eglise protestante
Remplacé par Ernest Muhleisen (1958).
A priori, l'orgue de Kunheim, 1878, a été détruit là bas en 1940 ; son déménagement à Neuf-Brisach est peu probable.
 1889 : Neuf-Brisach, Eglise protestante
1889 : Neuf-Brisach, Eglise protestante
Remplacé par Christian Guerrier (1982).
Koulen n'a jamais construit d'orgue pour Neuf-Brisach : on pensait que cet instrument venait de Kunheim, mais l'hypothèse est peu crédible. A priori, l'orgue de Kunheim, 1878, a été détruit là bas en 1940, et on ne sait pas d'où venait celui de Neuf-Brisach.
 1878 : Mittelwihr (région de Kaysersberg), Eglise protestante
1878 : Mittelwihr (région de Kaysersberg), Eglise protestante
Détruit en 1945. Remplacé par Alfred Kern (1963).
On ne connaît de cet orgue que ce que Schwenkedel a noté en rédigeant un devis pour remplacer la façade réquisionnés en 1917 : "19 Register mechanisch" et un plan de façade.
 1879 : Melsheim (région de Hochfelden), Eglise protestante St-Georges
1879 : Melsheim (région de Hochfelden), Eglise protestante St-Georges
Instrument actuel.
L'un des plus intéressants de la production de Koulen.
 1879 : Saales, St-Barthélemy Tribune
1879 : Saales, St-Barthélemy Tribune
Remplacé par Joseph Rinckenbach (1923).
Un tournant dans la carrière de Koulen : ce trois-claviers de 26 Jeux, dans un superbe buffet de la maison Klem qu'on peut encore voir aujourd'hui (il contient l'opus 160 de Joseph Rinckenbach) suscita l'enthousiasme de cinq "figures" du monde de l'Orgue (dont les très influents Stern et Erb).
 1880 : Andlau (région de Barr), Sts-Pierre-et-Paul Tribune
1880 : Andlau (région de Barr), Sts-Pierre-et-Paul Tribune
Instrument actuel.
Cet orgue était alors évalué comme l'un des meilleurs d'Alsace.
 vers 1881 : Strasbourg, Chapelle protestante de l'hôpital civil
vers 1881 : Strasbourg, Chapelle protestante de l'hôpital civil
Remplacé par Dalstein-Haerpfer (1910).
A partir de 1881, Koulen eut accès aux tribunes les plus prestigieuses, puisqu'il ajouta un récit expressif à l'orgue André Silbermann, 1728, de Strasbourg, St-Guillaume. Au milieu de l'année 1881 vint le rejoindre un apprenti qui allait se faire un grand nom dans la facture d'orgues : Edmond-Alexandre Roethinger. Ce dernier a donc pu participer aux travaux Koulen entre cette date et début 1886.
 1881 : Matzenheim (région de Benfeld), Collège St-Joseph
1881 : Matzenheim (région de Benfeld), Collège St-Joseph
Instrument actuel.
Fort bien conservé, cet instrument dispose d'une Clarinette d'origine. A part la façade, seuls 2 ou 3 jeux ont été modifiés.
 1882 : Duttlenheim (région de Molsheim), St-Louis
1882 : Duttlenheim (région de Molsheim), St-Louis
Remplacé par Franz Heinrich Kriess (1920).
Il s’agissait de la reconstruction d'un orgue Stiehr de 1817.
 1883 : Erstein, Eglise protestante
1883 : Erstein, Eglise protestante
Instrument actuel.
Cet orgue - certes légèrement dénaturé en 1975 et aujourd'hui en mauvais état - dispose d'un potentiel considérable. Les jeux d'origine ont une très belle harmonie, et l'instrument est idéalement assorti à son charmant édifice. C'est un précieux témoin de la "première façon" d'Heinrich Koulen.
 1883 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.
1883 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.
Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1925).
C'était un instrument plutôt conséquent (II/P 28j), doté d'une machine Barker, du fameux Tuba 16' de pédale, et même d'un accouplement à l'octave (en 1883). Malheureusement, la perspective des travaux de la "grande percée" (commencés en 1910) ne dut pas en faciliter l'entretien. Déjà en mauvais état avant le conflit, il fut remplacé en 1925.
 1884 : Altkirch, Temple réformé
1884 : Altkirch, Temple réformé
Remplacé par Dalstein-Haerpfer (1928).
Le buffet Koulen abrite l'orgue actuel ; une partie de la tuyauterie est certainement de Koulen (mais totalement réharmonisée).
 1884 : Guebwiller, Eglise protestante
1884 : Guebwiller, Eglise protestante
Remplacé par Alfred Kern (1976).
Un partie des travaux de Koulen sur cet orgue Joseph Callinet, 1828, a été conservée lors de la reconstruction de 1976 par Alfred Kern.
 1883 : Bourgheim (région d'Obernai), St-Arbogast
1883 : Bourgheim (région d'Obernai), St-Arbogast
Remplacé par Max Roethinger (1963).
L'installation d'un orgue Koulen dans ce village n'a pas beaucoup laissé de traces dans les archives, et vient épaissir le mystère de la disparition de l'orgue André Silbermann, 1707 du collège St-Guillaume de Strasbourg. Des éléments du buffet de Koulen ayant été retrouvés sur place, l'existence de cet orgue Koulen ne fait pas de doute. Caecilia N° 2, de février 1884, p. 14 rapporte : "Expertise d’orgue - Orgue de Koulen - Eglise mixte de Burgheim, près de Goxwiller. Expertisé par MM. Erb de Sélestat, Bachmann, organiste à Obernai et Schweitzer, organiste à Heiligenstein. Tout l’orgue est expressif "Les tuyaux de montre sont artistiquement peints sur bois par M. Ringelstein d’Obernai. A la distance de quelques mètres, l’illusion est complète"."
En 1883, Koulen transforma malheureusement l'orgue Silbermann de Balbronn, et, en 1884 l'orgue Silbermann/Geib de Strasbourg, St-Nicolas pour en faire un 3 claviers de 32 jeux. Il répara (travaux de soufflerie) et transforma légèrement l'orgue Stieffell de Reichshoffen.
En 1885, Koulen s'installa au 18 Faubourg de Saverne à Strasbourg. [GSagot]
En 1885, il y eut aussi deux projets (sans suite) : l'un pour réparer l'orgue (des frères Wetzel) de Saessolsheim (c'est Emile Wetzel qui eut le marché), l'autre pour un orgue neuf à Crastatt (et là, c'est une autre étoile montante de l'orgue alsacien qui emporta l'affaire : Franz Xaver Kriess, mais seulement en 1891. Martin Rinckenbach était aussi en lice. Kriess l'emporta parce qu'il était le moins cher (sur le devis)... mais son orgue finit par coûter plus cher que le projet Rinckenbach). En 1885, Koulen répara ausi l'orgue d'Eywiller (notons que ce peut aussi être l'orgue de l'église catholique du lieu). [GSagot]
 Après 1885
Après 1885
 1885 : Zinswiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
1885 : Zinswiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
Remplacé par Ernest Muhleisen (1959).
Le premier orgue pneumatique d'Alsace (sommiers à cônes) n'était malheureusement pas réparable suite aux dégâts subis en décembre 1944.
La construction d'un orgue à transmission pneumatique pour cette petite commune eut un énorme retentissement sur la facture d'orgues en Alsace et en Allemagne : il attira l'attention de Weigle de Stuttgart, qui vint visiter les ateliers de Koulen, étudier son système pneumatique... pour vraisemblablement le plagier un peu plus tard. Koulen lui intenta un procès, mais sans succès.
 1887 : Fessenheim-le-Bas (région de Truchtersheim), St-Martin
1887 : Fessenheim-le-Bas (région de Truchtersheim), St-Martin
Instrument actuel.
C'est bien un orgue à transmission mécanique que Koulen construit cette année-là dans un buffet Stiehr (le pneumatique n'était encore ni une doctrine, ni une routine). L'instrument a malheureusement été fortement dénaturé en 1974.
 1888 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Aloyse
1888 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Aloyse
Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1923).
Koulen mit en pratique sa licence Schmoele-Mols un an après l'avoir acquise, dans un orgue de 36 jeux sur 3 claviers, qui eut un accueil fort positif. Si la suite de l'histoire semble effectivement montrer un manque de fiabilité, cet instrument (dont il reste beaucoup de matériel dans l'orgue actuel) semble avoir donné toute satisfaction au cours des premières années.
 1888 : Lampertheim (région de Mundolsheim), St-Arbogast
1888 : Lampertheim (région de Mundolsheim), St-Arbogast
Instrument actuel.
Partie instrumentale classée Monument Historique (15/09/2003).
 1888 : Neuwiller-lès-Saverne (région de Bouxwiller), Sts-Pierre-et-Paul
1888 : Neuwiller-lès-Saverne (région de Bouxwiller), Sts-Pierre-et-Paul
Instrument actuel.
Partie instrumentale classée Monument Historique (21/02/1973).
De 1888 date aussi la reconstruction d'un orgue de Nicolas Dupont, 1778, à Neuwiller-lès-Saverne. Cela finit en procès quelques années plus tard, et ce travail, avec celui de St-Guillaume, n'arrangea pas la réputation de Koulen lorsque les instruments du 18ème revinrent à la mode (dans les années 1960-2000). Il n'en reste pas moins que l'orgue Koulen de Neuwiller était une bien belle machine machine, originale et pleine de possibilités.
 1889 : Strasbourg, Temple maçonnique Frédéric Piton
1889 : Strasbourg, Temple maçonnique Frédéric Piton
Instrument actuel.
Ce joli petit instrument, resté entièrement authentique, devriat bientôt être relevé. [ITOA:4p702] [PMSRHW:p227]
 1890 : Strasbourg, Ancien conservatoire Salle de concert
1890 : Strasbourg, Ancien conservatoire Salle de concert
La renommée de Koulen étant grandissante, il fournit instrument à traction électro-pneumatique au conservatoire de Strasbourg en 1890, sur lequel il travailla, dit-on, pas moins de trois ans ! Le conservatoire de Strasbourg était à l'époque installé à l'Aubette (place Kléber) et au centre d'une activité intense. L'orgue Koulen ne resta probablement pas en fonction très longtemps : c'était un "orgue-concept", et pas vraiment un instrument destiné à l'enseignement. Il a disparu, mais on ne sait pas trop quand. [IHOA:p184b] [ITOA:4p677-9] [Rupp:p307-8] [Caecilia:1964-4p149]
 1890 : Bischholtz (région de Bouxwiller), Eglise protestante
1890 : Bischholtz (région de Bouxwiller), Eglise protestante
Remplacé par Curt Schwenkedel (1959).
Il ne reste rien de l'orgue Koulen, détruit par faits de guerre en 1945.
 1891 : Ensisheim, Chapelle catholique de la maison d'arrêt
1891 : Ensisheim, Chapelle catholique de la maison d'arrêt
Instrument déménagé à Ensisheim, église protestante.
C'est l'orgue actuel, authentique et fort bien conservé, qui se trouve aujourd'hui à l'église protestante d'Ensisheim. [ITOA:2p105] [IHOA:p55a] [SchwenkedelNB:1929-1932p1385] [Barth:p189] [PMSSUND1986:p192-3] [PMSRHW:p199]
 1891 : Dauendorf (région de Haguenau), St-Cyriaque
1891 : Dauendorf (région de Haguenau), St-Cyriaque
Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1904).
Les buffets (encadrant la rosace) de l'orgue Koulen ont été conservés, et abritent l'orgue actuel.
 1891 : Strasbourg, Clinique Ste-Barbe
1891 : Strasbourg, Clinique Ste-Barbe
Probablement les derniers sommiers à gravures construits par Koulen.
En 1891, il y eut aussi un projet pour rénover l'orgue de Masevaux. [GSagot]
 1892 : Buhl (région de Guebwiller), St-Jean-Baptiste
1892 : Buhl (région de Guebwiller), St-Jean-Baptiste
Instrument actuel.
Partie instrumentale classée Monument Historique (17/07/2012).
L'un des plus grands (27 jeux comme à Andlau) des orgues Koulen conservés.
 1893 : Preuschdorf (région de Woerth), St-Adèlphe
1893 : Preuschdorf (région de Woerth), St-Adèlphe
Remplacé par Yves Koenig (2008).
Koulen avait reconstruit l'orgue Pierre Rivinach, 1860, et y a apposé sa plaque d'adresse. L'instrument a été restauré en l'état de 1860 par Yves Koenig en 2008.
 1893 : Bosselshausen (région de Bouxwiller), Eglise protestante
1893 : Bosselshausen (région de Bouxwiller), Eglise protestante
Instrument actuel.
Opus 80. Malheureusement dénaturé en 1959, ce joli petit orgue mériterait bien une restauration dans l'état de 1922.
 1893 : Lichtenberg (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante
1893 : Lichtenberg (région de la Petite-Pierre), Eglise protestante
Instrument actuel.
Ce pauvre petit instrument a lui aussi été altéré dans les années 50 (1956).
De 1893 datent les deux orgues Koulen de Prague : celui de St-Gabriel et celui d'Emmaüs. [GSagot]
Outre Sigismond Roethinger, le père d'Edmond-Alexandre, on connaît le nom d'autres collaborateurs de Koulen en Alsace : Ernst Ludwig Lohse (1850-1932) (employé jusqu'en 1881), Nikolaus Pauly (avant 1892) et surtout Johannes Klais (1852-1925), fondateur de la célèbre maison de Bonn (en 1882) ; Klais avait rejoint Koulen juste après 1874. [GSagot]
Koulen quitta progressivement l'Alsace pour installer ses ateliers à Oppenau, mais quelques instruments étaient encore à poser.
 1894 : Masevaux, Eglise protestante
1894 : Masevaux, Eglise protestante
Instrument actuel.
Le dernier orgue (existant encore) que Koulen construisit pour l'Alsace est bien conservé : les jeux transformés en 1971 seraient probablement restaurables. Il a même conservé sa façade d'origine.
 1894 : Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath.
1894 : Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath.
Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1910).
Un des orgues les plus marquants de Koulen, malgré ses 28 jeux seulement. Il semble que l'intervention de Roethinger en 1910 n'ait pas consisté à refaire l'instrument, mais plutôt à l'agrandir. L'orgue Koenig actuel, dont l'esprit est justement de revenir à cette esthétique "fin 19ème, début 20ème", intègre beaucoup d'éléments Koulen. Ils y sont non seulement conservés, mais particulièrement mis en valeur, et harmonisés de façon probablement très proche de ce que faisait Koulen.
 1894 : Strasbourg, Ste-Madeleine
1894 : Strasbourg, Ste-Madeleine
Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1913).
L'orgue Koulen, inauguré le 22/11/1894, était logé dans un buffet néo-gothique de Klem. Il fut entièrement détruit le 06/08/1904 lors de l'incendie de l'édifice (c'était alors l'église gothique des soeurs de l'ordre de Ste-Marie-Madeleine, qui tenaient un orphelinat ; il n'en resta que le choeur).
 1895 : Rothbach (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
1895 : Rothbach (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
Remplacé par Ernest Muhleisen (1956).
L'opus 75 de Koulen, logé dans le buffet de l'instrument précédent, a été détruit par faits de guerre en 1945.
 1896 : Drulingen, Eglise protestante
1896 : Drulingen, Eglise protestante
Remplacé par Gebrüder Link (1909).
C'est très probablement à Drulingen que Koulen a placé son dernier orgue alsacien.
Revenant à Strasbourg pour gérer le chantier de la cathédrale (l'affaire commença dès 1891), il emménagea au 5 de la rue des Veaux. [GSagot]
 1897 : Strasbourg, Cathédrale Notre-Dame Nef
1897 : Strasbourg, Cathédrale Notre-Dame Nef
Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1935).
Avant 1897, Koulen atteint à la fois le sommet et la fin de sa carrière alsacienne. Ayant obtenu le marché de la transformation de l'orgue de la cathédrale, il se lança dans un projet rapidement fort contesté. En plus des adjonctions déjà présentes de Wegmann, il fut ajouté au Silbermann 7 jeux au positif, 4 au grand-orgue, 9 au récit/écho et 4 à la pédale. Et plutôt que de conserver le "caractère Silbermann", il fallut bien que des tuyaux ressortent pour laisser entrer les neufs. Avec ses 42 jeux, le grand-orgue de Koulen fut sujet à critique avant même l'achèvement des travaux (mai 1897). Le résultat fut qualifié de "massacre". Koulen y perdit sa réputation en Alsace durant... au moins 100 ans. L'orgue de la cathédrale fut démonté en 1908, au plus mauvais moment, car il se trouvait en caisse au moment de la réquisition du métal par les autorités allemandes. Les tuyaux Silbermann n'entrant pas dans un instrument fonctionnel, ils furent fondus. Le grand buffet médiéval resta muet jusqu'en 1935.
Notons que c'est en raison de ce contrat que Koulen avait demandé (dès 1891) à l'un de ses plus talentueux élèves de revenir en Alsace : le jeune Edmond-Alexandre Roethinger (qui était alors à Munich et avait construit 19 orgues pour le compte de Märtz). Cela changea la face de l'Orgue alsacien.
Le départ pour Oppenau (1892, et 1897)
Koulen vendit alors ses ateliers de Strasbourg et partit définitivement pour Oppenau, puis Augsbourg (1903), où il fit une brillante seconde carrière, et transmit son entreprise à son fils Max en 1910. C'est donc en Allemagne que Koulen plaça plus de la majorité de ses 200 orgues, dont Augsbourg, Sts-Ulrich-et-Afre (V/73) en 1903, Landshut, St-Martin (III/70) en 1914, basilique d'Altötting (III/61) en 1915.
Heinrich Koulen s'est éteint le 14/03/1919 à Augsbourg.
L'entreprise continua jusqu'en 1922, lorsque Max la fusionna avec Welte-Mignon, de Freiburg (et là l'histoire de cette société rejoint la légende des orgues de transaltantiques !). Si les orgues Koulen entre 1885 et 1897 souffraient probablement de problèmes de transmission, ils furent par la suite surtout un symbole culturel de l'Alsace annexée, et de la perte de l'orgue Silbermann de la cathédrale de Strasbourg (perte un peu vite imputée à Koulen, car le fait déterminant était que la Réquisition des tuyaux métalliques par les autorités allemandes en 1917 concerna l'ensemble des tuyaux de l'orgue Silbermann (sauf la façade, exactement le contraire que dans la majorité des cas), car celui-ci était démonté en 1917 ; Koulen avait quitté l'Alsace depuis 22 ans !).
L'héritage alsacien de Koulen
Les orgues Koulen d'Alsace, originaux donc atypiques, devinrent vite difficile à entretenir en l'absence de leur créateur. Ils devinrent impopulaires, puis injouables, faisant les affaires de Roethinger et des autres qui y trouvèrent quelques jolis marchés. Et pourtant, la partie sonore devait être d'une grande qualité musicale : les instruments neufs de Koulen étaient très appréciés, et il était un harmoniste de grand talent, surtout en ce qui concerne les Jeux de détail.
En 2010 a été restauré l'orgue de Lampertheim, confirmant que celui qui était resté (avec Georges Wegmann, ironiquement aussi en raison d'une intervention à la Cathédrale de Strasbourg) le mal-aimé des historiens de l'orgue d'Alsace au 20ème siècle était effectivement un "grand" facteur. Ce qui fut à nouveau confirmé en 2015, à Buhl (1892, 27 Jeux).
Enfin, il faut souligner que Koulen a appris le métier, entre 1881 et 1889 à un facteur déterminant dans l'orgue alsacien : Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953). Au début, l'élève connut, comme le "maître", pas mal de déboires avec les transmissions pneumatiques. Mais en 1914 à Erstein, Roethinger, l'élève de Koulen, devint le porte-drapeau de la Réforme alsacienne de l'orgue. Pratiquement tous les facteurs d'orgues alsaciens du 20 ème siècle ont été formés chez Roethinger (Georges Schwenkedel, Ernest Muhleisen, Jean-Georges Koenig, Alfred Kern) ou par ceux qui y ont travaillé. Ils sont donc tous, quelque part, des héritiers de Koulen.
Sources et bibliographie :
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 97-100
- [Koulen1] Christian Kohler : "Orgeln und Orgelbauer im Allgäu von 1850 bis zur Gegenwart", p. 63-64
-
[Lampertheim2010] "Inauguration de l’orgue Koulen restauré - Eglise Saint Arbogast de Lampertheim", p. 6-7
Article de Christian Lutz à l'occasion de la restauration de l'orgue Koulen de Lamperheim
-
[GSagot] Guy Sagot : Document "20030515lettreGSagot"
Recherches de Guy Sagot sur Roethinger
-
[JDolle] Julie Dollé :
Recherches documentaires ; lettres de Guy Sagot

