| |
La soufflerie
Soufflet Cunéiforme, Réservoir à Lanterne,
Porte-vent, Postage
La soufflerie doit générer le vent, le réguler et le stocker. De gros tuyaux,
appelés Porte-Vents l'amènent ensuite aux Sommiers
pour faire parler les tuyaux.
La difficulté consiste à conserver une pression constante, alors que la partie instrumentale,
elle, consomme de l'air de façon variable en fonction du nombre de notes jouées et du nombre
de jeux tirés.
Le vent était jadis produit par des soufflets ressemblant beaucoup à des soufflets de forge.
Ils sont appelés Soufflets "Cunéiformes", et étaient actionnés soit par les bras, soit par
les pieds.
 |
- Une Soupape d'Admission (en bleu) s'ouvre lorsque la pression interne est inférieure à la pression
atmosphérique (parce qu'on le gonfle en le levant). Elle permet à l'air d'entrer.
- Une Soupape de Retenue (en vert) a le travail inverse : elle reste fermée quand la pression dans le
Soufflet est inférieure à celle de l'orgue. (Sinon, c'est l'orgue qui remplirait le soufflet).
- Lorsque l'on presse sur le Soufflet, la Soupape d'Admission se ferme, empêchant l'air de refluer
vers l'extérieur, et
- la Soupape de Retenue s'ouvre, car la pression dans le Soufflet est supérieure à celle dans
l'orgue.
|
Naturellement, Le caractère alternatif du cycle gonflage/dégonflage impliquait d'avoir au moins deux
Soufflets.)
Jusqu'au 15 ème siècle environ, il n'y avait pas de réservoir : les Soufflets alimentaient
directement les Sommiers. Naturellement, le vent n'était pas stable.
Ceci avait deux défauts majeurs :
- la Pression de l'air dans les Sommiers dépendait directement de l'effort exercé sur les Soufflets
(les Souffleurs devaient les manipuler avec beaucoup de régularité)
- l'absence de réservoir nécessitait de multiplier le nombre de Soufflets.
A partir du 15 ème siècle, on trouva le moyen de rigidifier les Soufflets et de les lester,
de façon à ce qu'un poids, toujours constant, vienne se substituer à la force exercée par le
Souffleur. Lors du regonflage, le Souffleur devait exercer un effort important, puisqu'il fallait
remonter le poids en plus d'aspirer de l'air dans le Soufflet.
|
Ensuite, on inventa le Réservoir. Il prit d'abord la forme d'un Soufflet Cunéiforme (en jaune) lesté
par un poids ou un ressort, gonflé par d'autres Soufflets Cunéiformes. On superposait généralement le tout.
Les éventuelles irrégularités étaient masqués par le Soufflet-Réservoir, qui était toujours lesté de la même
façon et restait toujours gonflé à peu près de la même façon.
|
 |
En 1677, Christian FOERNER inventa un accessoire très utile : le Pèse-Vent,
permettant de mesurer très précisément la pression produite. En effet, il faut que celle-ci
soit non seulement régulière, mais aussi d'une valeur très précise pour ne pas nuire à l'harmonisation.
Mais l'à peu près ci-dessus, qualifiant la constance de la pression dans le Réservoir Cunéiforme
est important, car le propre du Soufflet Cunéiforme lesté est de ne pas produire une pression égale quelle
que soit sa position.
On inventa donc, au 19 ème siècle, le Réservoir à Lanterne, ou à plis parallèles. Même presque
dégonflé, il donne toujours la même pression que plein. Celle ci est directement liée au poids du lest
(briques, ou rails de chemin de fer...) qu'on a mis dessus. (La pression interne est égale à la pression
atmosphérique, plus le poids du lest divisé par la surface du réservoir). Les plis sont maintenus
parallèles par un système de barres (en rose) articulées en "Z", dont les deux extrémités ainsi que le
centre de la barre du milieu sont solidaires des plis (axes en rouge).
Les Réservoirs à Lanterne ne donnèrent pas tout de suite satisfaction, car parce qu'il y avait trop de
plis entrants, ceux-ci, en fin de course, étaient à l'origine d'une surpression.
C'est l'horloger anglais CUMMINS qui inventa en 1814 le réservoir moderne, en ayant l'idée d'y mettre
autant de plis entrants que de plis sortants.
Dans ses réservoirs à lanterne, il y a deux niveaux superposés. Le premier est un pli rentrant et le second un pli sortant, afin d'équilibrer les pressions exercées par le poids des éclisses. Pour que ces plis ne se gonflent pas séparément les tables sont reliées entre elles par un système de parallélogramme. Grâce à ce système on arrive à avoir une pression constante quelle que soit la hauteur de la table supérieure du réservoir.
Jusqu'à l'invention du ventilateur, le Réservoir était alimenté par des Soufflets Cunéiformes
(prenant alors le nom de Pompes), actionnés par des leviers (à bras ou à pied).
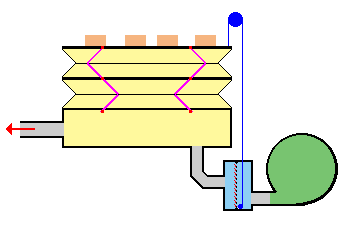
Réservoir à Lanterne associé à un ventilateur électrique |
Aujourd'hui, on utilise bien sûr des ventilateurs électriques (en vert) pour gonfler les réservoirs.
Au 19 ème siècle, quand l'orgue devait refléter l'ère industrielle, on a vu des ventilateurs
mus par des machines à vapeur.
Le ventilateur électrique est une hélice tournant dans une boîte circulaire. L'air est aspiré au
centre, accéléré par l'hélice en rotation, et prélevé en périphérie. Sa vitesse lui confère une pression
qui lui permet d'entrer dans le Réservoir.
Avec les moteurs électriques modernes, on pourrait faire éclater le soufflet s'il n'y avait pas un système
régulateur. Il constitue ce qu'on appelle une Boîte Régulatrice (en bleu). Lorsque le réservoir est plein, les volets sont
fermés. Le ventilateur tourne "à vide" puisqu'il ne peut plus évacuer l'air. Dès que l'orgue joue,
le réservoir s'abaisse légèrement (mais la Pression reste constante). La ficelle ouvre un peu les
volets, permettant au ventilateur de gonfler le Réservoir.
La boite est séparée en deux parties par une cloison étanche ou passante, "à la demande". Cette cloison est percée d'un trou muni de barreaux verticaux, sur lesquels vient se dérouler un rideau qui obstrue le trou coté ventilateur. Lorsque le réservoir est plein, le rideau est descendu grâce à une cordelette fixée en haut du réservoir, à ce moment là l'air provenant du ventilateur est stoppé, mais pour empêcher le rideau d'être décollé par la pression contenue dans le réservoir, on prévoit de mettre au dos de la cloison coté réservoir des soupapes anti retour.
|
D'autres réservoirs-régulateurs, disposés parfois dans l'instrument lui-même permettent d'éviter
les secousses.
La pression offerte par la soufflerie est très importante. Elle doit être constante, car tout l'orgue
est harmonisé pour une pression donnée. Quand on augmente la pression, l'orgue sonne plus
fort, mais s'il n'a pas été conçu pour ça, il se désaccorde, et certains tuyaux se mettent à "octavier",
c'est-à-dire à sonner une octave trop haut en raison d'un changement de mode de vibration à l'intérieur.
 |
Lorsqu'il faut amener le vent à des tuyaux qui ne sont pas directement posés sur
le Sommier, on utilise des tuyaux nommés Postages.
C'est le cas de tuyaux de façade (Montres), souvent des grands
Cornets (qui sont alors dit Postés : cela sert à les mettre
en valeur, en leur donnant une position privilégiée dans le Buffet)
et parfois de tuyaux graves qui n'ont pas trouvé de place sur le Sommier. |
|
|
 Les Jeux de l'Orgue
Les Jeux de l'Orgue
 L'architecture
L'architecture
 Les différentes esthétiques
Les différentes esthétiques
 Orgues d'Alsace
Orgues d'Alsace


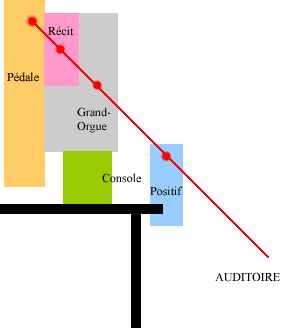



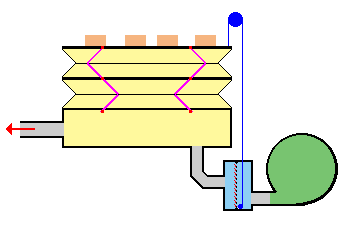




 Octave courte
Octave courte