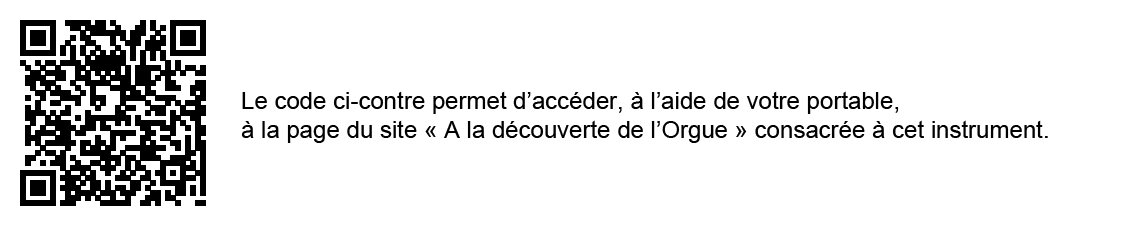Hégenheim, l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach, 1913, dans son buffet de 1846.
Hégenheim, l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach, 1913, dans son buffet de 1846.Les photos sont de Martin Foisset 06/07/2020.
Voici l'opus 141 de Martin et Joseph Rinckenbach. Construit en 1913, c'est l'un des derniers de la Belle époque, mais aussi l'un des premiers à annoncer les instruments d' "après-guerre" tels que les a imaginés Joseph Rinckenbach en élaborant un style post-romantique tout personnel. Mais l'histoire des orgues d'Hégenheim commence juste après la Révolution, car pas moins de 3 instruments se sont succédés ici avant l'arrivée de l'orgue actuel.
Historique
En 1816, l'un des facteurs Franz de Liesberg installa à Hégenheim un orgue venant d'Ettigen (CH, canton de Bâle-Campagne). [ITOA] [PMSSUND1983] [Sundgau1943-48]
Historique
Dès 1825, l'instrument fut remplacé par celui de Hirsingue, St-Jean-Baptiste, un petit orgue (9 jeux) que Joseph Franz avait récupéré à Mariastein en 1787. Il devait dater du début des années 1780. [ITOA] [PMSSUND1983] [Sundgau1943-48]
1846
Historique
En 1846, Joseph Callinet posa un orgue neuf. Il n'y eut ni devis, ni réception, car le paiement a été assuré par un don privé, de Marie Pauline Victoria von Barbier-Schroffenberg, la veuve du maire d'Hégenheim Joseph Bouat. [ITOA] [PMSSUND1983] [Sundgau1943-48]
Historique
En 1913, Martin et Joseph Rinckenbach construisirent un orgue neuf. [IHOA] [ITOA]
Il est pratiquement contemporain de ceux de Thannenkirch ou de Russ. Dans les trois cas, ces instruments ont été construits dans des buffets plus anciens. A Hégenheim, il fallut l'élargir par deux plates-faces latérales, car la partie instrumentale est considérablement plus grande que celle de 1846.
Il s'agit résolument d'un orgue post-symphonique : cinq fonds de 8' au grand-orgue, trois (plus la Voix céleste) au récit, ou on trouve également la Flûte octaviante et le Basson-Hautbois. Il y a les deux accouplements à l'octave du récit sur le grand-orgue. On y trouve une innovation : un crescendo général, commandé par la pédale d'expression.
La Tierce
La facture d'orgues était alors en rapide évolution, et souvent à la recherche de couleurs plus "classiques". C'est sûrement ce qui explique une remarquable surprise, qui ne figurait jusqu'à présent dans aucun inventaire : le tirant "Quintaton 16'" du récit correspond à une Tierce 1'3/5. Evidemment, dans ce cas, on pense aussitôt à une transformation ultérieure. (Le Quintaton aurait été remplacé par une Tierce à l'époque néo-classique.) Sauf que... cette Tierce paraît réellement être d'origine : elle possède des encoches d'accord dans les basses, et elle est placée sur une faux-sommier commun à avec la Voix-céleste, qui n'a pas été modifié. Reste qu'elle est placée au fond du sommier, là ou se trouve effectivement le Quintaton 16' quand il est présent dans un orgue Rinckenbach. L'hypothèse la plus crédible est donc qu'un Quintaton 16' était prévu à l'origine (la console et la disposition du sommier en témoignent), mais que Joseph Rinckenbach lui-même qui mit finalement une Tierce à la place. Si cela était confirmé, ce serait une des premières manifestations de l'esthétique qui sera plus tard appelée "néo-classique". Il est probable que le changement de la porcelaine à la console était prévu pour plus tard. Mais on se doute que ce qui était prévu pour plus tard en 1913... n'a pas toujours été fait.
On connaît l'intérêt de Joseph Rinckenbach pour les Mutations : à Russ, il revint en 1929 ajouter un Nasard 2'2/3 sur un sommier supplémentaire. Mais les Nasards n'ont jamais totalement disparu, contrairement aux Tierces indépendantes (hors des Cornets ou des Mixtures) qu'on ne construisait plus depuis des décennies. Elles ne reviendront "à la mode" que bien plus tard. On trouve une Tierce indépendante au récit du Bonhomme, mais c'est en 1928 !
Les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités le 03/03/1917. Mais comme ils sont purement décoratifs (la façade est muette), la partie instrumentale n'a absolument pas été affectée. [IHOA]
On sait que la façade a été remplacée "après 1926", mais pas par qui. En tous cas, elle est très belle. Cet instrument n'a nécessité aucune intervention majeure en plus d'un siècle de service. Dire que certains théoriciens continuent à seriner que la transmission pneumatique est peu fiable !
Caractéristiques instrumentales
| C | fis |
| - | 4' |
| 2'2/3 | 2'2/3 |
| 2' | 2' |
| 1'3/5 | 1'3/5 |
 Le porte-partitions "king size" n'est bien sûr pas d'origine.
Le porte-partitions "king size" n'est bien sûr pas d'origine.Console indépendante face à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirants de jeux de section ronde avec porcelaines frontales, disposés en une seule ligne au-dessus du second clavier. Les porcelaines sont à fond blanc pour le grand-orgue, rose pour le récit, et bleu pour la pédale. Les tirants de la pédale sont à gauche, puis viennent ceux du récit, et le grand-orgue est à droite. Claviers blancs.
Commande des accouplements et tirasses par taquets (manuels) à accrocher (en "L", comme les pédales habituelles, mais en plus petit), en fer forgé, placées sous le premier clavier, à gauche, et repérées par des porcelaines rondes disposées au-dessous : "Super-octavk. II a. I" (II/I 4'), "Sub-octavk II a. I" (II/I 16'), "II a P." (II/P), "I a P." (I/P), "II a I." (II/I). Ces porcelaines sont bicolores, et respectent le code de couleur, "II a P." étant par exemple rose en haut et bleue en bas.
Commande des combinaisons fixes par 7 pistons blancs, situés sous le premier clavier, du côté droit, et repérés par de petites porcelaines rondes placées en dessous : "PP.", "P.", "MF.", "F.", "FF.", "Tutti", et "0" pour l'annulateur. A leur droite, il y a le piston activant le crescendo ("General crescendo"), qui est alors commandé par la pédale basculante d'expression du récit, et son annulateur ("0"). Cette pédale basculante est la seule commande à pied.
Plaque d'adresse en position centrale, au-dessus du second clavier, à l'horizontale, constituée de lettres en laiton incrustées sur fond foncé, et disant :
Ammerschweier (Els.) Opus 141

Pneumatique tubulaire, notes et jeux.
A membranes, de Rinckenbach. Les sommiers du grand-orgue sont diatoniques, en "M" (basses aux extrémités), et disposés de façon conventionnelle derrière la façade. Récit également diatonique, en "M" ; la boîte expressive est placée à l'arrière et en hauteur, du côté gauche et dépassant légèrement le milieu.
Cette boîte expressive est particulièrement efficace, mais aussi très progressive, la place intermédiaire entre fermé et ouvert étant très étendue.
Majoritairement à entailles, la tuyauterie est intègre et cohérente. Bourdons à calottes mobiles. Les matériaux utilisés sont ceux de prédilection au cours du début du 20ème : zinc, spotted, étoffe.
 Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.
Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.Le centre de l'orgue est à gauche. De bas (avant de l'instrument) en haut :
le Principal 8', le Bourdon 16', le Salicional, la Gambe,
la Flûte majeure en bois et sans faux-sommier,
le Bourdon 8', le Principal 4', la Mixture et la Trompette.
 Une vue sur la tuyauterie du récit, depuis l'avant.
Une vue sur la tuyauterie du récit, depuis l'avant.En haut, le fond de l'orgue. De bas en haut :
le Hautbois, l'Octavin, le Nasard, la Flûte 4', le Bourdon 8', la Gambe 8',
le Principal 8', la Voix céleste, et, au fond, la fameuse Tierce.
Noter les deux tuyaux graves en spotted du Principal : ils ont été "mis en vedette".
Joseph Rinckenbach est coutumier du fait, et dispose souvent un ou deux tuyaux
de façon originale.

Cet orgue est un précieux témoin du niveau qu'avait atteint la facture d'orgues alsacienne avant 1914. Il offre d'innombrables possibilités de registration, est fort agréable à jouer et bénéficie de la magnifique harmonisation si distinguée caractéristique des orgues issus de la maison d'Ammerschwihr.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 06/07/2020
Remerciements à Georges Sattler.
-
[MFoisset] Martin Foisset : , 07/07/2020,23/07/2020
Photos du 06/07/2020 et relevé technique.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 74b
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 144
- [PMSSUND1983] Pie Meyer-Siat : "Les Frantz, facteurs d'orgues dans le Sundgau", in "Annuaire de la Société d'Histoire Sundgauvienne", 1983, p. 135
- [Sundgau1943-48] L. Freyther : "Aus Hegenheims Vergangenheit", in "Annuaire de la Société d'Histoire Sundgauvienne", 1943-48, p. 37
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 216-7
![]() Localisation :
Localisation :