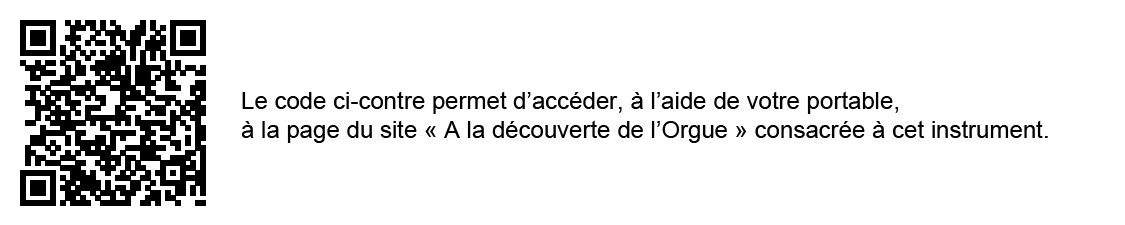Le Bonhomme, l'orgue Joseph Rinckenbach.
Le Bonhomme, l'orgue Joseph Rinckenbach.Les photos sont de Martin Foisset, 06/06/2021.
En 1928, Joseph Rinckenbach plaça au Bonhomme un orgue neuf destiné à remplacer celui qu'il avait construit avec son père juste avant la guerre. Mais l'histoire des orgues du Bonhomme commence dès 1842, et se révèle plutôt surprenante.
Historique
Le premier orgue du Bonhomme a été construit en 1842 par Valentin Rinkenbach, d'Ammerschwihr. [IHOA] [PMSRHW]
Il n'est pas étonnant que l'on se soit adressé au facteur installé juste à l'entrée de la vallée. Mais ce qu'on lui demanda est plus original. Car l'instrument présentait une caractéristique notable : une console indépendante. En 1842, c'est fort probablement la première d'Alsace. Cet orgue était en effet conçu comme celui de Soppe-le-Bas (lui aussi construit en 1842), mais il devait en plus disposer d'une Physharmonica, expressive et installée à l'intérieur de la console indépendante (tournée face à la nef). [PMSRHW]
Le devis du 08/07/1841 précise en effet : "L'orgue sera disposé et placé de manière à ce que l'organiste en jouant puisse être tourné vers l'autel ; les deux claviers seront donc entièrement séparés du grand jeu appelé Manuel, et tous les registres seront alors adaptés à ce buffet additionnel, dans lequel sera placé l'instrument appelé ci-dessus Physharmonica ; il y aura également à l'extérieur de ce second buffet des sifflets postiches faits en étain pour figurer un positif". [PMSRHW]
Valentin Rinkenbach appelle "buffet additionnel" la console indépendante (qui n'avait à l'époque... pas encore de nom). Par "les registres seront [...] adaptés à ce buffet additionnel", il veut dire que les tirants de jeux seront bien placés à la console, et non dans le buffet principal, dans le dos de l'organiste.
Cette console indépendante devait être placée à fleur de tribune, et disposer de tuyaux de façade décoratifs. C'était donc fort probablement une seconde première : le premier positif de dos postiche d'Alsace.
En tous cas, l'orgue du Bonhomme était résolument novateur. Alors que la facture d'orgues alsacienne allait encore se crisper pendant plus de 30 ans dans ce qu'on a appelé "l'orgue de transition" (Stiehr, Callinet), cet instrument fait exception : il innove, et écoute les organistes qui en ont assez de jouer avec la tête dans une armoire, comme c'est le cas pour les consoles en fenêtre. Et d'où vint l'innovation ? Pas d'une "tribune en vue" d'une métropole régionale (Strasbourg, Colmar, Mulhouse). D'une vallée Welsche que l'on pouvait croire à l'écart des grands mouvements culturels. (Il est vrai qu'à Strasbourg, à la même époque, on était très occupé à tailler et bouturer les fameux Silbermanns que-le-monde-entier-nous-envie...) Notons que le jalon fondateur de l'orgue romantique en Alsace a été posé en 1857 à Husseren-Wesserling, qui est une autre vallée vosgienne. Les "campagnes" n'étaient absolument pas à la traîne des cités, comme le laissaient croire certains vieux clichés.
L'orgue fut reçu le 08/11/1842 par le maire Joseph Ancel, deux membres du conseil municipal (nommés) et... quatre organistes (non nommés). [PMSRHW]
Le jour de la Fête-Dieu 1858 (06/06/1858), un pétard mit le feu à un toit en chaume, et un grand incendie ravagea le centre du Bonhomme, réduisant en cendres l'église, l'orgue, et la première console indépendante d'Alsace. [PMSRHW]
Historique
Dans le nouvel édifice tout juste achevé, en 1863, on installa un orgue de Joseph Merklin. [IHOA] [PMSRHW] [YMParisAlsace]
C'est-à-dire un orgue romantique d'esthétique parisienne. Les aspirations de 1841 n'étaient donc absolument pas anecdotiques. Et en 1862, la "solution naturelle" était de commander un Callinet, qui bénéficiait du statut d'orgue "comme il faut".
Pour comprendre sur quelles bases se sont faits les choix pour acquérir un orgue, il est souvent intéressant de voir comment il était entouré :
- A Orbey, il y avait un orgue du 18ème, construit par Rabiny en 1788.
Même à supposer que cet instrument fut encore jouable en 1862 (il a été remplacé dès 1869), inutile d'être grand clerc pour supposer que les commentaires furent "Euh... oui, mais non..."
- Dans la vallée voisine de Ste-Marie-aux-Mines, il y avait quatre orgues de Joseph Callinet : Ste-Croix-aux-Mines (1834), et trois à Ste-Maire-aux-Mines (celui de l'église Luthérienne des Chaînes, celui du temple réformé - datant tous deux de 1847 - et Ste-Madeleine, construit en 1849).
- A Lapoutroie, il y avait aussi un orgue de Joseph Callinet (1851),
- et à Aubure, un instrument de son frère cadet Claude-Ignace Callinet (1833).
Mais c'est à Joseph Merklin que l'on demanda un devis, qu'il envoya le 14/09/1860. La commande fut passée, et un supplément ajouté le 30/08/1862. L'orgue a été reçu le 08/01/1863 par Constant Sieg, Schuhmacher (Rudlin, Vosges), Laubser (architecte du département), ainsi que Théophile Stern, M. Simon (Lapoutroie) et Gaspard Vogt (Colmar). Le récit (sans octave grave) était doté d'un Octavin et d'un Hautbois (il y avait une Trompette au grand-orgue). Il était question d'un Cor anglais à la place de la Clarinette. Pas de Doublette du grand-orgue. Trompette et Bourdon 16' du grand-orgue étaient coupés en basse+dessus, ce qui était conforme à une tradition locale bien ancrée. Comme pour beaucoup d'orgues Merklin d'Alsace, le buffet été construit par la maison Klem. [YMParisAlsace]
Le 08/01/1863, "L'industriel Alsacien" écrivit : "Jeudi 8 janvier, aura lieu, dans la belle église du Bonhomme, construite par M. l'architecte Laubser, de Colmar, l'inauguration solennelle du nouvel orgue sorti des ateliers de la Société Anonyme pour la fabrication des grandes orgues, établissements Merklin-Schütze, à Paris et à Bruxelles. Les plus habiles organistes de l'Alsace prêteront leur concours pour faire entendre et apprécier la puissance de sonorité et les qualités de ce nouvel instrument construit d'après les procédés de la facture moderne." [YMParisAlsace]
Une deuxième fois, Le Bonhomme avait résolument fait preuve d'innovation.
Historique
En 1913, Martin et Joseph Rinckenbach placèrent leur opus 139 à Diedolshausen. (Nom allemand du Bonhomme, en vigueur à l'époque, où l'on retrouve la référence à Saint Dié, car "le bon homme" désigne Deodatus vivant en ermite). [IHOA] [Barth]
Cinquante ans après sa construction, l'orgue Merklin a donc bel et bien été remplacé (i.e. avant la guerre ; il n'a pas été endommagé). Un fait est donc indéniable : on plaçait la facture Rinckenbach bien au-dessus de celle de Merklin, puisqu'on est allé jusqu'à procéder à ce remplacement. On ne sait pas si ce premier orgue Rinckenbach était logé dans le buffet Klem de 1863, mais il est probable qu'il aurait été un peu à l'étroit.
 La plaque d'adresse de Martin et Joseph Rinckenbach à Zimmerbach
La plaque d'adresse de Martin et Joseph Rinckenbach à Zimmerbach(opus 136, 1913) : celle de l'orgue du Bonhomme de 1913 devait être semblable.
On peut parier que les jeux figurant sur cette photo, appartenant au
"premier cercle" des jeux symphoniques, étaient également présents au Bonhomme.
On ne sait à peu près rien de cet orgue. Il est noté à 22 jeux sur la liste du "dépliant Lapresté" (2 manuels et pédale). Pour se faire une idée de ce qu'il a pu être, on peut se rendre à Hégenheim, où se trouve un autre orgue d'Ammerschwihr construit en 1913, et qui compte 21 jeux. Mais aussi tout simplement à Lapoutroie (bien qu'à 33 jeux, celui-ci soit considérablement plus grand). En effet, les deux orgues de Lapoutroie (opus 122) et du Bonhomme (opus 139) ont été posés la même année.
On trouvera sur la page consacrée aux compositions des orgues Martin et Joseph Rinckenbach de 1899 à 1917 plus de détails sur le contexte esthétique.
En 1917, c'est l'intégralité de la tuyauterie métallique (884 kg) qui a été pillée. [IHOA]
Voisine de la Tête-des-Faux, la localité a été occupée par les troupes dès le début de la guerre. En 1918, il ne restait en gros de l'église que quatre murs.
Historique
Pour remplacer l'orgue perdu pendant la guerre, Joseph Rinckenbach construisit en 1928 pour le Bonhomme l'opus 177 de la maison d'Ammerschwihr. [IHOA]
Les deux orgues (celui de 1913 et celui de 1928) figurent dans les listes des instruments neufs de la maison Rinckenbach. Il ne s'agissait donc pas ici d'une reconstruction de l'orgue perdu. D'ailleurs, cette composition de 1928 est fort différente de celles d'avant-guerre.
Car le contexte avait changé :
- à Strasbourg, Edmond-Alexandre Roethinger pratiquait une évolution du style romantique inspirée de la Réforme alsacienne de l'orgue (théorisée par Emile Rupp, qui atteint son apogée à Erstein ; l'original orgue de Saint-Bernard date de 1927).
- En 1928, Georges Schwenkedel, qui avait beaucoup voyagé et expérimenté, s'était mis à son compte depuis 4 ans pour tracer sa voie propre, en valorisant des techniques issues de l'école Walcker (Largitzen, 1928).
- Joseph Rinckenbach, héritier d'une maison plus ancienne, pouvait conserver pour ses orgues une base symphonique très marquée, mais ouvrait ses compositions aux Mutations, Doublettes, Clairons et Cornets. Celle du Bonhomme intègre des éléments que l'on qualifiera plus tard de "néo-classiques" : Doublette et Tierce indépendante au grand-orgue, Plein-jeu de 4 rangs au récit, qui est aussi doté d'un Clairon et d'une Voix humaine.
Le côté néo-classique est ici nettement renforcé, de façon spécifique : avec l'accouplement en 4', le récit dispose d'un plein-jeu en 1' (à 3 rangs dans l'octave supérieure). Et il y a de fait un Piccolo 1' (car l'Octavin 2' est doté de 68 notes, et constitue alors un Piccolo 1' complet). Souvent, dans les orgues post-romantiques, les jeux aigus ne sont pas "complétés" par l'octave supérieure (56 notes et non 68). Le faire ici était un choix esthétique, d'autant plus que ce jeu est très sonore : il est "présent" même dans le tutti.
On trouvera sur la page consacrée aux compositions des orgues Joseph Rinckenbach de 1918 à 1931 plus de détails sur les évolutions esthétiques postérieures à la guerre.
En 2019, la statue du Roi David, victime des xylophages, a été traité et relevée. [Visite]
Le buffet
Le buffet, en chêne, présente un dessin très élaboré et original. Son style est éclectique, et plutôt néo-roman. Les lignes de composition en triangle sont chères à l'orgue romantique, et on les retrouve ici, matérialisées par les deux éléments séparant les trois tourelles rondes frontales. La plus grande est au centre. Les deux tourelles latérales (de 5 tuyaux) ont un entablement d'inspiration classique, mais sur la centrale, l'entablement est découpé pour constituer deux fleurons latéraux. Les plates-faces sont à deux étages, doubles en bas et triples en haut, avec des arcs en plein cintre. La ligne oblique au sommet est rehaussée de créneaux.

Il y a trois statues : sur la tourelle gauche, un ange jouant du cornet à bouquin, sur la centrale, le Roi David jouant de la harpe, et sur celle de droite, Sainte Cécile jouant un orgue portatif (muni d'un soufflet cunéiforme).


La "signature visuelle" de ce buffet est assurément la présence de deux tourelles de flanc (c'est-à-dire regardant sur les côtés, car disposées à l'avant contre les flancs de l'orgue). Elles ont la même forme que les tourelles (frontales) latérales, avec 5 tuyaux et un entablement classique, mais sont un peu moins hautes.
Caractéristiques instrumentales
| C | f | f' | gis''' |
| 2' | 2'2/3 | 4' | - |
| 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 4' |
| 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |
| 1/3' | 1' | 1'1/3 | 2' |
 La magnifique console indépendante de 1928.
La magnifique console indépendante de 1928.Après une série de consoles spectaculaires, multipliant les commandes,
voici une version plus épurée.
Console indépendante, frontale, dos à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos à porcelaines de couleur, placés en ligne au-dessus du second clavier. Les porcelaines sont à fond blanc pour le grand-orgue, bleu clair pour la pédale, et rose pour le récit.
Claviers blancs, à frontons biseautés.
Commande des accouplements par pédales à accrocher. De gauche à droite : "II aiguë-I" (II/I 4'), "II grave-I" (II/I 16'), "II-P", "I-P", "II-I", "G.O." (I/I). Suivent les pédales à bascule de l'expression du récit ("Expression") et du crescendo ("Crescendo général"). Commande du trémolo du récit par pédale à accrocher ("Tremolo").
Commande des combinaisons fixes par pistons blancs, placés sous le premier clavier. De gauche à droite : (la porcelaine "P." a disparu), "F.", "T." (tutti), "O." (annulateur). Il n'y a pas d'appel du crescendo. Sa position est indiquée par un cadran / fenêtre linéaire, placé au centre au-dessus du second clavier, et muni d'un curseur blanc. Le cadran est accompagné deux petites porcelaines rondes : en bas à gauche "PP." et à droite "FF".
Le Tutti par combinaison appelle les accouplements à l'octave, mais le crescendo ne le fait pas, même à fond. Il faut donc les ajouter pour "parachever" le crescendo. Cela permet aussi de réaliser un crescendo avec les octaves aiguës plus tôt dans la progression.
 L'indicateur du crescendo.
L'indicateur du crescendo.Banc d'origine, donc les flancs figurent une lyre.
Plaque d'adresse située à gauche, à hauteur du premier clavier, sur la partie inclinée, en laiton incrusté :
Manuf re de Grandes Orgues
Opus 177 AMMERSCHWIHR (Ht RHIN)
 La plaque d'adresse Rinckenbach au Bonhomme.
La plaque d'adresse Rinckenbach au Bonhomme.Cette console est de type Ingersheim / Scherwiller (conçues juste après-guerre). Mais la raison sociale de l'entreprise a changé en 1926 : c'est ici "J. Rinckenbach et Cie". C'était déjà le cas à Kintzheim (opus 173, 1926), et jusqu'à 1928. On retrouve cette plaque (portant le numéro d'opus 183) à Montebourg (Manche). C'est probablement la dernière de ce style, car l'orgue de Brunstatt, bien que portant le numéro opus 179, avait déjà été livré avec une plaque "Rinckenbach et Cie"). Après cela (au moins à partir de l'autre opus 183 - il y en a deux - à Schweighouse-près-Thann), "Ammerschwihr" ne figure plus aux plaques d'adresses de Rinckenbach, car Joseph n'a plus le droit d'utiliser ce nom, dont les droits ont été vendus à Lapresté.
Le nom des jeux, sur certaines porcelaines des dominos, a l'air calligraphié : par exemple pour "Basson", les deux "s" sont légèrement différents. Entre les jeux, la forme des lettres peut varier considérablement : par exemple, pour la plupart, le signe prime abrégeant "pied" est constitué d'un point, puis d'une queue remontante puis descendante. Mais pour "Doublette 2'", c'est un signe oblique simple, plus proche de la typographie habituelle du signe "prime". Les deux "t" de "Doublette" sont tellement semblables que l'on peut se demander s'il n'a pas été fait usage de caractères de transfert. Ceux-ci étaient très populaires après la seconde Guerre mondiale, mais il y avait peut-être un équivalent dans les années 20. (Surtout lorsque le support était en céramique.) En tous cas, le graphisme de ces porcelaines est rarement homogène pour un même instrument : il y avait probablement, dans une boîte de l'atelier, un petit stock de porcelaines, contenant sûrement beaucoup de "Flûte 8'", "Salicional 8'" et "Soubasse 16'". Peut-être même trois boîtes : une pour les blanches, une pour les roses, et une pour les bleues. Quand un nom de jeu venait à manquer, on devait entendre (après un juron) "Il va falloir en refaire quelques unes de comme ça".
Pneumatique tubulaire, notes et jeux.
A membranes, de Rinckenbach. Les sommiers du grand-orgue sont diatoniques. Il y en a deux pour les "grands jeux", dans le soubassement (à environ 70cm du sol), en "M" (basses contre les flancs). Et deux pour les "petits jeux", en hauteur (à environ 140cm des précédents), en mitre (basses au centre, sur la ligne médiane du buffet). Quatre sommiers diatoniques pour le récit : deux à l'avant, et deux contre le fond, de l'autre côté d'une passerelle ; ils sont en "M". La boîte expressive est constituée de deux niveaux de jalousies, avec un décrochement.
A la pédale, la Contrebasse 16' et le Basson 16' sont contre le flanc droit du buffet, chromatiques et faisant un aller-retour (C au fond). La Soubasse et la Flûte 8' occupent le reste du soubassement.
 Une vue sur une partie de la tuyauterie du grand-orgue.
Une vue sur une partie de la tuyauterie du grand-orgue.(Sommier des grands jeux.)
De gauche (avant de l'orgue) à droite (passerelle) :
la Montre 8', le Bourdon (à cheminées) 16', le Salicional 8',
la Flûte 8' toute en bois, et le Bourdon 8'.
Deux autres sommiers diatoniques portent les "petits jeux" du grand-orgue, avec, de l'avant vers l'accès : le Principal 4', le Nasard, la Doublette et la Tierce. Tous ces jeux sont d'origine. Le "C" de la Tierce est marqué à la pointe sèche :
 "Tierce 1 3/5 / I M / C"
"Tierce 1 3/5 / I M / C"On retrouve les mêmes marques à Rosheim.
 Une vue sur les sommiers avant du récit.
Une vue sur les sommiers avant du récit.De gauche (jalousies) à droite (passerelle) :
le Bourdon 8', la Flûte harmonique 4', l'Octavin 2', le Plein-jeu,
le Clairon et la Voix humaine.
A droite, de l'autre côté de la porte, on aperçoit des
tuyaux de la Flûte 8' de pédale.
 Le sommier arrière gauche.
Le sommier arrière gauche.De gauche (passerelle) à droite (fond) :
le Basson/Hautbois, la Trompette, la Gambe 8', le Principal 8',
la Voix céleste, et le Quintaton 16'.

En 1913, le Bonhomme et Lapoutroie avaient reçu des orgues Rinckenbach presque en même temps. Mais, victime de la guerre, celui du Bonhomme a été remplacé plus tard, toujours par la maison d'Ammerschwihr. Aujourd'hui, on mesure à quel point ils sont différents, alors qu'ils n'ont finalement que 15 ans d'écart. Ils sont surtout complémentaires : ces deux instruments racontent l'histoire de l'orgue alsacien pendant le premier tiers du 20ème siècle : innovante, imaginative, variée.
Ce qui caractérise avant tout cet instrument - comme ses contemporains les plus réussis - c'est sa dynamique, et la richesse des timbres. Il y a de multiples façons de jouer pianissimo, là où d'autres esthétiques ne proposent finalement que de se limiter au Bourdon 8'. Avec des octaves aiguës "réelles", chaque jeu de 8' du récit est aussi un 4'. Le Plein-jeu du récit peut atteindre une densité et une expressivité impossibles à retrouver dans un orgue dépourvu de plan sonore expressif et sans accouplements à l'octave.
Mais en dehors des considérations techniques essayant d'expliquer ses performances, c'est avant tout un instrument de musique exceptionnel et attachant que l'on trouve au Bonhomme. Cette localité le mérite bien, car depuis 1842, l'orgue y est un sujet important, pour lequel on a - malgré les coups du sort - su prendre le bonnes décisions.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 06/06/2021
Remerciements à Sébastien Marchand.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 29/06/2021.Document "Le Bonhomme, 06-06-2021.docx"
Photos du 06/06/2021.
-
[HSchlupp] Hervé Schlupp : e-mail du 14/10/2007.
Photos d'octobre 2007
- [YMParisAlsace] Yannick Merlin : "Orgues et organistes parisiens en Alsace (1860-1908)", in "L'Orgue, bulletin des Amis de l'Orgue", 2003-IV
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 40b
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 50
- [PMSRHW] Pie Meyer-Siat : "Valentin Rinkenbach, François Ignace Hérisé, les fils Wetzel, facteurs d'orgues", éditions Istra, p. 73-8
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 163,426
![]() Localisation :
Localisation :