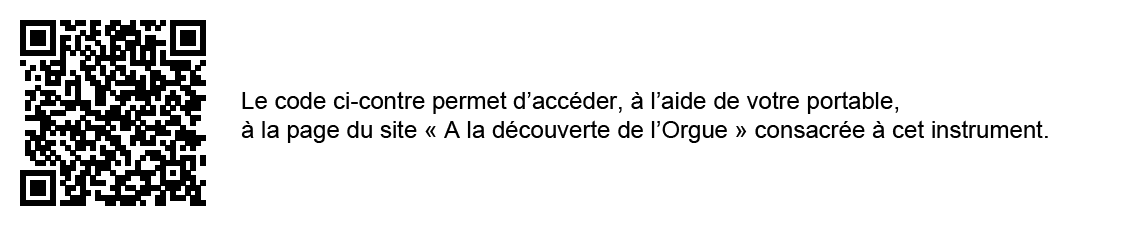Thannenkirch, l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach.
Thannenkirch, l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach.Toutes les photos sont de Martin Foisset, 22/04/2015.
Voici l'opus 140 de Martin et Joseph Rinckenbach, livré à Thannenkirch durant l'été 1913. Il est contemporain d'autres instruments remarquables construits à la fin de la Belle-époque par la maison d'Ammerschwihr : Dieffenbach-lès-Woerth ou Le Bonhomme. Comme celui de Muespach (1914), c'est un témoin émouvant et précieux d'une époque qui fut féconde et prometteuse... avant que l'élan ne fut brisé et que Europe ne se mette à se déchirer. Après 1918, plus rien n'allait être pareil. Mais l'histoire des orgues de Thannenkirch commence déjà au premier tiers du 19ème.
1836
Historique
En 1836, Claude-Ignace Callinet plaça à Thannenkirch un petit orgue, probablement neuf. [IHOA]
Ce sont les budgets communaux qui ont gardé trace de son prix, correspondant à un instrument de petite taille. La chronique paroissiale relate l'achat, vers 1834, d'un orgue "d'occasion", mais le buffet (conservé) est bien un Callinet du "petit modèle", de style compatible avec 1836, et paraît indiquer à coup sûr que l'on avait finalement opté pour un orgue neuf. Dans son étude, Hamel le note à 10 registres, avec un manuel seulement. Il est donc possible que l'orgue de 1836 n'avait même pas de jeux de pédale. [PMSCALL]
Tout ceci est corroboré par le fait que Claude-Ignace (bien que menant son affaire seul, sans son frère avec lequel il s'associa plus tard) parvint à réaliser 4 orgues en 1836 : Thannenkirch, Galfingue (I/P 18j, partie instrumentale reconstruite en 1923), Heidwiller (I/0P 8j, dont la tuyauterie a été pillée en 1915) et Hochstatt (1 seul manuel aussi, considérablement modifié par la suite). L'orgue de Thannenkirch était probablement jumeau de celui de Heidwiller. Là-bas, le pédalier (de 15 notes seulement) n'agissait qu'en tirasse. Il y avait 8 jeux sur l'unique clavier, et deux chapes laissées vides pour une extension future. C'était donc un "10 jeux", exactement le même nombre que celui noté par Hamel pour Thannenkirch.
En 1899, l'église (qui datait de 1769) a été agrandie. La nef fut allongée de 8 mètres, et l'orgue, évidemment, devait du coup paraître encore plus petit. [Barth]
La chronique paroissiale raconte aussi qu'on avait demandé une expertise à Henri Wiltberger (Colmar). Sa conclusion était claire : le petit orgue était irréparable. [PMSCALL]
Fait révélateur : aucun des quatre petits instruments construits par Claude-Ignace Callinet en 1836 n'a été conservé en l'état. Le bon sens suffit à l'expliquer : les organistes de la fin du 19ème étaient fort bien formés, surtout grâce aux écoles normales, qui les dotaient d'un solide répertoire. Celui-ci exigeait deux claviers et un pédalier complet. Il eut été regrettable de brider leurs prestations, et de laisser à la longue perdre leurs compétences, en conservant un instrument inadapté. De plus, ces petits instruments âgés d'environ 70 ans, devaient nécessiter, malgré leur "rusticité", des réparations d'envergure. Ce qui était le cas à Thannenkirch.
Enfin et surtout, les attentes du public - probablement beaucoup plus exigeant que ce qu'on a laissé croire à la fin du 20ème siècle - devaient se situer bien au-delà de ce que peut proposer un instrument de 8-10 jeux à un seul manuel.
Tout ceci ne doit pas minimiser la portée historique et culturelle de ces petits orgues construits vers 1820-1840, dans un style souvent qualifié de "transition" ou "pré-romantiques". Leur principal impact a été de constituer des traditions musicales locales bien ancrées. Fortes de cette expérience, les communautés ont pu, plus tard, mener avec succès des projets de plus grande envergure. Un fait révélateur venant étayer cela est la conservation, en 1913, du buffet de 1836 : bien que tout neuf, l'orgue devait ressembler, visuellement, à l'ancien. Même disparus, et malgré leurs possibilités très limitées, ces petits orgues ont laissé leur trace dans l'histoire en permettant l'élaboration du patrimoine actuel.
Historique
En 1913, Martin et Joseph Rinckenbach construisirent un orgue neuf, de 14 jeux sur deux claviers et pédale, avec octaves graves et aiguës. Il fut possible de conserver le buffet de 1836, avec ses plates-faces dessinant des lignes ascendantes depuis le centre et ses tourelles à entablement. L'instrument a été reçu le 26/07/1913. [IHOA] [ITOA] [Barth] [PMSCALL]
Voici la composition d'origine :
Ce changement radical de style doit être compris comme une démarche artistique et technique réfléchie et argumentée. Puisque de toutes façons, on l'a vu, l'instrument de 1836 devait être inadapté et avait été déclaré irréparable, les décideurs de Thannenkirch n'ont pas été confrontés aux choix liés à l'évolution d'un instrument existant. C'est un orgue tout neuf, "sur mesure", que l'on voulait. Ce qui devait représenter un effort considérable : deux manuels, pédale complète et 14 jeux pour une localité de cette taille, c'est plus que respectable, et cela témoigne même d'une forte ambition culturelle.
Rappelons la démarche esthétique : ces instruments sont issus du style romantique français (cela explique la Trompette au récit expressif et la Flûte octaviante). Au cours du dernier tiers du 19ème siècle, ce style évolua, pour proposer des couleurs plus "orchestrales". C'est l'orgue "symphonique", caractérisé par une grande dynamique sonore des ensembles, et une recherche poussée des caractères individuels des jeux (comme dans un orchestre, jouant sur les alternances ensembles/solos). Evidemment, le terme "symphonique" s'applique surtout aux grands instruments, comme ceux d'Obernai ou de Selestat (St-Georges).
Le principal défi, lors de la conception d'orgues comme celui de Thannenkirch, était d'adapter ce style symphonique aux instruments de taille "abordable" pour des petites communes. Ce que l'on voulait, c'est "un orchestre au village". Heureusement, les progrès techniques avaient permis une avancée considérable qui allait réellement permettre cette démarche ambitieuse : les accouplements à l'octave. (II/I 16', I/I 4'.) Par la magie de ces accessoires, un orgue de 14 jeux avec un récit de 6 jeux propose pratiquement la même dynamique sonore qu'un instrument de 14 + 2x6 = 26 jeux. Pour commencer, il faut une fondamentale solide, donc beaucoup de jeux de 8' et de 16', qui, même s'ils sont coûteux, sont indispensables pour que l'orchestre du village ne soit pas confondu avec une bande de moineaux.
On l'a vu, la Trompette est au récit, dans sa boîte expressive, ce qui donne accès à l'un des effets les plus appréciés de l'orgue symphonique, consistant à mélanger la Trompette aux jeux de fond, boîte fermée, avant d'ouvrir pour un crescendo qui s'accompagne d'un enrichissement des timbres. Toujours au récit, la Flûte octaviante ré-équilibre l'instrument vers les aigus, car la fondamentale est très solide : Flûte de concert 8', Gambe 8' et Quintaton 8' (ce dernier jeu a malheureusement disparu).
Le grand orgue a deux spécificités : le fondement sur 16' (le Bourdon 16', malheureusement éliminé en 1970 ; il était complété par l'accouplement à l'octave grâce des 8' du récit), et sa Mixture-tierce, grave (2'2/3) et qui doit être considérée comme un jeu "de couronnement", que l'on n'appelle que lorsqu'on a déjà tiré tout le reste. Les "canons" du style demandent normalement, à ce plan sonore, le "carré d'or romantique" de jeux de 8 pieds : un Principal, un Bourdon, une Gambe (ou un Salicional) et une Flûte. Les trois premiers sont représentés, et une seule concession a été faite : pas de Flûte ouverte. Pour en limiter les conséquences, le récit a été fondé sur une grande Flûte "de concert", qui vient "flûter" le grand-orgue dès que les claviers sont accouplés.
De façon cohérente avec le reste de la composition, la pédale, même si elle est limitée à deux jeux, dispose des deux tirasses. Elle propose donc l'habituel 16', et le 8' est une Gambe, colorée et orchestrale.
Les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités le 25/05/1917. Mais comme ces tuyaux (a priori de 1836) étaient purement décoratifs dans l'instrument de 1913, les prestations musicales n'ont pas été affectées. [IHOA] [PMSCALL]
En 1959, Paul Adam posa des tuyaux de façade neufs, en étain, et dota l'instrument d'un ventilateur électrique. [PMSCALL] [ITOA] [PlaquetteEglise]
Ici prend place un anecdote amusante. En 1961, lors de sa visite pour préparer son ouvrage sur les Callinet, Pie Meyer-Siat trouva l'orgue Rinckenbach. Il nota la composition, et confirma qu'à part le buffet, il ne fallait pas chercher à Thannenkirch quoi que ce soit qui vienne de Rouffach. Presque à regret (vu qu'il rédigeait un ouvrage quasi militant destiné à promouvoir les orgues Callinet), il dut admettre la qualité de l'harmonisation des jeux, et que l'orgue Rinckenbach était "soigné". Le contraste avec le ton employé pour décrire d'autres instruments ayant remplacé des Callinet, indique que "soigné" était ici un immense euphémisme, et donc un grand compliment ! [PMSCALL]
En 1970, Curt Schwenkedel fit une transformation, d'autant plus regrettable que c'est la seule qui ait altéré ce bel instrument de 1913. La partie instrumentale était parfaitement authentique à ce moment là. Bien que limitée à deux jeux seulement, cette altération toucha l'identité même de l'orgue, puisque c'est le Bourdon 16' manuel et le Quintaton de récit qui ont fait les frais de l'opération. Tout cela pour loger une Doublette au grand-orgue et un absurde Larigot au récit, ce dernier jeu étant totalement étranger à l'esthétique d'origine de l'instrument. [IHOA] [ITOA]
En 1983, il eut une réparation, par la maison Muhleisen. Malheureusement, rien ne fut fait pour restituer l'un ou l'autre des jeux perdus en 1970. [IHOA] [ITOA]
L'entretien est aujourd'hui confié à la maison Muhleisen. [Visite]
Le buffet
La partie avant remonte à 1846. Les Callinet ont construit de très nombreux buffets sur le même modèle. Les claires-voies des plates-faces sont ici constituées de roses (comme à Heidwiller) et non pas de marguerites comme pour les Callinet du début du siècle (Munwiller). Les marguerites faisaient référence à Marguerite Rabiny, épouse de François Callinet et mère de Joseph et de Claude-Ignace. Le passage aux roses est peut-être un symbole marial : 7 des 9 enfants de Claude-Ignace portent le nom de Marie (parfois composé, pour en faire un prénom masculin). La fille de Claude-Ignace née en 1835 (au moment de la réalisation de ce buffet) s'appelait Marie Elisabeth.
A l'arrière de cette partie ancienne, une clôture abrite le récit (en haut) et le soufflet (en bas), puis les deux jeux de pédale. Il y a un espace d'environ 1 mètre entre l'orgue et le mur du fond.
Caractéristiques instrumentales
 La belle console indépendante,
La belle console indépendante,caractéristique des orgues Rinckenbach achevés en 1913 et 1914.
Console indépendante face à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirants de jeux de section ronde, placés en ligne au-dessus du second clavier, à pommeaux tournés munis de porcelaines. Elles ont un fond bleu pastel pour la pédale, rose pour le récit, et blanc pour le grand-orgue. Claviers blancs.
Commande manuelle des tirasses et accouplements par petits taquets à accrocher, disposés sous le premier clavier, à gauche. De gauche à droite : "Super-octavk. I" (I/I 4'), "Sub. octavk. II a. I" (II/I 16'), "II a. P." (II/P), "I a P." (I/P), "II a. I". Les porcelaines rondes repérant les taquets respectent le code de couleur des plans sonores, ainsi "II/P" a un fond rose dans la moitié supérieure, et bleu dans la moitié inférieure.
 Les taquets à accrocher de commande des accouplements.
Les taquets à accrocher de commande des accouplements.Ce système est très efficace et rapide à manœuvrer.
Commande des combinaisons fixes par pistons blancs, placés sous le premier clavier, à droite. De gauche à droite : "PP.", "P.", "MF.", "F.", "Tutti", "0" (annulateur).
- PP. : I:{Salicional}, II:{Flûte de concert}, P:{Soubasse}
- P. : II+{Viole}, P+{I/P II/P}
- MF. : I+{Bourdon 8'}, P+{Violon 8'}
- F. : I+{Principal 8, Octave 4'} II+{Flûte octaviante 4'}
- Tutti : I+{Mixture, I/I 4', II/I, II/I 16-} II+{Trompette}
Les jeux altérés en 1970 ne sont pas appelés par les combinaisons : ils ont probablement été débranchés du mécanisme. Il reste donc à trouver la place du Bourdon 16' du grand-orgue et du Quintaton du récit.
L'accouplement des claviers à l'unisson (II/I) n'apparaît que dans le tutti, ce qui est fort surprenant. On l'attendait dès "Piano" (car sinon, avec le Salicional seul, le grand-orgue est moins fort que le récit, où la Flûte de concert et la Viole sont appelées). Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement, ou d'une erreur de remontage suite aux modifications de 1970.
A l'exception de deux porcelaines, toute la console est authentique.
Plaque d'adresse placée horizontalement sous les tirants de jeux, au centre, disant :
Ammerschweier (Els.) Opus 140
 La plaque Rinckenbach à Thannenkirch.
La plaque Rinckenbach à Thannenkirch.Ce modèle de plaque, faisant apparaître le numéro d'opus, a déjà été rencontré à Kiffis en 1912, mais avec une fonte de caractères un peu différente.
Ce modèle de console (avec tirants en ligne et taquets à accrocher) est apparu en 1912. On retrouve des consoles analogues à Schirmeck, Bootzheim, Oberlarg, Villé, Dieffenbach-lès-Woerth. Mais également à Muespach en 1914 (le dernier orgue Rinckenbach d'avant-guerre). Après-guerre, et pendant une dizaine d'années, on assiste au retour des consoles à dominos. Ce modèle semble avoir inspiré celui de la fin des années 20, décliné de façon différente (côtés des claviers, position de la plaque, commandes au pied), qui présente à nouveau des tirants (Vieux-Thann).
pneumatique.
à membranes.
Le système d'alimentation (une pompe à pied), à été conservé, à la droite du buffet, avec son indicateur de niveau de charge du réservoir (plomb coulissant verticalement) ; mais la ficelle est détachée).
Parfaitement adapté à son édifice et fort bien entretenu, cet orgue tient les promesses de sa plaque d'adresse : c'est vraiment un Martin et Joseph Rinckenbach, avec une harmonisation très plaisante. Il est doté d'une dynamique étonnante, malgré ses 14 jeux seulement, et ce par conception. (Et encore, il manque le Bourdon 16' manuel et le Quintaton !) Les deux accouplements à l'octave font merveille, et sont même au cœur de la registration. Tout est pensé en fonction de ces "accessoires", qui n'en sont plus, car ils sont devenus des composants indispensables à la registration.
La Trompette, qui est un jeu coûteux, a probablement nécessité en 1913 des efforts conséquents. Cela en valait la peine, car, s'il s'agissait bien d'une "petite folie" à l'époque, elle est très réussie, et confère aujourd'hui à l'orgue de Thannenkirch sa réelle spécificité. Déjà très attachant aujourd'hui, cet instrument serait à coup sûr exceptionnel si on lui rendait son Quintaton et son Bourdon 16' manuel. Ils ne seraient pas difficiles à restituer, puisqu'on pourrait prendre comme modèle ceux toujours présents dans l'orgue de Dieffenbach-lès-Woerth, qui est contemporain de celui de Thannenkirch.
![]() Activités culturelles :
Activités culturelles :
- 10/11/2002 : Récital de Vincent Coppey (Grenoble, St-Pierre).
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 22/04/2018
Remerciements à Jeanne Odile Gassmann.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 23/04/2018.Document "Thannenkirch, relevés sur place.pdf"
Photos du 22/04/2018.
- [PlaquetteEglise] Plaquette décrivant l'église, disponible sur place
-
[PRolli] Pascal Rolli : e-mail du 27/12/2005.
Photos du 20/11/2005.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 206a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 452
- [PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 166-7
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 366
![]() Localisation :
Localisation :