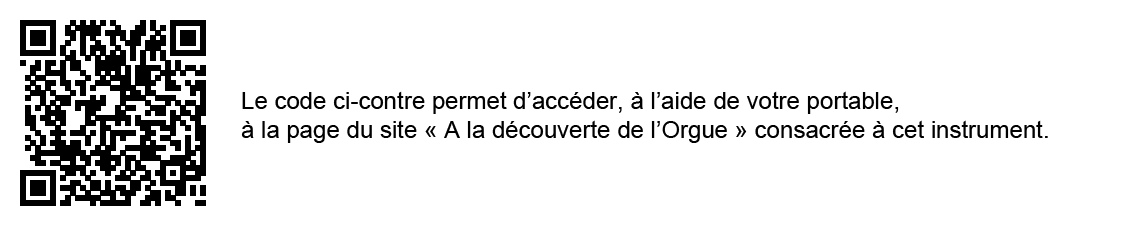Wolschwiller, l'orgue Joseph Rinckenbach.
Wolschwiller, l'orgue Joseph Rinckenbach.Toutes les photos de la page sont de Stéphane Linder, 07/01/2011.
Les "années 30" furent les dernières pour la maison Rinckenbach. Cet orgue ne figure pas dans la liste des opus de la maison d'Ammerschwihr, mais il n'en est pas moins intéressant, avec son buffet très spécial, pour partie hérité du tout début du 19ème, et sa composition se détournant un peu du néo-classicisme.
1809
Historique
En 1809, Jean I Franz plaça à Wolschwiller un instrument plutôt important (II/P 25r/23j), certainement le plus grand de sa production. [IHOA] [ITOA] [PMSSUND1983]
Le buffet de cet instrument constitue la partie centrale du grand corps de l'instrument actuel. Avec sa large tourelle centrale de 7 tuyaux, ce dessin était caractéristique de la production de Franz.
Quelques années plus tard, Franz vint installer son atelier à Wolschwiller, qui fut donc jusqu'en 1830 une terre de facture d'orgues.
Par analogie avec la composition proposée pour le couvent de Mariastein, on peut supposer que la composition était la suivante ('*' marquant les jeux attestés par leur évocation ultérieure) :
Jean Franz entretint son instrument, une dernière fois en 1827. [PMSSUND1983]
En 1855 les frères (Joseph-)Stanislas et Meinrad Burger effectuèrent des travaux à la soufflerie et des changements de composition, effaçant le "style suisse" pour rendre l'orgue plus ordinaire. [IHOA] [PMSSUND1983]
En 1870, c'est Meinrad Burger seul qui fit encore des travaux : ajout d'une Bombarde, modification à la transmission, au diapason, et aussi à l'harmonie. [PMSSUND1983]
On peut supposer que la composition était la suivante suite à ces derniers travaux:
En 1874, l'orgue de Wolschwiller reçut la visite du facteur Suisse Ferdinand Habertür (Breitenbach, CH). Il ne fit qu'un relevage, mais le fait que ce fut nécessaire quatre ans seulement après les travaux Burger confirme la réputation de peu de sérieux qu'ont acquise les frères. [PMSSUND1983]
En 1890, on demanda à Max Klingler de transformer l'orgue pour lui donner plus de couleurs romantiques. Il fallut élargir le grand corps du buffet de Franz d'1m24 (en lui ajoutant des parties latérales), et le positif de dos fut supprimé, sa partie instrumentale constituant un récit. L'espace vide dans la balustrade fut comblé avec les tuyaux de façade du positif de dos. L'instrument fut doté d'une console indépendante, tournée face à la nef. [ITOA] [PMSSUND1983]
On ne sait plus grand chose de cet instrument : dans les années 1980, lorsque l'histoire de l'orgue du lieu fut écrite, les instruments romantiques étaient systématiquement discrédités, et il était de bon ton de faire usage d'expressions telles que "le grand massacre". [PMSSUND1983]
Lors de sa réception, l'accueil fut très bon, et le procès verbal donne tous les indices permettant d'imaginer un orgue fort intéressant et réussi. Surtout du point de vue de l'harmonie, qui semble avoir été le point fort de Klingler. L'organiste (et instituteur) de Wolschwiller s'appelait alors A. Affholder, et son orgue devait être plein de possibilités. On peut supposer que la composition était la suivante :
Historique
En 1930, Joseph Rinckenbach construisit un instrument neuf dans le buffet Franz/Klingler. La réalisation d'un positif postiche a été confiée à la maison Rudmann et Guthmann (le simple alignement de tuyaux de façade comblant le vide laissé dans la tribune par l'orgue Klingler ne devait pas être très esthétique). [IHOA] [ITOA]
On peut se demander ce qui poussa Wolschwiller à remplacer un orgue de 40 ans, finalement pas très éloigné des standards ésthétiques de son époque, et déjà muni d'une console moderne. L'orgue Klingler était probablement très bien harmonisé, mais construit sur une base technique (sommiers en particulier) datant de Franz (1809), probablement pas conçue - au coeur de la révolution - pour affronter les siècles. En 1930, reconstruire un orgue en mécanique était inconcevable, à la fois pour des raisons de coût, mais aussi parce que le retour à une mécanique suspendue (la seule qui aurait vraiment fait la différence) aurait été exclu car la console indépendante apportait bien trop d'avantages, dont il était hors de question de se passer pour d'évidentes raisons pratiques. D'ailleurs, la console de Rinckenbach fut retournée (dos à la nef), dans la configuration préférée des organistes-chefs de choeur.
L'orgue possède une esthétique romantique très affirmée, et échappe un peu à la mode néo-classique qui s'était alors pourtant bien imposée, même dans la production de la maison d'Ammerschwihr. Sur une base ressemblant à ce qui a été fait à Ammertzwiller, mais avec un récit plus "étoffé", et sans Doublette au grand-orgue.
En 1992, il y eur un relevage, par Christian Guerrier. [IHOA]
L'orgue de Wolschwiller est donc un témoin précieux, authentique et intègre, des belles années 1930, très riches pour la facture d'orgue. Il est à classer dans la lignée des magnifiques instruments de Vieux-Thann ou d'Uffholtz.
Le buffet
Construit sur la base du petit buffet de Franz, le buffet complet actuel est plutôt de style néo-baroque. Sur le positif de dos (postiche) figure la devise "Soli Deo Honor et Gloria". Deux angelots forment un pendentif. Deux autres, dans le couronnement, se livrent à une vigoureuse querelle de trompettes, parmi quatre écussons fleuris. Jouées et claires voies librement inspirées du style rocaille, dorées, et ornées de motifis floraux. Minis pots-à-feu sur le positif.
Caractéristiques instrumentales
 La console indépendante de Joseph Rinckenbach.
La console indépendante de Joseph Rinckenbach.Console indépendante, dos à la nef, fermée par un volet coulissant. Tirants de jeux de section ronde disposés au-dessus des claviers, à porcelaines de couleur rose sombre pour la pédale, blanche pour le grand-orgue et rose pour le récit. Appels par pistons (4 avec l'annulateur), situés sous les claviers. Ordre des pédales : II/I 4', II/I 16', II/P, I/P, II/I, I/I, pédale d'expression basculante, Trémolo récit. Plaque d'adresse en laiton incrusté, placée du côté gauche.
 Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.
Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.
![]() Les Franz
Les Franz
Cette famille de facteurs d'orgues, dont le patronyme s'écrit indifféremment "Franz" ou "Frantz" selon les sources, était originaire d'Irtièmont (Liesberg, CH, situé juste à la frontière française, à quelques kilomètres de Wolschwiller). Une grande partie de son histoire reste à écrire.
L'entreprise semble avoir été fondée par Joseph I (? - 24/07/1791 à Liesberg), celui qui fit affaire avec le couvent de Mariastein pour un instrument conséquent et plein de personnalité (on dit qu'il influença plus tard Valentin Rinkenbach). Jean I (29/08/1769 à Liesberg – 21/11/1830 à Wolschwiller) s'est installé à Wolschwiller peu après 1810 pour adresser le marché sundgauvien. Jean Antoine (Anton) (~1792 - 27/04/1850 à Sondersdorf), fut d'abord instituteur à Sondersdorf (à l'origine un prétexte pour tenir l'orgue), mais vint rejoindre l'atelier Franz en 1838 (quand on s'aperçut, au bout de 10 ans, qu'avec un brevet "du 3 ème degré" seulement, il n'avait pas la qualification pour être instituteur). Il fit venir, et travailla essentiellement avec son frère Joseph II (~1788 - ?). Jean II (~1810 à Liesberg - ?), le fils de Jean I, s'installa plus tard à Cernay. De ses travaux, on en connaît guère qu'une réparation à Sondersdorf. [PMSSUND1983] [Zitierte]
Que reste-t-il de l'oeuvre des Franz ? Seulement quelques buffets, ainsi que de trop rares tuyaux : à Geispitzen (où l'orgue fut construit au tout début du 19ème pour Bettlach), on trouve encore trois jeux de pédale de Franz (une seule octave, l'étendue de la pédale à l'origine), plus le dessus de la petite Flûte, une partie de la Doublette, et le dessus du Nasard.
Malheureusement, à Geispitzen, les sirènes du synthétique ont sévi, au détriment du patrimoine, et on est pas près de pouvoir apprécier ces jeux dans un orgue en état de fonctionner.
- A Bendorf, l'orgue (sûrement Joseph) Franz de 1786 a été reconstitué par Christian Guerrier en 1996.
- L'un des buffets Franz les mieux conservés se trouve à Ligsdorf. Il date de 1809. La partie instrumentale a aussi été totalement refaite.
- En 1809 aussi, Jean I Franz construisit un grand instrument (II/P 24r) à Wolschwiller. Il n'en reste que la partie centrale du grand buffet.
- En 1809 toujours, Jean Franz a sûrement posé un orgue à Balschwiller.
- En 1810 à Sondersdorf, Anton et Joseph Franz construisirent le "petit frère" de l'orgue de Ligsdorf. Cet instrument a été reconstruit par Joseph Rinkenbach. Il était là aussi question de le reconstituer.
- A Bréchaumont puis à Fislis où il fut déménagé, il y eut un orgue Franz construit aux environs de 1826. Il a finalement été vendu à Eteimbes, où il disparut en 1954.
- En 1838, Joseph? (II?) Franz déménagea l'ancien instrument (Nicolas Boulay) de Pfaffenheim à Durlinsdorf.
- L'année suivante, en 1839, Anton construisit l'orgue de Ranspach-le-Haut. En matière de tuyauterie, on y trouve une partie du Cornet, du Bourdon et du Prestant qui sont authentiques.
- En 1841, Joseph et Anton Franz ont construit un orgue pour Werentzhouse. Il fut remplacé, dès 1890, par un magnifique instrument d'une toute autre envergure.
- On sait qu'Anton a réparé l'orgue de Attenschwiller (qui était alors installé à Tagsdorf) en 1849.
![]() Max et Titus Klingler
Max et Titus Klingler
 Le logo des frères Klingler.
Le logo des frères Klingler.Des frères Maximilien (1837-1903) et Titus (1839-1907) Klingler de Rorschach (CH), on retrouve des travaux à Bâle (Marienkirche, 1886), Eggenwil (1887, c'était déjà leur opus 33), Blauen (1890), Montsevelier (1890 - la localité est plutôt célèbre pour son Metzler...). L'entreprise avait été fondée au plus tard en 1851 par leur père, Bénédict Klingler (1808-1877, le frère de Vitus d'Ennetach, celui qui forma Alois Späth). Max travailla sans son frère à partir de 1891 (ou 1889). Parmi ses travaux : Appenzell (1892), Sevelen (1893), Zug (1895), Oberegg (1896), Willisau (1898) et Rorschach, Sacré-Coeur de Jésus (1901), jusqu'à sa mort (avec un superbe orgue à Weinfelden). Son affaire fut reprise par Auguste (Albert) Merklin (1860-1940) de Fribourg-im-Brisgau (D), apparenté à Joseph. C'est dans les ateliers Klingler de Rorschach que fut formé (en partie, entre 1895 et 1890) Jakob Metzler. [CPKlingler] [OFSG] [Zitierte] [OrguesEtVitraux]
![]() Webographie :
Webographie :
- [OFSG] http://ofsg.org : Sur Klingler : St-Galler Orgelfreunde : http://ofsg.org/wp-content/uploads/2011/06/RorschachHerzJesu-.pdf
- [OrguesEtVitraux] http://www.orgues-et-vitraux.ch : Le site "Orgues et Vitraux" donne beaucoup d'informations sur les orgues Klingler.
- [Zitierte] http://www.hslu.ch/m-odz-zitierte-orgelbauer-feb11.pdf : Zitierte Orgelbauer, sur le site de la Hochschule de Lucerne.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[SLinder] Stéphane Linder : e-mail du 08/05/2012.
Avec les photos de cette page.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 226a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 497
- [PMSSUND1983] Pie Meyer-Siat : "Les Frantz, facteurs d'orgues dans le Sundgau", in "Annuaire de la Société d'Histoire Sundgauvienne", 1983, p. 147-53
- [CPKlingler] Carte stale de la maison Klingler
![]() Localisation :
Localisation :