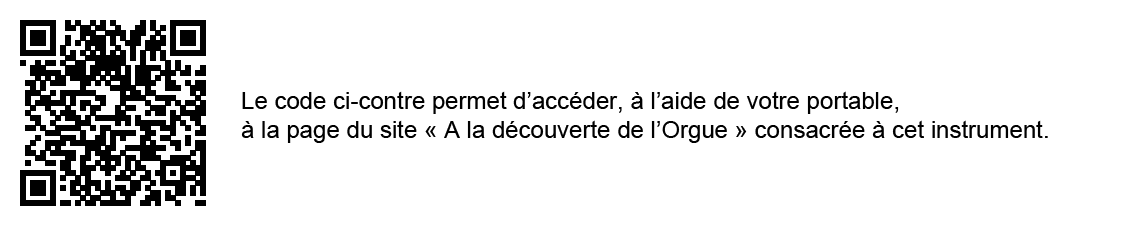Orgue muet, abandonné depuis 2003.
 Mulhouse, St-Paul, l'orgue Dalstein-Haerpfer.
Mulhouse, St-Paul, l'orgue Dalstein-Haerpfer.Les photos sont de Martin Foisset 13/09/2020.
La magnifique composition romantique de cet orgue Dalstein-Haerpfer, avec son Salicional de 16 pieds au récit, cache une bien triste réalité : cet orgue somptueux est abandonné depuis 2003. Quelle dommage que cet instrument, malgré une restauration exemplaire menée en 1995, ait été délaissé au profit d'un instrument neuf "provisoire". Il existait pourtant tant d'édifices sans voix (ou à la voix synthétique) où cet orgue neuf aurait été tellement utile... Malgré le classement de l'orgue Dalstein-Haerpfer, il est aujourd'hui difficile de savoir quel sera son avenir. Issu de la belle époque de la maison de Boulay, conçu avec la collaboration Albert Schweitzer, il fut l'outil privilégié du passé culturel rayonnant de la paroisse St-Paul. Son histoire commence en 1896.
Historique
En 1896, maison Dalstein-Haerpfer de Boulay livra ici son opus 122. [MulhouseStPaul1995]
C'est un instrument de taille plutôt raisonnable qui fut commandé pour le nouveau temple St-Paul. Le projet s'inscrivait dans une grande dynamique qui prit place à la fin du 19ème, consistant à doter Mulhouse de lieux de culte, de chorales et d'orgues appropriés. L'instrument fut posé en août, et reçu le 04/10/1896 par Eugène Münch (temple St-Etienne) et le pasteur Edmond Stern. L'instrument n'avait que 17 jeux à l'origine ; le récit était déjà expressif. Voici la composition en 1896 (accessoires et accouplements non précisés ; ils devaient être standards, comme à Pfaffenhoffen) : [MulhouseStPaul1995]
C'est André Stern (1875-1937) qui en fut le premier organiste. Il était élève d'Eugène Münch (1857-1898), organiste à l'église réformée St-Etienne (et frère d'Ernest Münch). On dit que les orgues ne sont pas des seulement instruments de musique, mais surtout des machines à faire rencontrer les gens : de fait, le 15/10/1902, André Stern épousa Rosalie-Jeanne Haerpfer, la fille d'un des facteurs ayant construit l'orgue de St-Paul. [MulhouseStPaul1995]
Malheureusement, le chauffage au gaz de l'édifice s'avéra totalement incompatible avec l'orgue : on signala des problèmes dès 1901. De plus, comme l'entretien fut concédé exclusivement à la maison Dalstein-Haerpfer, on peut en conclure qu'un autre facteur avait essayé de le maintenir, sans grand succès. En 1906, André Stern déclara l'orgue inutilisable. On envisagea même de le remplacer, mais finalement, en 1907, c'est le chauffage au gaz qui fut remplacé, par un système central à vapeur. Dès lors, le problèmes de l'orgue disparurent. [MulhouseStPaul1995]
Les compléments de 1908
En 1908, l'instrument fut complété, en le portant à 30 jeux, et doté d'une nouvelle console (indépendante et face à la nef). Les travaux furent confiés à la maison Dalstein-Haerpfer. Il conserva son numéro d'opus. [MulhouseStPaul1995] [Visite]
Le Dr G. Will avait pris la direction d'un chœur à St-Paul, et s'engagea activement dans la collecte de fonds. Son ami Albert Schweitzer proposa une nouvelle console, sur le modèle de celle de Cronenbourg. On décida d'agrandir le buffet existant, en lui ajoutant des plates-faces latérales. [MulhouseStPaul1995]
L'orgue était prêt à être monté le 13/02/1908, et il a été reçu le 22/02/1908 par Max Schlolchow (qui avait succédé à Eugène Münch). La composition de 1908 est la même que l'actuelle (2020). L'instrument donna totale satisfaction, et n'avait qu'un inconvénient : il nécessitait deux souffleurs ! Albert Schweitzer assura le concert d'inauguration le 15/03/1908, avec André Stern. [MulhouseStPaul1995]
Cet orgue d'exception, caractéristique du credo organistique d'Albert Schweitzer, est bien sûr à rapprocher de celui de Cronenbourg, St-Sauveur. Il en atteint pratiquement les proportions grandioses, puisqu'on ne note que l'absence de l'anche 16' de récit et du Principal 16' de pédale.
L'instrument fut au centre d'une activité culturelle très intense : André Stern invita de nombreux instrumentistes de premier plan pour des concerts spirituels. [MulhouseStPaul1995]
On présente parfois l'orgue de St-Paul comme "l'orgue de Schweitzer". C'est vrai, mais ce qu'il est avant tout, c'est l'orgue du public mulhousien de la Belle époque. Il est caractéristique des évolutions de l'esthétique romantique : il s'agit d'orgues populaires, avant tout destinés, par leur dynamique, leurs timbres "symphoniques" et les possibilités données à l'organiste, à enthousiasmer l'auditoire. Ils excellent dans les répertoires appréciés à l'époque, et malheureusement aujourd'hui tombés dans l'oubli, suite à l'élitisme exclusif de la vague "baroque" qui a sévi après les années 1960. Cet orgue n'est pas seulement l'orgue "de Schweitzer", c'est l'orgue de la communauté de l'église St-Paul et des musiciens de Mulhouse.
Les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités en 1917, et on note un petit relevage dans les années 1930. [Visite]
Malheureusement, en 1956, la console a été déplacée, certainement en même temps que fut construite une estrade destinée à agrandir la tribune. [MulhouseStPaul1995]
Les conséquences de l'allongement des tubulures de transmission furent calamiteuses : lorsque Schweitzer revint jouer l'instrument à la fin des années 50, il déclara, fort irrité : "L'orgue, c'était un cheval de cavalerie, c'est maintenant un cheval de labour." Une autre altération ne passa pas inaperçue à Schweitzer : on avait supprimé la Voix céleste ! [MulhouseStPaul1995]
Pas seulement la Voix céleste, d'ailleurs, puisque trois jeux avaient fait les frais d'une absurde opération de "baroquisation" : [MulhouseStPaul1995]
- la Trompette du grand-orgue, remplacée par... un Cromorne
- la Voix céleste, remplacée par une Quinte
- et le Clairon 4' du récit, remplacé par une Tierce.
Dans un rapport daté du 13/07/1992, Maurice Moerlen note que "Cet orgue était fort apprécié par le Docteur Albert Schweitzer. Par égard à ce qu'il représente pour nous tous et par égard aussi à tous nos devanciers qui se sont sacrifiés pour acquérir cet orgue, nous devons non seulement le sauvegarder, mais l'entretenir avec respect.". [MulhouseStPaul1995]
L'instrument a longtemps été tenu par Marguerite Loegel, qui, de toute évidence, l'appréciait particulièrement. Elle s'était fait construire un petit orgue d'étude par la maison Kern. Ce petit orgue a été par la suite acquis par le pasteur Frédéric Humbert, et il se trouve aujourd'hui utilisé comme orgue de choeur à l'église protestante de Munster.
En 1984, Daniel Kern remit la console à sa place, mais retournée dos à la nef (alors qu'elle était à l'origine face à la nef). [Visite]
En 1995, Daniel Kern restaura l'orgue dans son état de 1908. La réception eut lieu le 31/03/1995. [IHOA] [MulhouseStPaul1995]
L'opération fut exemplaire, et dans les années qui suivirent, l'orgue de St-Paul était l'un des plus beaux d'Alsace. [MulhouseStPaul1995]
La catastrophe de 2003
Que s'est-il passé en 2003 ? C'est difficile à établir. Certainement un événement climatique extrême. Toujours est-il que depuis cette date, l'orgue a été déclaré injouable, et plutôt que de le réparer, il a été décidé de construire un orgue "temporaire", dans un style complètement étranger au précédent et surtout à l'édifice. [Visite]
Et voilà des décennies d'histoire musicale à l'église St-Paul brusquement reniées et réduites à néant... Et le monde de l'orgue alsacien privé du St-Sauveur mulhousien.
Le buffet

Le buffet est plutôt sobre. Il est de style néo-gothique. La partie centrale date de 1896 : deux tourelles latérales, une centrale plus petite, et deux plates-faces doubles. La disposition en "V" permet de dégager une rosace située à l'arrière de l'instrument. Chaque élément est surmonté d'un gâble, avec des couronnements constitués de pinacles. Le complément de 1908 est constitué de deux tourelles latérales supplémentaires, en encorbellement. L'avant de la superstructure est également en encorbellement par rapport au soubassement, ce qui donne beaucoup de relief à la composition.
Caractéristiques instrumentales
| C | c | c' |
| 2'2/3 | 2'2/3 | 2'2/3 |
| - | 4' | 4' |
| - | - | 8' |
| C | c | c'' | c''' |
| 2'2/3 | 4' | 4' | 5'1/3 |
| 2' | 2'2/3 | 2'2/3 | 4' |
| - | 2' | 2' | 2'2/3 |
| - | 1'1/3 | 2' | 2' |
 La console est issue des efforts de Schweitzer
La console est issue des efforts de Schweitzerpour parvenir à une meilleur ergonomie.
Console indépendante dos à la nef, fermée par un couvercle basculant. Tirants de jeux de section ronde à porcelaines, disposés en deux gradins de part et d'autre des claviers. Les tirants des jeux de pédale (à fond bleu-vert) sont situés en bas sur les côtés. Ceux du grand-orgue (blancs) occupent le reste du côté gauche, et ceux du récit (à fond rose) le reste de côté droit. Toutes les porcelaines (y-compris celles repérant les accessoires) utilisent le code de couleur pour indiquer à quel plan sonore on se réfère. Ainsi, la porcelaine "I/P" est-elle moitié blanche, moitié bleu-vert. Claviers blancs. Touches du récit biseautées, mais droites au grand-orgue.

Commande du crescendo et l'expression du récit par une deux pédales basculantes (dans cet ordre), placées au centre, et repérées par des porcelaines rectangulaires "Crescendo" et "Expression". Repérage de la position du crescendo par cadran circulaire marqué "CRESCENDO", situé au-dessus de la première octave du second clavier, gradué en 30 segments. Le reste des commandes à pied est constitué de pédales-cuillers à accrocher : du côté gauche, et de gauche à droite : "P-I" (I/P) , "P-II" (II/P) , "GC" (accouplement général ; General Coppel, tricolore puisque agissant sur les trois plans sonores, par bandes verticales), "I-II" (II/I), "SPC" (II/I 4'), "SBC" (II/I 16'), "T" (Tutti ; tricolore), "LCI" (I/I, pour Leerlauf Coppel I). A droite des pédales basculantes : "HA" (Annulateur jeux à mains, Handregister Ab), "FCI" (Combinaison libre pour le 1er clavier, Freie Combination I), "FCII" (Combinaison libre pour le 2nd clavier), "FCP" (Combinaison libre pour la pédale), "Trémolo".
Programmation des combinaisons libres par mini-tirants situés au-dessus des tirants principaux des jeux. Indicateur de remplissage du réservoir principal par un cadran circulaire situé au-dessus de la dernière octave du second clavier, gradué de 1 à 10 (mais il manque le "1" à ce "10", si bien que la dernière graduation est "0"), et repéré "SOUFFLERIE".
Il y a une double commande des accessoires de registration, par petits tirants sous le premier clavier, au centre, biseautés pour tourner la porcelaine vers le haut : "H.A.", "F.cI.", "F.cII." et "F.cP.". La porcelaine de la combinaison libre du récit est presque effacée.

La combinaison libre, que l'on appelle indépendamment pour chaque plan sonore, présente la particularité de pouvoir soit s'ajouter, soit se substituer à la registration manuelle. Quand "HA" (Handregister Ab) est appelé, la combinaison se substitue aux grands tirants. Dans le cas contraire, les jeux sélectionnés par la combinaison sont simplement ajoutés aux tirants déjà actifs (les jeux ne faisant pas partie de la combinaison ne sont pas retirés).
Banc aux montants en forme de lyre.
Plaque d'adresse disposée en haut et au centre de la console, en laiton incrusté dans le bois, et disant :
Orgelbauer
BOLCHEN (LOTHRINGEN)
OP.122
 La plaque d'adresse Dalstein-Haerpfer à Mulhouse St-Paul.
La plaque d'adresse Dalstein-Haerpfer à Mulhouse St-Paul.Elle semble dater de 1896 et pas de 1908.
pneumatique tubulaire, notes et jeux.
Le grand-orgue est diatonique en "M" (basses aux extrémités), derrière la façade, et le récit est à l'arrière, au même niveau, lui aussi diatonique en"M". La pédale est logée sur les côtés, diatonique, basses à l'arrière. Ordre de chapes depuis l'intérieur vers les côtés : Basson 16', Violoncelle 16', Soubasse, Octavebasse, Violoncelle 8', Flûte 4'.
On retrouve les écrous en bois pour maintenir les faux-sommiers, une solution chère à la maison Dalstein-Haerpfer.
 Une vue sur les aigus de la tuyauterie du grand-orgue.
Une vue sur les aigus de la tuyauterie du grand-orgue.On remarque la disposition diatonique en "M", avec une passerelle centrale.
Le revers de la façade est en haut à droite.
Le fond de l'orgue et le récit sont à gauche.
De gauche (accès) à droite (façade) :
la Trompette, la Mixture/Cornet, la Doublette, le Prestant, la Flûte ouverte 4',
le Bourdon 8' (dessus à cheminées entrantes), la Gambe,
la Flûte 8' (dont les dessus sont harmoniques), le Salicional,
le Bourdon 16', et la Montre 8'.
 Une vue sur les basses du grand-orgue,
Une vue sur les basses du grand-orgue,ainsi que sur les jalousies du récit (et leur tringlerie), et, au fond,
les tuyaux de pédale, disposés orthogonalement au reste.
 Une vue sur la tuyauterie du récit,
Une vue sur la tuyauterie du récit,les jalousies donnant sur le grand-orgue sont à gauche ; le fond de l'orgue est à droite.
De gauche à droite : le Clairon, la Trompette, le Hautbois,
le Flageolet 2', la Mixture à 4 rangs, la Fugara 4', la Flûte octaviante 4',
le Bourdon 8', l'Aeoline, le Geigenprincipal, la Voix céleste,
la grande Flûte harmonique 8', et le Salicional 16'.
 Une autre vue du récit, avec, en particulier,
Une autre vue du récit, avec, en particulier,les tuyaux aigus du Bourdon 8', ouverts, métalliques et bombés.

Qu'un instrument de cette classe soit aujourd'hui muet constitue l'un des pires crève-cœur de l'orgue alsacien. Alors qu'on engloutit des sommes folles, depuis des décennies, dans des reconstructions d'instruments "à la mode", produisant toujours plus de simili-Silbermann et de pseudo-Callinet, on trouve ici une des pièces maîtresses de notre patrimoine, qui dépérit dans l'abandon... Quand on aime les orgues et que l'on contemple ce désolant spectacle, on en a littéralement les larmes aux yeux.
L'orgue de Mulhouse St-Paul n'est aujourd'hui (2020) réellement plus du tout jouable. Des cornements systématiques apparaissent dès les premières secondes. Les quelques sons que peut encore produire cet orgue sont très beaux. Les problèmes semblent être localisés au système de tirage des notes, juste sous les sommiers. L'intérieur est dans un très bon état, et la tuyauterie très bien conservée.
L'installation d'un instrument provisoire "standard" (selon les critères des Experts de l'orgue ; notons qu'il est dépourvu de 16'...) n'augure rien de bon, car bien sûr, aujourd'hui "rien ne presse". Notons que cet orgue "de chœur" (il encombre en fait la tribune, juste devant la porte d'accès, son soufflet cunéiforme (!) reposant sur les bancs) n'est pas intrinsèquement mauvais. Il est juste totalement inadapté au lieu. On peut même dire que c'est exactement l'orgue qu'il ne fallait pas ici, issu à l'évidence de quelque lubie autoritaire.
Alors, bien sûr, l'orgue Dalstein-Haerpfer est à présent classé. Ce qui n'est que justice ; il aurait dû être l'être bien longtemps, et le mérite infiniment plus que toute une kyrielle d'instruments "issus du 18ème", mais totalement reconstruits depuis. Mais à part lui fournir une "reconnaissance" auprès du grand public, qu'est-ce que ce classement va changer ? Les ressources allouées aux orgues classés ont réduit comme peau de chagrin, et on finit par se demander si le maigre espoir de quelques subsides vaut vraiment les démarches, les paperasses, et les années d'attente. L'orgue est classé, certes, mais on en a... plus "besoin". Evidemment, pour sortir de cette situation Ubuesque, il faut des moyens financiers. Mais ceux-ci ont été engloutis dans "l'orgue de chœur". La situation semble à présent inextricable et désespérée.
C'est l'occasion de rendre hommage au courage et la ténacité des affectataires et conservateurs de ces trésors de notre patrimoine, qui s'engagent pour les sauver. Ils doivent vraiment connaître des jours d'intense désarroi, tellement il est difficile de faire bouger les choses. Leur action et la dynamique dont ils sont capables devraient être mieux encouragées !
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 13/09/2020
Remerciements à Michèle Ackermann.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 30/09/2020,21/11/2020.
Photos du 13/09/2020 et données techniques.
-
[APlatz] Alexis Platz :
Documentation
- [MulhouseStPaul1995] ""1885-1995 Paroisse Saint-Paul - Mulhouse". Plaquette éditée à l'occasion du relevage de l'orgue en 1995"
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 119a
-
[ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 278
Les volumes "techniques" et "historiques" ne sont pas d'accord sur l'historique (1984 n'apparaît pas dans l'inventaire historique, qui décrit une "Situation depuis 1976" inchangée, et ce jusqu'en 1995).
![]() Localisation :
Localisation :