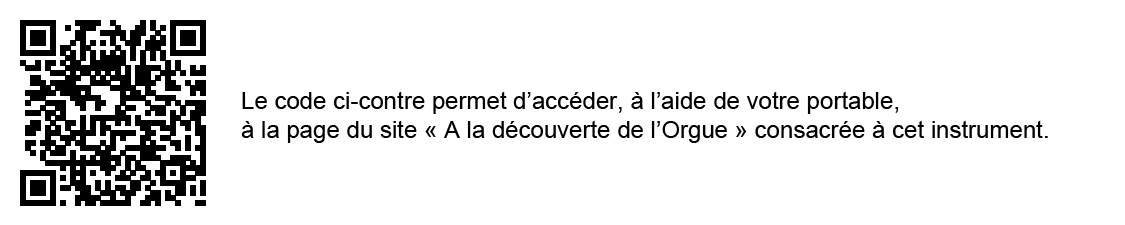L'orgue Besançon de Sierentz ; photo de Stéphane Chalaye (Sierentz), remerciements à Camille Deck.
L'orgue Besançon de Sierentz ; photo de Stéphane Chalaye (Sierentz), remerciements à Camille Deck.L'orgue Jacque Besançon de Sierentz date de 1773 : il était à l'époque installé dans l'ancienne église. Malgré plus de deux siècles d'une histoire mouvementée, il reste un témoin remarquable de la facture de Besançon, abritant dans son clavier principal une large partie du matériel d'origine. Les deux autres plans sonores ont été ajoutés par la suite ; l'ensemble fait preuve, depuis la restauration de 2014, d'une grande homogénéité.
Historique
C'est de 1773 que date l'orgue de Jacque Besançon. Il ne disposait que d'un manuel (et pas de pédale), et était logé dans la "Hochkirche" (près du cimetière). [IHOA] [PMSAEA83] [HOIE]
La date de construction, c'est le buffet qui la donne, l'année figurant sur les culots des deux tourelles latérales : "17" à gauche, "73" à droite. L'instrument était analogue, par sa taille, à celui de Voegtlinshoffen (même taille de sommier), mais il est doté d'un buffet plus spacieux.
En 1839, les frères Callinet installèrent l'orgue dans l'église neuve (achevée en 1836), après l'avoir réparé et transformé. [IHOA] [HOIE]
La Trompette manuelle et la Gambe ("Salicional" en 1986) acuelles, sortant des ateliers de Rouffach, datent donc de cette époque. Un ou deux autres jeux ont également été remplacés ou ajoutés par les frères Callinet (tuyaux dans le Bourdon d'écho de 1986 et l'actuel Nasard). C'est sûrement à cette occasion que des travaux de fiabilisation du sommier furent menés : celui de Sierentz était en effet en bien meilleur état (et de meilleure qualité intrinsèque) que celui de Voegtlinshoffen avant restauration). [JCGuerrier]
Les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités le 12/03/1917. [PMSAEA83] [HOIE]
En 1946, Georges Schwenkedel reconstruisit le petit instrument pour le doter d'un récit et d'une pédale. [IHOA]
La transmission fut rendue pneumatique, et c'est probablement à ce moment que la Montre passa à 8'. Ce fut l'opus 82 de la maison Schwenkedel. [IHOA]
La console était indépendante, face à la nef, et elle était dotée d'un crescendo et de combinaisons. L'instrument était en tous cas doté d'une belle composition néo-classique (malheureusement, les accouplements, pourtant fondamentaux mais qu'il était "de bon ton" de décrier "par dogmatique" dans les années 60, n'ont pas été notés) : [PMSCALL]
En 1977, Christian Guerrier reconstruisit l'orgue pour transformer le récit en un écho, et re-mécaniser la transmission avec une console en fenêtre. [IHOA] [HOIE]
Malheureusement, l'écho fut placé dans le soubassement, et, pour qu'il soit audible, des ouvertures ont été découpées dans les panneaux frontaux et latéraux. [ITOA] [Visite]
En 2014, l'orgue a été restauré dans son état de 1773, plus les plans sonores ajoutés, par la maison Guerrier/Bücher de Willer. [Sierentz2014]
Le grand-orgue a pu retrouver la configuration initiale laissée par Besançon, à l'exception de la Trompette de Callinet. Ce plan sonore est redevenu homogène, les parties manquantes ayant été restituées avec des tailles déduites de tuyaux "rescapés" lors des transformations. Le tout est servi par le sommier d'origine (renforcé par les Callinet en 1839), qui a pu être restauré. Les jeux Callinet (sauf la Trompette) ont été regroupés au positif. La façade a été construite sur le modèle de St-Ursanne. La pédale a été dotée d'une anche sur le modèle de St-Ursanne.
Jean-Christian Guerrier a été en charge de la conception technique, des plans et du vent ; Marianne Bucher de la tuyauterie, de la conception sonore et de l'harmonisation, assistée de Pauline Wira et Alexandre Fremiot ; les sommiers ont été confiés à Brice Muller ; le buffet et la transmission à Bruno Federspiel ; la mécanique des jeux à Alexandre Fremiot.
L'orgue a été inauguré les 31/05 et 01/06/2014, par Olivier Wyrwas (Mulhouse, St-Jean), Joseph Meyer (Sierentz) et Louis Patrick Ernst (Colmar, St-Martin).
Le buffet
Buffet rococo, avec trois tourelles à entablements (la plus petite au centre) et des places-faces cintrées. Ce cintrement des plates-faces, les claires-voies très développées, et la finesse des jouées sont la signature des buffets Besançon. Il n'y a pas de cloisonnement arrière.
Il y a actuellement des couronnements sur les trois tourelles, mais ceux-ci ne sont pas d'origine (ils ne sont d'ailleurs pas présents sur les photos d'inventaires) et ont été "prêtés" à l'instrument, vu leur grande unité de style. La disposition de la façade (qui avait été réquisitionnée en 1917) a été reprise sur St-Ursanne (tuyaux de tourelles écussonnés, lignes de bouches), et la nouvelle façade (2014) a été construite sur ce modèle. Noter que la ligne des bouches est une droite (à plat), mais, en raison du cintrement des plates-faces, on à l'impression d'une courbe parabolique.
 La date figure sur les deux culots des tourelles latérales.
La date figure sur les deux culots des tourelles latérales.Caractéristiques instrumentales
 La console frontale, photo de Roland Lopes, 04/05/2014.
La console frontale, photo de Roland Lopes, 04/05/2014.Console frontale (claviers saillants (1977 et 2014). Ancienne console Schwenkedel (elle était encore sur place en 1986) ? Tirants de registre de section carrée et pommeaux tournés (de deux couleurs différentes), placés en colonnes de part et d'autre du clavier.
L'accouplement II/I estcommandé par le tirant inférieur gauche, la tirasse I/P par le tirant inférieur gauche (à cran). Pas d'étiquette.
❍
❍
❍
❍
basse
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Mécanique suspendue (2014). L’abrégé a été reconstruit en copie de celui de Voegtlinshoffen. La seule différence est le remplacement d'une partie des rouleaux en bois par des rouleaux en métal en prenant modèle sur les abrégés de Silbermann. Second manuel à double balanciers. [JCGuerrier]
Le sommier du grand-orgue est d'origine (il avait été renforcé par les Callinet en 1839). Il présente la particularité d'avoir des divisions très étroites, ne permettant pas de disposer toutes les boursettes en ligne dans les dessus. Elle sont disposées en décalage (l'abrégé ayant des bras plus ou moins longs pour que la vergette reste verticale). Le tout laisse aussi plus de place aux vergettes. [JCGuerrier]
 Papier collé sous une des pièces gravées.
Papier collé sous une des pièces gravées.Comme souvent, dans les orgues du 18ème, l'étanchéité était assurée avec du papier "recyclé". Ce fut le cas à Sierentz, où Besançon se servit d'un livre de chants, avec des psalmodies grégoriennes (neumes). Sous une pièce gravée (elle sert aujourd'hui pour le postage des basses de la Trompette de Callinet au grand-orgue, on peut reconnaître un passage du Cantique des Cantiques (6-10) : (photo ci-dessus, à partir de la lettre rouge) "Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens pulchra ut luna electa ut sol terribilis ut acies ordinata" ("Qui est celle-ci, qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons ?")
Une improvisation sur le thème de la psamodie écrite dans les entrailles de l'intrument sera peut-être un jour au menu d'un concert ? Cela ne manquerait pas de charme.
Le sommier du second manuel est disposé à l'arrière, en hauteur (comme un récit non expressif). Celui de pédale est disposé à l'arrière un peu au-dessus du niveau de la tribune.
Réservoir à plis parallèles des frères Callinet (facture de Claude Ignace).
Pression : 73 mm de colonne d'eau
Diapason : La 392 Hz à 16°
Tempérament :

Façade, Tierce, Cromorne, Nasard et Trompette de pédale construits (2014) sur le modèle de St-Ursanne. Tuyauterie coupée au ton (sauf le Nasard du second clavier), Bourdons à calottes soudées. Aucun tuyaux à cheminée. Les tailles vont en s'élargissant dans les aigus.
L'ensemble "arrière", constitué par le second clavier et la pédale peut pratiquement être considéré comme un orgue neuf, complétant le grand-orgue de Besançon avec une belle homogénéité, tout en faisant usage du matériel ancien (en particulier Callinet) disponible. La bonne surprise de l'opération vient du fait que la restitution de la partie de Besançon a pu être menée bien plus loin que ce qui était espéré au début (deux reconstructions laissaient penser que toute velléité de restauration serait illusoire). De fait, le grand-orgue (sauf la Trompette) présente, en plus de l'intégralité du matériel Besançon disponible, les techniques et méthodes d'origine (disposition, tailles, diapason).
Le "complément", parfaitement "détouré" (identifiable et ne prêtant pas à confusion avec le matériel de 1773), a été réalisé dans l'esprit : Besançon était certes un facteur formé en Alsace au style "classique français", mais il était sensible aux influences Suisses (c'était après tout sa nationalité) et germaniques. La Gambe de Callinet est ainsi complètement "dans le ton" (cf. St-Ursanne), et absolument pas une "pièce rapportée". Dans cet esprit, la Trompette de pédale est plutôt douce (en complément du grand plein-jeu), et ne cherche pas à faire trop "classique Français" : elle aussi a été construite sur le modèle de St-Ursanne. Bien sûr, Couperin et Grigny y sont à l'aise, mais on peut aller plus loin (comme l'atteste le programme du second concert d'inauguration !)
![]() Webographie :
Webographie :
- [Guerrier] http://www.orgues-guerrier.org : le site de la maison Guerrier / Bucher publie le rapport de restauration de l'orgue Sierentz.
- [SChalaye] http://www.stephanechalaye.com/ : le site du photographe Stéphane Chalaye, de Sierentz (cf première photo de la page).
![]() Activités culturelles :
Activités culturelles :
- 31/05/2014 : Récital d'Olivier Wyrwas (Mulhouse, St-Jean) : Muffat, Bach, Couperin, Böhm, Blow et Knecht.
- 31/05/2014 : Récital de Louis Patrick Ernst (Colmar, St-Martin) : Grigny, Guilain, Byrd, Bach, Alain, Françaix et Dupré.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 19/07/2014
Remerciements à Jean-Christian Guerrier et Camille Deck.
- [JCGuerrier] Jean-Christian Guerrier : e-mail du 22/07/2014.
- [RLopes] Roland Lopes : e-mail du 06/05/2014.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 174a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 421
- [Sierentz2014] "plaquette éditée par le conseil de fabrique de la paroisse St-Martin de Sierentz, réalisée avec la participation de la mairie."
- [PMSAEA83] Pie Meyer-Siat : "Jaque Besançon, facteur d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 42., éditions de la société Haguenau, 1983, p. 246-7
- [HOIE] Pie Meyer-Siat : "Historische Orgeln im Elsass", éditions Schnell und Steiner, München - Zürich, 1983, p. 132
- [PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 255-6
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 341
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im68005008
![]() Localisation :
Localisation :