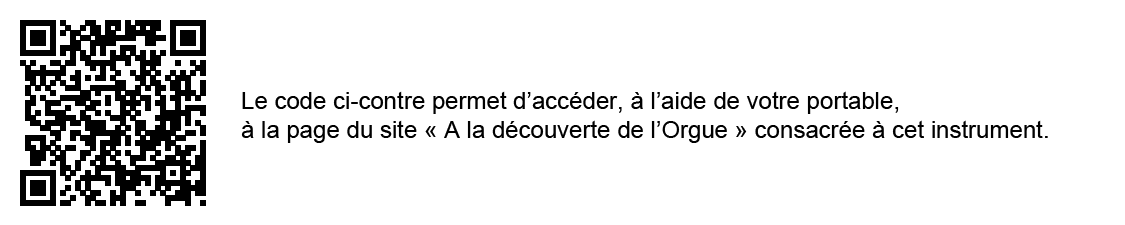Hartmannswiller, l'orgue Georges Schwenkedel.
Hartmannswiller, l'orgue Georges Schwenkedel.Sauf précision contraire, toutes les photos sont de Martin Foisset, 18/01/2020.
Il y a, non loin de Soultz, à Hartmannswiller, l'un des premiers orgues de Georges Schwenkedel : son opus 24. Après avoir appris le métier chez Roethinger, et collaboré un moment avec Zann, Schwenkedel se mit à son compte en 1924. Cet orgue partage beaucoup de caractéristiques avec celui de Bisel. Son positif de dos (postiche) est bien curieux, et le buffet est orné de nombreuses sculptures dorées. Il résulte d'une approche fondamentalement originale du style d'orgues que l'on a (plus tard), appelé "néo-classique".
Historique
Un instrument est attesté en 1790 ; il devait dater de 1725 environ. [IHOA]
1828
Historique
En 1828, Joseph Callinet construisit un orgue neuf. [IHOA]
L'instrument a été réparé en 1895 par Joseph Antoine Berger, suite à des travaux à l'édifice. Berger changea un jeu. [Barth] [IHOA] [PMSCALL]
La région de Hartmannswiller eut à souffrir de certains des plus violents événements de la première Guerre Mondiale (dont l'effrayante et interminable bataille du Vieil Armand - "Hartmannswillerkopf", 1915, qui causa probablement la perte de plus de 30000 vies). L'orgue Callinet, probablement endommagé vers 1915, ne devait plus être réparable après le conflit. [IHOA]
Historique
En 1929, Georges Schwenkedel posa son opus 24 à Hartmannswiller. [IHOA] [ITOA]
La maison Schwenkedel revint réparer son orgue en 1951. [IHOA] [ITOA]
En 1980, il y eut une petite intervention, pas la maison Steinmetz (qui avait en quelque sorte pris la succession de Schwenkedel). [IHOA] [ITOA]
En 2013, l'instrument a bénéficié d'un relevage en profondeur, mené par Sébastien Fohrer. [SFohrer]
L'orgue a été inauguré le 02/02/2014 par Thierry Mechler.
Le buffet
 Un des rinceaux.
Un des rinceaux.Le buffet, éclectique, est presque de style néo-renaissance : il y a du "Troubadour" dans les inflexions des ornements. Deux tourelles latérales prismatiques (demi-hexagone de base) encadrent 3 plates-faces, celle du milieu jouant un peu le rôle de tourelle centrale. Ornementation dorée. Les deux "vraies" plates-faces sont munies de rinceaux (symétriques), figurant de chaque côté deux anges musiciens. L'un joue du chalumeau et l'autre de la viole. Jouées très ajourées. Toute la façade du grand buffet parle. (77 tuyaux !) Le positif est évidemment postiche, et "taillé" exactement à la largeur de la console.
 Le positif (décoratif) porte l'inscription
Le positif (décoratif) porte l'inscription"Soli Deo honor et Gloria", une des traductions de Timothée, 1, 17,
que l'on retrouve aussi, sous la forme "SDG", sur de nombreux manuscrits de Bach.
Noter que le mot "honor" n'a ici pas de majuscule,
pour que celles-ci fassent tout de même "SDG".
Caractéristiques instrumentales
| C | c | c' | c'' | c''' |
| - | - | 8' | 8' | 8' |
| - | - | 4' | 4' | 4' |
| - | 2'2/3 | 2'2/3 | 2'2/3 | 2'2/3 |
| 2' | 2' | 2' | 2' | 2' |
| 1'3/5 | 1'3/5 | 1'3/5 | 1'3/5 | 1'3/5 |
| 1'1/7 | 1'1/7 | 1'1/7 | 1'1/7 | - |
 La magnifique console "début années 30".
La magnifique console "début années 30".Console indépendante face à la nef (encastrée dans le positif postiche), fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux et accouplements par dominos, munis de pastilles blanches pour le grand-orgue, roses pour le récit, et vertes pour la pédale (accouplements et tirasses bicolores avec le même code de couleur). Claviers blancs. Joues de claviers ondulées, joliment "Spätromantik". Programmation de la combinaison libre par picots situés au-dessus des dominos. Indicateur de crescendo linéaire situé au-dessus. Commande des combinaisons par 5 pistons placés à gauche, sous le premier clavier : "Comb.", "P.", "MF.", "TT." et annulateur. Plaque d'adresse en 3 éléments de porcelaine blanche, lettres noires. Les deux de droite donnent le numéro d'opus (Opus 24) et la date (1929). Celle de gauche :
Manufacture de grandes Orgues
Strasbourg - Koenigshoffen.

 La tuyauterie du récit.
La tuyauterie du récit.De gauche à droite : Trompette, Nachthornlein, Nasard,
Flûte harmonique 4', Gambe, Cor de nuit, Voix céleste, Gemshorn.
Les deux photos de la tuyauterie sont de Sébastien Fohrer
 Voici ce fameux "Cornet",
Voici ce fameux "Cornet",en fait une Mixture-tierce à Septième.

D'habitude, quand on découvre un instrument, on "fait le tour" des jeux, en les jouant l'un après l'autre pendant quelques secondes. Mais, avec les orgues Georges Schwenkedel des années 30, il y a tant d'originalités et de trouvailles qu'on se prend à consacrer plusieurs minutes à chaque jeu... Ces instruments - pourtant encore si méconnus des experts et des "grands organistes" - sont tout simplement remarquables et extrêmement attachants.
Ces instruments construits entre 1920 et 1939 par Joseph Rinckenbach, Edmond-Alexandre Roethinger et Georges Schwenkedel constituent un style alsacien spécifique et original. Ce style résulte d'une approche fondamentalement différente du "néo-classique" tel qu'on le retrouve ailleurs. Si les influences de Walcker et de l'orgue romantique suisse sont souvent marquées, il ne s'agit pas d'une simple "synthèse" de styles, comme cela est souvent - et un peu facilement - théorisé. En fait, on est bien loin de la théorie : ces instruments doivent être joués et entendus. Chacun propose - parfois juste par l'ambiance ou l'esthétique visuelle - des originalités, et chacun indique une réelle volonté de faire "unique".
A Hartmannswiller, on pense forcément au premier conflit mondial, à ses victimes, ses destructions, et aux conséquences funestes, à peine 20 ans plus tard, de sa "résolution". Mais on ne peut qu'admirer la résilience de la population après 1918 : soumise aux conséquences du conflit, à la grippe dite "espagnole", à une crise économique sans précédent, et à la montée des pires totalitarismes, elle a tout de même su faire de la place à la création. Et avec quel succès ! Face à cet orgue, un peu comme après l'écoute d'une pièce de Jehan Alain, on ne peut que se dire qu'il serait vraiment temps de le faire découvrir au plus grand nombre.
![]() Augustin Zeiger
Augustin Zeiger
Hartmannswiller, c'est aussi le village de naissance (1805) de l'organiste et facteur d'orgues Augustin Zeiger.
If fut organiste à Lyon (à l'hospice de la Charité) jusqu'en 1835, puis se lança dans la facture d'orgues. A Hattstatt, c'était l'expert choisi par Claude-Ignace Callinet, car ils étaient amis de longue date. Sa réputation en Alsace dut se faire du temps où il était organiste à Hartmannswiller. En 1840, Zeiger fit une proposition pour l'orgue de la cathédrale de Metz (face à Wegmann, Claude de Mirecourt, Verschneider et Joseph Callinet. C'est ce dernier qui eut le marché). C'est lui qui prêta à Bitschwiller-lès-Thann un orgue pendant 12 ans (à partir de 1846) dans l'espoir de conclure un marché pour un orgue neuf. Avec son associé Michel Côte (qui avait travaillé avec François Callinet, le père de Claude-Ignace) Zeiger construisit 33 orgues de 1835 à 1848. [PMSCALL]
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 18/02/2020
Remerciements à Christophe Blosser
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 09/02/2020.
Photos du 18/02/2020
- [SBraillon] Sébastien Braillon : e-mail du 04/12/2002.
-
[SFohrer] Sébastien Fohrer : e-mail du 04/02/2014.
Photos de l'album Facebook
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 74a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 142
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 215-6
- [PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 48,158-9
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im68003776
- [FJungk] Dominique Amann : "Le facteur d'orgues Frédéric Junck", éditions La Maurinière, p. 6
![]() Localisation :
Localisation :