 Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953).
Edmond-Alexandre Roethinger (1866-1953).Durant la première moitié du 20ème siècle, c'est probablement la maison Roethinger qui a été la plus prospère, et la plus "en vue" des entreprises de facture d'orgues alsaciennes. Son nom est indissociable de l'esthétique dite "néo-classique", qui, sur la base d'instruments post-romantiques, a tenté d'ouvrir le répertoire à la musique écrite avant le 19ème siècle. L'essentiel des grands noms de la facture alsacienne sont des "anciens" de chez Roethinger. On pense évidemment aux deux "embauchés de 1921" : Georges Schwenkedel et Ernest Muhleisen, mais aussi Jean-Georges Koenig et Alfred Kern. Pratiquement toute la facture alsacienne, jusqu'à aujourd'hui, est de près ou de loin apparentée à celle de Roethinger (soit en tant qu'exemple, soit en tant que repoussoir), et l'importance historique de cette maison - outre l'impressionnant parc d'instruments - est et restera fondamentale.
Les ateliers de Strasbourg, puis de Schiltigheim ont produit pas moins de 360 orgues. Et des centaines d'harmoniums (auxquels il faudrait un jour aussi s'intéresser sérieusement). Il ne saurait donc être question de tous les inclure dans cette page. Il y a toutefois quelques instruments incontournables:
- - Celui d'Erstein, par exemple, avec ses jeux à haute pression, est encore par certains côtés "romantique allemand". Il est caractéristique d'une "première façon" (1893-1914), directement héritée de Koulen, qui inclue les premiers tâtonnements avec la transmission pneumatique, mais aussi les années les plus prolifiques (en nombre d'instruments et en nouveautés).
- - Le grand instrument construit en 1925 pour l'ancienne Synagogue (place des Halles) de Strasbourg, bien que disparu (comme l'édifice, situé place de Halles, auquel il était intimement lié) était une étape marquante dans la Réforme alsacienne de l'Orgue, mais aussi dans l'oeuvre de Roethinger.
- - C'est à Gueberschwihr qu'Edmond-Alexandre, le fondateur de la maison, acheva probablement sa carrière. Après-guerre, il passa la main, et c'est à Max et André qu'il convient d'attribuer les orgues ultérieurs.
- - La maison Roethinger resta capable de réaliser des instruments de toute beauté, comme en témoigne l'orgue de Strasbourg, Ste-Madeleine (1965). Aussi bien techniquement qu'artistiquement, il paraissait témoigner d'un réel renouveau, qui fut confirmé par quelques uns de ses successeurs. Ce n'était donc pas un déclin artistique qui provoqua la fermeture, mais bien la perte progressive de son "adhésion" au monde de l'orgue : la maison Roethinger ne prit jamais vraiment le virage du "néo-baroque". Ceux que le style enthousiasmait vraiment (Curt Schwenkedel, Alfred Kern) conquirent leur place en construisant des instruments avec beaucoup de sincérité, sans concession. Or, Max et André Roethinger y étaient allés "à reculons", avec, à l'évidence, autre chose à dire, mais sans pouvoir le faire.
- - La "dynamique" perdue, l'aventure s'acheva à Anould (Vosges) en 1969, après des "funérailles" offertes par le monde de l'Orgue à la Ste-Famille en 1968. Arrêtée alors qu'elle était encore viable, cette entreprise ne connut au moins pas de triste agonie.
A côté de ces 5 "figures" de l'orgue alsacien, choisissons de nous arrêter sur les principaux Opus de la maison de Strasbourg / Schiltigheim. Ne serait-ce que pour souligner l'incroyable diversité d'une production que certains ont un peu vite qualifiée de "semi-industrielle".
L'apprentissage
Edmond-Alexandre Roethinger est né le 13/04/1866 à Strasbourg. Dès son jeune âge, il montra une forte aptitude pour les arts graphiques. Il a commencé une formation de verrier, puis d'imprimeur chez Steinbrecht. Mais rapidement, il trouva sa voie dans la facture d'orgues : à 15 ans, il entra comme apprenti chez Heinrich Koulen, où son père Sigismond était compagnon. Après 5 ans de formation initiale (1881 au 04/03/1886), il fit son service militaire dans l'artillerie (jusqu'au 23/09/1888). [Erstein2001] [Caecilia:1953p74-5] [GSagot] [OanEncyclopedia]
Le perfectionnement
Il retourna alors chez Koulen pour commencer à approfondir ses techniques, et prépara un "tour d'Europe" de facture d'ogures. Il partit travailler à Munich, chez Franz Borgias Maerz (de mai 1889 à 1891), et, pendant ses "vacances", il allait visiter des ateliers de facteurs prestigieux. il commença par la Bavière : Koppenberger à Freising, Riederer à Landshut, Hechenberger à Passau, Mühlbauer à Augsburg, Schlimbach à Wurzburg, Hackl à Rosenheim, Steinmeyer à Oettingen. Mais cela ne suffit pas à ce boulimique d'informations sur la facture d'orgue : il continnua par l'Autriche : Lieber à Linz, Rieger à Vienne-Jägerndorf, Mauracher à Saltzbourg. Puis vint l'allemagne centrale et du nord : Hildebrand à Leipzig, Dinse à Berlin, Klais à Bonn. Il se rapprocha alors de sa terre natale, en visitant les ateliers du Pays de Bade : bien sûr Walcker à Ludwigsburg, mais aussi Schiessmayer à Stuttgart, Laukhuff à Weickersheim. Ce fut ensuite la Suisse : Goll à Lucerne, Zimmermann à Bâle. Roethinger connaissait déjà l'orgue romantique français : grâce à des liens familiaux, il pouvait passer du temps à Paris, où il visita Merklin (le maître de Koulen) et bien sûr Cavaillé-Coll. Il entretint aussi de longues relations avec Didier, d'Epinal. Durant les années où il travailla pour Maerz, il construisit pour lui 19 orgues, donc celui... de Joseph Rheinberger ! [Erstein2001] [Caecilia:1953p74-5] [GSagot] [OanEncyclopedia]
Orphelin à 3 ans, Franz Borgias Maerz était le fils adoptif de Max Maerz. Ce dernier n'ayant pas d'autre héritier, Franz Borgias repris la maison bavaroise en 1878 ; il resta en activité jusqu'en 1908 et construisit dans les 450 orgues. A 58 ans, il trouva le temps de se marier. Du temps où Edmond-Alexandre travaillait chez Maerz (comme harmoniste), il a peut-être travaillé sur l'orgue de Prittlbach. [Maerz]
Koulen était passé à la transmission pneumatique en 1885. Roethinger a donc dû voir en chantier les derniers orgues mécaniques : le collège St-Joseph de Matzenheim, l'église protestante d'Erstein, les deux orgues d'Altkirch (celui d'Notre-Dame de l'Assomption a été remplacé) et celui de l'église protestante de Guebwiller. Roethinger faisait encore partie des ateliers Koulen lorsque le premier orgue pneumatique d'Alsace fut construit : Zinswiller. A son retour du service militaire, Edmond-Alexandre a dû participer à la construction du grand orgue de Neudorf, St-Aloyse, et ceux d'Ingenheim et de Lampertheim (les deux derniers ayant des sommiers à gravures pour les manuels et un sommier à cônes pour la pédale). Son expérience en matière de pneumatique ne devait donc pas être très grande. Une fois mis à son compte, avec l'aide de son père Sigismond (1837-1926), Edmond-Alexandre pratiqua une facture très proche de celle de Koulen. Mais l'indispensable "conquête" du savoir-faire pneumatique n'allait pas être facile, surtout que dans le Haut-Rhin, Martin et Joseph Rinckenbach se mirent à en produire d'excellentes à partir de 1899.
En 1891, alors que Koulen renouvelait l'orgue de la cathédrale de Strasbourg, il demanda à Roethinger de revenir collaborer avec lui. L'ancien élève de Koulen participa au dessin des plans (dont il garda précieusement un double dans ses archives). [Caecilia:1953p74-5]
 Principaux travaux de la fondation (1893) à 1914
Principaux travaux de la fondation (1893) à 1914
Les publicités pour l'entreprise porteront souvent la mention "Maison fondée en 1893", et c'est effectivement à cette date que l' "Opus 1" fut construit (d'autres entreprises sont connues pour avoir pris un peu de liberté avec leur date de fondation). Edmond-Alexandre avait 27 ans. L'entreprise commença à Schiltigheim (17a, Wehrstrasse - rue du Barrage), avant de s'installer à Strasbourg en 1919, rue Jacques Kablé (44-44a rue Jacques Kablé). [Erstein2001] [Caecilia:1953p74-5]
 1893 : Baerendorf (région de Drulingen), St-Rémy
1893 : Baerendorf (région de Drulingen), St-Rémy
Détruit par faits de guerre, 25/11/1944. Remplacé par Georg Westenfelder (1999).
Le 25 novembre 1944, l'église et le presbytère de Baerendorf furent totalement détruits. Les archives furent aussi en grande partie perdues. On savait bien qu'il y avait les restes d'un orgue dans les décombres, mais même le buffet avait brûlé, et on en ignorait la provenance. En fait, c'était le premier orgue Roethinger, posé dès 1893, et que tout le monde avait oublié (y-compris Roethinger lui-même, dans sa liste publiée en 1924). C'est en quelque sorte l' "Opus 0", à placer avant Oberhaslach. L'église de Baerendorf fut reconstruite en 1955, et on chercha à l'équiper d'un harmonium. Celui qui fut livré était un harmonium Roethinger : par un étrange caprice du destin, c'était le dernier instrument de musique sur lequel Roethinger avait travaillé lui-même. [IHOA:p29b] [Caecilia:p74-5]
 1893 : Oberhaslach (région de Molsheim), St-Arbogast
1893 : Oberhaslach (région de Molsheim), St-Arbogast
Instrument actuel.
Quand on lève les yeux vers la petite chose, on a du mal à croire que ce fut le premier (ou deuxième) orgue d'une maison qui marqua tant la facture l'orgue au cours du 20ème siècle. Le buffet (en chêne) est très voisin de que celui que Roethinger posa en 1926 à Kutzenhausen (ici, c'est la "taille au-dessus", avec un élément central). La traction était mécanique. L'opus 1 (officiel) (II/P 16j) n'a malheureusement plus grand-chose d'authentique : il a été chamboulé en 1952, au cours d'une de ces transformations dont la définition était probablement le fruit de quelque tirage au sort. Ainsi, le récit est sur 16', mais le grand-orgue sur 8'... Et une inévitable Cymbale (retouchée en 1976, tout comme la Fourniture du grand-orgue) cotoie la Voix céleste. [IHOA:p130a] [ITOA:4p459] [Barth:p283-4]
 1894 : Lalaye (région de Villé), St-Aurélie
1894 : Lalaye (région de Villé), St-Aurélie
Instrument actuel.
Dans son buffet néo-roman avec une console retournée, on dirait un de ces jolis petits orgues Koulen de la fin du 19ème. La réception de l'opus 2 a été effectuée par Friedrich Wilhelm Sering. La mécanique à équerres, la console, les sommiers et le buffet sont d'origine. Mais la tuyauterie a malheureusement été transformée (Mixture, Doublette, entailles ressoudées). [IHOA:p97a] [ITOA:3p324] [Barth:p243]
Parmi les premiers collaborateurs de Roethinger figure Joseph Kleinpeter (il l'a rejoint en 1894 et le quitta en 1899 - peut-être pour finalement suivre Koulen à Oppenau -). [GSagot]
 1895 : Stutzheim-Offenheim (région de Truchtersheim), Sts-Pierre-et-Paul
1895 : Stutzheim-Offenheim (région de Truchtersheim), Sts-Pierre-et-Paul
Instrument actuel.
Ce troisième opus alsacien est aussi à rapprocher de l'héritage Koulen. Console indépendante mécanique, six 8' sur 11 jeux manuels : l'instrument était bien dans son style. Malheureusement, en 1969, trois jeux furent supprimés : le grand Bourdon 16' du grand-orgue (au bénéfice d'un Nasard), la Gambe 8' du grand-orgue (pour céder sa place à une Tierce 1'3/5) et... la Voix céleste du récit, supprimée pour y placer une Trompette. La console est presque jumelle de celle de Lalaye. Elles sont fermées par un rideau coulissant. L'expression n'a encore que deux positions (ouvert et fermé) : on ne peut pas la faire varier de façon continue. L'opus 3 a été relevé par Richard Dott ; une restauration n'était toutefois pas encore envisagée. [IHOA:p204a] [ITOA:4p779] [Barth:p362] [Caecilia:2000-4p30]
 1895 : Vendenheim (région de Brumath), Eglise protestante
1895 : Vendenheim (région de Brumath), Eglise protestante
Remplacé par Georges Emile Walther (1975).
L'opus 4 n'a pas totalement disparu, puisque la pédale de l'orgue actuel contient des tuyaux de Roethinger. [IHOA:p211a-b] [ITOA:4p808]
 1895 : Goersdorf (région de Woerth), St-Martin
1895 : Goersdorf (région de Woerth), St-Martin
Orgue détruit pour laisser la place à deux haut-parleurs.
L'orgue Roethinger de Goersdrof, opus 5 (I/P 11 ou 15j), dont il reste la façade du buffet, était peut-être le premier à être muni d'une pédale d'expression "continue". C'est du moins ce que semblaient indiquer les restes de la console. C'est l'un des rares "cadavres d'orgue" exhibé en Alsace. [IHOA:p65a-b] [ITOA:3p202] [Barth:p201]
 1896 : Russ (région de Schirmeck), St-Etienne
1896 : Russ (région de Schirmeck), St-Etienne
Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1914).
Sommiers neuf, console neuve, pédale indépendante : l'instrument était quasi-neuf - même s'il "recyclait" une partie de la tuyauterie de 1858. Il fut reçu par Friedrich Wilhelm Sering le 25/04/1896.
 1895 : Buhl-Seltz (région de Seltz), St-Ulrich
1895 : Buhl-Seltz (région de Seltz), St-Ulrich
Détruit par faits de guerre en janvier 1945. Remplacé par Koenig (1981).
En 1895, Roethinger fut primé à la "Handels-und Gewerbeausstellung" de Strasbourg, pour un petit orgue de 6 jeux (opus 13). Il l'installa à Buhl-Seltz en 1900, dans l'église qui venait d'être construite (1899). L'orgue et l'église furent détruits en janvier 1945. [IHOA:p44b] [ITOA:3p92]
En 1895, l'entreprise donnait déjà du travail à 9 personnes (une photo d'époque montre Edmond-Alexandre entouré de ses collaborateurs). [Erstein2001]
 1896 : Waltenheim-sur-Zorn (région de Hochfelden), Eglise mixte
1896 : Waltenheim-sur-Zorn (région de Hochfelden), Eglise mixte
Remplacé par Gebrüder Link (1912).
Cet instrument, l'opus 8 (II/P 14j), souffrit de problèmes de transmission, et cessa de fonctionner dès la fin du siècle. De fait, certains de ces premiers instruments pneumatiques, un peu comme les orgues de Heinrich Koulen, connurent à l'origine des problèmes de fiabilité. La conception était bonne, mais les solutions techniques (choix des matériaux, dimensionnement) étaient bien sûr encore à affiner en 1897. Ici, la maison Link refit les sommiers en 1912. [IHOA:p214b] [ITOA:4p880] [PMSLINK:p255]
 1896 : Pfaffenhoffen (région de Bouxwiller), Sts-Pierre-et-Paul
1896 : Pfaffenhoffen (région de Bouxwiller), Sts-Pierre-et-Paul
Remplacé par Gaston Kern (1985).
L'inventaire paru en 1986 montre encore un orgue passionnant, avec son magnifique buffet néo-gothique en deux parties, dû à Oscar Hettich, servant aussi d'écrin à deux belles statues polychromes. C'était l'opus 10 de la maison Roethinger, idéalement proportionné à l'édifice et avec une composition donnant accès à un large répertoire : (II/P 17j), avec Trompette et Mixture-tierce (fondée sur 2'2/3) au grand-orgue, Voix céleste et Hautbois au récit et une Gambe de pédale. Il avait dû paraître très intéressant à l'auteur de l'inventaire (4 photos, dont une montrant la belle console aux flancs sculptés). Adolphe Blanarsch aussi, avait dû trouver cet instrument à son goût : il y apposa sa plaque d'adresse, vers 1930, après l'avoir réparé ! Dans les années 80, l'inventaire le déclare en mauvais état : il aurait probablement fallu remplacer les membranes, qui sont des pièces d'usure. Mais évidemment, à l'époque le verdict fut sans appel : "romantique = on remplace pour mettre du comme-il-faut". Ce serait aujourd'hui un orgue historique de grande valeur. Le buffet actuel fait peine à voir, tout comme les statues orphelines. C'est d'autant plus triste que Pfaffenhoffen est une terre de facteurs d'orgues. Peut-être pensera-t-on un jour à restaurer le bel orgue de 1896 ? [IHOA:p141a] [ITOA:4p498-9] [PaysAlsace89:p22] [Caecilia:p27] [Barth:p297]
 1897 : Couvent des Franciscains de Metz (Moselle)
1897 : Couvent des Franciscains de Metz (Moselle)Cet instrument (II/P 18j) est logé dans un buffet néo-roman assez simple, dont au moins le dessin semble dû à Laukhuff (très voisin de celui de Hangwiller). La transmission est pneumatique (tubulaire), mais - comme c'était souvent le cas à l'époque - la console est entièrement mécanique : les relais pneumatiques actionnés par la console se trouvent dans le buffet. Cela permet de réduire la longueur tubulures. En 1932, Frédéric Haerpfer remplaça le Hautbois par une Voix humaine, renouvela la console, et ré-harmonisa le tout (c'est un indice semblant confirmer que les orgues Roethinger du 19ème étaient fondamentalement différents des instrument ultérieurs, influencés par l'Orgelbewegung et la Réforme alsacienne de l'Orgue). L'opus 9 n'eut pas beaucoup de chance par la suite : en 1991, l'inventaire trouva l'orgue avec pas moins de 5 chapes vides... Les tuyaux étaient déposés : ils avaient été cédés à un organiste, qui les avait emportés, puis ramenés (sûrement parce qu'ils ne faisaient pas l'affaire). Depuis, le monde de l'orgue n'a pas beaucoup de nouvelles de ce pauvre instrument certes mutilé, mais doté d'un grand intérêt historique, et qui conserve presque tout son matériel d'origine... [IOLMO:H-Mip1446-59.]
 1897 : Synagogue de Metz (57)
1897 : Synagogue de Metz (57)Partiellement remplacé en 1924.
L'opus 7 est celui qui fut posé à la synagogue de Metz (dont c'était le premier orgue, et pour laquelle un projet Dalstein-Haerpfer de 1887 n'avait pas vu le jour). Les "Kegelladen" actuelles (sommiers à pistons) et de nombreux tuyaux d l'orgue actuel sont fort probablement de Roethinger. [IOLMO:H-Mip1330-3.]
 1897 : Kutzenhausen (région de Soultz-sous-Forêts), Eglise protestante
1897 : Kutzenhausen (région de Soultz-sous-Forêts), Eglise protestante
Remplacé par Frédéric Haerpfer (1921).
Cet instrument était la reconstruction d'un orgue Stiehr détruit par la grêle. Plus tard (1926), la maison Roethinger fut choisie pour construire un orgue à l'église catholique de la localité, mais en 1921, on préféra Dalstein-Haerpfer pour refaire celui de l'église protestante. [IHOA:p96a] [ITOA:3p323]
 1897 : Reichshoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel
1897 : Reichshoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel
Remplacé par Max Roethinger (1962).
De 1897 date une première version de l'orgue de Reichsfoffen. Toute poésie issue du 19ème s'y est depuis longtemps volatilisée : il y eut d'abord une version électro-pneumatique (gageons qu'on avait installé un chauffage), puis celle de 1962, qui est l'orgue actuel, avec une Cymbale à chaque manuel (probablement pour qu'il n'y en ait pas un qui soit plus "à la mode" que l'autre). [IHOA:p144a] [ITOA:4p515-6] [HOIE:p134] [PMSSTIEHR:p59-60]
Le 02/11/1897 naquit Max Roethinger, le fils qui plus tard allait reprendre l'entreprise. [OanEncyclopedia]
 1898 : Woerth, St-Laurent
1898 : Woerth, St-Laurent
Instrument actuel.
Partie instrumentale classée Monument Historique (13/09/1982).
L'opus 11 (II/P 23j) constitue le véritable "décollage" de la maison Roethinger. Dans son magnifique buffet néo-gothique fourni par Oscar Hettich (Haguenau) et sculpté par Weyh, cet instrument est un des premiers (le cinquième ou le sixième) doté d'une transmission pneumatique. Ici, ce sera des sommiers à cônes ("Kegelladen"). Les tirants de jeux sont encore tournés et munis de porcelaines : il sont disposés en ligne, au-dessus du récit. La tuyauterie est déjà caractéristique de la belle époque de la "façon" Roethinger, en particulier ces résonateurs d'anches munis de trous et de calottes : en tournant la calotte on peut partiellement occulter l'ouverture, et ainsi régler le volume sonore. La plaque d'adresse indique "E.A. Roethinger, Schiltigheim, I.E.". [IHOA:p225b] [ITOA:4p881-2] [Barth:p392,427]
L'instrument de Woerth était un tournant dans la production Roethinger ; c'est avec l'aide de F.X. Mathias que Roethinger arrive à se faire connaître dans le monde catholique. Et c'est son contremaître Jean Bierbauer qui est chargé des relations avec les commanditaires protestants. [URSRoethinger]
 1898 : Plobsheim (région de Geispolsheim), Eglise protestante
1898 : Plobsheim (région de Geispolsheim), Eglise protestante
Instrument reconstruit en 2012. Remplacé par Hubert Brayé (2013).
C'était l'une des bonnes nouvelles de l'année 2012 : cet instrument qui était resté longtemps à l'abandon (la console avait arrachée lors de "l'installation" d'une chose électronique) a retrouvé vie ! Au vu des dégâts, il y a quelques années, on se disait qu'il faudrait un miracle. Il a eu lieu. Le reconstruction a été confiée à Hubert Brayé, de Mortzwiller, qui a choisi une transmission mécanique. Une partie de l'opus 19 de la maison Roethinger a donc pu être sauvé. Il y avait 12 jeux à l'origine (le 2' étant extrait de la Mixture). La Mixture était en 2'2/3 : ce rang avait été sorti en 1962 pour faire une Quinte, et placé sur la chape de la Gambe. La Voix céleste du récit avait aussi été recoupée pour en faire une seconde Doublette. Les tirants de jeux (action pneumatique) étaient disposés en ligne au-dessus du récit. [IHOA:p142a] [ITOA:4p507]
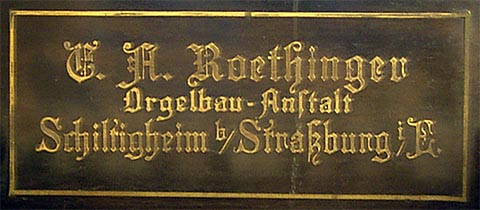 La belle plaque d'adresse de 1898 confirme l'installation à Schiltigheim 'près de' Strasbourg.
La belle plaque d'adresse de 1898 confirme l'installation à Schiltigheim 'près de' Strasbourg.
 1898 : Bischheim, Eglise protestante
1898 : Bischheim, Eglise protestante
Remplacé par Gaston Kern (1983).
De 1889 date la reconstruction de l'orgue de Bischheim (l'église, aujourd'hui protestante, était à l'époque "mixte"), qui fut l'opus 16 de la maison. Logé dans un buffet du 18ème, il n'avait pas une grande espérance de vie. De fait, il a été démoli en 1983.
 1899 : Wiwersheim (région de Truchtersheim), St-Cyriaque et Notre-Dame
1899 : Wiwersheim (région de Truchtersheim), St-Cyriaque et Notre-Dame
Remplacé par Yves Koenig (2002).
Ce n'était pas vraiment un orgue neuf que la maison Roethinger posa ici en 1899. A son démontage, l'instrument intégrait de nombreux éléments de provenances diverses. D'un orgue attesté peu après 1840 (hors service en 1892) datait certainement ce curieux sommier à gravures qui figurait parmi les sommiers à cônes de Roethinger. Le buffet néo-gothique, en chêne, est intéressant, encore très "19ème". Cet instrument a été totalement reconstruit en 2002 par Yves Koenig. [IHOA:p225a] [ITOA:4p880-1] [Caecilia:2002-4p26] [Barth:p392]
 1899 : Climbach (région de Wissembourg), Sts-Philippe-et-Jacques
1899 : Climbach (région de Wissembourg), Sts-Philippe-et-Jacques
Instrument actuel.
L'opus 23 (II/P 17j) est logé dans un très beau buffet néo-roman. Il a été relevé par Laurent Steinmetz en 1965 et par Hubert Brayé en 2010-2011. A part la façade, ce superbe instrument, ré-inauguré le 15/05/2011, est entièrement authentique. [IHOA:p46b] [ITOA:3p100-1] [Barth:p172]
 1900 : Neuviller-la-Roche (région de Schirmeck), Eglise protestante
1900 : Neuviller-la-Roche (région de Schirmeck), Eglise protestante
Instrument actuel.
En 1897, le pasteur Gustave Kopp ne pouvait pas se résoudre à voir son temple doté d'un orgue d'occasion : il prit donc son bâton de pèlerin (si on ose dire), et réussit à réunir suffisamment de dons et de subventions pour pouvoir faire construire l'orgue neuf (II/P 11+1j) proposé par la maison Roethinger. Ce fut l'opus 21 (II/P 11+1j). Ici, la console (pneumatique) est fermée par un couvercle incliné. La plaque d'adresse est encore d'un autre modèle : "E.A. ROETHINGER Orgelbaumeister". Comme à Plobsheim, l'Octave 2' est en fait un rang séparable de la Mixture. A part la façade, réquisitionnée en 1917, et le changement d'un jeu (Voix céleste recoupée en Quinte 2'2/3) par Ernest Muhleisen en 1963, l'orgue est resté authentique. [ITOA:3p420] [PMSAM84:p15-6] [IHOA:p126a]
 vers 1899 : Mulhouse, Chapelle de la rue Schlumberger
vers 1899 : Mulhouse, Chapelle de la rue Schlumberger
Orgue disparu.
C'est seulement parce qu'il figure sur la liste Roethinger que l'on connaît l'existence de cet instrument, qui, pour une chapelle, était quand même plutôt important (II/P 14r). [Caecilia:p74-5] [IHOA:p121a]
 1899 : Saverne, Chapelle de l'Hôtital civil
1899 : Saverne, Chapelle de l'Hôtital civil
Remplacé par Georges Schwenkedel (1936).
C'était un petit instrument (I/P 7j), remplacé par un orgue plus "néo-classique", et ce dernier fut finalement abandonné. [IHOA:p164b] [ITOA:4p587] [SchwenkedelAB:1p85] [SchwenkedelNB:1932-1939p4322-3] [Mathias:p49] [Barth:p329]
De cet époque date aussi un orgue privé pour Mulhouse (I/P 5r), un tout petit instrument pour Königsfeld (D) St-Peter und Paul (I/P 6r, qui n'a pas été conservé) et l'ajout d'un clavier à l'orgue de Bindernheim.
 1900 : Betschdorf (région de Soultz-sous-Forêts), St-Jean-Baptiste à Oberbetschdorf
1900 : Betschdorf (région de Soultz-sous-Forêts), St-Jean-Baptiste à Oberbetschdorf
Instrument actuel.
C'est le premier orgue de l'édifice (achevé en 1887). Son numéro d'opus (opus 28) apparaît sur une plaque d'adresse située à l'intérieur de l'orgue, et non sur la console : "E.A. ROETHINGER ORGELBAUMEISTER SCHILTIGHEIM STRASBOURG OPUS 28". Tirage des jeux par dominos. A part la Montre, cet orgue semble entièrement authentique. [Palissy] [IHOA:p130a] [ITOA:3p44] [Barth:p282,427]
 1900 : Eglise luthérienne de Hangviller (Moselle)
1900 : Eglise luthérienne de Hangviller (Moselle)Dès le devis, orgue était prévu avec le nombre de jeux actuel (II/P 14j), mais l'expert Hamma amenda la composition avant sa réalisation : il demanda une Flûte ouverte 8' au grand-orgue (Hohlflöte, à la place d'un Bourdon 8'), une Aéoline au récit (à la place d'une Flûte douce), et surtout il passa la pédale à 2 jeux au lieu de 3 pour pouvoir placer une Clarinette, à anches libres, au grand-orgue. La facture de ce jeu est équivalente à celle de Koulen (chape-pied et résonateurs coniques en bois). Le buffet, comme celui posé 3 ans plus tôt aux Franciscains de Metz a un dessin dû à Laukhuff (la tuyauterie métallique a aussi été achetée chez Laukhuff). Transmission pneumatique tubulaire pilotant des sommiers à pistons. La plaque est à fond blanc (porcelaine), et dit "E.A. Roethinger Orgelbaumeister Schiltigheim-Strasbourg". "Orgelbaumeister" est écrit en gothique. Cet instrument faillit être défiguré en 1972, mais heureusement, des difficultés financières firent capoter ce projet de "néo-baroquisation", et l'orgue Roethinger a été sauvé par le manque d'argent ! Il est aujourd'hui complètement authentique (sauf la façade). Attaqué par le ver à bois, cet instrument exceptionnel fait l'objet d'un projet de relevage. Espérons que ce ne sera vraiment qu'un relevage. [IOLMO:H-Mip746-8]
 1901 : Trimbach (région de Seltz), St-Laurent
1901 : Trimbach (région de Seltz), St-Laurent
Détruit par faits de guerre le 15/06/1940. Remplacé par Max et André Roethinger (1956).
Cet instrument (II/P 12j) a été détruit en 1940. [IHOA:p206b-7a] [ITOA:4p792]
 1901 : Schiltigheim, Eglise protestante rue Principale
1901 : Schiltigheim, Eglise protestante rue Principale
Remplacé par Gaston Kern (2005).
Chez lui, à Schiltigheim, Roethiger posa un orgue (II/P 21j) placé dans le choeur de l'église protestante. Fortement altéré dans les années 50, et déplacé sur une tribune inadéquate, l'instrument a été supprimé en 2004, et une partie de sa tuyauterie a servi pour construire un néo-baroque neuf. [IHOA:p166b] [ITOA:4p602] [PMSCS65:p17-21] [Barth:p333]
 1901 : Neuhaeusel (région de Bischwiller), St-Luc
1901 : Neuhaeusel (région de Bischwiller), St-Luc
Remplacé par Georges Emile Walther (1972).
Peut-être trop limité (I/P 7j), ce petit orgue, qui avait été opus 34 de la maison Roethinger, ne fut pas conservé. [IHOA:p125b] [ITOA:3p418] [Barth:p275]
 1902 : Voellerdingen (région de Sarre-Union), Ste-Croix
1902 : Voellerdingen (région de Sarre-Union), Ste-Croix
Instrument actuel.
L'opus 35 (II/P 9j), resté fort authentique, a été relevé en 1999 par Yves Koenig. [IHOA:p212b] [ITOA:4p810] [Barth:p373-4] [PMSLINK:p241]
 1902 : Belmont (région de Schirmeck), Eglise protestante
1902 : Belmont (région de Schirmeck), Eglise protestante
Remplacé par Alfred Wild (1989).
Le petit sanctuaire situé à Belmont - l'une des localités constituant le Ban-de-la-Roche ("Zum Stein") - était jadis une chapelle de pèlerinage. Certains de ces éléments sont fort anciens, puisqu'on peut y voir un vitrail du 13 ème siècle. L'orgue Roethinger qu'il abrite avait été conçu pour être un orgue de salon. Il a été reconstruit en 1989 par Alfred Wild. [IHOA:p33a] [ITOA:3p20] [PMSAM83:p20-1]
 1902 : Boofzheim (région de Benfeld), St-Etienne
1902 : Boofzheim (région de Benfeld), St-Etienne
Instrument actuel.
Evidemment, il ne faut plus chercher de traces de l'orgue Silbermann que Louis Geib a installé ici en 1818 (l'édifice a été reconstruit en 1870, mais le Silbermann y a bel et bien été réinstallé par Stiehr ; l'instrument a disparu en 1903). Cette jolie petite (II/P 7j) version d'orgue "de campagne" construite par Roethinger était déjà à l'abandon depuis des décennies... en 1986. Mais du coup, ce petit instrument a l'air très authentique et préservé. Au prix d'une remise en état, il réservera certainement de bien elles surprises. [IHOA:p41a] [ITOA:3p68] [PMSSTIEHR:p644] [PMSCS65:p18-9] [Barth:p163,428]
 1902 : Strasbourg, Eglise protestante St-Pierre-le-Jeune
1902 : Strasbourg, Eglise protestante St-Pierre-le-Jeune
Remplacé par Ernest Muhleisen (1950).
Il s'agissait de construire pour St-Pierre-le-Jeune un orgue neuf, en reprenant des éléments anciens. Le buffet a été placé sur le jubé, d'une seconde façade, côté chœur, et d'une ornementation polychrome en harmonie avec le reste de l'intérieur de l'édifice. La composition (dans sa version de 1945, mais c'était pratiquement la même qu'en 1902) est connue.
 1903 : Strasbourg, Ecole normale protestante
1903 : Strasbourg, Ecole normale protestante
De 1903 date aussi le grand (II/P 23j) orgue de l'Ecole Normale protestante de Strasbourg, qui était située avenue de la Forêt-noire. [IHOA:p186b,68b,73a]
 1904 : St-Jean-Saverne (région de Saverne), St-Jean-Baptiste
1904 : St-Jean-Saverne (région de Saverne), St-Jean-Baptiste
Remplacé par Richard Dott (2009).
L'opus 40 était en fait la reconstruction en pneumatique de l'orgue Silbermann/Stiehr du lieu. Dans les années 1980, on considérait les vilains orgues du début du siècle comme coupables de la disparition des magnifiques orgues du 18ème. Cette approche simpliste de l'histoire conduisit évidemment à mépriser ces instruments sans même les étudier. Ici, ce fut encore pire, car ce fut à l'électronique que l'on céda pendant plus de 20 ans. L'orgue Roethinger étant considéré sans valeur, on l'avait laissé à la merci des "installateurs" de la chose électronique. Ce fut édifiant et instructif (nous avons conservé les photos)... Du coup, l'orgue Roethinger fut lui aussi irrémédiablement perdu. La situation s'éclaircit en 2007 quand se concrétisa un projet de reconstruction d'une orgue dans l'esprit (Jean-André) Silbermann. Il fut confié à Richard Dott, qui dota à nouveau l'édifice d'un instrument de musique à la hauteur de son histoire prestigieuse. [IHOA:p159b] [ITOA:4p563-5] [Vogeleis:p486] [ArchSilb:p390-2,502] [PMSSTIEHR:p241-3] [Barth:p39,55,321-2] [Caecilia:p37-8]
 1904 : Eckartswiller (région de Saverne), St-Barthélemy
1904 : Eckartswiller (région de Saverne), St-Barthélemy
Instrument actuel.
Avec Eckartsweiller, c'est encore un chapitre douloureux de l'histoire de notre patrimoine qu'il faut aborder. Et pourtant, le passé organistique de cette localité est ancien et de qualité. L'église était dotée d'un orgue dès 1763 ! L'instrument avait été racheté à François-Joseph Seelig, maître d'école à Bouxwiller. En 1846, on fit construire un orgue par Nicolas Lété, de Mirecourt (à qui on doit, entre autres, les orgues de Bains-les-Bains et de Lamarche (Vosges). La chorale actuelle a été créée en 1882. En 1904, on voulut un instrument plus grand et mieux adapté au répertoire de l'époque, qui fut donc fourni par la maison Roethinger. Doté d'une Montre en zinc, ses tuyaux de façade ne furent pas réquisitionnés en 1917. L'instrument fut ensuite abandonné lors de l'installation d'une chose électronique (certainement plusieurs, depuis le temps...). Arriva ensuite ce qui est arrivé presque partout ailleurs dans ce cas : désintérêt, vandalisme, abandon. En 2004, l'état de l'orgue était déjà affligeant. On le déclara "irréparable" (on se demande bien sur la base de quoi : d'autres paroisses arrivent très bien à réparer, relever ou reconstruire leur instrument). Tout ceci est d'autant plus désolant que l'orgue historique d'Eckartswiller est probablement absolument authentique, d'une grande valeur, et que celle-ci est probablement juste méconnue. Evidemment, comme tous les orgues à transmission pneumatique, encore faut-il demander l'avis de quelqu'un de compétent, pas à quelqu'un qui cherche juste à "placer" un exorbitant devis de "mécanisation". [IHOA:p55b] [ITOA:3p145] [CS85Eckartswiller:p16] [PMSCS60:p27] [PMSSTIEHR:p702] [Barth:p186] [SchwenkedelNB:1932-1939p4273] [Mathias:p49] [Barth:p186]
 1904 : Climbach (région de Wissembourg), Eglise protestante
1904 : Climbach (région de Wissembourg), Eglise protestante
Instrument actuel.
La maison Roethinger avait déjà placé un orgue à Climbach en 1899 : il fut visiblement apprécié, puisque l'église protestante en demanda un aussi. Il ne s'agissait cependant pas vraiment d'un orgue neuf, mais d'agrandir l'instrument précédent, fourni par Stiehr, qui était inadapté en raison de tracasseries administratives de la préfecture (1840). L'agrandissement de Roethinger fut en fait une transformation profonde. L'instrument fut encore modifié par la suite. [IHOA:p46b] [ITOA:3p101-2] [PMSSTIEHR:p285] [Zegowitz1836:p210-5]
 1904 : Reichstett (région de Mundolsheim), St-Michel
1904 : Reichstett (région de Mundolsheim), St-Michel
Remplacé par Yves Koenig (1982).
Il s'agissait ici de reconstruire un des premiers orgues Stiehr (1792). Pas de quoi faire date dans l'histoire de la maison. [IHOA:p144a] [ITOA:4p518]
 1904 : Still (région de Molsheim), St-Mathias
1904 : Still (région de Molsheim), St-Mathias
Remplacé par Curt Schwenkedel (1967).
La reconstruction de l'orgue de Still n'est peut-être pas à considérer comme un instrument neuf. Mais il en est sorti, en 1904, un orgue post-romantique tout à fait alsacien : Violoncelle de pédale, cinq 8' et Cornet au grand-orgue, Voix céleste et Flûte harmonique. Dessus de Clarinette. Le répertoire adressable était immense ; il était taillé pour le récital, l'improvisation et la création. Bref, l'orgue qu'on voudrait avoir à quelque kilomètres de chez soi. [IHOA:p180a] [ITOA:4p652] [PMSSTIEHR:p196-7,657-8] [PMSAM75:p99-105] [SchwenkedelNB:1946-1953p4675] [SchwenkedelDO:1p2890,2891,2925,2939] [Barth:p345] [Mathias:p45]
 1905 : Haegen (région de Marmoutier), St-Quirin
1905 : Haegen (région de Marmoutier), St-Quirin
Remplacé par Michel Gaillard (2005).
Ce travail était la reconstruction d'un orgue de Nicolas Verschneider, 1853, qui était probablement devenu trop petit (I/P 8j)? L'orgue Roethinger (II/P 11j) occupait le buffet ancien (de 1853) qui arborait alors fièrement la date "1905". Kriess, à l'occasion du remplacement de la façade, plaça un Bourdon 16' et mit son nom sur le buffet Verschneider contenant l'orgue Roethinger. En 1986, le Bourdon 16' de Kriess était muet. En 2005, Michel Gaillard (maison Aubertin) construisit un orgue neuf dans le buffet Verschneider. [IHOA:p72] [ITOA:3p226] [PMSCS137:p33-4] [CahierPerdu:p5,7] [PMSSTIEHR:p597,698-9] [Mathias:p44] [Barth:p208]
Ce cette époque environ datent aussi plusieurs orgues livrés hors Alsace : celui de Nordrach (D), 1905, existe encore (Winterhalter 1977 et 2001), II/P 30j, électro-pneumatique à membranes.
Celui de Niederkorn (Lux), 1906, II/P 15j a été remplacé en 1958 par Karl Kamp. Celui de Prinzbach (D), II/P 12r, semble avoir été remplacé.
En 1906, il y eut un orgue pour Weimerskirch (Lux) II/P 28j, mais il fut remplacé en 1954 par Kemper (III/P 40r), et l'histoire se termina en désastre en 2004.
En 1908, Roethinger livra pour Ottersweier (D) St-Johannes der Täufer, un instrument plutôt conséquent (II/P 32r, pommiers à pistons pneumatiques) ; il fut vigoureusement "späthorgelbewegungué" par Josef Schwarz en 1935. L'essentiel de la tuyauterie Roethinger (un peu plus de 10 jeux, essentiellement des tuyaux en bois et des jeux gambés, mais aussi 2 anches) fut récupérée pour construire le nouvel orgue Winterhalter en 1987. Le pauvre orgue Schwartz resta muet et à l'abandon : le Roethinger avait été détruit pour rien.
Il y eut aussi un orgue privé de 4 registres pour Metz (57). [OrguesLux]
[PPOberrhein]
 1907 : Koenigshoffen (région de Strasbourg), Couvent des Capucins
1907 : Koenigshoffen (région de Strasbourg), Couvent des Capucins
Instrument actuel.
Et pourtant, ce devait être un bel instrument à l'origine ! L'opus 50 a été sacrifié, en 1960, pour le rendre compatible avec la "cuisine internationale", comme on disait (c'est à dire que l'instrument a été modifié en lui retirant ses spécificités pour le rendre "standard" ; même la boîte expressive a été démolie...). On voit mal comment, aujourd'hui, les importants dégâts correspondants pourraient être réparés. Ce malheureux instrument est toutefois chargé d'histoire : il avait été offert par une bienfaitrice de Mayence, et reçu par François-Xavier Mathias. Sa plaque d'adresse dit "E.A. Roethinger Orgelbaumeister Schiltigheim. Opus 50-1907". Il est logé dans un très beau buffet éclectique (néo-roman avec des couronnements plutôt néo-gothiques). Il a été minutieusement entretenu par Erwin Sattler dans les années 1970. Voici la belle composition qu'il avait avant d'avoir été défiguré :
 1907 : Strasbourg, Grand séminaire
1907 : Strasbourg, Grand séminaire
Remplacé par Max et André Roethinger (1949), déménagé à Schiltigheim, Ste-Famille.
Ce fut un événement, relaté dans Caecilia : le nouvel orgue du grand séminaire de Strasbourg était résolument novateur. La Mixture-tierce était décomposable : Quinte 2'2/3, Octave 2', Tierce 1'3/5. On disposait donc d'une Tierce indépendante : c'est déjà un trait du néo-classique qui apparaît ici. La console était assez exceptionnelle, avec 5 rangées de boutons correspondant à tous les jeux, pour piloter efficacement les 5 combinaisons libres (rappelons que le tout était 100% pneumatique). La console proposait aussi un crescendo et une pédale piano automatique. [IHOA:p199b] [ITOA:4p759] [Caecilia:3-4p37-39] [Caecilia:3-4p25] [Caecilia:1-2p27] [ZeitschriftInstrmentenbau:27p404] [PMSSTIEHR:p499-500,564] [Barth:p357-358] [Mathias:p34]
 1907 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Urbain
1907 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Urbain
Démonté en 1973. Remplacé par Bernard Aubertin (2018).
Cet orgue, démonté lors de la construction de la nouvelle église, aurait été entreposé dans le sous-sol de celle-ci. Même s'il est peu probable qu'il y soit resté plus de 40 ans, il serait affligeant qu'un instrument d'une telle valeur dorme sous la poussière. Ce serait un des rares exemplaires survivants de la période "entre Woerth (1898) et Erstein (1914)" dans la production Roethinger. En fait, il aurait de bonne chances d'être le seul authentique. [IHOA:p193b,204b] [Caecilia:p43-5]
 1908 : Ettendorf (région de Hochfelden), St-Nabor
1908 : Ettendorf (région de Hochfelden), St-Nabor
Remplacé par Martin et Joseph Rinckenbach (1908), déménagé à Gumbrechtshoffen, St-Barthélemy.
Cet instrument, construit en 1907 pour Ettendorf, n'y a probablement jamais été posé. En 1912, Roethinger l'installa finalement à Gumbrechtshoffen. Il fait partie de ces orgues qui ont "beaucoup vécu" (Médard Barth l'attribue à Blanarsh). Suite à deux "mises au goût du jour", l'instrument a perdu toute authenticité. [IHOA:p59a,70b] [ITOA:3p171] [ITOA:3p219] [Barth:p192,207]
 vers 1908 : Engwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
vers 1908 : Engwiller (région de Niederbronn-les-Bains), Eglise protestante
Détruit en 1945. Remplacé par Ernest Muhleisen (1960).
C'était un petit instrument (I/P 10j).
 1902 : Mundolsheim, Eglise protestante
1902 : Mundolsheim, Eglise protestante
Remplacé par Muhleisen (1971).
Roethinger dota cet instrument d'un second manuel et d'une vraie pédale, ce fut l'opus 35.
 1901 : Illkirch-Graffenstaden, Eglise luthérienne de Graffenstaden
1901 : Illkirch-Graffenstaden, Eglise luthérienne de Graffenstaden
Remplacé par Ernest Muhleisen (1963).
 1910 : Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath.
1910 : Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath.
Remplacé par Edmond-Alexandre Roethinger (1945).
Vers 1910, la maison Roethinger avait déjà construit dans les 60 opus, mais c'étaient surtout des orgues "de campagne". Il restait à fournir quelques références sur des tribunes "en vue". A St-Pierre-le-Jeune, ce fut la reconstruction de l'orgue Koulen du lieu qui permit à Roethinger de démontrer sa capacité à gérer un chantier d'envergure (III/P 37 ou 40j). Cet instrument était logé dans le magnifique buffet Klem de l'orgue Koulen, buffet qui ne fut malheureusement pas conservé en 1945. [IHOA:p196b,39b,176b] [ITOA:4p749,643-5] [Barth:p349] [HOIE:p108] [ArchSilb:p413-4,513] [PMSAEA85:p213-5] [PMSAM80:p167-71] [PMSSTIEHR:p509,562-3]
 1911 : Strasbourg, Bon Pasteur
1911 : Strasbourg, Bon Pasteur
Instrument déménagé à Wittenheim, Notre-Dame des Mineurs.
Le buffet, à 7 plate-faces, est original et intéressant (à rapprocher de celui de Cronenbourg). Après une vigoureuse transformation en 1960, cet orgue doit être attribué à Max Roethinger. Depuis 1990, pour le voir et l'entendre, c'est à Wittenheim qu'il faut aller. [IHOA:p183a,224a-b] [ITOA:4p660] [Barth:p359] [Caecilia:p32]
Pendant ses vacances parisiennes, en 1911, Roethinger rencontra Charles-Marie Widor, qui lui fit visiter l'orgue de St-Sulpice. [GSagot]
 1912 : Soultz-sous-Forêts, Sts-Pierre-et-Paul
1912 : Soultz-sous-Forêts, Sts-Pierre-et-Paul
Remplacé par Alfred Kern (1971).
De ce qui fut probablement un bel instrument romantique (II/P 16r) à l'image de ses contemporains de taille comparable, il ne reste plus que le buffet. Dans les années 70, il "fallait" tout refaire en mécanique. Bilan : en 1910, II/P 15 ou 16 jeux, en 1971, II/P 8 jeux (notons que la chape prévue pour l'inévitable Cymbale avait été laissé libre). [IHOA:p177a] [ITOA:4p646] [PMSSTIEHR:p508] [Mathias:p52] [Barth:p343]
 1912 : Strasbourg, Couvent Marie-Réparatrice
1912 : Strasbourg, Couvent Marie-Réparatrice
Remplacé par Curt Schwenkedel (1959).
Cet orgue avait 23 jeux à l'origine. Il a été reconstruit par Curt Schwenkedel.
 1904 : Lampertsloch (région de Woerth), Eglise mixte
1904 : Lampertsloch (région de Woerth), Eglise mixte
Instrument actuel.
L'opus 39 a été mofifié par la suite, et, occupant un buffet "ancien", son avenir ne fait pratiquement aucun doute.
 1905 : Nordrach (Bade-Wurtemberg, D), St. Ulrich
1905 : Nordrach (Bade-Wurtemberg, D), St. UlrichL'opus 40, pour Nordrach (tout près de Gegenbach) était plutôt conséquent : (II/P 30j). Il a été plus ou moins reconstruit par Winterhalter en 1977 et 2001.
 1906 : Niederkorn (L)
1906 : Niederkorn (L)L'opus 42, (II/P 16j), a été remplacé en 1958 par un néo-classique de Karl Kamp d'Aachen (III/P 36j).
 1905 : Prinzbach (Bade-Wurtemberg, D)
1905 : Prinzbach (Bade-Wurtemberg, D)L'opus 43, pour Nordrach (tout près de Gegenbach) était plutôt conséquent : (II/P 12j). Il a été plus ou moins reconstruit par Winterhalter en 1977 et 2001.
 1906 : Weimerskirch (L)
1906 : Weimerskirch (L)L'opus 44, (II/P 24j) (28 registres) remplaçait (après l'agrandissement de l'église) un orgue Dalstein-Haerpfer de 1871 (à un manuel). L'orgue Roethinger a été remplacé en 1954 par un Kemper (Lübeck), et ce dernier a subi le même sort en 2004... au profit d'une chose électronique. ("Renaissance", 81 "registres", 4 claviers et tout le tintouin. Comme on dit : "C'est bien la peine d'avoir une Histoire, si elle se finit comme ça...")
 1913 : Strasbourg, Ste-Madeleine
1913 : Strasbourg, Ste-Madeleine
Détruit par faits de guerre le 11/08/1944. Remplacé par Max Roethinger (1948).
Avec l'appui de François-Xavier Mathias, tout était devenu possible pour la maison de Schiltigheim. Pas moins de trois orgues Roethinger vont se succéder à Ste-Madeleine. Le premier, l'opus 67 de 1913, remplaçait le Koulen disparu dans les flammes le 06/08/1904. Il était logé dans un superbe buffet Art Nouveau tout en courbures et c'était jusque là le plus grand orgue construit par la maison Roethinger (III/P 47j). [IHOA:p191a, 97a] [ITOA:4p705] [Lobstein:p90-91] [PMSSTIEHR:p672-3,659-60] [ArchSilb:p359-60] [LORGUE:122-123p128-30] [RMuller:p163]
 1913 : Cronenbourg (région de Strasbourg), St-Florent
1913 : Cronenbourg (région de Strasbourg), St-Florent
Remplacé par Muhleisen (1955).
L'opus 68 était la "pointure au-dessus" de l'instrument placé au Bon Pasteur, lui aussi avec 7 plate-faces. L'architecture est semblable, mais le style très différent (le buffet de Cronenbourg a pu être modifié par la suite). L'instrument a été totalement reconstruit en 1955. [IHOA:p185b] [ITOA:4p686] [Barth:p361]
 1913 : Mutzenhouse (région de Hochfelden), St-Blaise
1913 : Mutzenhouse (région de Hochfelden), St-Blaise
Remplacé par Gaston Kern (1989).
Cet instrument (II/P 16j) avait été logé dans le buffet d'un orgue d'occasion amené par Stiehr en 1869. Sa composition est connue, et comportait une Harmonia aetherea (cela désigne parfois une Mixture constituée de Gambes, mais chez Roethinger plutôt une Mixture-tierce de 3 rangs, parfois décomposable). L'instrument neuf de 1989 n'a plus qu'un manuel (I/P 12j). [IHOA:p123b] [ITOA:3p410] [PMSSTIEHR:p624-5] [Barth:p272-273] [IOLMM:p324]
 Principaux travaux d'Erstein (1914) à 1925
Principaux travaux d'Erstein (1914) à 1925
Juste avant le conflit mondial, la maison Roethinger avait donc acquis un élan prometteur : près de 70 orgues, dont deux 3-claviers "en vue" dans le centre-ville strasbourgeois. Et surtout, l'Orgelbaumeister s'était attiré les faveurs de plusieurs appuis qui comptaient : Sering, Mathias. Plutôt que le "successeur" de Koulen (qui avait quitté l'Alsace plus ou moins tombé en disgrâce), il était devenu l'héritier des espoirs que l'on avait placé en lui. En particulier celui de doter la région d'instruments romantiques aux couleurs "germaniques". Un Weigle ou un Voit alsacien, voilà ce qu'on voulait. Mais le petit monde de l'orgue était en train de vivre une révolution, en gestation depuis l'achèvement du grand instrument de Strasbourg, St-Maurice (1899). Le mouvement, initié par Emile Rupp, amplifié par Albert Schweitzer, allait - très en avance - définir un style "néo-classique" spécifique, à rapprocher (un peu) des débuts de l'"Orgelbewegung" allemand.
 1914 : Erstein, St-Martin
1914 : Erstein, St-Martin
Instrument actuel.
Partie instrumentale classée Monument Historique (05/07/1996).
Avant d'être l'expression des pensées de Rupp, Gessner, Schweitzer ou même Roethinger, l'orgue d'Erstein est d'abord celui de Victor Dusch, son organiste. C'est lui qui l'a voulu et conçu. Nommé en 1902, brillant musicien, Dusch avait "hérité" d'un orgue avec un pédalier de 18 notes : c'est pratique "pour aider à tourner les pages" (en délestant la main gauche), mais pas pour "attaquer" le répertoire qu'ambitionnait le jeune organiste. Après 10 ans d'un "lobbying" intense, Dusch savait ce qu'il voulait, et avait eu le temps de peaufiner et de faire mûrir son projet. Et quel projet ! En 1912, tous les facteurs qui "comptaient" en Alsace étaient sur le coup. C'est Mathias qui fit pencher la balance dans le sens de Roethinger (en 1913), face à Edgard Wetzel, Dalstein-Haerpfer, Walcker, Weigle et Rinckenbach, qui étaient tous moins chers. L'opus 70 est un instrument majeur dans le paysage organistique alsacien. A la fois le dernier "romantique allemand" et l'annonciateur des magnifiques instruments qui seront construits entre les deux guerres (par Roethinger, Schwenkedel, et surtout Joseph Rinckenbach). L'orgue fut inauguré (avant sa réception) par Martin Mathias (cathédrale de Strasbourg), Auguste Stoecklin (Issenheim), Auguste Schirlé (Benfeld, mais natif d'Erstein), Louis? Huber (Guebwiller, Notre-Dame), Léon Thomas (St-Pierre-le-Jeune) et bien sûr Victor Dusch. Le procès-verbal de réception fut signé le 01/01/1915 (il faudrait donc en toute rigueur dater cet orgue de 1915...) : la guerre avait commencé. C'est le seul orgue alsacien où l'on trouve des jeux à haute pression. [SagotErstein2005:p9-14] [SagotErstein2003:p29-32,33] [IHOA:p58a] [ITOA:3p161-3] [PMSCALL:p104-7] [Barth:p190-1et planche 30] [Rupp:p345] [Caecilia:p28-9]
 1914 : La Wantzenau (région de Brumath), St-Wendelin
1914 : La Wantzenau (région de Brumath), St-Wendelin
Détruit avec l'église par un incendie le 15/05/1961. Remplacé par Max Roethinger (1966).
Cet orgue, reconstruction du Stiehr de 1830 (qui était lui-même la reconstruction d'un instrument plus ancien) était plutôt conséquent (II/P 26j). Roethinger avait été en concurrence avec Martin et Joseph Rinckenbach, et a probablement eu le marché grâce à l'appui de François-Xavier Mathias. L'orgue a été inauguré par Joseph Ringeissen. Pour le remplacer fut posé en 1966 un orgue Max Roethinger. [IHOA:p215b] [ITOA:4p825] [PMSSTIEHR:p218-22] [Caecilia:1995-1p30]
 1915 : Kleinfrankenheim (région de Truchtersheim), St-Georges
1915 : Kleinfrankenheim (région de Truchtersheim), St-Georges
Instrument actuel.
Même après avoir fourni plusieurs 3-claviers, la maison Roethinger n'abandonnait pas le marché des orgues "de campagne". Celui-ci (I/P 6j) a été logé dans le buffet de l'instrument précédent ; il présente la particularité de ne pas avoir été doté d'une transmission pneumatique (comme la quasi-intégralité de la production de l'époque) mais d'une mécanique à équerres actionnant un sommier à gravures. C'est sûrement parce que ce sommier a été repris sur l'orgue précédent. Une Doublette a été ajoutée par la suite. Voir aussi Jetterswiller. [IHOA:p92b] [ITOA:4p611] [Barth:p238] [PMSSTIEHR:p721]
 1915 : Koenigshoffen (région de Strasbourg), St-Joseph
1915 : Koenigshoffen (région de Strasbourg), St-Joseph
Remplacé par Muhleisen (1988).
L'opus 75 avait été construit pour Koenigshoffen en ré-employant des éléments de l'orgue Stiehr qui était venu de Strasbourg-St-Jean quelques années plus tôt. L'orgue Roethinger, caractéristique de la Réforme alsacienne de l'orgue, était logé dans un magnifique buffet éclectique idéalement assorti à l'édifice. Il a été remplacé en 1988. [IHOA:p189a-b] [ITOA:4p698] [PMSSTIEHR:p217] [CMAVS98:p108-12] [SchwenkedelDO:4p3335-6,3346-9] [Mathias:p34] [Barth:p361]
 1916 : La Montagne-Verte (région de Strasbourg), St-Arbogast Orgue de tribune
1916 : La Montagne-Verte (région de Strasbourg), St-Arbogast Orgue de tribune
Instrument actuel.
Cet orgue était destiné, à l'origine, à une Mission africaine. Il a souffert d'un manque d'entretien, et d'un déplacement fort malheureux de sa console. Il y a quelques années, de façon assez inexplicable, on a préféré le remplacer par un orgue de choeur, plutôt que de le remettre en état... Ce témoin incontournable de la construction d'orgues durant le premier conflit mondial, dont tous les indices laissent à penser qu'il est de très grande qualité, est aujourd'hui muet. [IHOA:p192a-b] [ITOA:4p714] [Barth:p361, 428]
 1917 : Jetterswiller (région de Marmoutier), St-Pancrace
1917 : Jetterswiller (région de Marmoutier), St-Pancrace
Instrument actuel.
A comparer avec celui de Kleinfrankenheim : il s'agissait de reconstruire un petit orgue ancien en conservant son buffet. Ce dernier, à 3 tourelles ressemble beaucoup à un buffet Rabiny ou Dubois/Bergäntzel : il n'y a plus de culots, ce qui n'aide pas. La largeur du soubassement, pas plus étroit que les superstructures, plaide plutôt pour le début du 19ème (ou la toute fin du 18ème) ; mais il peut très bien s'agir d'une modification ultérieure, voir d'un positif de dos transformé. La partie instrumentale, malgré sa taille réduite (I/P 7j), a été reconstruite en pneumatique. [IHOA:p87a] [ITOA:3p294] [Barth:p403]
 1916 : Durrenbach (région de Woerth), St-Barthélemy
1916 : Durrenbach (région de Woerth), St-Barthélemy
Instrument actuel.
L'affaire fut "rondement menée", malgré le conflit, puisque le devis est daté du 01/03/1916, le contrat du 21/04 et le procès-verbal de réception du 04/09. A part un jeu modifié en 1983, cet instrument (II/P 18j) semble authentique. [IHOA:p54a-b,73a] [ITOA:3p135] [Barth:p184]
 1917 : Reichsfeld (région de Barr), St-Urbain
1917 : Reichsfeld (région de Barr), St-Urbain
Instrument actuel.
Ce petit instrument (I/P 8j) est logé dans un buffet un peu plus ancien (1832) et présente la particularité d'être entièrement expressif. A part son malheureux Salicional, recoupé pour en faire un 2', il semble authentique. [IHOA:p143b] [ITOA:4p514] [PMSAEA69:p172-3] [PMSRHW:p218] [PMSSTIEHR:p330] [Barth:p301-2]
 1917 : Lingolsheim (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Jean-Baptiste
1917 : Lingolsheim (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Jean-Baptiste
Remplacé par Paul Adam (1978).
Il faut évoquer ici le pauvre orgue de Lingolsheim, qui devait être un bel instrument, cohérent (II/P 16j) à l'origine. Ce serait aujourd'hui un instrument fort intéressant, s'il n'avait pas été totalement défiguré en 1978, sous prétexte d'une reconstruction de la transmission en électrique (alors qu'il aurait sûrement été beaucoup moins coûteux de changer des membranes et faire un bon relevage). Larigot, Mixture jusqu'à 7 rangs, Sesquialtera au récit : rien a été épargné à ce malheureux instrument. [IHOA:p103b] [ITOA:3p340]
 1918 : Eschbach (région de Woerth), St-Martin
1918 : Eschbach (région de Woerth), St-Martin
Remplacé par Louis Blessig (1968).
Inauguré le 06/07/1918, alors que certains des pires moments de la guerre étaient encore à venir, cet orgue (II/P 10j) fut endommagé lors du conflit suivant (1944). Il a été réparé en 1951, mais a été remplacé en 1968 de façon assez incompréhensible, par un "néo-quelquechose" aussi absurde qu'éphémère... Heureusement, Rémy Mahler a fourni un orgue neuf en 1989. [IHOA:p58b,213a] [ITOA:3p167] [Barth:p191]
 vers 1919 : Ostwald (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Oswald
vers 1919 : Ostwald (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Oswald
Remplacé par Max Roethinger (1948).
Un premier orgue Roethinger fut posé à Ostwald juste après guerre. [IHOA:p41a] [ITOA:3p485] [PMSWETZEL75:p252]
 1919 : Hohatzenheim (région de Hochfelden), Sts-Pierre-et-Paul
1919 : Hohatzenheim (région de Hochfelden), Sts-Pierre-et-Paul
Remplacé par Yves Koenig (1986).
Cet instrument (II/P 13j) fut complété par la suite par Ernest Muhleisen pour donner une machine assez extraordinaire, finalement remplacée en 1986 par un orgue plus conventionnel. [IHOA:p80a] [ITOA:3p271] [PMSSTIEHR:p637-638] [Barth:p224] [RMuller:p15-6]
 1919 : Strasbourg, Ecole normale protestante
1919 : Strasbourg, Ecole normale protestante
Instrument déménagé à Tieffenbach, St-Barthélemy.
L'instrument précédent (un Roethingher de 1903) a été rejoint en 1919 par un plus petit (un seul manuel et 5 jeux). C'est peut-être cet orgue de l'école normale (ou un de ses collègues de l'établissement catholique) qui fut installé en 1949 à Tieffenbach. C'est l'hypothèse que nous retenons ici. [IHOA:p186b,68b,73a]
Pour compléter le grand orgue de l'Ecole Normale protestante de Strasbourg (1903), fut livré en 1919 un petit (I/P 5j) orgue d'étude.
En 1919, Roethinger installa ses ateliers à Strasbourg, 44-44a rue Jacques Kablé. [Caecilia:1953p74-5]
Les années 20
S'ouvre alors une période où Max s'occupera progressivement des clients. Mais Edmond-Alexandre sait aussi se faire "VRP" : il voyage à bord de sa fameuse Willys (véhicule utilitaire américain). Jusque là encore tourné vers le romantisme (allemand), Roethinger se laissera séduire par les idées de la Réforme alsacienne de l'orgue. En 1921, Ernest Muhleisen et Georges Schwenkedel furent embauchés par Roethinger. En 1924, un ami de Muhleisen, Alfred Kern, vint les rejoindre. [URSRoethinger]
 Le centre du papier à entête en 1923.
Le centre du papier à entête en 1923.
 1921 : Morhange (Moselle)
1921 : Morhange (Moselle)Instrument remplacé en 1960.
Que c'était-il vraiment passé en 1920-1921 à Morhange ? Sur le papier, l'orgue (II/P 23j) était très intéressant et directement issue de la Réforme alsacienne de l'Orgue. La tuyauterie Roethinger qui a survécu à la profonde transformation de 1965 a été inventoriée en 1991 : elle est de grande qualité, en étain sur pieds d'étoffe. Mais "quelque chose" n'a pas fonctionné à Morhange. Le projet d'un orgue de tribune fut initié juste après la Première guerre mondiale, mais fut vite sujet à d'importants retards : de mauvaises surprises attendaient à la fois le facteur et le maître d'ouvrage. Tribune trop petite, hausse des prix. L'expertise du 16/03/1921, menée par l'abbé Bour, souligne la qualité des matériaux employés, mais la trop grande concentration de tuyaux dans un espace si restreint (de nombreux tuyaux avaient dû être abondamment siphonnés). La Flûte octaviante 4' "laissait à désirer". Que ce soit pour des raisons climatiques ou techniques (densité des tuyaux), l'accord aussi semblait être plus qu'approximatif. Au bas du rapport, le curé ajouta par la suite la mention suivante : "M. l'abbé Bour a été trop bon et trop faible. C'est plus que des réserves qu'il fallait faire. On aurait dû refuser d'accepter purement et simplement le travail manqué." L'orgue fonctionna mal dès 1923. On décida donc de le confier à un concurrent de Roethinger : Adolphe Blanarsh. Son intervention coûta le double de ce qui était prévu. L'humidité semble avoir joué un grand rôle. Puis vint la Seconde guerre mondiale. On se décida ensuite à faire reconstruire l'orgue, par la maison Haerpfer-Ermann, mais les Beaux-arts firent interrompre le projet : il fallait d'abord s'occuper de l'édifice. Finalement, ce n'est qu'en 1965 que fut achevé un orgue extrêmement "typé" années 60, sans buffet, "néo-baroque" sur le papier (à des années-lumière de l'orgue de 1921), mais avec une tuyauterie non coupée au ton et des sommiers à pistons... De Roethinger, il ne reste que quelques jeux de belle facture, mais aux entailles de timbres rebouchées. Et on a retenu sa composition, qui vaut le détour : [IOLMO:Mo-Sap1446-59.]
 1922 : Ste-Claire de Julienrupt, au Syndicat (Vosges)
1922 : Ste-Claire de Julienrupt, au Syndicat (Vosges)Ce petit instrument (I/0P 5j) a été inauguré le 20/08/1922 par Emile François (Dommartin-lès-Remiremont). Il fut totalement détruit par faits de guerre le 03/10/1944. En 1948, la paroisse acheta, d'occasion, l'opus 870 de Jacquot-Lavergne, à savoir un orgue de série (6 rangs font 18 "jeux" par un système d'emprunts et extensions) : l' "Unit Organ" de Charmes. (C'est bien le seul qui le soit.) L'orgue Roethinger, avec une transissions pneumatique tubulaire, avait une composition on ne peut plus typée, mais aussi infiniment plus d'attrait: [IOLVO:p583-4]
 1923 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Aloyse
1923 : Neudorf (région de Strasbourg), St-Aloyse
Remplacé.
L'orgue de 1923 pour Neudorf reprenait bon nombre d'éléments de Koulen, mais était considéré comme "presque neuf".
 1923 : Spechbach-le-Haut (région d'Altkirch), St-Martin
1923 : Spechbach-le-Haut (région d'Altkirch), St-Martin
Remplacé par Christian Guerrier (1992).
L'opus 92 était la reconstruction d'un orgue Jean-Frédéric II Verschneider, détruit par faits de guerre après 1915. Le buffet fut probablement sauvé. La partie instrumentale a malheureusement été "mécanisée" en 1992. Dire que cet instrument devait être de la trempe de ceux de Galfingue ou Morschwiller-le-Bas, et qu'il aurait probablement juste suffi de remplacer les membranes...
 avant 1930 : Orgue aujourd'hui situé à Harol (Vosges)
avant 1930 : Orgue aujourd'hui situé à Harol (Vosges)Ce petit instrument (I/0P 5j) était certainement un orgue de salon à l'origine : il est entièrement en boîte expressive, est logé dans un buffet néo-classique richement travaillé et a une étendue non standard du clavier (au La). Il est arrivé à Harol après 1933, une fois achevée la tribune en béton qui devait pourvoir "supporter un orgue de 1510 kg"". Transmission pneumatique tubulaire. Ce joli petit orgue, muni de la plaque blanche de Roethinger ("Etablisements E.A. Roethinger Manufacture de grandes orgues Strasbourg") était malheureusement muet en 1990. La composition n'a jamais été retouchée (chapes repérées): [IOLVO:p339-40]
 1923 : Plaine-de-Walsch (Moselle)
1923 : Plaine-de-Walsch (Moselle)Ce petit instrument (II/P 10+1j) opus 88, encore entièrement pneumatique (c'est à dire pas électro-pneumatique) était fort bien préservé. Il portait une place d'adresse peu commune : "E.A. ROETHINGER OPUS 88 STRASBOURG: 1923", du même modèle que celle de Spechbach-le-Haut (opus 92, éliminé en... 1992). Le tirage des jeux se faisait par tirants à accrocher, non par dominos. Cet orgue a été détruit en 2004. En juin 2020, un site de petites annonces en ligne en proposait à la vente des éléments de console, dont le bloc-clavier avec la belle plaque d'adresse, et les tirants permettant de confirmer que la composition n'avait jamais été altérée. Les photos montrant notre patrimoine dans cet état ne peuvent que causer une grande tristesse à tout amateur d'orgue, d'histoire ou de musique. [IOLMO:Mo-Sap1637-8.]
 1927 : Galfingue (région de Mulhouse), St-Gangolphe
1927 : Galfingue (région de Mulhouse), St-Gangolphe
Instrument actuel.
Le bel orgue de Galfingue est l'opus 91 de la maison Roethinger, placé un buffet de 1836 (celui de Claude-Ignace Callinet dont la tuyauterie avait été réquisitionnée durant le conflit mondial, Galfingue ayant été évacué). [IHOA:p63a-b] [ITOA:2p121]
 1923 : Petit-Landau (région d'Illzach), St-Martin
1923 : Petit-Landau (région d'Illzach), St-Martin
Instrument actuel.
La partie instrumentale a malheureusement été "baroquisée" par 3 jeux incongrus ; mais le reste de l'instrument est fort intéressant ! [IHOA:p140b] [ITOA:2p336] [PMSSUND1987:p269-71] [IOLMO:Mo-Sap1637-8] [Barth:p296]
 1923 : Rhinau (région de Benfeld), St-Michel
1923 : Rhinau (région de Benfeld), St-Michel
Remplacé par Max Roethinger (1960).
Rhinau fait partie de la liste d'opus de la maison schilico-strasbourgeoise, ce qui montre qu'Edmond-Alexandre le considérait pratiquement comme un orgue neuf (II/P 17j). [IHOA:p146a] [ITOA:4p523-4] [PMSSTIEHR:p531-2] [Barth:p304]
 1924 : Morschwiller-le-Bas (région de Mulhouse), St-Ulrich
1924 : Morschwiller-le-Bas (région de Mulhouse), St-Ulrich
Instrument actuel.
Sur l'opus 93, la console est mécanique, et actionne ensuite une transmission pneumatique. Cette technique a aussi été utilisée par Joseph Rinckenbach, et donne d'excellent résultats (le toucher est agréable, les tubulures commencent toutes ensemble, au même endroit, proche des sommiers). C'est déjà un orgue néo-classique : le Larigot est d'origine. [IHOA:p116b-117a] [ITOA:2p252-3] [Vogeleis:p592] [Barth:p280]
En 1925, Edmond-Alexandre se fit construire une grande maison au 28, avenue Schutzenberger.
 Principaux travaux de la Synagogue (1925) à 1943
Principaux travaux de la Synagogue (1925) à 1943
 1925 : Strasbourg, Ancienne Synagogue (place des Halles)
1925 : Strasbourg, Ancienne Synagogue (place des Halles)
C'est une des légendes de l'orgue alsacien (III/P 62j) (16' ouvert, 32' de pédale) : l'instrument préféré d'Emile Rupp, qui y jouait régulièrement, et y était visiblement heureux comme un enfant : "On chantait du Naumbourg, du Lewandowski, du Sulzer, le tout accompagné à l'orgue par Emile Rupp. Il jouait tellement fort qu'on se croyait ailleurs. C'était formidable." (Jacques Rosenzweig, in "La Synagogue du quai Kléber" de Jean Daltroff). Ces chants, cet orgue, ce magnifique édifice et ces gens qui ne sont jamais revenus manqueront toujours à Strasbourg. Ils ne manquent pas tout à fait, cependant, si on garde précieusement leur souvenir. [IHOA:p200a]
 1925 : Herbsheim (région de Benfeld), Ste-Barbe
1925 : Herbsheim (région de Benfeld), Ste-Barbe
Détruit par faits de guerre, 01/1945. Remplacé par Max et André Roethinger (1956).
Il s'agissait de la reconstruction, en traction penumatique, de l'instrument que Jean-André Silbemann avait construit en 1743 pour Strasbourg, clinique de la Toussaint. [IHOA:p76b,203a] [ITOA:3p253] [ArchSilb:p437,455,511-2] [Barth:p219,429] [PMSSTIHEHR:p699]
 1925 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.
1925 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.
Remplacé par Max Roethinger (1964).
Le premier orgue Roethinger de St-Pierre-le-Vieux datait de 1925 (III/P 37j), et construit sur une base Wetzel/Koulen. Agrandi et électrifié par la maison Roethinger en 1934 (IV/P 46j) en 1934, il fut endommagé pendant la guerre. En 1960-1962, il a été déménagé à Caen, St-Julien, pour faire place à l'orgue Roethinger actuel. A Caen, il a été redisposé sur 3 manuels (console moderne), et, dans les années 2000, c'était un "grand orgue malade". Il est question de le reconstruire. [OrguesNormandie] [OrguesCalvados] [ITOA:4p751-2] [IHOA:p197b] [PMSAVS75:p118-28] [IOLMO:A-Gp170-3] [ArchSilb:p139-44] [PMSRHW:p193] [Caecilia:1997-2p26]
 1925 : Marlenheim (région de Wasselonne), Ste-Richarde
1925 : Marlenheim (région de Wasselonne), Ste-Richarde
Instrument actuel.
Cet instrument, assez exceptionnel, est doté d'un récit de 16 jeux dont un Larigot. Dans cet orgue post-symphonique, c'est l'une des premières évocations annonçant le style que l'on appellera plus tard "néo-classique". Ce Larigot, bien sûr, n'a pas grand-chose à voir, ni du point de vue de la réalisation, ni de celui de l'usage, avec les Larigots de l'époque néo-baroque. L'orgue de Marlenheim est également doté d'une Clarinette très réussie. [IHOA:p108a] [ITOA:3p357] [HOIE:p104] [Barth:p254,429,121-2,94-5] [PMSSTIEHR:p318]
 1925 : Schleithal (région de Wissembourg), St-Barthélemy
1925 : Schleithal (région de Wissembourg), St-Barthélemy
Remplacé par Gaston Kern (2003).
Cet orgue Roethinger n'existe plus. Il faut dire qu'il avait "pas mal vécu" (dommages de guerres, transformation en 1949). Il a été remplacé par un instrument mieux en accord avec son original buffet du 18 ème. [IHOA:p167b] [ITOA:4p607-8] [PMSSTIEHR:p88,649-50] [Caecilia:2004-2pp22] [CahierMockers:p585] [Mathias:p55] [Barth:p334]
 1926 : Ferrette, St-Bernard-Menton
1926 : Ferrette, St-Bernard-Menton
Instrument actuel.
L'orgue de Ferrette, caractéristique de son époque, a été plutôt bien conservé, et c'est un précieux témoin de la belle facture des années 20. [IHOA:p60a-b] [ITOA:2p111] [PMSAEA83:p253-5] [Barth:p194]
 1926 : Batzendorf (région de Haguenau), St-Arbogast
1926 : Batzendorf (région de Haguenau), St-Arbogast
Instrument actuel.
Ce très bel instrument, logé dans un buffet du début 19 ème a non seulement été laissé authentique, mais a bénéficié de tous les soins qu'il mérite. En 2009, la maison Koenig effectua un relevage, sous la maîtrise d'oeuvre assurée par Robert Pfrimmer. L'opération, exemplaire, a fourni une preuve de plus de la qualité de ces orgues Roethinger des années 20, décidément fort attachants. Même s'il ne dispose que de 14 jeux (et se trouve dépourvu d'anches), rien de manque pour aborder son répertoire de prédilection : sept fonds de 8' manuels, dont une Voix céleste et une Flûte harmonique, une Mixture-tierce, et même une Quinte-flûte pour envisager le répertoire néo-classique (et pour "faire anche" avec le Salicional). [IHOA:p32b] [ITOA:3p27] [PMSSTIEHR:p250-1] [Barth:p147] [Caecilia:p17]
 1926 : Kutzenhausen (région de Soultz-sous-Forêts), St-Georges
1926 : Kutzenhausen (région de Soultz-sous-Forêts), St-Georges
Instrument actuel.
Cet instrument est resté authentique. On observe qu'entre 10 et 15 jeux, le grand-orgue est souvent composé de 3 fonds de 8' et d'un Prestant. Les 3 accouplements du récit produisent toute la richesse des combinaisons possibles. Malgré les 11 jeux seulement, il dispose d'une anche : une Trompette de récit. Il dispose aussi d'une particularité très rare : une "tirasse à l'envers" (P/I) permettant de faire parler la Soubasse au grand-orgue. [IHOA:p96a] [ITOA:3p322-3] [Barth:p243]
 1926 : Soufflenheim (région de Bischwiller), St-Michel
1926 : Soufflenheim (région de Bischwiller), St-Michel
Remplacé par Gaston Kern (1980).
C'était l'opus 100 de la maison Roethinger. Il était logé dans le buffet fourni par Boehm pour l'orgue précédent (Stiehr, 1849), mais qui était en parfaite adéquation avec ce somptueux orgue romantique (la composition est connue). L'opus 100 était un vrai 16' ouvert (Montre 16' au grand-orgue). Son "carré d'or" de 8 pieds romantiques au grand-orgue (Montre, Bourdon, Flûte, Gambe) était complété par une Dulciane. Tandis que le côté "néo-classique" était représenté par des principaux en 16', 8', 4', 2', Plein-jeu de 4 rangs et des accouplements à l'octave. Au récit, on trouvait un incroyable choeur de Flûtes en 8' (harmonique !), 4' (pastorale), 2'2/3, 2' (Flageolet) et 1' (Piccolo), mais aussi une extraordinaire dotation en anches (Basson/Hautbois, Clarinette, Trompette harmonique, Clairon, Voix humaine). Cet orgue symphonique "tardif" assez extraordinaire restera une des victimes les plus regrettées de la vague "tout baroque", appuyée par "le pneumatique ne vaut rien". Bilan après 1980 : orgue construit avec des matériaux de récupération (on sait ce que ça veut dire), premier clavier sur 16' bouché seulement, perte de la quasi-intégralité des jeux romantiques (dont la Clarinette et la grande Flûte harmonique 8' !), récit de... 4 jeux. Malgré ce mini-récit qui semble n'être là que pour "se faire pardonner" (en fait, il remue douloureusement le couteau dans la plaie...), l'instrument de 1980 est néo-baroque jusqu'au bout de son Larigot, et donc en total désaccord avec son magnifique buffet. [IHOA:p176a] [ITOA:4p642] [PMSSTIEHR:p379]
 1927 : Seebach (région de Wissembourg), St-Martin
1927 : Seebach (région de Wissembourg), St-Martin
Remplacé par Gaston Kern (1992).
Cet orgue de style romantique français a été construit (malheureusement pour lui) dans un buffet plus ancien, de Ferdinand Stieffell. Et on y oublia un bout de Flûte 4' (constituant d-cis' du Bourdon 8') de ce facteur du 18ème. En 1917, lors de la réquisition des tuyaux de façade par les autorités, le sort s'acharna : la Montre fut qualifiée de "Silbermann", et laissée en place... Il n'en fallut pas plus en 1992 pour exiger la destruction sur-le-champ de cet orgue romantique pour le faire remplacer par un néo-baroque standard avec une composition "alla Silbermann". Et pourtant, l'orgue Roethinger devait pouvoir faire de bien jolies choses : le "carré d'or" 8', plus un Prestant au grand-orgue, Montre-viole, Flûte harmonique, Éolienne, Voix céleste, Flûte 4' et Trompette au récit expressif (octaves graves et aiguës), Soubasse et Violoncelle 8' à la pédale. [IHOA:p135a] [ITOA:4p621]
 1927 : Saint-Bernard (région d'Altkirch), St-Bernard
1927 : Saint-Bernard (région d'Altkirch), St-Bernard
Instrument actuel.
Cet instrument remarquable (II/P 18j), est resté totalement authentique. Représentatif d'une certaine idée de ce qu'on a appelé le style "néo-classique", il mériterait vraiment d'être mieux connu. C'est un orgue extraordinaire, unique à bien des égards. [IHOA:p56b] [ITOA:2p395] [Barth:p188] [PMSSUND1982:p219-22]
 1927 : Sengern (région de Guebwiller), St-Nicolas
1927 : Sengern (région de Guebwiller), St-Nicolas
Instrument actuel.
Dans son beau buffet néo-gothique (ce doit être un des derniers), cet orgue (II/P 14j) a été conservé sans modification. Le grand-orgue, muni de 4 fonds de 8' et d'un Prestant, peut être joué... en 16'. Il n'y a pas d'anche, mais un Salicional et une Quinte. [IHOA:p172a] [ITOA:2p215] [Barth:p339] [PMSCALL:p48,287]
 1927 : Lembach (région de Wissembourg), St-Jacques
1927 : Lembach (région de Wissembourg), St-Jacques
Instrument actuel.
C'était un instrument plutôt important (II/P 22j), qui devait avoir fière allure à l'origine. Malheureusement, les années 1960 sont passées par là avec leur cortège de Cymbales et Fournitures. Pourtant, ce n'est toujours pas l'idéal pour jouer Couperin, et l'instrument a perdu toute authenticité. [IHOA:p101a] [ITOA:3p333] [Barth:p245,429] [Muhleisen1991:p84]
 1927 : La Claquette (région de Schirmeck), Immaculée Conception
1927 : La Claquette (région de Schirmeck), Immaculée Conception
Remplacé par Alfred Kern (1969).
C'était un bel orgue, pas très grand (II/P 14j), placé à l'origine dans un beau buffet (dont il reste une photo), bien en harmonie avec le reste de l'édifice. La transmission était pneumatique, et bonne : en 1969, on chamboula la composition, supprima la boîte expressive, démolit le beau buffet pour le remplacer par quelques tristes planches sans grâce ni imagination... mais la transmission resta pneumatique. La composition actuelle (jeu de Tierce au second manuel qui n'est plus un récit, Cymbale, Cormorne,) est directement issue de la "cuisine internationale" des années 60-70. Le pauvre instrument a perdu tout intérêt. C'est peut-être restaurable, mais à quel prix ? [IHOA:p97a] [ITOA:3p86] [Barth:p171-2,429]
 1927 : Klingenthal (région de Rosheim), St-Louis
1927 : Klingenthal (région de Rosheim), St-Louis
Remplacé par Max Roethinger (1968).
Cet orgue était logé dans un buffet du début du 19ème, a priori celui de l'instrument précédent. La partie instrumentale bénéficiait intéralement d'une boîte expressive. La composition a été altérée en 1952. Il était déclaré à 6 jeux (Mathias) (II/P 6j), mais on sait qu'il y avait 8 jeux en 1952. Malheureusement, il a été impitoyablement éléminé en 1968 au cours de la période noire de la facture d'orgues, par un instrument de semi-série fourni par Max Roethinger. [IHOA:p93a] [ITOA:3p313-4] [Barth:p239]
 1927 : Ecole St-Sigisbert de Nancy (Meurthe-et-Moselle)
1927 : Ecole St-Sigisbert de Nancy (Meurthe-et-Moselle)Ce devait être un bel instrument à l'origine, quand il avait encore sa Gambe et sa Voix céleste. C'est Mgr Guise (1867-1947), supérieur de l'école Saint-Sigisbert qui avait voulu et mené le projet. La console portait la plaque "Etablissements E.A. Roethinger, Manufacture de Grandes Orgues, Strasbourg". L'inauguration fut une vraie fête : l'orgue était attendu et apprécié. "Cet instrument, sorti des Etablissements E.-A. Roethinger de Strasbourg réalise en effet les tout derniers progrès dans la facture moderne des orgues. Pour obtenir la douceur, la rapidité du toucher, on s'était servi jusqu'à présent des systèmes pneumatiques ou tubulaires. L'orgue de Saint-Sigisbert, suivant une formule neuve, pratiquée, paraît-il, en Angleterre, est électro-pneumatique. Le courant, produit par des accumulateurs, rend facile et sensible, non seulement l'exécution, mais encore la registration et les combinaisons de jeux. A la précision, ce système joint encore l'avantage d'un très faible encombrement. C'est ainsi qu'à Saint-Sigisbert, l'instrument est installé de part et d'autre de la tribune, laissant encore libre, au milieu et dans le fond, un assez vaste espace." On rapporte aussi que "les employés de la maison Roethinger [l']ont monté en l'espace de quelques jours". La traction électro-pneumatique avait permis de doter l'orgue de 9 accouplements - c'est peu courant - enrichissant ainsi ses possibilités.
Malheureusement, à l'occasion du tri-cinquantenaire de l'école, en 1986, on décida de "réviser" l'orgue... et cela tourna à la catastrophe : le bel instrument fut totalement défiguré : jeux Gambés découpés en d'incongrues Mutations, disparition du 16' manuel et de la Flûte harmonique (le jeu qui avait assurément le plus de valeur !), ajout d'un absurde Larigot, occultation des entailles de timbre (!), accord à base de ruban adhésif...
L'orgue mutilé faisait pitié, mais on essaya même pas de le restaurer : on préféra le remplacer par un orgue d'occasion en 2006 (par un orgue Kemper de Lübeck de 1961 à la composition passe-partout approuvé pour la Cuisine Standardisée ; mécanique comme il se doit - gageons que l'on a seriné jusqu'à la nausée à tout le monde que c'est la seule transmission valable, et hasardé d'un ton grave que l'électricité "présenterait un risque d'incendie"). C'est d'autant plus regrettable que la chapelle est de style... néo-gothique, 1867, le cadre idéal pour un orgue romantique. C'est d'autant plus désolant que l'orgue Roethinger aurait certainement pu être restauré pour pas très cher ; il était parfaitement adapté à l'endroit ; il avait été conçu pour cet endroit ! Finalement, il n'a pas été perdu pour tout le monde : il a été cédé à un particulier... Comme quoi, pour profiter de belles opportunités, il suffit de connaître la valeur des choses. Et pour commettre des bêtises, de l'ignorer. Un preuve de plus qu'il devient urgent de sensibiliser les gens à la qualité des oeuvres produites dans les années 1920-1930.
"Venez, enfants de l'antique Austrasie,
Vous devez savoir que votre orgue historique était beau.
Il le serait encore... s'il était toujours là."
Les recherches historiques à l'occasion de l'arrivée du "nouvel" orgue ont tout de même permis de retrouver sa composition (la voici, "croisée" avec celle de l'inventaire): [IOLMM:p345-6] [NancyStSigisbert]
C'est donc vers 1927 que la maison Roethinger produisit ses premières transmissions électro-pneumatiques ; Joseph Rinckenbach y était parvenu à Altkirch dès 1924.
 1928 : Boersch (région de Rosheim), St-Médard
1928 : Boersch (région de Rosheim), St-Médard
Cet instrument avait été construit sur la base (et dans le buffet) d'un orgue de Jean-Frédéric Verschneider (1865). Il est probable que sa curieuse composition date de 1953, quand la maison Roethinger fit une transformation (électro-pneumatique) : Fourniture, Trompette et Clairon au grand-orgue, Cymbale au récit où se trouve une seconde Trompette, troisième Trompette à la pédale (alors qu'il y a déjà une Bombarde). [IHOA:p40b] [ITOA:3p66] [PMSAM83CRosheim:p22-32] [PMSSTIEHR:p345] [Mathias:p47] [Barth:p160-162] [OLMO:Sc-Zp2566] [ArchSilb:p72]
 1928 : Zillisheim (région de Mulhouse), St-Laurent
1928 : Zillisheim (région de Mulhouse), St-Laurent
Remplacé par Michel Gaillard (2005).
L'instrument était la reconstruction d'un Stiehr (1841) qui avait été chamboulé par Berger (dès 1868). Il a été reconstruit en 2005. [IHOA:p227a,28a] [ITOA:2p501-2]
 Le logo en 1929.
Le logo en 1929.En 1929, un autre événement survint : la fin de la maison Rinckenbach, qui était, au moins sur le plan qualitatif, le plus dangereux concurrent de Roethinger. Reprise par Lapresté, la maison d'Ammerschwihr ne rivalisera plus vraiment, sur le plan commercial, avec Roethinger. A partir de là, il a le champ libre. Ses prochains concurrents locaux seront issus de sa propre entreprise ! Le talentueux Georges Schwenkedel s'était mis à son compte dès 1924.
 1929 : Liebsdorf (région de Ferrette), St-Jean Gualbert
1929 : Liebsdorf (région de Ferrette), St-Jean Gualbert
Instrument actuel.
Le buffet ressemble à celui des orgues Dalstein-Haerpfer de chapelle protestante de l'hôpital civil de Strasbourg ou Link de Merkwiller-Pechelbronn. Libsdorf a su préserver son patrimoine : cet instrument fort intéressant (II/P 19j) avec un récit permettant des octaves aiguës réelles semble être resté authentique. L'instrument dispose d'une "Harmonia aetherea", qui est ici une Mixture-tierce, décomposable. [IHOA:p102a] [ITOA:2p220] [Barth:p246]
 1929 : Muhlbach-sur-Munster (région de Munster), St-Barthélemy
1929 : Muhlbach-sur-Munster (région de Munster), St-Barthélemy
Instrument actuel.
L'opus 122 (II/P 14+1j), lui aussi, a été bien entretenu : il a été relevé en 2005. [ITOA:2p255] [AMun1960:p47] [IHOA:p118a] [Barth:p266] [Caecilia:2006-02p39]
 1929 : Mittlach (région de Munster), Immaculée conception
1929 : Mittlach (région de Munster), Immaculée conception
Instrument actuel.
L'opus 123 est situé dans une localité voisine du précédent ils semblent avoir été construits ensemble. C'est aussi un instrument qui a été remarquablement bien préservé. On retrouve une "Harmonia aetherea" comme à Liebsdorf. [IHOA:p114a] [ITOA:2p244] [Barth:p261]
 1929 : Munster, St-Léger
1929 : Munster, St-Léger
Remplacé par Alfred Kern (1975).
La maison Roethinger a beaucoup travaillé en 1929 dans la région de Munster. Cet orgue, placé à St-Léger, était un assez grand instrument (II/P 37j). Même le buffet était neuf (les dommages dûs à la guerre avaient été importants). Il était néo-gothique, et absolument remarquable (une photo est conservée). Au lieu d'entretenir cet instrument, on préféra le démolir en 1974. Il fut finalement remplacé en 1986 par un orgue néo-baroque "passe-partout", logé dans un buffet jaunâtre aux lignes lourdes et maladroites. Mais pourquoi n'a-t-on pas simplement gardé le Roethinger ?
 1928 : Mulhouse, Hôpital Hasenrain
1928 : Mulhouse, Hôpital Hasenrain
Instrument actuel.
Ce petit instrument (II/P 9j) a été pratiquement reconstruit par la maison Roethinger elle-même (console électrique) en 1959. Il présente un jeu original : une Clarinette "labiale" (jeu à bouche). [IHOA:p120b] [ITOA:2p287] [Mathias:p66] [Barth:p268]
 1929 : Pulversheim (région d'Ensisheim), St-Jean
1929 : Pulversheim (région d'Ensisheim), St-Jean
Instrument actuel.
C'est dans l'ancienne église, consacrée à St-Etienne (1887) qu'a été posé l'instrument en 1929. L'édifice a été endommagé durant la seconde Guerre mondiale. En 1968, une nouvelle église "à l'épreuve des affaissements miniers" a été construite. Quant à l'orgue Roethinger, il a été réparé en 1951, puis transféré en 1968 dans la nouvelle église. Malheureusement, et sûrement pour "accorder" l'orgue à l'esthétique "contemporaine" du nouvel édifice, on ne trouva rien de mieux que de supprimer le haut du buffet. Lors de l'Inventaire de 1986, il se trouvait réduit à un soubassement surmonté d'une effrayante palissade de tuyaux en zinc. Il a aujourd'hui heureusement retrouvé un peu de bois, suite à un relevage par Hubert Brayé, en 1999. [IHOA:p142b] [ITOA:2p340]
 1929 : Domèvre-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle)
1929 : Domèvre-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle)La maison Roethinger construisit deux orgues pour Domèvre. Celui de 1929 (7j) fut endommagé durant le second conflit mondial, et plus ou moins dispersé par la suite. Un instrument neuf fut construit en 1959 (voir ci-après). [IOLMM:p117-8]
 vers 1930 : Krafft (région d'Erstein), Chapelle de Krafft
vers 1930 : Krafft (région d'Erstein), Chapelle de Krafft
Instrument actuel.
Cet instrument est avant tout un harmonium (à pédalier), et nous rappelle que la maison Roethinger en construisait beaucoup. Construit vers 1930, il était la propriété d'un célèbre organiste d'Erstein : Victor Dusch. C'est son fils Robert qui en fit don à la chapelle de Kraft en 1965. Mais on peut classer cet instrument parmi les orgues, puisqu'il dispose d'un jeu traditionnel : une Flûte 8', bouchée dans les graves, et en Montre dans les mediums. [IHOA:p94b] [ITOA:4p895]
 1930 : Mulhouse, Sacré-Coeur
1930 : Mulhouse, Sacré-Coeur
Remplacé par Max et André Roethinger (1965).
Cette "première version" de l'orgue du Sacré-Coeur (II/P 24j) était placée dans l'édifice "provisoire". [IHOA:p120a] [ITOA:2p267] [Mathias:p66]
 1930 : Chapelle de la Compassion à Domfront (Oise)
1930 : Chapelle de la Compassion à Domfront (Oise)Séparé en deux corps, avec un positif factice au centre pour masquer la console, cet instrument doté de grands claviers de 5 octaves est resté authentique. C'est un témoin précieux de cette époque. Entailles de timbre (sauf certains dessus) et calotte mobiles pour la tuyauterie. Traction électrique et composition plus "romantique tardive" que néo-classique: [IOOISE:p104-6]
 1930 : Wisembach (Vosges)
1930 : Wisembach (Vosges)L'opus 129 avait encore été payé par les dommages de guerre. Dans un édifice Art déco achevé l'année précédente, Roethinger posa un orgue (II/P 12+2j) post-romantique, logé dans un buffet néo-roman en chêne, d'une grande simplicité. La transmission était déjà électro-pneumatique (1930) : elle était alimentée à l'origine par des batteries. L'instrument est resté entièrement authentique, et une association pour sa sauvegarde a été créée. [IOLVO:p638-40]
 1931 : Dambach-Neunhoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Maurice
1931 : Dambach-Neunhoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Maurice
Instrument actuel.
Malheureux opus 137... citons tout simplement l'Inventaire Technique des orgues d'Alsace (ARDAM, 1986), vol 3, p. 107 : "Injouable. Pour laisser place à un orgue électronique, la console a été démontée et placée de force dans l'orgue, entre les sommiers, écrasant tuyaux et faux-sommiers. Un tel vandalisme effectué par le propriétaire lui-même de l'orgue est consternant..." [IHOA:p50a] [ITOA:3p107]
 1931 : Bendorf (région de Ferrette), Exaltation de la Croix
1931 : Bendorf (région de Ferrette), Exaltation de la Croix
Remplacé par Christian Guerrier (1995).
Cet orgue, logé dans un buffet de la fin du 18ème, a malheureusement été totalement remplacé en 1995 par un instrument néo-baroque soit-disant "nordique". [IHOA:p33a-b] [ITOA:2p27] [Barth:p148]
 1931 : Saint-Benoît-la-Chipotte (Vosges)
1931 : Saint-Benoît-la-Chipotte (Vosges)"La Chipotte" est le nom du col où reposent les victimes des terribles combats d'août et septembre 1914. En souvenir de ces évènements tragiques, au nom de Saint-Benoît fut ajouté "la-Chipotte", en 1925. L'opus 130 (II/P 12+1j) n'a pas été payé que par les dommages de guerre : les familles de soldats inhumés au cimetière militaire ont aussi contribué. Le buffet, en chêne, de style "art déco", est parfaitement en accord avec le reste de l'édifice reconstruit en 1928. Comme quoi, "reconstruction" ne veut pas forcément dire "à l'économie". Si les basses sont en zinc (pour plus de robustesse), les dessus des jeux à bouche sont en étain. La transmission est électro-pneumatique, et le récit a 68 notes, pour pouvoir disposer d'octaves aigues même dans la dernière octave. La composition est encore très "post-romantique" : Roethinger n'avait pas fait une religion du style néo-classique: [IOLVO:p530-1]
 1932 : Dornach (région de Mulhouse), St-Barthélemy
1932 : Dornach (région de Mulhouse), St-Barthélemy
Instrument actuel.
Cette réalisation eut un grand retentissement dans le monde de l'orgue alsacien : un grand instrument (IV/P 59j 62r), avec des claviers de 61 notes. La console d'origine a malheureusement été remplacée en 1974. Même s'il n'y a que 3 claviers à la console, l'instrument dispose de cinq plans sonores. En effet, le 3ème clavier permet de jouer, en plus du récit expressif, deux jeux d'orgue et un jeu de clochettes logés dans un Fernwerk situé dans le transept droit. C'est directement comparable avec ce que Joseph Rinckenbach à fait à Colmar, sur son chef d'oeuvre malheureusement disparu, mais aussi avec le Fernwerk de l'orgue de Bischheim, St-Laurent (1933, donc pratiquement contemporain). Les années 30 créaient des orgues résolument originaux, dotés d'un caractère "mystérieux" (peut-être à rapprocher de la mode du spiritisme et des "expérience scientifiques édifiantes" qui étaient alors très populaires). Au programme, Harpe éolienne, Harpe céleste et de nombreuses Mutations simples, ainsi qu'un Cornet complet. [IHOA:p52b] [ITOA:2p269-70] [Barth:p182]
 1933 : Obersteinbach (région de Wissembourg), St-Martin
1933 : Obersteinbach (région de Wissembourg), St-Martin
Instrument actuel.
Ce petit (II/P 7j) orgue est muni d'un Cornet 3-5 rangs. Aucun jeu ne dépasse le 4', mais un accouplement à l'octave permet de réaliser une Flûte 2'. Il n'y a plus de réel buffet : une rangée de tuyaux est simplement disposée sur un soubassement. Ce n'est pas Weingarten... mais au moins il s'agit d'un vrai instrument de musique. [IHOA:p135b] [ITOA:4p469]
 1932 : Wittelsheim (région de Cernay), St-Michel Orgue de tribune
1932 : Wittelsheim (région de Cernay), St-Michel Orgue de tribune
Remplacé par Max et André Roethinger (1956).
Cet instrument, plutôt important (III/P 36j) était déjà à traction électrique. Le buffet, néo-classique et orné, était constitué de deux tourelles latérales rondes avec couronnements et culots, et d'une tourelle centrale plate. L'instrument fut perdu lors des bomardements de 1945. L'église a été reconstruite en 1946, et, en 1956, Max et André fournirent le deuxième Roethinger du lieu.
 1932 : Haselbourg (Moselle)
1932 : Haselbourg (Moselle)Orgue remplacé en 1990.
Initialement prévu avec un Fernwerk, l'opus 134 fut finalement réalisé sans (II/P 11j). Il remplaçait un orgue qu'avait fourni d'occasion Franz Staudt. A la fin des années 80, l'orgue Roethinger fut victime d'une chute de plâtre du plafond et d'infiltrations d'eau (peu compatibles avec une transmission électrique). Vu l'instrument actuel, on aurait quand même du mal à regretter cet orgue Roethinger... Depuis l'arrivée de l'orgue de François Delhumeau, Haselbourg a un "palmarès" culturel impressionnant ! [IOLMO:H-Mip756-9.] [OrgueHaselbourg]
 1932 : Chapelle des Soeurs de la Providence à Portieux (Vosges)
1932 : Chapelle des Soeurs de la Providence à Portieux (Vosges)L'opus 139 fait usage d'une transmission électro-pneumatique. Cette solution technique, introduite par la maison Roethinger vers 1927, se faisait jusque là discrète, mais à Portieux, la console s'orne d'une plaque "Système breveté S.G.D.G." (i.e. "Sans Garantie Du Gouvernement"). L'instrument était doté d'une composition élaborée par Lucien Noël (Saint-Dié). Elle fut retouchée par la suite, et l'originale était la suivante: [IOLVO:p464-5]
 1933 : Bischheim, St-Laurent
1933 : Bischheim, St-Laurent
Instrument actuel.
C'est bien sûr un orgue "clé" de l'oeuvre Roethinger, une grande machine symphonique avec Fernwerk, Gambes et Mutations. A découvrir absolument. [Barth:p154-5] [IHOA:p38a] [ITOA:3p52-4]
 La plaque en 1933 (Bischheim).
La plaque en 1933 (Bischheim).En 1933, F.X. Mathias publia une liste de travaux de Roethinger dans son "Orgues, organiers et organistes de Notre-Dame de Strasbourg", qui compte 149 instruments achevés. Si la plupart d'entre eux ont été posés en Alsace, en retrouvait des orgues en Moselle, Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, Pas-de-Calais, Nord, Pays de Bade, Luxembourg, Saare, Norvège, Madagascar - et deux orgues aux Indes. La "liste Caecilia 1924" donne 85 orgues alsaciens entre 1893 et 1924. La "liste Barth" la complète en donnant 113 instruments, exclusivement alsaciens, jusqu'en 1936. [Barth:p427-30]
 1933 : Pexonne (Meurthe-et-Moselle)
1933 : Pexonne (Meurthe-et-Moselle)Visuellement, on dirait un orgue Stiehr. Le buffet, plus ancien que la partie instrumentale, provient de l'important stock que Roethinger s'était constitué. De nombreuses hypothèses peuvent être envisagées au sujet de sa provenance (Obersteinbach, l'ancien orgue de Bischheim...). La partie instrumentale est un bel exemple de post-romantisme minimal : [IOLMM:p367-8]
 1933 : Wasselonne, St-Jean Bosco
1933 : Wasselonne, St-Jean Bosco
Instrument actuel.
De 1933 date également l'opus 151 construit pour les Spiritains de Neufgrange. En 1940, il est revenu en Alsace, puisqu'il se trouve aujourd'hui à Wasselonne, St-Jean Bosco. C'est un instrument qui mérite absolument d'être découvert. [IHOA:p216b] [ITOA:4p826] [IOLMO:Mo-Sap1518-21]
 1934 : Merkwiller-Pechelbronn (région de Soultz-sous-Forêts), Ste-Barbe
1934 : Merkwiller-Pechelbronn (région de Soultz-sous-Forêts), Ste-Barbe
Remplacé par Gaston Kern (1989).
C'était un tout petit orgue (I 5j), entièrement expressif, sans pédale, mais avec une basse de Bourdon 16'. Il a été reconstruit à la fin des années 1980. [IHOA:p111a] [ITOA:3p374]
 1934 : Strasbourg, Ste-Jeanne d'Arc
1934 : Strasbourg, Ste-Jeanne d'Arc
Instrument actuel.
C'est un tout petit orgue (I/0P 6j), avec pas mal de bizarreries (Cromorne et basse de Sifflet...) qui doivent probablement s'expliquer par des modifications ultérieures. [IHOA:p189a] [ITOA:4p695]
 1934 : Distroff (Moselle)
1934 : Distroff (Moselle)Cet instrument (II/P 18j) est absolument caractéristique de la production des années 1930. Frédéric Haerpfer avait proposé un buffet néo-gothique (avec nettement plus d'allure) mais tous les goûts sont dans la nature, et c'est le dessin qualifié de "Modern style" qui fut retenu. Toute l'étonnante ambiance des "années 30" se retrouve autour de la genèse de ce projet. Ainsi, c'est "après avoir pris les renseignements voulus auprès d'hommes compétents et impartiaux" que la fabrique se décida. C'est le mécénat qui permit la construction de l'instrument, en particulier celui de la Société thionvilloise des ciments. C'est le "Président de la Société internationale d'organologie" (le chanoine Mathias) qui en assura l'inauguration. Au revers de la console, on apposa une plaque en laiton : "Cet orgue construit en 1934 par E.A. Roethinger, facteur d'orgues, Strasbourg, a été béni lorsque Monseigneur Jean Baptiste Pelt était évêque de Metz, Monsieur l'abbé Sondag, curé de Distroff, et Monsieur Ferdinand Maritus, Maire de Distroff." (On ne connaîtra pas le nom de Monsieur l'Organiste.) La composition du devis (II/P 17+3j) prévoyait un Cor anglais au récit (clavier doté d'un sommier de 68 notes). Tout un programme. Malheureusement, tout cette magie fut anéantie en 1985, lorsque des improbables Plein-jeu, Tierce et... Flûte 2' de pédale vinrent dénaturer la composition en remplaçant des jeux qui servent. Heureusement, l'instrument est, depuis quelque temps, confié à Jean-Baptiste Gaupillat, et a probablement de beaux jours devant lui. [IOLMO:A-Gp44851]
 1935 : Strasbourg, Cathédrale Notre-Dame Grand orgue
1935 : Strasbourg, Cathédrale Notre-Dame Grand orgue
Remplacé par Alfred Kern (1981).
Au début du 20ème siècle, une fissure apparut dans un des piliers nord qui supportent le poids de la tour de la cathédrale de Strasbourg. La fissure se fit lézarde, et bientôt des travaux très importants, qui touchaient aux fondations elle-mêmes, durent être menés. Il fallut construire des échafaudages de soutènement pour les voûtes nord, et donc démonter l'orgue, ce qui fut fait en plusieurs étapes, juste avant le première guerre mondiale. Le démontage eut donc lieu au plus mauvais moment. Les autorités, qui réquisitionnaient l'étain partout où elles en trouvaient, descendaient les façades de tous les orgues, et pour les instruments démontés ou injouables, c'était l'intégralité de la tuyauterie métallique qui était envoyée à la fonderie. On décida d'épargner la façade (qui est probablement antérieure à Silbermann, peut-être même de Krebs). Ce fut fait en partie, mais certains tuyaux furent tout de même réquisitionnés par erreur. Après la guerre, de nombreuses personnalités se mobilisèrent pour doter la cathédrale d'un orgue de nef. Le projet consistait à construire un orgue neuf avec les tailles (rapports dictant les dimensions des tuyaux, donc leur timbre) de Silbermann. Et surtout, avec une transmission mécanique (assistée par machine Barker). Charles-Marie Widor prit la présidence de la Commission chargée d'organiser le concours. Un appel d'offre fit produire des devis aux maisons Cavaillé-Coll, Gonzalez, Jacquot, Lapresté (l'ex-Maison Rinckenbach), Rochesson et Roethinger. Une "short list" dressée en 1933 ne retint que Cavaillé-Coll et Roethinger, et le Strasbourgeois l'emporta finalement. Mais l'orgue de la cathédrale est un instrument dangereux, et Roethinger le savait. L'instrument était la "beauté fatale" qui avait déjà coûté leur renommée à Wegmann et Koulen. Le seul vrai problème, pour Roethinger, c'est qu'il ne disposait absolument pas, dans son entreprise, des compétences nécessaires à la construction d'un instrument à traction mécanique. En bon chef d'entreprise, il alla chercher la compétence chez ses concurrents, en la personne de Salmon, le spécialiste des mécaniques chez Cavaillé-Coll. Mais en plus du caractère atypique de la transmission mécanique, il y avait le problème de la profondeur très limitée (1m20 à 1m50) et surtout du positif de dos, qui nécessite des techniques différentes. En Alsace, on n'avait pas construit de positif de dos depuis les années 1870 (à quelques exceptions notables, comme Uhlwiller, 1878). Roethinger ne savait vraiment pas comment construire cette mécanique pour un positif de dos. Et à nouveau, il prit une décision pragmatique : il le fit en pneumatique. Et les experts chargés de la Réception de l'instrument, tout aussi peu familiers que le facteur avec les mécaniques... ne se rendirent compte de rien. L'orgue Roethinger remplit son office. Il restait 250 tuyaux Silbermann dans l'orgue.
 La plaque Roethinger sur la console à la cathédrale de Strasbourg.
La plaque Roethinger sur la console à la cathédrale de Strasbourg.Elle provient du livre écrit par Félix Raugel 'Les Orgues et les Organistes de la Cathédrale de Strasbourg" (Editions Alsatia Colmar) 1948
L'impact de la reconstruction de l'orgue de la cathédrale eut un impact positif : pas moins de 25 commandes d'orgues neufs arrivèrent après son achèvement. [Barth:p430]
 1935 : Haguenau, Collège des Missions africaines
1935 : Haguenau, Collège des Missions africaines
Instrument actuel.
L'instrument qui fut installé en 1956 dans la chapelle du collège des Missions africaines de Haguenau paraît être un Roethinger, datant de 1935. Il est doté d'une console des années 1950, et parfois attribué à Schwenkedel. [ITOA:3p237] [FLHaguenau:p197] [IHOA:p73a] [SchwenkedelDO:4p3248]
 1935 : Orgue de Charles Montaland (Lyon)
1935 : Orgue de Charles Montaland (Lyon)Cet orgue - à l'origine privé - a été monté et harmonisé par Alfred Kern et Georges Koenig, qui travaillaient alors pour Roethinger. Avec ses grands claviers de 5 octaves (et une pédale allant jusqu'au Sol), l'instrument est entièrement expressif (deux boîtes). Sa composition est très spécifique, avec un récit constitué du couple Gambe/Voix céleste, d'un Jeu de tierce de 5 rangs, et d'un Cornet à 5 rangs. Les jeux du grand-orgue et 3 jeux du récit disposent d'octaves aigues réelles (donc 6 octaves, soit 73 notes). En 1986, l'instrument fut déménagé (après quelques modifications) dans l'église St-Jacques des "Etats-Unis" de Lyon. [IOLYON:p401-2]
 1935 : Sainte-Ruffine (Moselle)
1935 : Sainte-Ruffine (Moselle)Récemment relevé (et utilisé en concert : Agathe Zenier et Olivier Schmitt en septembre 2010), l'orgue de Sainte-Ruffine est encore un exemple de la "belle époque" de Roethinger. Si les buffets se "minimalisent" (celui-ci est Modern-style, mais montre quand même peu de bois, alors qu'il est disposé à fleur de tribune), la composition sait se faire polyvalente, même avec 12 jeux réels seulement. Un intéressant système (souvent installé par Roethinger, mais aussi par Joseph Rinckenbach) permet d'alimenter la Soubasse différemment et de disposer ainsi d'un Bourdon doux 16' (mais évidemment, ces deux "jeux" ne fonctionnement pas en même temps). L'autre jeu "virtuel" de cet orgue est la "Fourniture" du récit, qui est en fait un appel de la Doublette, du Nasard et de la Flûte 4'. [IOLMO:Mo-Sap1858-9.]
 1936 : Neufgrange institut St-Joseph
1936 : Neufgrange institut St-JosephInstallé à Wasselonne en 1941. A la console, revoilà le : "Système breveté S.G.D.G." C'est probablement le brevet "FR719767 (A) - Perfectionnements aux grandes orgues" du 10/02/1932. C'est l'opus 151.
 1936 : Cathédrale Notre-Dame d'Amiens
1936 : Cathédrale Notre-Dame d'AmiensIl s'agissait de la reconstruction, dans le fameux buffet médiéval d'Alphonse le Mire, d'un orgue Pescheur / Dallery / Abbey / Cavaillé-Coll. [Ciccero:p286-7]
 1936 : Etain (Meuse)
1936 : Etain (Meuse)Etain est riche d'une tradition organistique plusieurs fois séculaire. Elle a vu passer Moucherel, et Rivinach. Ce dernier avait posé un orgue dans un magnifique buffet néo-gothique (après 1850). Cet orgue romantique (III/P 33j dont 9 anches, avec machine Barker) fut anéanti le 24/08/1914. Pour le remplacer, la maison Roethinger fournit un instrument sur une composition due à Félix Raugel, dans un buffet dessiné par André Ventre. Même s'il n'est pas à la hauteur de son illustre prédécesseur de Rivinach, le buffet est remarquable. La composition de Raugel fut fortement modifiée en 1977 (déplacement des anches, ajout d'un Cromorne). A cette occasion la plaque d'adresse de Roethinger fut supprimée... [IOLME:p227-31]
 1936 : Pfettisheim (région de Truchtersheim), St-Symphorien
1936 : Pfettisheim (région de Truchtersheim), St-Symphorien
Instrument actuel.
Cet instrument a été construit sur la base d'un Stiehr qu'il s'agissait de munir d'une console indépendante. [IHOA:p141b] [ITOA:4p502]
 1937 : Carvin (62), St-Martin
1937 : Carvin (62), St-MartinCet instrument neuf de Roethinger fut construit en 1937 sur des plans de Félix Raugel et placé dans un buffet de de 1846 du facteur F.J Carlier (Cathédrale d'Arras, collégiale St Pierre de Douai, église de Marchiennes). Rien n'a été conservé de l'orgue de Carlier qui, à l'exception de la façade manquante, était complet. Il ne reste rien aujourd'hui -à part quelques tuyaux- de cet orgue Roethinger. [MAlabau]
 1938 : Chapelle du grand Séminaire de Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)
1938 : Chapelle du grand Séminaire de Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)C'est un orgue en deux parties (car il fallait dégager une grande baie). Il a été inauguré par l'abbé Camonin (Verdun), et était doté dès l'origine d'une composition très spécifique. Par exemple, le Nasard est au grand-orgue et la Tierce au récit. Ce dernier est aussi une sorte de positif (avec un Cromorne et une Cymbale). Autre illustration des "tâtonnements" de l'époque : la constitution d'une Grande Quinte 10'2/3... par extension de la Soubasse. La quinte résultante est donc tempérée, et non juste, cela n'avait donc aucune chance de donner le résultat escompté. La surprise est à l'intérieur : c'est une tuyauterie de grand luxe, en étain (quelques éléments en cuivre, déjà), avec des entailles de timbre. Cet instrument a été vendu aux enchères en 2006, et acquis par un particulier [IOLMM:p454-5]
 1938 : Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)
1938 : Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)Juste avant-guerre, l'Orgue savait se faire original. Cet instrument prend la forme de deux lyres en encorbellement complet, réunies par un segment central. Le style visuel est Art-déco, sans être excessif. Pour la partie instrumentale, néo-classique, sans excès non plus : Gambe, Voix céleste et Hautbois au récit cotoient un Jeu de Tierce. Mais il n'y a ni Mixture ni Larigot. Le "Cornet 4 rgs" apparaissant à la console n'est pas un jeu, mais un appel (tirant la Flûte 4', le Nasard, la Doublette et la Tierce). L'inventaire des orgues de Lorraine, en 1989, trouva la Voix céleste accordée sur les autres jeux, comme s'il s'agissait d'une seconde Gambe... L'accordeur ne savait donc probablement pas à quoi il avait à faire ! En 1992, cet instrument fut confié à la maison Koenig, de Sarre-Union, pour une remise en état et son transfert dans le transept gauche. [IOLMM:p229-30] [LongwySaintMartin]
 1938 : Saint-Quirin/Lettenbach (Moselle)
1938 : Saint-Quirin/Lettenbach (Moselle)Ce petit instrument (I/0P 7j) fut construit sur la base d'un orgue plus ancien, probablement celui de Gondreville (voir ci-après) (Henri Didier, 1889). (En tous cas pas le Septième Positif d'André Silbermann, qui avait déjà disparu il y a bien longtemps.) L'instrument présente la particularité d'être mécanique (à équerres). Le sommier chromatique date probablement d'avant 1889, et la tuyauterie est "issue des stock" Roethinger. [IOLMO:Mo-Sap1852-4.]
 1939 : Gondreville (Meurthe-et-Moselle)
1939 : Gondreville (Meurthe-et-Moselle)Probablement construit sur la base d'un orgue d'Henri Didier, ce petit instrument est suspendu en encorbellement au-dessus de l'entrée. Le pédalier, pourtant prévu au devis, n'a jamais été posé : peut-être la guerre est-elle arrivée avant ? L'instrument était entièrement expressif à l'origine, mais l'expression a malheureusement été supprimée dans les années 80. C'est probablement le buffet de l"orgue Didier récupéré à cette occasion qui fut posé à Saint-Quirin/Lettenbach. [IOLMM:p158-9]
Juste avant la guerre, la maison Roethinger fut chargée d'entretenir l'orgue André Silbermann d'Ebersmunster. Ce fut une "restauration exemplaire" dans le sens où Roethinger ne changea rien, découvrant en quelque sorte le concept de "relevage".
En 1939, l'occupant réquisitionna les locaux de l'entreprise. La famille Roethinger trouva refuge dans les Vosges. [URSRoethinger]
 1943 : Gueberschwihr (région de Rouffach), St-Pantaléon
1943 : Gueberschwihr (région de Rouffach), St-Pantaléon
Instrument actuel.
Le dernier orgue à faire figurer dans les travaux de l'époque "Edmond-Alexandre" est certainement le bel instrument de Gueberschwihr, avec ses claviers de 5 octaves et sa composition néo-classique qui reste très personnelle (II/P 26+1j). [IHOA:p68a] [ITOA:2p128] [Barth:p205-6] [PMSCALL:p334-8]
 Principaux travaux après le départ d'Edmond-Alexandre (1943)
Principaux travaux après le départ d'Edmond-Alexandre (1943)
Edmond-Alexandre prit sa retraite à l'âge de 79 ans, laissant le contrôle à Max et André. Jusqu'à sa mort en 1953, les orgues sortis de la maison seront toutefois toujours signés "Edmond-Alexandre Roethinger", ce qui est un fait révélateur : les héritiers restaient un peu dans l'ombre du fondateur. La période de l' "après-guerre" fut évidemment celle des réparations des "dommages de guerre". Il fallait faire vite, et avec ce qu'on avait. Mais il ne faut pas généraliser : c'était aussi l'occasion de certaines réalisations "de prestige". Du point de vue de la vie de l'entreprise, cette période est marquée par le départ des employés les plus talentueux de la maison : Ernest Muhleisen, Jean-Georges Koenig et Alfred Kern. Il s'établirent à leur nom avec le succès que l'on connaît. La maison Roethinger disposait toujours d'une renommée qui lui permettait d'affronter Gonzalez, Beuchet-Debierre, MMK, Haerpfer-Ermann ou Maurice Puget. Mais il est évident que ces trois départs s'accompagnèrent d'une sérieuse perte de compétence. En 1950, la maison Roethinger donnait encore du travail (à Schiltigheim) à 60 employés. [URSRoethinger] [Caecilia:1953p74-5]
 1945 : Schaeffersheim (région d'Erstein), St-Léger
1945 : Schaeffersheim (région d'Erstein), St-Léger
Instrument actuel.
Cet instrument occupe un (tout petit) buffet historique (et une bonne partie du reste de la tribune). [IHOA:p165a] [ITOA:4p588] [Barth:p331] [Mathias:p40]
 1945 : Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath.
1945 : Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath.
Remplacé par Yves Koenig (2003).
Le premier orgue Roethinger n'avait qu'un défaut : il empiétait sur la tribune de façon incompatible avec la place nécessaire à la grande chorale de Gaston Gauer, Il a été inauguré le 31/03/1946 par Jean Mark (Nancy, N.D de Lourdes), Marie Goldbach (qui fut longtemps titulaire de l'instrument) et Suzanne Gauer. Au programme figurait la Messe Solennelle de Vierne. C'était quand même une bien belle machine, qui tenait (et tient toujours) une place particulière dans le cœur de pas mal d'organistes strasbourgeois. [IHOA:p196b,39b,176b] [ITOA:4p749,643-5] [Barth:p349] [HOIE:p108] [ArchSilb:p413-4,513] [PMSAEA85:p213-5] [PMSAM80:p167-71] [PMSSTIEHR:p509,562-3]
Orgues de série
En 1945 fut commencée une série de petits instruments, fort "pragmatiques" (lire : peu esthétiques). Un des premiers exemplaires semble être celui qui avait été fourni comme orgue provisoire à Herrlisheim ; on le retrouve à Carcans (Gironde), où il fut remonté par Serge Groleau en 1971 après avoir été racheté à... la maison Schwenkedel. A Carcan, ce petit orgue, décidément très laid, fait face à un joli buffet néo-gothique placé en tribune, qui est malheureusement factice. Un autre exemple est l'ancien instrument de Metzeral (1955), aujourd'hui à St-Pierre de Caucriauville près du Havre. Par la suite, cette série d'orgues néo-classiques "minimaux" sera remplacée par une autre, avec un petit buffet carré en sipo, plus "néo-baroque". [IOAQU:2p134-5] [AdoraOrgues]
Remplacé par Curt Schwenkedel (1971).
Bien sûr, s'ouvrait une période de réparations / reconcstructions, ou, comme ici, il s'agissait de donner de la voix à une église provisoire. Le petit instrument (II/P 8j) fut déménagé en 1971 à Carcans 3(3). [IHOA:p76b] [ITOA:3p254]
 1947 : Abbaye Notre-Dame de Chiry-Ourscamps (Oise)
1947 : Abbaye Notre-Dame de Chiry-Ourscamps (Oise)Deux claviers expressifs, grand pédalier de 32 notes et une console électrique très éloignée (dans le choeur) caractérisent cet instrument. La Fourniture du grand-orgue avait certainement été prévue à 5 rangs (console), mais seulement 4 furent posés : le monde l'orgue n'était pas encore prêt ! Les oreilles s'habituaient doucement au retour des Mixtures : la grande Fourniture est sagement fondée sur 2'. Au récit, où la boîte peut tempérer les ardeurs des rangs aigus, la Mixture n'a plus rien de romantique : elle est fondée sur 1'1/3. Et, comme si cela ne suffisait pas, on peut mettre le récit en octaves aigues (II/II 4'). L'instrument est caractéristique d'une époque de tâtonnements, où se cotoient des réalisations vraiment créatives et d'évidentes absurdités. A part un déplacement de console, cet orgue a été fort bien préservé, et est un témoin clé de la période d'après-guerre : la preuve qu'il ne faut pas retenir de cette époque que l'aspect "dommages de guerre". [IOOISE:p47-9]
 1947 : Fresse-sur-Moselle (Vosges)
1947 : Fresse-sur-Moselle (Vosges)De 1947 date aussi l'étrange petit canard que Christian Guerrier découvrit en 1985. Guerrier - qui en avait pourtant vu d'autres - dut quand même rester assez perplexe. Il changea la composition de l'instrument ; qu'auriez-vous fait à sa place ? [IOLVO:p300-1]
 1948 : Fellering (région de St-Amarin), St-Antoine
1948 : Fellering (région de St-Amarin), St-Antoine
Instrument actuel.
Après l'époque néo-classique, et avant d'expérimenter le "retour à Dom Bédos", la facture d'orgue fut tentée par les "extrêmes" : voici donc les Cymbales au récit. On avait en tête une esthétique inspirée des orgues de la première moitié du 19ème (dotés à la fois de Mixtures et d'un récit, de Mutations simples et de Gambes), mais munis d'une transmission électrique. Comme souvent, la "mode" s'imposa parfois au détriment de ce qui l'avait elle-même inspirée : cet instrument remplaça un Joseph Callinet de 1827 (il est vrai très réduit, puisqu'il n'était doté que d'un seul manuel). [IHOA:p60a] [ITOA:2p109] [PMSCALL:p130-2] [Mathias:p69] [Barth:p193]
 1948 : Synagogue de Nancy (Meurthe-et-Moselle)
1948 : Synagogue de Nancy (Meurthe-et-Moselle)Pour remplacer l'orgue Cavaillé-Coll pillé au cours de la seconde Guerre mondiale (un "numéro 17" dans le catalogue de 1889, avant des claviers allant jusqu'au Fa), la maison Roethinger - qui avait, rappelons-le, doté la Synagogue de Strasbourg de son orgue de légende - construisit pour celle de Nancy un petit instrument, bien sûr spécifique. Le buffet est surmonté d'une représentation des Tables de la Loi, sur une petite console ornée de l'Etoile de David. Le tout dans un style néo-classique. La partie instrumentale (II/P 10+1j), elle, ne cherchait pas rivaliser avec celle de son illustre prédécesseur. L'instrument n'est d'ailleurs pas très utilisé, mais il a une chance : lorsqu'il l'est, c'est toujours dans un contexte festif ! [IOLMM:p321-3]
 1948 : Basilique Notre-Dame de Lourdes à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
1948 : Basilique Notre-Dame de Lourdes à Nancy (Meurthe-et-Moselle)Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce "grand seize pieds" (III/P 55j) revint de loin. Lors de la grande tempête du 26/12/1999, un clocheton de l'édifice chuta, traversa la toiture et la voûte pour venir s'écraser à deux pas de la console. Avec, bien entendu, une énorme quantité de gravats. La console et l'orgue lui-même étaient remplis de sable et de débris, et de nombreux tuyaux avaient été littéralement déchiquetés. L'instrument, posé en 1948, n'était plus authentique : outre le remplacement de l'Unda maris du positif expressif par une Cymbale, l'instrument avait été réharmonisé par Emile Wolff dans le sens d'une "baroquisation" ; les coûteuses Flûtes octaviantes avaient été rendues banales, des entailles de timbre (fenêtres dans les tuyaux) avaient été bouchées et remplacées par des encoches. L'instrument accidenté a été confié à Jean-Marc Cicchero (qui fut, rappelons-le, harmoniste chez Roethinger) en février 2001. Démonté sur place, par tranches, il a été entièrement nettoyé et réparé. A la console, les contacts ont été remplacés. Les travaux ont été achevés en septembre 2001. Avec ses trois batteries d'anches complètes (plus Trompette et Clairon au positif expressif) soutenues par un grand Cornet et deux Jeux de tierce, son "32'" virtuel à la pédale (Soubasse et Grande Quinte 10'2/3) et ses grands claviers de 5 octaves (pédalier montant jusqu'au Sol), c'est un des instruments marquants de la période "néo-classique" de la maison Roethinger. [IOLMM:p253-5] [NancyLourdes]
 1949 : Strasbourg, Grand séminaire
1949 : Strasbourg, Grand séminaire
Remplacé par Yves Koenig (1985).
Certains faits sont symptomatiques d'évolutions profondes. Bien sûr, un orgue de séminaire, comme un orgue de conservatoire, se doit d'évoluer. C'est probablement ce qui explique le remplacement du bel instrument qui avait fait l'objet de tant d'attention en 1907 par un neuf (II/P 18j), à traction électrique. Mais du coup fut donné un étrange signal : un orgue pouvait être (était) obsolète au bout d'un peu plus de 40 ans : on s'orientait clairement vers une logique de consommation ! [IHOA:p199b] [ITOA:4p759] [Caecilia:3-4p37-39] [Caecilia:3-4p25] [Caecilia:1-2p27] [ZeitschriftInstrmentenbau:27p404] [PMSSTIEHR:p499-500,564] [Barth:p357-358] [Mathias:p34]
 1949 : Strasbourg, Eglise Néo-apostolique
1949 : Strasbourg, Eglise Néo-apostolique
Remplacé par Alfred Higelin (1971).
De 1949 date un petit orgue muni d'une façade "libre". L'instrument disparut lorsqu'un instrument néo-baroque fut construit pour l'édifice par Alfred Higelin. [ITOA:4p716] [IOLMO:A-Gp285] [IHOA:p192b]
 1949 : St-Antoine de Padoue à Epinal (Vosges)
1949 : St-Antoine de Padoue à Epinal (Vosges)Sur la base d'un petit orgue Didier, l'orgue d'Epinal (très modifié par la suite) avait une composition toute néo-classique: [IOLVO:p262-4]
 1950 : Mackenheim (région de Marckolsheim), St-Etienne
1950 : Mackenheim (région de Marckolsheim), St-Etienne
Instrument actuel.
Le bel orgue de Mackenheim, fort bien entretenu, a été construit sur la base d'un Koulen, et démontre que l'impulsion d'Edmond-Alexandre était encore bien là. Un orgue pour jouer J. Alain, mais aussi Boëly, Lefébure-Wély ou Saint Saëns. [IHOA:p106a] [ITOA:3p352] [PMSAEA69:p162-4] [Barth:p251]
 1950 : Niederschaeffolsheim (région de Haguenau), St-Michel
1950 : Niederschaeffolsheim (région de Haguenau), St-Michel
Instrument actuel.
C'est bien un orgue "dommages de guerre", mais sa composition s'écarte un peu du "néo-classicisme" pour retrouver des couleurs romantiques (peut-être faut-il y voir l'héritage de l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach endommagé en 1944 ; il en reste pas mal de tuyaux) : ici pas de Cymbale au récit, mais un Octavin ! Voilà qui a quand même une autre allure. Il ne manquait à cet instrument qu'un buffet, ce qui a été (timidement mais proprement) corrigé depuis. [IHOA:p128b-9c] [ITOA:3p443]
 1950 : Gravelotte (Moselle)
1950 : Gravelotte (Moselle)Cet instrument est resté inachevé (3 jeux manquants). Sans buffet, il est encore très néo-classique (récit avec Cymbale (2/3'), pas de buffet mais panneaux en isorel sur les côtés, tuyauterie pour parie coupée au ton, pour partie à entaille, pédale à extensions, sommiers à pistons pilotés électro-pneumatiquement). [IOLMO:A-Gp662-3]
 vers 1950 : Basilique de Douvres-la-Délivrande (choeur)
vers 1950 : Basilique de Douvres-la-Délivrande (choeur)Il s'agit d'un orgue de choeur, sans pédalier ni buffet (simple soubassement), avec console séparée. [OrguesCalvados]
 vers 1950 : St-Pierre de Clécy
vers 1950 : St-Pierre de ClécyC'est un orgue de transept, sans buffet (hormis un simple soubassement), avec emprunts et extensions, et une console séparée. [OrguesCalvados]
 1952 : Rossfeld (région de Benfeld), St-Wendelin
1952 : Rossfeld (région de Benfeld), St-Wendelin
Instrument actuel.
Cet instrument a été construit avec pas mal de tuyaux Stiehr légués par l'orgue précédent. Mais les anches coniques n'avaient plus (ou pas encore) droit de cité en Alsace : le Clairon de Stiehr ne fut pas réemployé par Roethinger, qui finit par le poser dans l'orgue "jumeau", à La Bresse (Vosges). On remettait aussi des Cymbales, mais dans des conditions absurdes (sans Doublette, sans Fourniture, sans même un Prestant au clavier) et harmonisées à la limite du supportable (ou au-delà, après l'inévitable fluctuation de l'accord). [IHOA:p153a-b] [ITOA:4p547] [PMSSTIEHR:p339-341] [PMSAEA69:p168-9] [Caecilia:p38-9]
 1952 : St-François du Havre (76), choeur
1952 : St-François du Havre (76), choeurCe petit instrument (II/P 10+2j) a été construit dans un buffet plus ancien (19ème). [OrguesNormandie]
A noter, toujours au Havre, que dans le choeur de l'église St-Michel, on trouve un ancien orgue de salon construit par Roethinger en 1954 (II/P 21+4j). Il y a été installé en 1974. [OrguesNormandie]
 1952 : Listrac-Medoc (Gironde)
1952 : Listrac-Medoc (Gironde)Un orgue de salon (I 4j) (tous jeux coupés en Basse+Dessus), construit pour un particulier habitant Oran (Algérie) fut offert à Listrac-Medoc. Pour son usage liturgique, il fut muni d'un pédalier (et la console semble avoir été retournée) (I/0P 4j). [IOAQU:2p170-1] [AdoraOrgues]
 1952 : Lépanges-sur-Vologne (Vosges)
1952 : Lépanges-sur-Vologne (Vosges)Cet instrument (II/P 12+2j) est la reconstruction d'un orgue d'Henri Didier (1903). Seuls certains éléments de la tuyauterie ont été ré-employés (plaque Roethinger - en sipo - et année d'achèvement sur la console). C'est Emile Wolf qui supervisa le montage. L'instrument est intéressant, car un panneau de la boîte expressive a servi de carnet d'entretien. On y apprend pas mal de choses sur la maison Roethinger : que Kastner y travailla en 1962, Albin Unfer en 1961. En 1966, Kastner effectua un relevage en profondeur, toujours pour le compte de Roethinger. Cela prouve une fois de plus l'intérêt des boîtes expressives, qui peuvent être tour à tour un système pare-feu, un bloc-note, ou un élément de musicalité. Celle-ci abrite un Octavin, une Voix céleste, une Flûte octaviante et la Trompette, mais quand même un Plein-jeu de 3 rangs néo-classique commençant au 1'1/3. Un projet de relevage est en cours (Fondation du Patrimoine, 2012). [IOLVO:p357-9]
 1952 : Neunkirchen, St-Marien (Sare, D)
1952 : Neunkirchen, St-Marien (Sare, D)C'est un grand instrument (à sommiers à cônes pneumatiques) ; mais il a été réharmonisé et malheureusement muni d'une console neuve en 1985. [JanBroegger]
 1953 : Ebersheim (région de Sélestat), St-Martin
1953 : Ebersheim (région de Sélestat), St-Martin
Instrument actuel.
Dans ce très joli buffet de 1785, il y eut un orgue de Martin Rinckenbach (1885). La maison Roethinger l'avait probablement transformé en 1925, mais le 26/12/1944, l'instrument fut frappé par un obus, à l'arrière du buffet. Les "dommages de guerre" ne purent pas remplacer un orgue de cette trempe : on fit ce qu'on put. La plaque d'adresse indique 1951 : instrument a peut-être été remis en état en plusieurs tranches. Le bilan est lourd : dix rangs de Mixtures, Cymbale (et Trompette + Clairon) au grand-orgue, Sesquialtera au récit... une page est tournée. Mais la Voix céleste et le Hautbois sont toujours là et rappellent le glorieux passé. [LR1907:p83] [PMSBERGANTZEL:p237-239] [HOIE:p160-161] [ITOA:3p138] [IHOA:p55a] [Barth:p185]
 1953 : Wissembourg, Sts-Pierre-et-Paul Transept
1953 : Wissembourg, Sts-Pierre-et-Paul Transept
Instrument actuel.
Accroché dans le transept gauche de l'édifice en 1953, cet instrument sauva l'orgue Louis Dubois (de la tribune) d'une presque certaine destruction. En effet, plutôt que de "remettre au goût du jour" le vénérable instrument de 1766, on demanda à Max Roethinger de construire un orgue neuf, encore joliment néo-classique (II/P 19+3j). Cet instrument est resté authentique ; malgré quelques traces d'usure bien légitimes, il est doté de très belles couleurs. Trompette au grand-orgue, Jeu de tierce au récit (le 2' étant un Octavin). En nid d'hirondelle, l'absence de buffet n'est pas choquante, et elle est compensée, comme à Rhinau, par des courbes intéressantes. Espérons que ce bel instrument néo-classique très réussi ne connaisse pas le même sort que son voisin issu des ateliers Muhleisen, installé à l'église luthérienne St-Jean (qui après presque 50 de service, a été déclaré trop vieux, et éliminé). Si l'orgue Roethinger est un jour relevé, il aura finalement été sauvé par le Dubois : ce serait un juste retour des choses, et une belle histoire à raconter. [IHOA:p223a] [ITOA:4p872]
 1953 : Gueberschwihr (région de Rouffach), Couvent St-Marc
1953 : Gueberschwihr (région de Rouffach), Couvent St-Marc
Remplacé par Georges Frédéric Walther (1996).
C'était déjà le troisième orgue de l'église de 1868. L'instrument fut démonté en 1970 à l'occasion de travaux à l'édifice, et a probablement été repris par Schwenkedel, qui proposa pour le remplacer un 3-claviers (qui ne vit jamais le jour). Dans les années 80, il n'y avait pas d'orgue du tout. Finalement, la maison Muhleisen a construit un orgue neuf en 1996. [AMS189Z96:11p4133-4] [IHOA:p160b]
 1953 : La Bresse (Vosges)
1953 : La Bresse (Vosges)Cet instrument "dommages de guerre" a été construit avec beaucoup de matériel sonore ancien. Une partie provient des deux anciens orgues, détruits en 1944, mais Roethinger ajouta aussi des tuyaux Stiehr (le Clairon de Rossfeld) et Callinet. Quant au dessin de la façade (le buffet est limité à un simple soubassement), il provient aussi de l'orgue de Rossfeld. [IOLVO:p231-3]
Le 20/02/1953 s'éteint le fondateur de la maison Roethinger, Edmond-Alexandre, à l'âge de 87 ans. C'était le doyen de la facture d'orgue française, comme le soulignait Jean lapresté (alors président du Groupement des Facteurs d'orgue de France) dans l'hommage qu'il avait fait paraître en 1951. Comme Edmond-Alexandre avait pratiquement jusqu'au bout participé à la vie de ses ateliers, on peut lui attribuer environ 500 orgues (incluant les reconstructions) en 70 ans de carrière. L'Eglise catholique le décora de sa médaille Benemerenti, "in organis bene sonantibus". [Caecilia:1953p74-5]
 1954 : Cathédrale St-Etienne de Bourges
1954 : Cathédrale St-Etienne de BourgesComme Joseph Rinckenbach, la maison Roethinger travailla à Bourges, dans le buffet de Bernard Perette (1667). Le tout fut bien sûr soigneusement reconstruit par la suite de façon compatible avec les dogmes des années 1980, tant le néo-classique était tombé en disgrâce. [Ciccero:p284]
 1955 : Friesenheim (région de Benfeld), St-Nicolas
1955 : Friesenheim (région de Benfeld), St-Nicolas
Instrument actuel.
Les remplacements des dommages de guerre continuent, et, progressivement, se dessinent les tendances qui s'affirmeront fermement au cours années 60 : Tierce, Cymbale et Cromorne au "récit", Ranquette 16' à la pédale. Pas de buffet. [IHOA:p62b] [ITOA:3p183] [PMSAS1978:p106] [PMSSTIEHR:p690-1,687] [Barth:p196-7]
 1954 : Cathédrale St-Benigne de Dijon
1954 : Cathédrale St-Benigne de DijonDe 1954 date aussi un travail sur le fameux orgue Riepp de Dijon. L'instrument de 1745 avait été modifié à plusieurs reprises : Jean Richard, Daublaine et Callinet, Merklin (réharmonisation)... et classé en 1908. Cette intervention "néo-classique tardive" ne restera donc pas dans les annales comme un travail marquant de la maison Roethinger. L'instrument fut heureusement confié par la suite à Gerhard Schmid (Kaufbeuren, D). La console Roethinger de 1954 a été conservée, elle est exposée dans la tour. [Ciccero:p96]
 1954 : Notre-Dame de Villerville
1954 : Notre-Dame de VillervilleCe petit instrument (II/P 10+4j) n'a pas de buffet (hormis un simple soubassement) et une rangée de tuyaux parcourt toute la largeur de la nef. Au menu : emprunts, extensions, console indépendante, et une composition totalement néo-classique (Dulciane, Voix céleste, Plein-jeu et Trompette au récit). [OrguesCalvados]
 1954 : Deywillers (Vosges)
1954 : Deywillers (Vosges)Avec ses 21 jeux à la console et seulement 8 (plus une octave de Bombarde) réels, l'instrument est caractéristique de l'époque des "emprunts" et des "extensions". [IOLVO:p231-3]
 1954 : Onville (Meurthe-et-Moselle)
1954 : Onville (Meurthe-et-Moselle)Ce petit instrument a été construit sur la base d'un orgue plus ancien de Théodore Jacquot. Sur 16 jeux à la console, 8 seulement sont réels : les autres sont des emprunts ou des extensions. Même la Mutation (Quinte 2'2/3) a été réalisée par extension, et joue donc des quintes "tempérées" au lieu de quintes justes. [IOLMM:p361-2]
 1955 : Diebolsheim (région de Marckolsheim), St-Boniface
1955 : Diebolsheim (région de Marckolsheim), St-Boniface
Instrument actuel.
L'orgue Kriess de 1913 avait été "Völlig zerstört". Pour le remplacer, la maison Roethinger fournit un orgue (II/P 15j) absolument caractéristique de son époque : pas de buffet, sommiers à cône électriques, Cymbale au récit et aucun 16' manuel. [IHOA:p51a] [ITOA:3p115] [PMSDBO1974:p128-30] [PMSAEA69:p191-2] [PMSRHW:p18] [ArchSilb:p122,310]
 1950 : Metzeral (région de Munster), St-Blaise
1950 : Metzeral (région de Munster), St-Blaise
Remplacé par Hubert Brayé (2005).
Remplacé par Hubert Brayé, cet orgue a été vendu et installé en 2009 dans l'église St-Pierre de Caucriauville (Le Havre). [OrguesNormandie]
 1955 : Strasbourg, Maison de retraite St-Joseph
1955 : Strasbourg, Maison de retraite St-Joseph
Instrument déménagé à la Montagne-Verte, St-Arbogast.
C'est l'orgue qui se trouve aujourd'hui à la Montagne Verte (St-Arbogast), de façon assez inexplicable, puisqu'il y a déjà là-bas, en orgue de tribune, un Roethinger de la belle époque (1916 ; il est certes déclaré muet, probablement suite à une transformation hasardeuse, mais ce ne soit pas être insurmontable de lui redonner sa splendeur). [IHOA:p191a,192b] [ITOA:4p707] [Caecilia:1996/2p28]
 1956 : Herbsheim (région de Benfeld), Ste-Barbe
1956 : Herbsheim (région de Benfeld), Ste-Barbe
Instrument actuel.
En 1925, la maison Roethinger avait déjà reconstruit ce qui restait de l'orgue Jean-André Silbermann, 1743, de la clinique de la Toussaint à Strasbourg, qui était venu à Herbsheim en 1792. En janvier 1945, l'instrument fut détruit (II/P 14j). A noter : le Jeu de Tierce au grand-orgue. [IHOA:p76b,203a] [ITOA:3p253] [ArchSilb:p437,455,511-2] [Barth:p219,429] [PMSSTIHEHR:p699]
 1956 : Salmbach (région de Lauterbourg), St-Etienne
1956 : Salmbach (région de Lauterbourg), St-Etienne
Instrument actuel.
Le buffet de l'orgue Roethinger était réduit à son soubassement : la façade était constituée d'une rangée de tuyaux (en zinc) avec une ligne de bouches horizontale et la courbe sommitale en "U", avec une tourelle centrale, le tout flanqué de deux fois 4 tuyaux d'acajou. L'acajou ("sipo") était le bois préféré de la maison Roethinger, qu'elle utilisait pour la tuyauterie, les chapes, les panneaux des consoles ou même des éléments du buffet. L'orgue de Salmbach reçu un vrai buffet en 2006, et on peut dire que ça change tout... Sesquialtera et Chalumeau au "récit", 4' de pédale, pas de Mutation simple. [IHOA:p162b] [ITOA:4p571]
 1956 : Trimbach (région de Seltz), St-Laurent
1956 : Trimbach (région de Seltz), St-Laurent
Instrument actuel.
Pour remplacer l'instrument d'Edmond-Alexandre Roethinger de 1901 détruit le 15/06/1940, on fit encore appel à la maison Roethinger (on devait donc en être content). Les manuels du nouvel orgue sont à transmission mécanique, la pédale pneumatique, le récit abrite à la fois une Voix céleste et une Sesquialtera, et il est désespérément dépourvu de buffet : la disposition était analogue à celle de son contemporain de Salmbach. [IHOA:p206b-7a] [ITOA:4p792]
 vers 1956 : Offendorf (région de Bischwiller), Ste-Brigitte et Sts-Pierre-et-Paul
vers 1956 : Offendorf (région de Bischwiller), Ste-Brigitte et Sts-Pierre-et-Paul
Remplacé par Jean-Georges Koenig (1963).
Le petit orgue qui fut placé dans l'église provisoire a été déménagé à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle). Les deux manuels sont expressifs (et partagent la même boîte, qui est en façade). [LR1907:p83] [IHOA:p136b] [ITOA:4p473] [ArchSilb:p395-6-21,507-8] [PMSSTIEHR:p113]
 1956 : Wittelsheim (région de Cernay), St-Michel Orgue de tribune
1956 : Wittelsheim (région de Cernay), St-Michel Orgue de tribune
Instrument actuel.
C'est le cinquième orgue à occuper la tribune de ce lieu chargé d'histoire. L'édifice actuel date de 1931, mais eut à nouveau à souffrir de la guerre en 1945. L'orgue de 1956 était entièrement neuf, et doté d'une personnalité peu commune. [IHOA:p223b,168b] [ITOA:2p491] [YMParisAlsace:p44-9] [CSauter:p256] [Barth:p391]
 1956 : Domèvre-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle)
1956 : Domèvre-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle)La maison Roethinger construisit deux orgues pour Domèvre. Celui de 1929 fut endommagé durant le second conflit mondial, et plus ou moins dispersé par la suite. L'instrument neuf (II/P 7+1j) est une sorte d'orgue-tribune. Néo-classique et électro-pneumatique, son aspect visuel a été moins négligé qu'à l'habitude : deux groupes de tuyaux métalliques sont unis par une mitre de tuyaux en bois (de la Soubasse), et un treillis en remplit le fond. [IOLMM:p117-8]
 1957 : Bitschhoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Maurice
1957 : Bitschhoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Maurice
Instrument actuel.
L'église fut totalement détruite en février 1945, comme pratiquement l'intégralité de Bitschhoffen. L'aspect extérieur de l'orgue de 1957 est vraiment peu séduisant. Contrairement à Trimbach et Salmbach (dont la transmission est partiellement mécanique), Roethinger a de nouveau utilisé ici des dispositifs électriques pour commander ses sommiers à cônes. Trois 8 pieds seulement en tout pour 7 harmoniques de principaux (Prestant, Mixture 3 rgs et Plein-jeu 3 rgs) : les compositions étaient devenues complètement déséquilibrées vers l'aigu, et vont le rester pendant longtemps. [IHOA:p39b] [ITOA:3p63]
 1957 : Niederbronn-les-Bains, Couvent St-Joseph
1957 : Niederbronn-les-Bains, Couvent St-Joseph
Instrument actuel.
L'instrument est logé dans une niche du mur, avec un simple alignement de tuyaux en façade. La console est située en bas, et du coup la transmission ne peut être qu'électrique. Il est très comparable à l'orgue qui sera posé plus tard à la chapelle du séminaire Walbourg. [IHOA:p127b] [ITOA:3p432]
 1957 : St-Martin de Villers-Bocage
1957 : St-Martin de Villers-BocageC'est un petit (II/0P 13j) instrument sans pédale séparée (entièrement empruntée), complètement néo-classique (Dulciane, Voix céleste, Trompette au récit). La Doublette (présente sur le sommier) ne fonctionne pas... parce qu'on a oublié de la doter d'un domino. [OrguesCalvados]
 1957 : St-Pie X du grand-duché de Luxembourg
1957 : St-Pie X du grand-duché de LuxembourgL'orgue a été harmonisé par Maurice Gobin. A cette occasion, Jean-Marc Cicchero cite les harmonistes qui travaillaient - directement ou en sous-traitance - pour Roethinger à la fin des années 1950 : Robert Boisseau, Charles Acker, Higelin et André Roethinger. Cicchero fit son apprentissage chez Roethinger de 1959 à fin 1961. La maison alsacienne avait alors une cinquantaine d'employés. [OrguesNormandie]
 1957 : Limon, bénédictines de St-Louis-du-temple
1957 : Limon, bénédictines de St-Louis-du-templeCet instrument (dont il existe une photo) a été déménagé à Celles-sur-Belle, et pratiquement reconstruit par Olivier Chevron, qui a intégré d'autres éléments (IV/P, 42 jeux réels au final). L'orgue pratiquement neuf a été doté d'un (très beau) buffet. Il a été inauguré en avril 2018. [OrguesCelles]
 1958 : Formerie (Oise)
1958 : Formerie (Oise)La vigoureuse transformation en 1958 d'un orgue Jean Ver Hasselt (ce n'est pas l'organiste de St-Gervais...) construit en 1937 est difficilement explicable. Rien que du point de vue de la composition, l'orgue Roethinger, électrique (II/P 10+2j), est loin d'avoir la distinction de son prédécesseur (II/P 14j). [IOOISE:p116-8]
 1958 : Le Tholy (Vosges)
1958 : Le Tholy (Vosges)L'orgue précédent avait été détruit durant la seconde Guerre mondiale. C'est un instrument "dommages de guerre" standard, sans buffet (hormis un simple soubassement, avec une mitre de tuyaux en zinc électrolytique encadrée de deux groupes de cinq tuyaux plus grands). La composition est sans surprise. Des tuyaux anciens, provenant de l'ancien Grossir / Géhin, ont été conservés pieusement par les paroissiens et proposés à Roethinger, mais ils ne furent pas réutilisés. Transmission électro-pneumatique. La date "1958" figure sur la console. L'instrument a été relevé et réharmonisé en 2011 par la maison Guerrier, de Willer (68). L'instrument a été inauguré le 18/11/2011 par Vincent Daniel. A cette occasion une plaquette (disponible en PDF), retraçant en détail l'histoire des orgues et de la chorale a été publiée. [LeTholy] [OrguesVosges] [IOLVO:p604-7]
 1958 : Revigny-sur-Ornain (Meuse)
1958 : Revigny-sur-Ornain (Meuse)Il y a des orgues à Revigny depuis le 17ème siècle, mais l'héritage de cette longue tradition disparu lors de la seconde Guerre mondiale. L'orgue Roethinger (II/P 20+7j), au buffet limité à un simple soubassement, et avec 7 emprunts/extensions, a toujours fait preuve d'une incompatibilité avec l'humidité de l'édifice. L'orgue de choeur est beaucoup plus intéressant. [IOLME:p383-9]
 1958 : Seuil-d'Argonne (Meuse)
1958 : Seuil-d'Argonne (Meuse)Comme celui de Revigny, ce petit orgue Roethinger (II/P 7+5j) a souffert de l'humidité. On a dit de lui qu'il était en panne dès le lendemain de son inauguration (ce qui n'était sûrement exagéré que de quelques mois). Soubassement en sipo, et Chalumeau dans un récit expressif en font un instrument soudé aux caractéristiques de son époque. Il ne semble pas qu'il y ait jamais eu d'orgue à Pretz ni à Senard. [IOLME:p450-1]
 1959 : Strasbourg, Chapelle catholique de l'hôpital civil
1959 : Strasbourg, Chapelle catholique de l'hôpital civil
Instrument actuel.
Même s'il a perdu sa Clarinette au bénéfice d'une Cymbale au récit, cet instrument reste fort intéressant, avec son Cornet à 3 rangs sur toute l'étendue du grand-orgue, et un Jeu de Tierce au récit. Le buffet vient de l'orgue Stiehr, 1859 du lieu, qui a vu intervenir successivement Heinrich Koulen (1881), Dalstein-Haerpfer (1910) et Edmond-Alexandre Roethinger (1923). Longtemps muet et à l'abandon, cet instrument a retrouvé sa voix en 1915. [IHOA:p188a] [ITOA:4p694] [PMSSTIEHR:p484] [Barth:p358-9]
 1959 : Bacqueville en Caux (76)
1959 : Bacqueville en Caux (76)Néo-classique jusqu'au bout de sa Cymbale en boîte expressive, cet instrument (II/P 19+4j) est caractérisé par des grands claviers de 5 octaves. [OrguesNormandie]
 1959 : Saint-Amand de Caudéran (Bordeaux)
1959 : Saint-Amand de Caudéran (Bordeaux)L'instrument qui a été reconstruit par Robert Boisseau pour le compte de la maison Roethinger, dans le pur esprit néo-classique, a connu un beau succès. Pas de buffet, mais une preuve supplémentaire de l'incroyable dotation en bois de la maison Roethinger: les boiseries (invisibles) de cet instrument sont en acajou. Le positif est intérieur et expressif, mais traité comme un positif classique. Fourniture de grand-orgue en 16'. Octavin, Hautbois et batterie d'anches complète au récit expressif, complété d'une Cymbale 3 rgs. [IOAQU:2p72-3] [AdoraOrgues]
 1959 : St-Barthélémy de Gérardmer (Vosges), choeur
1959 : St-Barthélémy de Gérardmer (Vosges), choeurLe petit-frère du grand-orgue Roethinger de Gérardmer est en fait arrivé un an plus tôt, puisqu'il assurait le service lors du montage de l'orgue de tribune. L'aspect visuel est conçu pour s'harmoniser avec le grand orgue (avec cet espèce de treillis derrière la façade. C'est le moment où, après avoir abandonné les buffets pendant des années, on s'interrogeait pour savoir s'il ne faudrait pas en refaire. Il y a encore un récit, abritant un Quintaton 4' (appelé Flûte à cheminée à la console), mais aussi une Cymbale "sans concession" : 2 rangs (fondement sur 2/3') avec 5 reprises. Tuyaux en bois en sipo. Les manuels sont mécaniques, mais la pédale pneumatique. Cet instrument arriva dans l'église neuve juste après son achèvement ; il faut dire que dans l'édifice provisoire avait sévi pendant presque 20 ans un "Unit organ" (le premier, celui-là même qui avait été montré à l'Exposition universelle de 1935 !) : le "Roethinger" devait être très attendu comme une ondée dans le Sahara... [IOLVO:p312-3,308]
 1960 : St-Barthélémy de Gérardmer (Vosges), tribune
1960 : St-Barthélémy de Gérardmer (Vosges), tribuneLes deux orgues de Gérardmer constituent un autre tournant dans la production de la maison Roethinger. C'est un style "néo-classique" très particulier que signent ici Max et André Roethinger : la transmission est électro-pneumatique, mais les sommiers sont à gravures.
Le récit est expressif et comporte une batterie d'anches complète et un Hautbois, mais aussi une Sesquialtera et un étonnant "Plein-jeu" qui est en fait une Cymbale tout droit surgie du traité de Dom Bédos (5 rangs sur 2/3' avec 6 reprises). Avec 51 jeux, ce n'est même pas un "seize pieds" au sens classique (les 16' manuels sont bouchés) ; mais il y a quand même un Quintaton 32' "acoustique" à la pédale (réalisé par "battements" d'un 16' et d'une Grande quinte 10'2/3). Il n'y a pas moins de 6 Mixtures dans l'instrument, totalisant 31 rangs de Principaux, le tout coupé au ton. Bon nombre de tuyaux graves sont en sipo, ce qui est courant chez Roethinger; mais, révolution pour l'époque : les tuyaux sont abrités par un buffet (qui se fait toutefois discret vu de la nef).
Après, tout est question d'harmonisation : celle d'origine était très typée, avec des basses très discrètes comme on le voulait à l'époque (ou aigus tonitruants, cela dépend comment on entend les choses). Elle avait été signée par Robert Boisseau et Jean-Marc Cicchéro, qui connaissaient leur affaire, et avaient à coup sûr réalisé ce qu'on leur demandait. L'instrument a été inauguré par André Fleury, et eut bien sûr un retentissement énorme. C'était quand même 21 ans avant qu'Alfred Kern ne signe son orgue de la Cathédrale de Strasbourg... En 1983, André Schaerer, pour le compte de la maison Muhleisen, réharmonisa l'instrument (plaque spécifique sur la console rappelant ces travaux - la plaque Roethinger étant bien entendu conservée) : il est vrai qu'on ne jouait (et on écoutait) plus l'orgue de la même façon qu'en 1960. Entre 1960 et 1983, presque tout avait changé en facture d'orgue. Comme si on avait su l'importance historique qu'allait prendre cet instrument, il a été enregistré avant et après sa réharmonisation.
Pour l'anecdote, l'instrument est aussi célèbre, dans le monde de l'orgue, pour le "message" d'Antoine Grossir (1828) retrouvé dans le réservoir. Le malheureux raconte comment un homme de l'art peut se retrouver "arnaqué" par des commanditaires malhonnêtes, contre lesquels il n'y a aucun recours. C'est une des seules choses, finalement - un "éclat d'Histoire" - qui survécut à la terrible nuit du 22 juin 1944. [IOLVO:p307-11]
 1948 : Ostwald (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Oswald
1948 : Ostwald (région d'Illkirch-Graffenstaden), St-Oswald
Instrument actuel.
Le premier orgue Roethinger du lieu fut détruit par faits de guerre le 25/09/1944. Pour le remplacer, voici un orgue sans buffet, avec sommiers à cônes et transmission électrique : l'orgue Roethinger d'Ostwald (qui vient d'être relevé) est un témoin de son temps, avec son récit doté à la fois d'un Cromorne et d'un Hautbois. [IHOA:p41a] [ITOA:3p485] [PMSWETZEL75:p252]
 1960 : Rhinau (région de Benfeld), St-Michel
1960 : Rhinau (région de Benfeld), St-Michel
Instrument actuel.
La patrie de Beatus Rhenanus a été dotée du "meilleur orgue du 20 ème siècle en Alsace". C'était du moins l'avis des journalistes de 1960 (surtout ceux qui n'en ont vu qu'un). Mais c'est vrai que cet instrument, à forte identité, plein de charme et idéalement adapté à son édifice, restera l'une des réussites de son temps. Disons "l'un des plus attachants de la seconde moitié du 20 ème siècle en Alsace"... Il a malheureusement été réharmonisé. [IHOA:p146a] [ITOA:4p523-4] [PMSSTIEHR:p531-2] [Barth:p304]
 1964 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.
1964 : Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux cath.
Instrument actuel.
Le vaisseau-amiral alsacien de la maison Roethinger (IV/P 49j) a toujours fière allure. Il est vrai qu'il a été soigneusement revu en 1996. [ITOA:4p751-2] [IHOA:p197b] [PMSAVS75:p118-28] [IOLMO:A-Gp170-3] [ArchSilb:p139-44] [PMSRHW:p193] [Caecilia:1997-2p26]
 1960 : Schiltigheim, Notre-Dame
1960 : Schiltigheim, Notre-Dame
Instrument actuel.
Mis à part l'absence de buffet (il n'en avait pas à l'origine) et la transmission électrique à la pédale, cet orgue est bien de ceux qui ont rompu avec le néo-classicisme. Autre caractéristique révélatrice, il a été harmonisé par André Roethinger "à Plein-vent", c'est-à-dire à basse pression et sans limiter l'entrée du vent dans le pied des tuyaux. L'orgue a été inauguré par Michel Chapuis (qui avait participé, avec L. Brau, à sa conception) le 29/05/1960. En 1977, Alfred Kern modifia l'instrument en profondeur. Il ajouta un buffet-caisse autour de la tuyauterie et réharmonisa tous les plans sonores, à l'exception du Brustwerk. [IHOA:p167a] [ITOA:4p600-1] [LORGUE:97p13-4] [Barth:p333]
 1960 : Notre-Dame de la Gloriette à Caen
1960 : Notre-Dame de la Gloriette à CaenL'histoire des orgues de l'endroit ressemble à une longue liste de rendez-vous ratés. L'épisode de 1960 ne fait pas exception, et l'orgue Roethinger (III/P 34+5j) est à l'abandon. L'édifice n'est plus un lieu de culte, et bien qu'un projet de remplacement ait été signalé, il est peu probable qu'un instrument neuf soit construit ici à court terme. [OrguesCalvados] [OrguesNormandie]
 vers 1960 : Eglise du Mont-Carmel de Basse-Terre (Guadeloupe)
vers 1960 : Eglise du Mont-Carmel de Basse-Terre (Guadeloupe)Cet instrument n'est plus tout à fait néo-classique : Trompette et Clairon au grand-orgue, et pas de Gambe au récit pour adosser la Voix céleste. En fait, il n'y a pas de Gambe du tout, la Fourniture fait 6 rangs et la Cymbale (au récit expressif) 3 rangs. L'instrument est entretenu par Sébastien Fohrer. [LORGUE:121p32]
 vers 1960 : College des Freres à Tripoli (Liban)
vers 1960 : College des Freres à Tripoli (Liban)Composition caractéristique de la fin du néo-classique : la maison Roethinger rechigne vraiment à adhérer au "néo-baroque" : le second clavier reste expressif ; il est doté à la fois d'un couple Dulciane/Voix céleste, mais aussi d'une Sesquialtera. On dirait un orgue romantique qui a été "baroquisé". Mais il s'agissait bien d'un orgue neuf, avec des sommiers à gravures à traction électrique (c'est vrai que c'est plus facilement "exportable"). Composition: [LORGUE:121p32-3]
 1961 : Munchhouse (région d'Ensisheim), St-Agathe
1961 : Munchhouse (région d'Ensisheim), St-Agathe
Instrument actuel.
C'est à cette époque que prit progressivement fin l'usage de jeux "par extensions". Cet orgue en comporte encore 4 (uniquement à la pédale), mais on ne reverra plus beaucoup cet usage par la suite. Il n'y a pas de buffet. A l'origine, la Trompette était au récit. Mais le "vrai" orgue de Munchouse restera celui que posèrent Martin et Joseph Rinckenbach en 1908 (opus 112). Doté de 16 jeux, il fut malheureusement détruit en février 1945. [IHOA:p121a] [ITOA:2p291]
 1961 : Couvent des Pères Carmes d'Ixelles (B) (Tribune)
1961 : Couvent des Pères Carmes d'Ixelles (B) (Tribune)Il s'agissait de travaux sur l'orgue Joseph Merklin du lieu (1864) (inauguré par Alphonse Mailly et Renaud de Vilbac). Par rapport au Merklin, l'instrument a 4 manuels (un solo expressif en plus et traction électrique). [LORGUE:121p33] [OrguesIrisnet]
 1961 : St-Jean-Baptiste de Breteuil (Oise)
1961 : St-Jean-Baptiste de Breteuil (Oise)Pas de buffet pour cet orgue doté de claviers de 5 octaves (pédale en extension de 2 jeux, jusqu'au 2'). Façade "en double parabole" avec trois grands tuyaux en bois. L'orgue est complètement néo-classique : récit avec Voix céleste, entailles de timbre et calottes mobiles sont toujours au programme. La Trompette de récit est presque harmonique (sur-longueurs). [IOOISE:p47-9]
 1962 : Achenheim (région de Mundolsheim), St-Georges
1962 : Achenheim (région de Mundolsheim), St-Georges
Instrument actuel.
Larigot et Cromorne au récit expressif, Quarte 2' à la pédale... Les années 60 étaient décidément un temps de tâtonnements, offrant le meilleur comme le pire. Malheureusement, par la suite, on élimina le meilleur et conserva le pire : l'instrument était à l'origine doté d'une sympathique Unda-maris. Mais en 1980 Paul Adam retira cet élément que l'on devait sûrement suspecter de receler un peu de poésie. [IHOA:p24a] [ITOA:3p1] [PMSDBO1972:p158] [PMSSTIEHR:p404-5] [Barth:p135]
 1962 : Reichshoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel
1962 : Reichshoffen (région de Niederbronn-les-Bains), St-Michel
Instrument actuel.
Deuxième version de l'orgue de Reichsfoffen. Toute poésie issue du 19ème s'y est depuis longtemps volatilisée : il y eut d'abord une version électro-pneumatique (gageons qu'on avait installé un chauffage), puis celle de 1962, qui est l'orgue actuel, avec une Cymbale à chaque manuel (probablement pour qu'il n'y en ait pas un qui soit plus "à la mode" que l'autre). [IHOA:p144a] [ITOA:4p515-6] [HOIE:p134] [PMSSTIEHR:p59-60]
 1962 : Cathédrale St-Vaast d'Arras
1962 : Cathédrale St-Vaast d'ArrasL'orgue de la cathédrale d'Arras a été doté d'une composition due à Joseph Bonnet. Il s'agissait, dès 1937, de remplacer l'orgue Merklin détruit en juillet 1915. Mais la seconde Guerre mondiale stoppa le projet. Le matériel (mal) entreposé à Arras (environ 2/3 du nouvel orgue) n'était plus utilisable après guerre. Et l'affaire traîna. L'orgue ne fut finalement achevé qu'en 1962 par André Roethinger. Il a été harmonisé par Jean Daniellot (qui venait de quitter Gonzalez pour rejoindre Roethinger, et dont c'était la première harmonisation pour la maison alsacienne), et inauguré par Maurice Duruflé. Dans les années 1970, il a été revu par Jean-Marie Tricoteaux. [Ciccero:p286-7]
 A l'époque, Roethinger utilisait des "goodies" pour sa publicité,
A l'époque, Roethinger utilisait des "goodies" pour sa publicité,comme en témoigne ce cendrier représentant l'orgue d'Arras.
 1962 : St-François du Havre (tribune)
1962 : St-François du Havre (tribune)Ce projet, "décroché" suite à la fourniture de l'orgue de choeur du lieu, ne fut jamais achevé : seule la première tranche a pu être menée à bien. La console reçut tout de même la plaque Roethinger.
De 1965 date aussi un retour de la maison Roethinger à la cathédrale d'Amiens, pour une transformation.
 1962 : Londinières (76)
1962 : Londinières (76)L'instrument est caractéristique de l' "orgue minimal" des années 1960: [OrguesNormandie]
 1962 : Eglise du Sacré-coeur à Bordeaux
1962 : Eglise du Sacré-coeur à BordeauxCe n'est pas un instrument neuf que la maison Roethinger posa en 1962 à Bordeaux : le malheureux buffet (déjà prié de s'écraser sous une rosace) de l'orgue Auguste Commaille (fin du 19ème) fut dépouillé d'une bonne moitié de sa façade ! Electrification et "Cymbalification" vigoureuse furent aussi du programme: [LORGUE:121p32] [AdoraOrgues]
 1962 : Sturzelbronn (Moselle)
1962 : Sturzelbronn (Moselle)Il s'agit de l'église paroissiale, et non de l'abbaye. L'histoire de cet orgue est surtout intéressante pour les chicaneries que déploya la très protectionniste Commission diocésaine des orgues, furieuse de voir la construction d'un instrument neuf confiée à un facteur alsacien. Ce fut bien sûr la composition qui fut critiquée : Jean Sadoul décida qu'il ne pouvait pas approuver un orgue sans Montre 8'. La maison Roethinger répondit que l'orgue du conservatoire de Grenoble avait la même composition que celle proposée. Le fait que Michel Chapuis ait approuvé l'absence de Montre mit aussitôt et définitivement fin au débat ! L'orgue lui-même est, encore une fois, un "néo-classique" pur sucre. Si on trouve toujours un récit expressif et une transmission électro-pneumatique, ledit récit n'a pas sa partie romantique (8', 4' et Cymbale, coupée au ton). Le grand-orgue est un simple 8'/4'/2', les deux derniers étant des Principaux mais le 8' étant une Flûte. Ce qui est intéressant, c'est que, si la Flûte 8' a servi de prétexte aux critiques, la Cymbale 2 rgs (1') (sans qu'il n'y ait de Fourniture dans l'orgue) est "passée" sans problème. [IOLMO:Sc-Zp2053-4]
 1963 : Séminaire d'Essey-lès-Nancy
1963 : Séminaire d'Essey-lès-NancyCet orgue avait été construit en 1963 pour le séminaire d'Essey-lès-Nancy. Il a été déménagé à La Meinau, St-Amand en 1973. Il appartient à une série de petits instruments d'accompagnement "pragmatiques" (II/P 7j) dont le buffet est constitué d'un caisson presque carré, encadré de deux fois 3 tuyaux. Les registres sont commandés par des glissières horizontales. [IHOA:p192a] [ITOA:4p712]
 1963 : Bourgheim (région d'Obernai), St-Arbogast
1963 : Bourgheim (région d'Obernai), St-Arbogast
Instrument actuel.
Cet instrument appartient à la même série que celui qui est actuellement à La Meinau, St-Amand. L'harmonisation est "à plein vent" ; "Ein Kind seiner Zeit", comme on dit. Dire qu'il y avait eu ici un petit orgue Silbermann, puis un Koulen de la plus belle époque (fin des années 1880)... Il resterait des éléments de ce dernier instrument au grenier. [IHOA:p42a] [ITOA:3p73]
 1963 : Ostheim (région de Ribeauvillé), St-Nicolas
1963 : Ostheim (région de Ribeauvillé), St-Nicolas
Instrument actuel.
L'orgue Valentin Rinckenbach du lieu avait été détruit en 1945. L'instrument de 1963 a été conçu en deux corps situés de part et d'autre de la fenêtre de la tribune. C'est un instrument d'inspiration très néo-classique, tout en compromis. Il y a ici des sommiers à gravures (mais électriques), et un récit expressif. Il y a un Cromorne, mais il est placé au grand-orgue (au lieu du positif). La Trompette se situe au récit, qui est fondé sur un Principal 8' et dispose d'une Voix céleste. Quant au grand Cornet, on lui a préféré une Sesquialtera au second clavier. [IHOA:p138b] [ITOA:2p330] [Barth:p293]
 1964 : Ottrott (région de Rosheim), Mont Ste Odile
1964 : Ottrott (région de Rosheim), Mont Ste Odile
Instrument actuel.
Cet instrument néo-classique (III/P 21j) n'est peut-être pas forcément l'orgue qu'on s'attend à trouver dans ce sanctuaire d'exception. Ses 21 jeux sont dispersés sur 4 plans sonores, si bien que la composition va directement à l'essentiel. Pas vraiment de buffet, pas de fioritures, pas grand-chose qui fasse rêver (à part l'Unda-maris ?), rien que du "pragmatique" et c'est dommage. Mais au moins, il a la "noblesse de l'usage" (il sert beaucoup), et il "fait le boulot". [MTSteOdile:p98,118,165,211,231,249-50,317,395,421,432,440] [Vogeleis:p544] [IHOA:p162a] [ITOA:4p494] [Barth:p288-9] [PMSSTIEHR:p487-8] [LORGUE:121p31]
 1964 : Laubach (région de Woerth), St-Joseph
1964 : Laubach (région de Woerth), St-Joseph
Instrument actuel.
Il s'agit d'un positif (I/P 6j), qui venait remplacer un harmonium. [IHOA:p99a] [ITOA:3p331] [EtudesHagu80:p147] [Barth:p245]
 1964 : Thann, St-Pie X
1964 : Thann, St-Pie X
Instrument actuel.
Ce positif (I/0P 5j) a été complété par une Soubasse dès 1965, ce qui en fait un jumeau de celui de Laubach. [IHOA:p205b] [ITOA:2p450]
 1964 : Notre-Dame de Vire
1964 : Notre-Dame de VireC'est un orgue placé au sol, dans le transept, sans buffet (hormis le soubassement). Son remplacement est envisagé depuis longtemps. [LORGUE:121p31] [OrguesCalvados] [OrguesNormandie]
 1964 : St-Médard à Paris (choeur)
1964 : St-Médard à Paris (choeur)L'instrument (II/P 14j) est placé dans une chapelle du choeur, et la composition s'écarte complètement du néo-classique, pour être résolument "néo-baroque" : le second clavier s'appelle encore "récit" mais a tout d'un positif. La transmission des notes est mécanique, même si les registres des sommiers à gravures sont tirés électriquement. Composition: [LORGUE:125p40]
Il y aurait eu un orgue (II/P 23j pour Pont l'Abbé (Finistère), mais ce n'est ni l'église du couvent des Carmes, ni le monastère des Augustines (Notre-Dame de Miséricorde). Peut-être St-Jacques de Lambour ? [OrguesFinistere]
 1964 : Colroy-la-Roche (région de Saales), St-Nicolas
1964 : Colroy-la-Roche (région de Saales), St-Nicolas
Instrument actuel.
Cet instrument appartient à une série de petits orgues analogues à celui de Bourgheim. Le caisson du buffet est ici en sipo. La Soubasse aussi : la maison Roethinger devait détenir une sorte de pierre philosophale, capable de transformer n'importe quoi en acajou sipo. [IHOA:p49b] [ITOA:3p102]
 1965 : Strasbourg, Ste-Madeleine
1965 : Strasbourg, Ste-Madeleine
Instrument actuel.
C'est un des orgues (IV/P 48j) les plus marquants de Strasbourg, pas seulement par sa taille, mais surtout en raison du talent de ses titulaires, à qui l'orgue alsacien doit beaucoup. Cette réalisation fit date : elle proposait une déclinaison originale de l'esthétique néo-baroque. On y trouve du cuivre, un Brustwerk expressif, un buffet en "Werkprincip" (respectant la structure interne des plans sonores), des chamades, 8 mutations simples, et une pédale de 12 jeux : du 16 ouvert à la Mixture 4-6 rangs, en passant par des mutations en harmoniques de 32' et 16', une batterie d'anches et même une anche de 2'). [IHOA:p191a, 97a] [ITOA:4p705] [Lobstein:p90-91] [PMSSTIEHR:p672-3,659-60] [ArchSilb:p359-60] [LORGUE:122-123p128-30] [RMuller:p163]
Un projet dans le même esprit, mais un peu plus petit que celui de Ste-Madeleine (III/P 36j), fut rédigé vers 1964 par la maison Roethinger pour l'église de la Nativité de Freyming-Merlebach. Ce projet ne fut pas retenu (malheureusement pour les commanditaires, comme on l'a vu par la suite). [IOLMO:A-Gp620]
 1965 : Mulhouse, Sacré-Coeur
1965 : Mulhouse, Sacré-Coeur
Instrument actuel.
L'esthétique néo-classique est encore présente, avec le récit, expressif et très fourni. Le Cromorne se trouve curieusement au grand-orgue, et la batterie d'anches (Trompette et Clairon) au récit, donc sans le grand Cornet, mais conjointement au Jeu de Tierce. [IHOA:p120a] [ITOA:2p267] [Mathias:p66]
 1965 : Walbourg (région de Woerth), Chapelle du séminaire
1965 : Walbourg (région de Woerth), Chapelle du séminaire
Instrument actuel.
Cet instrument ressemble (en plus étoffé), à celui du couvent St-Joseph à Niederbronn-les-Bains. L'instrument est logé dans une niche du mur (ici, c'est celui surplombant la porte d'entrée), avec de simples alignements de tuyaux en façade. La console est située en bas, et la transmission, bien sûr, ne peut être qu'électrique. [IHOA:p213b] [ITOA:4p814-5]
 1965 : La Croix-aux-Mines (88)
1965 : La Croix-aux-Mines (88)A lire ce que rapporte l'inventaire des orgues des Vosges sur ce vilain petit canard (I/0P 5j), on pouvait douter de l'avenir de cet instrument. "Nombreuses étaient les touches qui restaient coincées, en raison de l'humidité, et l'accord des jeux à calottes mobiles était insoutenable". L'orgue de choeur avait été installé car l'instrument historique du lieu (Augustin Chaxel, 1824) était dans un état épouvantable, et qu'on avait renoncé à réparer suite à un devis présenté en 1961 par... Roethinger. La tuyauterie de l'orgue de tribune disparaissant peu à peu, l'affaire tourna vite au vinaigre, et dès 1966, le maire accusa les gens de chez Roethinger d'avoir pillé la tuyauterie de l'orgue de tribune... Bien plus tard, l'orgue Chaxel fut finalement confié à Laurent Plet, qui livra en 1993 un magnifique travail reçu avec grand enthousiasme. Le petit orgue de choeur Roethinger en sipo devait à coup sûr faire pâle figure ! Mais il ne finit pas au rebut : on le retrouve aujourd'hui à Saint-Léonard (76), ou il sert d'orgue de choeur. André Bellet et Philippe Lecoq furent chargés de son déménagement et de sa réhabilitation : de fait, comme les matériaux étaient bons, il n'y eut que de bonnes surprises ! Le canard n'est pas tout à fait devenu un cygne, mais il a au moins la noblesse que confère l'usage... et n'a rien de numérique, contrairement à ce qu'on trouvait la-bas avant son arrivée. Il a été inauguré par Vincent Bénard. [IOLVO:p215,219-02] [OrguesCalvados]
 1965 : Saint-Léonard (Vosges)
1965 : Saint-Léonard (Vosges)Un petit orgue d'accompagnement (II/P 7j) faisant partie de la même série que Bourgheim et Colroy-la-Roche. Dire que l'édifice était jadis doté d'un orgue Claude-Ignace Callinet ! Mais ce petit orgue historique (I/0P 8j) a été brûlé par les allemands en 1944. L'instrument actuel est donc bien un orgue "dommages de guerre". [IOLVO:p562-3]
 1966 : La Wantzenau (région de Brumath), St-Wendelin
1966 : La Wantzenau (région de Brumath), St-Wendelin
Instrument actuel.
Le 15/05/1961, l'église de La Wantzenau fut entièrement détruite par un incendie, avec l'orgue Edmond-Alexandre Roethinger, 1914, qu'elle abritait (que l'on songeait à remplacer). L'orgue de 1966 (II/P 25j) présente la particularité d'avoir une pédale très fournie (8 jeux du 16' au 2' et Mixture, avec batterie d'anche complète). [IHOA:p215b] [ITOA:4p825] [PMSSTIEHR:p218-22] [Caecilia:1995-1p30]
 1966 : Truchtersheim, Sts-Pierre-et-Paul
1966 : Truchtersheim, Sts-Pierre-et-Paul
Instrument actuel.
Cromorne au grand-orgue (qui, à part un Bourdon 8', n'a pas de Flûte) et Trompette au positif intérieur (non expressif)... les années 1960 étaient vraiment une époque de tâtonnements et d'expérimentations diverses. [IHOA:p207a-b] [ITOA:4p793] [PMSSTIEHR:p200-4] [Mathias:p52] [Barth:p368]
 1966 : St-Laurent de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
1966 : St-Laurent de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)Les années 1960 firent parfois payer un lourd tribut à notre patrimoine. Ici, c'est un magnifique buffet néo-gothique de la maison Klem (1895) qui fut démoli en 1966 par les Savonarole de service. Un épouvantable nivelage par le bas qu'il sera bien difficile de rattraper dans l'avenir. Dépourvu de buffet, l'orgue Roethinger est d'une laideur rare, avec ses lignes rigides, et surtout en raison du contraste avec la belle tribune, tout ce qui reste des somptueuses boiseries d'antan. Il ne s'accorde pas du tout à son édifice. Pour le reste, on sait bien ce que donne un positif de dos de 4 pieds avec un récit : le positif écrase le récit. [IOLMM:p369-71]
 1967 : Chapelle du séminaire des Jésuites à Lyon
1967 : Chapelle du séminaire des Jésuites à LyonCet instrument appartient à la série de petits instruments néo-baroques (Bourgheim, Colroy-la-Roche, Saint-Léonard). Ici (II/0P 6j) le buffet est constitué d'un caisson en contre-plaqué. Pas de place pour le rêve ou la poésie : deux Bourdon 8' (octave grave commune), deux 4 pieds (un Principal pour le grand-orgue, une Flûte pour le positif), et on attaque directement la partie tranchante : Plein-jeu 3 rgs (1') et Larigot (Basse+Dessus ; pour enlever la basse ?)... L'instrument a été déplacé au CNR de Lyon en 1988 par Jean-François Dupont, qui lui ajouta une Soubasse l'année suivante (II/P 7j). C'est à coup sûr mieux, mais on raconte qu'on peut se couper rien qu'en lisant la composition. [IOLYON:p338-9]
 1968 : Strasbourg, Clinique de la Toussaint
1968 : Strasbourg, Clinique de la Toussaint
Instrument actuel.
On y retrouve les recettes qui ont eu le plus de succès au cours des années 1960, dont 2 jeux coniques et des Principaux "italiens". [IHOA:p76b, 203a] [ITOA:3-4p253,770] [ArchSilb:p437,455,511-2]
 1968 : Klingenthal (région de Rosheim), St-Louis
1968 : Klingenthal (région de Rosheim), St-Louis
Instrument actuel.
L'orgue fait partie de la même série que ceux de Bourgheim, Colroy-la-Roche, Saint-Léonard ou de Lyon. Le buffet est juste constitué d'un caisson non cloisonné, et ne témoigne d'aucune préoccupation esthétique. C'est dommage, car le buffet de l'orgue précédent, éliminé en 1964, était fort réussi. [IHOA:p93a] [ITOA:3p313-4] [Barth:p239]
 1968 : La Robertsau (région de Strasbourg), Clinique Ste-Anne
1968 : La Robertsau (région de Strasbourg), Clinique Ste-Anne
Instrument actuel.
Cet instrument fait aussi partie de la série d'instruments "pragmatiques" (Bourgheim, Colroy-la-Roche, Essey-lès-Nancy (aujourd'hui à La Meinau), Saint-Léonard (Vosges), Lyon (Jésuites), Klingenthal). Le modèle pouvait se décliner pour inclure des compositions plus étoffées (les "petits jeux" néo-baroque ne prenant pas beaucoup de place), par exemple à Ixelles (B). [IHOA:p198b] [ITOA:4p758]
 1968 : Couvent des Pères Carmes d'Ixelles (B) (Choeur)
1968 : Couvent des Pères Carmes d'Ixelles (B) (Choeur)C'est un petit instrument très voisin mais plus grand que de ses contemporains de la série achevée à clinique Ste-Anne de La Robertsau. [OrguesIrisnet]
 vers 1968 : St-Pierre d'Amiens
vers 1968 : St-Pierre d'AmiensL'église, détruite en 1940, avait été reconstruite en 1949. Elle fut dotée d'un orgue Roethinger (II/P? 17j).
 1968 : Plouguerneau
1968 : PlouguerneauCet instrument placé à même le sol, et avec sa console retournée "alla Cavaillé-Coll" ne manque pas de personnalité. Contre vents et marées, la composition est restée joliment néo-classique avec son Hautbois dans un Brustwerk expressif, accompagnant le très Jean-André-Silbermannien Sifflet 1' : l'instrument ne renie pas ses origines alsaciennes ! [OrguesFinistere]
A ces derniers jours de la maison Roethinger correspondent aussi les orgues de la Madeleine de Chateaudun (19 j), du choeur de St-Médard à Paris, de Weiskirchen (D) (21 j), des travaux à l'orgue de choeur de la cathédrale de Dijon. [LORGUE:125p40]
 1968 : Schiltigheim, Ste-Famille
1968 : Schiltigheim, Ste-Famille
Instrument actuel.
Pie Meyer-Siat, dans "Stiehr-Mockers", rapporte que "caché, seul, derrière l'orgue, Max Roethinger, âgé de 70 ans, pleura durant tout le concert d'inauguration". Celle-ci, qui eut lieu le 24 novembre 1968, fut celle du dernier orgue alsacien de la maison Roethinger. L'harmonisation originelle avait été confiée à Jean Daniellot (qui harmonisa les orgues de Strasbourg, Ste-Madeleine, Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux, mais aussi de la cathédrale d'Arras et de l'oratoire du Louvre à Paris). L'instrument a été inauguré par Robert Pfrimmer, qui avait beaucoup participé à sa conception ; la composition est due à Michel Chapuis. Aujourd'hui placé dans le choeur, cet orgue était situé dans le transept à l'origine. La disposition des buffets respecte la localisation des éléments sonores ("Werkprinzip"). Les trois buffets encadrent la console. Les deux tourelles latérales, contenant bien-sûr la pédale, sont assez profondes, avancées, et montrent les tuyaux du Principal 16', en cuivre flambé, sur le devant, mais aussi sur le côté. Grâce à cet instrument, on peut dire que la maison Roethinger finit en beauté. [IHOA:p167a] [ITOA:4p599-600] [PMSSTIEHR:p499-500,562-4] [SSF_LORGUE:p2-4]
 1969 : Anould (Vosges)
1969 : Anould (Vosges)Si les "funérailles" de la maison Roethinger ont bien eu lieu à Schiltigheim en 1968, l'orgue de la Sainte-Famille n'est pas le dernier Roethinger. Le tout dernier fut posé à Anould, dans les Vosges ; il a été harmonisé par Jean Daniellot. A quelques détails près, la composition est pratiquement la même qu'à Ixelles, à l'exception notable du Hautbois, qui devient ici une Cymbale. Traction mécanique, sommiers à gravures, buffet à caissons respectant l'architecture interne, tuyauterie coupé au ton en étain, cuivre ou Sipo : cet instrument était tout à fait "néo-baroque". Mais décidément, ce n'était pas le style de la maison Roethinger. Il faut aller dans les détails pour trouver des indices : la mécanique n'est pas suspendue, les rouleaux d'abrégés sont en aluminium, et surtout, la plaque d'adresse porte le nom "E. A. Roethinger Strasbourg". 16 ans après la mort du fondateur. Max et André n'ont jamais vraiment voulu occuper le devant de la scène ; le rideau se ferma définitivement en 1969, entre Saint-Dié et Gérardmer, "sur le chemin de la prairie". [IOLVO:p93-5]
| C | B | gis | fis' | e'' |
| 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 4' |
| 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |
| 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' |
| C | Gis | e | c' | gis'' | e'' | c''' |
| 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 4' |
| 1/3' | 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |
| 1/4' | 1/3' | 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' |
Max Roethinger est décédé le 22/03/1981. [OanEncyclopedia]
L'héritage de Roethinger
Koulen, Rupp et Schweitzer
La maison Roethinger aura eu une place prépondérante dans l'orgue alsacien de 20ème siècle, et une grande place dans la facture européenne. Partant des idées et techniques de Heinrich Koulen (donc, aussi de Joseph Merklin), Edmond-Alexandre a su écouter les idées d'Emile Rupp et d'Albert Schweitzer, à la fois du point de vue de l'ergonomie des instruments et de l'esthétique sonore. Les premiers orgues Roethinger devaient beaucoup à la facture romantique allemande, mais, rapidement, la maison de Schiltigheim devint de porte-drapeau de la Réforme alsacienne de l'Orgue.
Réforme alsacienne de l'Orgue, sans dogmatisme
Mais elle le fit en sachant garder le sens du compromis : dès le commencement du 20ème siècle, Roethinger sut concevoir des orgues dans cette optique, mais parfois aussi en restant plus près de sa sensibilité "Spätromantik" originelle. Une caractéristique forte de sa production est de proposer des instruments très différents. A Erstein, on trouve encore des jeux à haute pression. Les opus strasbourgeois (St-Pierre-le-Jeune) sont clairement "Réforme alsacienne". L'intégration des idées de Schweitzer créa une sorte de néo-classicisme avant l'heure.
Un 'néo-classique' tout particulier
Du coup, quand, au début des années 30, le néo-classique "mainstream" rejoignit l'Alsace, beaucoup de ses caractéristiques étaient déjà présentes. Le "néo-classique" (rappelons-le, mélangeant des caractéristiques de l'orgue romantique avec d'autres issues plutôt du 18ème), tel que le pratiquait Roethinger, trouve directement ses racines dans les orgues construits entre 1910 et 1930 : ce n'était pas une "vue de l'esprit" amenée par quelque théoricien, mais une évolution logique. Tellement logique que jamais la maison Roethinger ne put l'abandonner tout à fait.
Cette période fut la plus enthousiasmante dans l'histoire de la maison, et trouve ses sommets à Erstein (1914) et à la Synagogue de Strasbourg (1925). Si, comme Koulen, Roethinger semble avoir rencontré quelques problèmes de qualité avec ses premières transmissions pneumatiques, cela fut vite arrangé. Malheureusement, l'incompréhensible et totale aversion des années 1970-2000 pour ce type de transmission a causé de lourdes pertes à ce patrimoine. Les tractions électro-pneumatiques ont, quelque part, infléchi la production vers des instruments malheureusement plus standardisés, qui n'avaient plus la personnalité originelle du "Rohrpneumatik". Un peu de la magie disparut dès le début des années 30, et Georges Schwenkedel, par exemple, sut probablement mieux s'exprimer avec ces techniques.
Il faut ajouter que l'Alsace étant certes le pays des orgues, mais surtout celui des petits orgues (10 à 30 jeux, rarement plus), les compositions néo-classiques étaient forcément sujettes à compromis. On peut peut-être faire un orgue "à tout jouer" (ou au moins un répertoire très large) avec 40-50 jeux, mais avec 15, on se retrouve vite avec un "récit" hébergeant au mieux deux 8', avec une Cymbale sans Prestant ni Doublette, et seulement un Salicional pour "adosser" la Voix céleste. A la pédale, le "3 ème jeu" a de fortes chances d'être un 4' (moins cher et plus "vendeur"), au détriment de la Gambe 8' qu'il faudrait. Le "petit" orgue néo-classique était un exercice de style plutôt difficile.
Roethinger sans Edmond-Alexandre
Les évidentes qualités morales de Max ne font pas oublier qu'il ne donna pas réellement de nouvelle impulsion à une entreprise qui continua à utiliser la place "E.A. Roethinger" pratiquement jusqu'au bout. Après-guerre, il y eut de nombreux instruments fortement "pragmatiques", puis, quand s'imposa la logique "néo-baroque", la maison Roethinger ne "s'aligna" visiblement qu'à reculons, et de toutes façons jamais complètement. On préférait les consoles indépendantes, les claviers expressifs, et les transmission en duralumin. Du point de vue des compositions, la plupart respectent les marottes des années 1970-1990, avec leur lot de Chalumeaux, Douçaines, Sesquialtera et Cymbales. Reste qu'une Cymbale harmonisée "alla 1980" dans un récit expressif constitue forcément une faute de goût : même avec le sens du compromis, on ne concilie pas l'inconciliable. Reste qu'un orgue Roethinger sans 16' manuel n'est pas tout à fait un orgue Roethinger, car il lui manque la "pâte sonore" caractéristique. Il y eut toutefois encore deux orgues d'exception : Ste-Madeleine et Ste-Famille : la maison Roethinger sut finir en beauté, à nouveau en échappant aux dogmes (ici, du néo-baroque), et avec personnalité.
Une maison qui fit école
De fait, pratiquement tous les facteurs d'orgues alsaciens du 20 ème siècle ont participé, au moins un moment, à l'aventure Roethinger : Georges Schwenkedel, Ernest Muhleisen, Jean-Georges Koenig, Alfred Kern.
Webographie :
- [URSRoethinger] http://mcsinfo.u-strasbg.fr : Dans une série 'L'Alsace en 1904', l'université Robert Schuman a publié sur son site l'excellent article de Sylvain Le Texier et Aurélie Sobocinski. En dépit de quelques erreurs finalement amusantes ("tuyaux à hanches") et la reprise d'une citation totalement absurde ("les Roethinger réalisent les seules pièces valables de l'époque") absolument injustifiée (qui relève du simple parti-pris), cet article remarquable (la source principale étant Jean Roethinger) reste une des meilleures présentations de la maison Roethinger disponible sur le Web.
- [Maerz] http://kirchenundkapellen.de/kirchenko/maerzfranzborgias.htm :
- [OrguesCalvados] http://www.orgues-calvados.fr/ :
- [OrguesNormandie] http://orgues-normandie.com/ :
- [AdoraOrgues] http://adora.orgue.pagesperso-orange.fr : Le site de l'Association pour le Développement de l'ORgue en Aquitaine
- [OrguesIrisnet] http://www.orgues.irisnet.be/ : Orgues en région de Bruxelles-Capitale
- [orgue.free.fr] http://orgue.free.fr/ : Le site "Les Orgues"
- [OrguesFinistere] http://orgues.finistere.free.fr/ :
- [OrguesLux] http://www.orgues.lu/ :
- [PPOberrhein] http://www.philipp-pelster.de/ :
- [OrguesVosges] http://vosges.orgues.free.fr/ :
- [LeTholy] http://www.catholique-vosges.fr/sites/catholique-vosges.fr/IMG/pdf/Historique_de_l_orgue_09.pdf :
- [LongwySaintMartin] http://longwy-saint-martin-54.catholique.fr :
- [NancyStSigisbert] http://www.musimem.com/st-sigisbert-nancy.htm :
- [NancyLourdes] http://orgue.ndlourdes-nancy.com : Le site de l'association des amis de l'orgue de la basilique Notre-dame de Lourdes à Nancy
- [OrgueHaselbourg] http://www.haselbourg.fr/vie_associative/amis_orgue.html : Le site des amis de l'orgue de Haselbourg
- [JanBroegger] http://www.jan-broegger.de :
- [OrguesCelles] https://www.orguescelles.fr/ :
Sources et bibliographie :
- [Erstein2001] ""Erstein - élise paroissiale Saint-Martin - La restauration de l'orgue Roethinger". Plaquette réalisée à l'occasion du relevage de l'orgue d'Erstein en 2001", in "Patrimoine Restauré", vol 4.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66
-
[Caecilia] "Caecilia, Revue de musique liturgique du diocèse d'Alsace", éditions Union Sainte Cécile, p. 43-5 du 1924
"Liste des orgues construites depuis 1893" (jusqu'à l'opus 101), par E. Roethinger
-
[Caecilia] "Caecilia, Revue de musique liturgique du diocèse d'Alsace", éditions Union Sainte Cécile, p. 74-5 du 1953
Ein Veteran des Orgelbaues, Edmond-Alexandre ROETHINGER, gestorben
-
[Caecilia] "Caecilia, Revue de musique liturgique du diocèse d'Alsace", éditions Union Sainte Cécile, p. 94-6 du 1951
Hommage de Jean Lapresté à Edmond-Alexandre Roethinger pour son 85ème anniversaire
-
[OanEncyclopedia] "The Organ, an encyclopedia", éditions Douglas Bush, Richard Kassel, p. 469
Article de Christian Lutz.
- [Ciccero]
- [LORGUE] "L'orgue, technique, esthétique, histoire. Revue trimestrielle"
- [IOLVO] Christian Lutz et Paul Farinez : "Orgues de Lorraine, Vosges", éditions ASSECARM / Serpenoise, 1991
- [IOLMM] Christian Lutz et René Depoutot : "Orgues de Lorraine, Meurthe-et-Moselle", éditions ASSECARM / Serpenoise, 1990
- [IOLME] Christian Lutz : "Orgues de Lorraine, Meuse"
- [IOLMO] Christian Lutz et François Ménissier : "Orgues de Lorraine, Moselle"
- [IOAQU] Bernard Lummeaux et François-Xavier Benusiglio : "Orgues en Aquitaine", éditions ADAMA-Edisud, 1989
- [IOOISE] Arsène Bedois, Marcel Degrutere et Christine Dogny : , éditions ASSECARM, 1989
- [IOLYON] Pierre-Marie et Michèle Guéritey : , éditions Comp'Act, 1992
- [VWeller] Victor Weller : e-mail du 05/08/2018.
-
[RLopes] Roland Lopes :
Recherches documentaires
-
[ECorde] Eric Cordé : e-mail du 30/06/2012.
Documents
-
[SWernain] Samuel Wernain : e-mail du 28/08/2005.
Documents
-
[GSagot] Guy Sagot : Document "20030515lettreGSagot"
Recherches de Guy Sagot sur Roethinger
-
[JDolle] Julie Dollé :
Recherches documentaires ; lettres de Guy Sagot
-
[MAlabau] e-mail du 23/02/2016.
Orgue de Carvin.
