 L'orgue du Sacré-coeur de la Montagne-Verte, le 07/06/2019.
L'orgue du Sacré-coeur de la Montagne-Verte, le 07/06/2019.Cet orgue construit par Curt Schwenkedel est caractéristique de la production des années 60, et ce style appelé "néo-baroque". L'instrument a été inauguré le 23/06/1968. En retraçant son histoire, on constate que, comme beaucoup d'orgues, il a produit de la valeur pour la communauté qui l'a voulu bien avant d'être utilisé dans son rôle : par l'élaboration du projet et l'engagement qu'a nécessité son acquisition.
Historique
Le premier orgue du lieu a été fourni (d'occasion) par la maison Muhleisen en 1960. Il avait probablement été construit vers 1939 par Henri Vondrasek. [GWalther]
L'instrument était un ancien orgue privé, attribué à Henri Vondrasek sur témoignage d'Ernest Muhleisen, et qui a sûrement été réalisé à partir d'un orgue Heinrich Koulen. [GWalther] [IHOA]
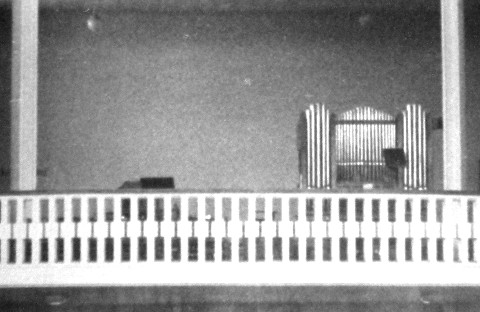 Photo de l'ancien orgue, installé à la tribune de l'édifice actuel
Photo de l'ancien orgue, installé à la tribune de l'édifice actuel(et non dans l'édifice provisoire utilisé avant 1960), issu des archives Schwenkedel.
En 1967 l'instrument quitta la Montagne-Verte pour aller à l'église protestante de la Meinau (projet mené par Jean Daniel Weber). Initialement placé en tribune, il a été transféré dans le choeur de l'église en 1980. Il y fut reconstruit, et muni d'un véritable buffet, en 2002 par la maison Muhleisen. [GWalther] [IHOA]
Voici sa composition à son départ (le second manuel était dépourvu de jeux ; il n'y avait pas la place à l'intérieur). Le second clavier, électrique, était probablement prévu pour commander un sommier extérieur, d'où la présence d'un accouplement et d'une tirasse II/P :
Historique
En 1968, Curt Schwenkedel construisit un orgue néo-baroque neuf, réalisé d'après une composition de R. Gérédis et Michel Chapuis, et logé dans un buffet à caissons dessiné par Georges Lhôte. Il a été harmonisé (à plein-vent) par Jean-Marie Tricoteaux, et inauguré le 23/06/1968. L'instrument est donc pratiquement contemporain de celui de Solesmes (1967). [IHOA] [MVSacreCoeur1968] [LORGUE]
 Dessin de l'orgue du Sacré-coeur de la Montagne-Verte, comme il apparaît sur la plaquette d'inauguration de 1968.
Dessin de l'orgue du Sacré-coeur de la Montagne-Verte, comme il apparaît sur la plaquette d'inauguration de 1968.Extrait de numérisations réalisées par Alexis Platz, comme les deux suivantes.
Les plans du nouvel édifice, construit en 1960, sont dûs à Olivier de Lapparent.
Les projets non réalisés sont souvent significatifs de l'évolution de la facture d'orgue ; or, au cours des les années 50-60, ce fut d'avantage une révolution qu'une évolution. Les archives Roethinger et Schwenkedel témoignent du "bouillonnement" qui agitait leurs bureaux d'études :
Le projet Roethinger de 1960
La maison Roethinger élabora un projet (II/P 24j) concernant un orgue néo-classique "tardif" muni d'un récit expressif doté d'un Cornet 5 rangs, un Larigot, une Cymbale 4 rangs et d'un Cromorne. Le grand-orgue était armé pour en découdre, avec Sesquialtera 2 rangs, Fourniture 4 rangs, Cymbale 3 rangs, Trompette et Clairon. La pédale n'était pas en reste, avec une Mixture 3 rangs.
Une autre piste était de passer à 3 manuels (grand-orgue, récit et positif de dos), avec des sommiers à gravures de 56 notes. Le tout figure sur des notes non datées, qui précisent qu'une "contre-proposition" sera faite pour une traction électrique. [ARoethinger]
Une lettre dactylographiée du 29/10/1960 au curé Grasser de la Montagne-Verte propose le projet : "J'ai l'honneur de me référer à notre récente conversation au sujet de la construction d'un nouvel orgue en votre Eglise. Je suis d'avis qu'il serait inutile de mettre dans cette Eglise un instrument trop important [...]". Suit un II/P 22j avec Nasard et Tierce (indépendantes), Fourniture 6 rangs (!), Trompette et Clairon au grand-orgue. Larigot et Cymbale 3 rangs au positif (de dos en option ; et dont le seul jeu de fond en 8' devait être un Bourdon). Mixture 3 rangs à la pédale, dont les anches devaient être une Dulciane 16' et un Chalumeau 4' (pas d'anche 8'). Pour passer de 26 à 24 jeux, on avait en gros sacrifié la Cymbale du grand-orgue et... son Bourdon 16', laissant deux malheureux fonds de 8' (Montre et Flûte conique) supporter 8 rangs de Principaux.
Ce courrier est suivi d'un second, daté 12/11/1960, qui nous apporte encore d'intéressants éléments sur la façon dont Max Roethinger (qui signait d'ailleurs toujours "E.A. Roethinger", bien qu'Edmond-Alexandre soit mort en 1953) abordait ce que l'on allait appeler plus tard le "néo-baroque" :
- la composition est inspirée de l'orgue de Schiltigheim (i.e. : Notre-Dame ; achevé en 1960) [ARoethinger]
- Il est précisé "qu'il s'agit d'un instrument néo-classique d'après le système mécanique."
- Le 3-claviers à positif de dos est proposé (24 jeux) : "Il serait souhaitable de répartir les 24 jeux de l'orgue sur 3 claviers et pédalier en mettant à la balustrade un "Rückpositiv"."
- "D'accord pour les sommiers à gravures."
- "Selon mon avis 56 notes aux claviers manuels seraient suffisants. Nous avons des orgues de cathédrale qui n'ont pas plus."
- "La traction mécanique est difficilement réalisable si la console de claviers ne se trouve pas sur la même axe de l'orgue ce qui nécessiterait pas mal de dérivations. C'est pour cette raison que je propose des sommiers à gravures avec traction électrique."
Le projet Schwenkedel
Curt Schwenkedel s'est lancé dans la course bien plus tôt, puisque son devis est daté du 27/12/1957. On commença avec 14 jeux seulement, dont Nasard et Tierce indépendants, résistant à la mode "nordique", qui aurait sûrement préféré une Sesquialtera. Cependant, fait significatif, ces deux Mutations devaient être réalisées en étain. La pédale devait être plutôt restreinte :
La console devait être en fenêtre, et les claviers blancs. pour la transmission, il n'y avait ici pas de débat : mécanique, tirant des sommiers à gravures. [ASchwenkedel]
Le devis de 1965
Un nouveau devis, daté du 20/10/1965; commence par des "remarques générales", et en particulier : "Comme il a été convenu lors de notre dernière visite avec Monsieur Michel CHAPUIS, l'orgue sera installé selon le plan joint à ce devis, mais les buffets du Grand-Orgue et de la Pédale seront avancés de 75 cm".
Le contraste est saisissant avec le style "arrangeant" de Roethinger (en gros "Bah, on peut faire ça aussi, oui ; ou autrement si vous voulez... Mais on peut en discuter"). Ici, Curt Schwenkedel détaille les caractéristiques du nouvel orgue (dans sa tête, il est déjà construit), et suggère qu'il est temps d'arrêter les parlottes : "[...]nous sommes persuadés que cette solution est la plus convenable à tous points de vue". Surtout, il se pose en militant de la facture "moderne", par exemple sur le "Werkprinzip" : "Quant à l'orgue proprement dit, son aspect extérieur ne doit être ni un fond de décor plus ou moins théâtral, ni une vague série de tuyaux indiquant là qu'il s'agit bien d'un orgue. Celui-ci doit former un tout homogène et complet, bien délimité dans l'espace par le buffet bien proportionné à son contenu sonore. Les éléments essentiels de la structure interne, visibles de l'extérieur". Cette fois, la console sera indépendante et dos à la nef : "Console séparée, placée entre le Grand-Orgue, Pédale et le Positif, l'organiste, le dos tourné à la partie arrière du buffet du Positif". [ASchwenkedel]
Vient ensuite la composition qui a été réalisée (à quelques détails près, dont une Mixture à 6 rangs avec 7 reprises ; la composition de la Sesquialtera apparaît à côté du Larigot). On note, par rapport au projet avant-Chapuis, une Trompette au grand-orgue, la disparition des Mutations du grand-orgue au profit d'une Sesquialtera au positif, et surtout une pédale considérablement plus fournie. Sur le devis, une note manuscrite évoque la possibilité de mettre le Chalumeau 4' de pédale en chamade. [ASchwenkedel]
On retrouve la Mutation composée "Larigot 1'1/3 + Sifflet 1'" (appelée "Larigot 2 rangs" à la console) à Drusenheim (1964), Rittershoffen (1964 également), Scheibenhard (1965), ainsi qu'à Herrlisheim, St-Arbogast en 1972. Notons qu'il n'y a pas de grand Cornet, mais une Sesquialtera, placée au positif. L'orgue néo-baroque n'est pas "classique français", et fortement soumis aux influences des instruments du nord de l'Europe. Noter aussi le 2 pieds de pédale, caractéristique de l'époque.
Pour le buffet, il y avait une "variante A et B". La seconde, beaucoup plus anguleuse, n'a pas été réalisée. Elle adopte les lignes brisées et asymétriques déjà vues à Sentheim (1964) :
 Dessin de la "variante B", issu des archives Schwenkedel.
Dessin de la "variante B", issu des archives Schwenkedel.Extrait de numérisations réalisées par Alexis Platz.
Le texte du marché (20/01/1966), ainsi que la plaquette d'inauguration, indique que la composition a été "arrêtée par Messieurs les Experts Monsieur l'Abbé R. GEREDIS Monsieur Michel CHAPUIS". [ASchwenkedel]
La "grande vente de Noël" de 1966, organisée par la paroisse du Sacré-coeur était destinée à permettre l'acquisition du nouvel orgue. [ASchwenkedel]
On constate aujourd'hui, que la kyrielle de "Marchés de Noël" (ces deux mots vont ils ensemble ?) tant adulés, et qui attirent les touristes par millions profitent surtout... à des intérêts privés. Le modèle précédent, assurément plus généreux, dirigeait de plus les fonds levés intégralement et directement vers l'artisanat local, donc l'emploi. Chacun peut interpréter à sa façon les conséquences sociétales de ces évolutions.
Le curé Daul fit en sorte d'organiser d'autres événements, dont un concert spirituel (04/12/1966), avec le concours de "l'Office de Radiodiffusion - Télévision français à Strasbourg" : Jacqueline Keck (soprano), François Hébral (flûte), André Burget (orgue) et l'Orchestre de Chambre (Charles Schwarz, direction). Le programme rassemblant François Couperin, Georges Muffat, Jean Marie Leclair (1697-1764), Fred Barlow (02/10/1881-03/01/1951, natif de Mulhouse, qui n'eut pas une vie facile), J.S. Bach (la triple fugue en Mib !), mais aussi César Franck et Max Reger ("Mariä Wiegenlied" - "Der Hirten Lied am Krippelein" Op.76 n.52) ! [ASchwenkedel]
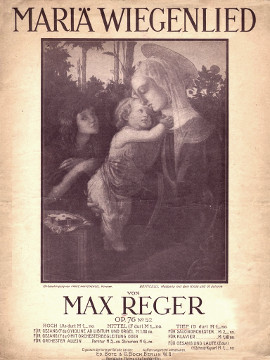
L'orgue Schwenkedel a été inauguré le 23/06/1968 (à 14h30). Le concert spirituel rassemblait la chorale de la cathédrale de Strasbourg et J. Rosenblatt (Colmar, St-Martin). Le triptyque Toccata-Adadio-Fugue en Do M était séparé par "Tout l'univers" de Mendelssohn et "Ô Jesu Christe" de Van Berchem (16ème). Il y eut aussi Orlando di Lasso, Mozart, Bruckner et César Franck pour la parie vocale), et Fescobaldi (la "Toccata per l'Elevazione"), Louis Vierne (Adagio et Scherzo de la 2ème symphonie) pour la partie orgue, qui fut conclu par un retour à J.S. Bach avec la Sinfonia en Ré.
Mais ce n'était pas fini ! Après le concert, il y eut une "Grande Fête Champêtre", avec l'orchestre Charles Kuntz, et, en soirée, les "Arlequins", les "Favorites", les "Régentes" et le "Charly' Cabaret". Le tout avec jeux, danses rythmiques, attractions, buffet (il était précisé : "bien garni !") et tombola. [ASchwenkedel]
L'article du "Nouvel Alsacien" qui relate l'inauguration prend trois colonnes. L'auteur sait de quoi il parle, cite les participants à la conception de l'instrument, donne des références (justes) sur la maison Schwenkedel, commente de façon intelligente la composition (y compris la Mixture, finalement à 5 rangs et non à 6 : le journaliste était décidément informé du moindre détail !), puis la prestation de l'abbé Rosenblatt. [ASchwenkedel]
On comparera avec les insipides comptes-rendus de financement de la presse régionale du 21ème siècle, obnubilés par un "est-ce bien raisonnable de mettre tant d'argent dans un orgue ?". Sachant que cela se résume finalement à : est-ce préférable de payer des artisans pour faire un travail ou autant de personnes au chômage ?
En 2000, il y eut une réparation, qualifiée d'urgente, menée par la maison Muhleisen. [IHOA]
Caractéristiques instrumentales
| C | f |
| 2/3' | 2'2/3 |
| 4/5' | 1'3/5 |
Console indépendante dos à la nef.
mécanique à équerres.
Sommiers à gravures, dans chaque caisson, selon le "Werkprinzip" (la structure interne et celle rendue visible par le buffet).
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[APlatz] Alexis Platz :
Recherches historiques ; pièces d'archives.
-
[GWalther] Georges Walther : e-mail du 03/02/2004.
Données sur l'orgue de 1960.
- [ASchwenkedel] Archives Schwenkedel, aux Archives Municipales de Strasbourg :
- [ARoethinger] Archives Roethinger, aux Archives Municipales de Strasbourg :
- [MVSacreCoeur1968] plaquette éditée à l'occasion de l'inauguration de 1968
-
[IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 192b,192a
La composition de l'orgue de 1960 (p. 192a) ne correspond pas aux archives Muhleisen ; elle est peu cohérente (pas de 8' manuel).
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 715
- [LORGUE] "L'orgue, technique, esthétique, histoire. Revue trimestrielle", vol. 128, p. 188,178, 10-12/1968
![]() Localisation :
Localisation :
