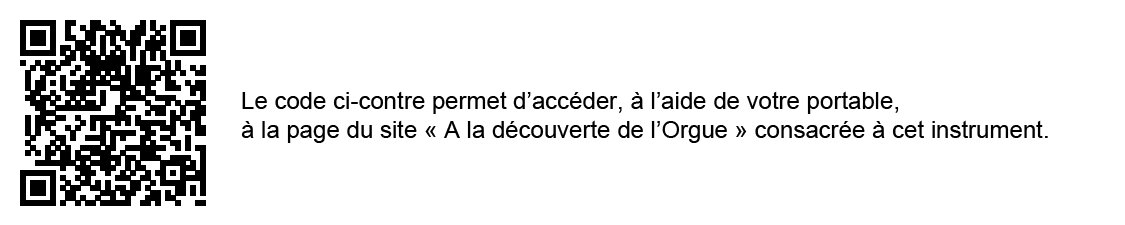L'orgue Joseph Rinckenbach d'Uffholtz, dans son buffet de Paul Brutschi, le 31/10/2016.
L'orgue Joseph Rinckenbach d'Uffholtz, dans son buffet de Paul Brutschi, le 31/10/2016.L'église d'Uffholtz est la seule à être consacrée à Saint Erasme en Alsace (peut-être parce qu'à la fin du moyen-âge, la foire y commençait le jour de la St-Erasme). Elle fut détruite (comme tout le village) au cours de la première Guerre mondiale. Pour la reconstruire, Louis Schwartz fit le choix du style néo-classique, de références à l'architecture de Wallonie, et de la chaleur du grès rouge. La nouvelle église fut achevée en 1927 (première messe en 1924), puis dotée d'un mobilier exceptionnel, créé par la maison Brutschi de Ribeauvillé (dont un autel "Sulpicien" et une chaire portée par un infatigable Samson). L'orgue arriva en 1930. Il est idéalement adapté à l'ambiance néo-classique et éclectique du lieu. C'est un instrument symphonique, caractéristique du style alsacien de cette époque, et l'œuvre de Joseph Rinckenbach.
1753
Historique
Le premier orgue d'Uffholtz date de 1753, et fut construit par Christian Langes. Il était donc placé dans la première église (démolie en 1825, et qui était située dans l'actuel cimetière). [IHOA]
Historique
En 1829, sûrement suite à la construction de la nouvelle église (1825) l'orgue Langes fut remplacé ; on ne connaît pas l'origine de ce ce deuxième instrument. [IHOA]
En 1866, il fut réparé par Claude-Ignace Callinet. Les travaux comprenaient le remplacement de la soufflerie, le renouvellement des deux claviers (54 notes) et du pédalier, mais aussi le déplacement du grand-orgue vers l'arrière et donc la construction d'une nouvelle la mécanique pour le positif. On peut en déduire que l'orgue de 1829 était un II/P, muni d'un positif de dos. [PMSCALL] [IHOA]
L'orgue fut détruit, comme l'église de 1825 et presque tout le village, durant la première Guerre mondiale, probablement dès 1915. (Nous sommes ici au pied du Hartmannswillerkopf - le "Vieil Armand" - ; l' "Abri Mémoire" est l'un des seuls édifices survivants.) [IHOA]
Historique
En 1930, Joseph Rinckenbach posa ici l'opus 194 de la maison d'Ammerschwihr. L'instrument, reçu le 17/03/1930, est logé dans un buffet dû à la maison Paul Brutschi (Ribeauvillé), de style néo-classique, et parfaitement adapté à l'église reconstruite après la guerre. [IHOA] [ITOA] [Barth]
Il s'agit de l'un des tous derniers orgues sortis des ateliers d'Ammerschwihr : après lui, on ne compte guère que Wittenheim (opus 196, détruit en 1945), le malheureux orgue de La Broque (opus 198), le bel orgue post-symphonique de Carspach (1930), et celui de Balschwiller (1931, qui a récemment bénéficié d'un relevage). Les opus 197, 199, 200 et 201 restent à trouver, et correspondent probablement à des orgues privés.
La "recette" de Joseph Rinckenbach était la suivante :
- Il partait d'une base romantique, héritée de Cavaillé-Coll (Trompette harmonique et Clairon au récit, Hautbois, Flûte octaviante), et relevée d'une Voix humaine.
- Cette base était enrichie, de façon plutôt "germanique", par des fonds puissants (Flûte majeure au grand-orgue) et par une pédale plutôt fournie (avec une anche de 16', mais pas d'anche de 8').
- Cet ensemble était ensuite magnifié grâce aux fonctions rendues possibles par la transmission pneumatique : accouplements à l'octave, combinaisons, crescendo...
- Du point de vue de la composition, Joseph Rinckenbach a d'abord (après 1918) commencé par placer des Doublettes et des Cornets, puis a continué à les "éclaircir" de façon différente, en renouant avec les Mutations (Nasard, Tierce, qui avaient alors totalement disparu depuis un bon demi siècle).
Ces instruments sont souvent qualifiés de "symphoniques", du nom de la période qui suivit l'époque romantique et précéda celle du néo-classique. Ces étiquettes, par ailleurs plutôt jolies, constituent bien sûr un schéma un peu réducteur. En Alsace, depuis le début du 20ème siècle, mûrissaient plusieurs idées destinées à retrouver des couleurs de l'époque classique. Le style néo-classique français (lire : "parisien") a été "théorisé" après 1930, et, décidément, l'orgue d'Uffholtz n'est pas de ceux-là.
On le voit, on est bien loin de l'orgue "à tout jouer" évoqué par l'étiquette néo-classique. Cet instrument est bien plus proche des Merklin de la fin du 19ème (Obernai), proprement qualifiés de "symphoniques". Il délivre les mêmes couleurs sonores tant qu'on retient les accouplements à l'octave et les Mutations. Mais lorsqu'on les utilise, l'orgue acquiert une toute autre personnalité, parfois qualifiée de "post-symphonique", et qui lui est surtout tout à fait personnelle.
L'orgue a été relevé en 1980 par Christian Guerrier. Le moteur électrique a été remplacé. [IHOA] [SBraillon]
L'orgue a été relevé en 2012 par Michel Gaillard. [SiteGaillard]
Malheureusement, les membranes n'ont pas été renouvelées. [Visite]
Le buffet
Le buffet, en chêne massif, est l'œuvre de Paul Brutschi, de Ribeauvillé, et constitue une vraie scénographie. Tout, depuis les lignes et les volumes jusqu'à la disposition des ornements, appelle à élever le regard. La balustrade, formant une unité avec le reste, permet de donner du relief et d'accentuer l'effet "enveloppant" produit par les lignes retombantes du buffet. Depuis la nef, on aimerait presque, tant les volumes sont affirmés, que l'orgue soit placé plus en avant, bras ouverts vers son public. Depuis la tribune, quand s'ajoute le côté "Jules Verne" de la console, l'ensemble évoque plutôt quelque vaisseau d'apparat, ancré ici pour un temps, mais ne demandant qu'à reprendre son voyage. Heureusement pour Uffholtz, ce voyage est musical : un orgue, ça ne se carapate pas comme ça.
L'élément central est constitué de deux tourelles rondes encadrant une haute plate-face. Il est flanqué de chaque côté d'une plate face retombante et d'une tourelle latérale plus basse que l'élément central. Les dispositions à 4 tourelles sont très appréciées en Haute Alsace depuis le 19ème ; c'est donc un trait tout à fait Haut-Rhinois, qui "ancre" ce buffet dans la tradition locale. Le style est résolument néo-classique : les tourelles sont à entablement, et rien ne manque au discours ornemental inspiré du 18ème : jouées sculptées en motifs végétaux (feuilles, fleurs et fruits), claires-voies à guirlandes, frises et couronnements spectaculaires.
 L'angelot sous la plate-face gauche.
L'angelot sous la plate-face gauche.Toute référence à "El condor pasa" serait incongrue.
Le spectacle commence avec la balustrade, puis continue sur le soubassement, où deux angelots musiciens sont assis nonchalamment dans l'espace disponible sous les grandes plates-faces retombantes. Celui de gauche joue de la flûte de Pan, et celui de droite du triangle. Ils n'ont pas de chaussures (ce qui explique qu'ils ne se soient pas mis à l'orgue). Le centre offre sa place logique à un trophée de fleurs et de fruits.
 L'angelot sous la plate-face droite.
L'angelot sous la plate-face droite.C'est le seul percussionniste de l'ensemble.
Les pieds des tuyaux de façade sont disposés en lignes ondulantes, élevant l'ensemble quand on se rapproche du centre, sauf lorsque celui-ci est atteint, où ils redescendent, comme affectés par le poids du couronnement central. L'auteur du dessin de ce buffet semble ne s'être autorisé aucune ligne droite horizontale. Postérieurs à 1917, ces tuyaux de Montre sont d'origine, et dotés d'écussons rapportés. Pour donner un caractère plus élancé, la hauteur des pieds des tuyaux a été augmentée par rapport aux standards de l'époque.
Les culots des tourelles et les imposantes jouées conduisent lentement l'œil vers la partie supérieure. Les lignes verticales figurent des faisceaux aux liens sculptés, passant la main aux riches claires-voies associant volutes d'acanthes et guirlandes végétales. La claire-voie centrale comporte des fleurs, des grappes de fruits et un motif central en pomme-de-pain. Une frise cannelée rappelle que ce buffet n'a pas été dessiné au 18ème, et constitue une évolution (plus éclectique) assumant l'héritage classique, mais sans chercher à le plagier. Le regard continue son ascension.
 Comme pour souligner le parallèle entre l'élévation du regard et celle de l'âme, le thème des angelots et traité bien différemment que sur le soubassement.
Comme pour souligner le parallèle entre l'élévation du regard et celle de l'âme, le thème des angelots et traité bien différemment que sur le soubassement.Ceux du bas sont potelés, adossés dans une position un rien "flemmarde" et dépourvus d'ailes - finalement un rien Dionysiaques - ; ils sont proches et on peut même les toucher.
Ceux du couronnement, par contre, sont vraiment "Paradisiaquement corrects", ailés, et ont une pose élancée et élégante ; inaccessibles et lointains, ils sont nimbés de brume d'encens.
Les couronnements son particulièrement développés : chaque tourelle est surmonté d'un chérubin. Celui de gauche, dans une position fort dynamique, joue du violon en pizzicato. Celui de droite préfère la harpe. Les deux qui sont posés sur les tourelles centrales sont symétriques, et embouchent chacun un cornet à bouquin. Avec leur bras disponible, ils enlacent un fruit porté par une des guirlandes. Enfin, la partie centrale, beaucoup plus éclectique que le reste, avec son style réellement "début 20ème", figure Sainte Cécile, en médaillon, tenant un orgue portatif (8 tuyaux). Le cadre du médaillon est constitué d'une frise d'oves puis d'une guirlande végétale. Le visage de la patronne des musiciens apparaît de profil, et souriant. En écoutant l'orgue Rinckenbach, on comprend pourquoi.

Caractéristiques instrumentales
Console indépendante face à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirants de section ronde à porcelaines, disposés au-dessus du second clavier (sur toute la largeur), ainsi qu'à droite et à gauche de celui ci (deux de chaque côté). Ceux du grand-orgue ont des porcelaines à fond blanc et sont disposés au-dessus de la moitié grave du second clavier. Ceux du récit ont des porcelaines à fond rose, et sont disposés au-dessus de la moitié aiguë du second clavier, la Voix humaine correspondant à l'un des deux tirants placés à droite à l'étage inférieur. Les jeux de pédale disposent de porcelaines à fond mauve. Deux sont placés en haut, à gauche des jeux du grand-orgue, deux autres à l'étage inférieur, juste en-dessous, et le Basson est de l'autre côté, à côté du tirant de la Voix humaine du récit.
Commande des combinaisons fixes par 6 pistons blancs, placés sous le premier clavier, et désignés par sérigraphie sur le piston (pas de petite porcelaine).
Toutes les commandes à pied sont repérées par des porcelaines rondes. Commande des tirasses et accouplements par pédales-cuillers à accrocher : de gauche à droite : II/I 4' ("II aigu-I"), II/I 16' ("II grave-I"), II/P ("II-P"), I/P ("I-P"), II/I ("II-I") et I/I ("G.O."). Vient ensuite la pédale basculante de l'expression du récit ("Expression"), puis, à sa droite, celle du crescendo ("Crescendo"). A leur droite se trouve la pédale-cuiller commandant le trémolo du récit ("Tremolo").
Cadran de crescendo placé en haut et en position centrale, entre les tirants du grand-orgue et ceux du récit. C'est un modèle circulaire, rappelant les "horizons artificiels" de l'aéronautique naissante (le premier vol 100% aux instruments a été effectué par Jimmy Doolittle en 1929, donc pendant la construction de cet orgue) : un secteur noir de 180° pivote devant un cadran gradué fixe.
Sur la plaque d'adresse, le "4" de "194" à été rayé à la pointe, et corrigé par un "5" (lui aussi écrit à la pointe).
Bien qu'il soit fort dommage que cette magnifique plaque d'adresse ait été ainsi endommagée, cela rappelle que les numéros d'opus sont parfois difficiles à attribuer. Il faut dire que la décision d'un attribuer un est fortement subjective (faut-il les réserver aux orgues neufs ou inclure des transformations conséquentes ? Doit-on compter les orgues d'étude et les orgues privés ?
Les listes (même celles produites par les facteurs eux-mêmes) sont souvent contradictoires. Celle de Jacqueline Artzer-Rinckenbach (la fille de Joseph) donne l'orgue d'Uffholtz au numéro 190 (Barth, p.427). La plaquette Lapresté (1939) cite l'instrument (26 jeux) mais ne donne pas de numéro. Le "dépliant Lapresté" lui donne le numéro 189. La référence devrait donc être le numéro d'opus apparaissant à la console, mais l'orgue de Carspach (inauguré le 23/11/1930, soit 8 mois après celui d'Uffholtz) est communément désigné comme le n.194.
D'autre part, il faut se souvenir que les numéros d'opus sont généralement attribués en début de construction, et leur ordre n'est donc souvent pas l'ordre chronologique (réalisé en fonction de la date de réception). Ainsi, l'orgue Rinckenbach de Raon-l'étape (Vosges) est l'opus 186 : bien qu'il ne fut livré qu'en 1931, l'affaire à commencé dès 1927.
Finalement, on ne voit pas bien le problème que représente, pour deux orgues qui ne se rencontrent pas très souvent, le partage d'un même numéro d'opus. Notons que l'orgue de Carspach propose également un médaillon supérieur figurant Sainte Odile. Mais là-bas, il y a un positif de dos ; on peut donc difficilement les confondre !

Il s'agit probablement d'un des plus beaux orgues du Haut-Rhin (il le serait à coup sûr avec des membranes neuves et un ventilateur correctement dimensionné). Aujourd'hui (2016), l'orgue est tout à fait jouable, mais présente les symptômes caractéristiques de l'usure des membranes : celles-ci n'ont en effet pas été remplacées lors des derniers relevages. Ce sont des pièces d'usure, et il est souhaitable que cet entretien soit effectué rapidement pour limiter les risques de dégradation rapide dans le futur. De plus, ce type d'instrument demande à être joué au minimum deux fois par semaine, pour éviter l'usure par raidissement des membranes (quand elles restent trop longtemps immobiles, mais tout de même soumises aux dilatations/contractions liées aux changements de température).
Sur place, les promesses qu'apportent la plaque d'adresse de la maison d'Ammerschwihr sont tenues. L'incomparable harmonisation de Joseph Rinckenbach s'accorde avec merveille au buffet et à l'ambiance du lieu, et le domaine de registration accessible par la composition ne demande qu'à être exploré, révélant à chaque fois d'autres perspectives ou d'autres détails. L'instrument est entièrement authentique, fort bien conservé, et c'est l'un des témoins les plus attachants de la diversité du patrimoine musical (et ornemental) alsacien.
![]() Webographie :
Webographie :
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 07/07/2003,31/10/2016
Remerciements à Matthieu Freyburger.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 208a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 459-60
- [TMeyer] Tharcise Meyer : e-mail du 31/01/2003.
- [SBraillon] Sébastien Braillon : e-mail du 29/04/2003.
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 369,427
- [PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 343
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im68008032 ; le dossier propose des photos de l'orgue des inventaires Menninger (en noir et blanc) et Jordan (en couleurs)
![]() Localisation :
Localisation :