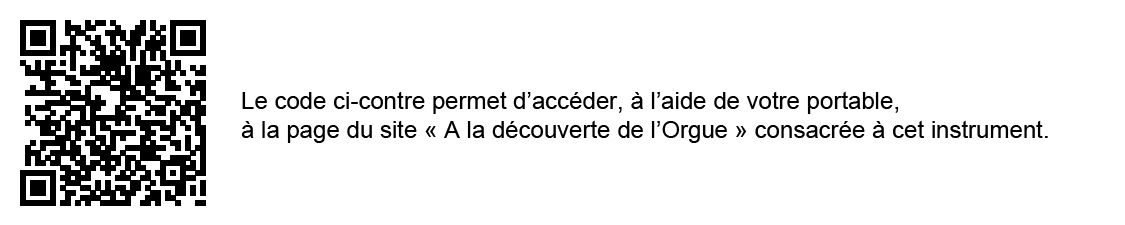L'orgue Roethinger de Diebolsheim.
L'orgue Roethinger de Diebolsheim.Les photos sont de Martin Foisset, 28/11/2017.
Cet instrument a été construit en 1955 par Max et André Roethinger. Il est placé, comme il était d'usage à l'époque, derrière une rangée de tuyaux dont les sommets dessinent des hyperboles. C'était une époque "minimaliste" en ce qui concerne l'ornementation. Mais l'instrument lui-même, caractéristique du style néo-classique, réserve de bonnes surprises.
Historique
En 1838, Antoine Herbuté déménagea à Diebolsheim l'ancien orgue de Rhinau, St-Michel, qui avait été construit par Nicolas Boulay. [IHOA] [PMSAEA69] [ArchSilb]
L'église de Diebolsheim date de 1835, comme l'indique la pierre angulaire au sud-ouest de la nef. Le projet de construction remonte au 14/05/1834. Sa réception par l'architecte d'arrondissement Théodore Kuhlmann, a eu lieu le 15/11/1837. [FBaumann]
L'orgue Boulay, construit en 1760, avait 14 registres. Il apparaît dans les archives de Jean-André Silbermann. Le conseil municipal de Rhinau avait décidé le 03/11/1837 de mettre son ancien orgue aux enchères. Diebolsheim décida d'en faire l'acquisition le jour même. L'accord avec Antoine Herbuté pour le transfert de l'orgue de Rhinau à Diebolsheim a été adopté par le conseil municipal le 08/12/1837. [FBaumann] [ArchSilb]
On apprend que cet orgue Boulay amené par Herbuté était "inutilisable depuis longtemps" en 1875. [PMSDBO1974]
Historique
En 1876, Diebolsheim reçut un deuxième orgue d'occasion : il venait de Steige, Ste-Madeleine où il avait été construit (pour l'ancienne église) par Valentin Rinkenbach et reçu le 17/03/1829 par Kuhlmann. [IHOA] [PMSRHW] [PMSDBO1974]
L'instrument a été repris en 1913 par Franz Xaver Kriess. [IHOA]
Historique
En novembre 1913, Franz Xaver Kriess plaça ici un orgue neuf. [IHOA] [PMSDBO1974]
C'était probablement un instrument très intéressant, quand on connaît les bonnes surprises laissées (entre 1890 et 1937) par la maison de Molsheim : Uttenheim (1892), Dorlisheim (1902), Heiligenberg (1906), Maisonsgoutte (1917). Georges Schwenkedel releva la composition lors de son estimation des dégâts, en 1948 :
Il y avait probablement des combinaisons fixes, et les accouplements d'usage, dont sûrement des octaves graves et/ou aiguës. Les claviers avaient 56 notes.
Kriess n'avait donc pas placé ici sa fameuse Clarinette, et le grand-orgue n'était pas fondé sur 16'.
Les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités en 1917. [IHOA]
Cette façade était constituée de 7 gros tuyaux de chaque côté, et 14 plus petits dans la partie centrale, ce qui donne une idée de la disposition du buffet : sûrement une version plus compacte de celui de Maisonsgoutte. [PMSDBO1974]
L'instrument a été détruit, par faits de guerre, en 1944. [IHOA]
Le rapport de Georges Schwenkedel était sans appel : "Völlig zerstört" [PMSDBO1974] ("Totalement détruit"). [PMSDBO1974]
Historique
Pour remplacer l'orgue Kriess, Max et André Roethinger posèrent en 1955 un instrument néo-classique neuf. [IHOA]
Une tradition orale raconte que le curé de l'époque, Aloyse Wendling aurait payé l'anche de 16' de pédale avec ses propres deniers. [AAdam]
Caractéristiques instrumentales
 La console Roethinger, en acajou.
La console Roethinger, en acajou.Console indépendante dos à la nef, fermée par un rideau coulissant. Comme souvent chez Roethinger, elle est en acajou. Tirage des jeux par dominos, placés en ligne au-dessus du second clavier, en 4 groupes (grand-orgue, récit, pédale et accouplements). Claviers blancs.
Commande des accouplements dupliquée (influence tardive du "Congrès de Vienne" ?) par des pédales cuillers à accrocher, situées à gauche au dessus du pédalier. A leur droite (et au centre de la console) se trouve la pédale basculante commandant l'expression du récit "Expression II", puis celle du crescendo "Crescendo général", de même géométrie mais disposant d'un "détrompeur" dans l'angle supérieur droit. A sa droite, la pédale-cuiller de la combinaison fixe "Grand jeu".
Indication de l'état du crescendo par cadran linéaire horizontal, gradué de 0 à 10, et placé en haut et à droite de la console. Voltmètre rond, gradué de 0 à 25 volts, indiquant 16 volts en marche, et placé en haut à gauche de la console.
 L'indicateur du crescendo, et la plaque "1955".
L'indicateur du crescendo, et la plaque "1955".Plaque d'adresse principale en lettres de laiton incrustées dans le bois, placée en haut de la console, légèrement à gauche, entre le voltmètre et les dominos, et disant :
Strasbourg
 La plaque Roethinger à Diebolsheim.
La plaque Roethinger à Diebolsheim.Elle est complétée par une petite plaque blanche, placée sous l'indicateur de crescendo, et donnant l'année d'achèvement de l'instrument :
Electrique. (Notes et tirage des jeux).
A cônes. Le grand-orgue est à gauche, le récit à droite, et la pédale au fond à gauche et au milieu.
 Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.
Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.(Et les basses de la pédale, à droite.)
Le grand-orgue est diatonique, en "M", avec les basses aux extrémités, et des ravalements (du côté gauche) et des postages. Depuis l'accès à l'arrière jusqu'à la façade : Fourniture, Doublette, Prestant, Flûte 8' et Montre (postages en tuyaux souples). Les chapes sont tamponnées avec le nom du jeu, et sur celle de la Doublette figure "Oktavin 2" (comme à la console).
 Une vue sur la tuyauterie du récit.
Une vue sur la tuyauterie du récit.Le récit est diatonique (avec des postages). Depuis l'accès vers le fond : la Cymbale, la Trompette, le Nasard, la Flûte 4', le Bourdon, puis la Voix céleste et le Salicional.
 La curieuse disposition des aigus de la pédale.
La curieuse disposition des aigus de la pédale.A droite, la partie centrale de la façade.
Les basses de la pédale sont placées derrière le grand-orgue, à gauche, et les aigus sur un sommier placé en hauteur, au centre, et orthogonal à la façade (la plupart des basses au fond, mais avec de nombreux ravalements). Une partie de la Flûte 8' de pédale constitue la façade de droite, devant le récit.
L'accès au clocher se fait par une porte située au milieu du mur du fond de la tribune (qu'on distingue partiellement sur la photo). Pour l'atteindre, il faut passer par l'orgue, et se glisser sous le sommier de pédale. C'est donc une contrainte architecturale, et pas de facture d'orgues, qui explique sa position. [MFoisset]
Bourdons à calottes mobiles, et de nombreux biseaux ont des dents. Par contre, la majorité de la tuyauterie est coupée au ton ou munie d'encoches d'accord (grands principaux). Il y a toutefois des entailles de timbre pour le Salicional et la Voix céleste.
En façade, on trouve des tuyaux de la Montre 8' (à gauche), du Prestant (au milieu). A droite, une partie de la Flûte 8' de pédale.

Evidemment, le répertoire de prédilection de cet orgue est plutôt celui 20ème siècle. Mais sa Trompette et sa Voix céleste, en boîte expressive, élargissent grandement ses possibilités. L'anche de pédale, offerte par le curé Wendling, était une bonne idée, car elle "fonde" un plein jeu très... enthousiaste, qui, sinon, aurait été totalement déséquilibré dans les aigus.
L'esthétique néo-classique n'a plus la cote depuis 2 ou 3 décennies, et ces orgues ne sont vraiment plus à la mode. C'est bien dommage, car celui de Diebolsheim est là pour témoigner que, lorsqu'ils sont bien conservés et entretenus, ils constituent des instruments très intéressants et polyvalents. Face à l'uniformisation en "tout-mécanique" / "tout-baroque" qui sévit depuis plusieurs décennies, ils commencent à devenir un élément majeur contribuant à la diversité de notre patrimoine. Espérons que l'orgue de Diebolsheim soit conservé dans cet état encore longtemps, pour qu'il puisse continuer à servir ses auditeurs et ses musiciens en faisant un atout de ses spécificités.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 26/11/2017
Remerciements à Francine Maas.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 28/11/2017,01/06/2018.
Photos du 26/11/2017.
-
[RLopes] Roland Lopes : e-mail du 21/05/2006.
Photo du 21/05/2006.
-
[AAdam] Antoine Adam : e-mail du 15/12/2004.
Données techniques et instrumentales.
-
[FBaumann] Fabien Baumann-Gsell : e-mail du 19/10/2005.
Recherches aux archives.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 51a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 3, p. 115
- [PMSDBO1974] Pie Meyer-Siat : "Les Orgues de Steige ; Les Orgues d'Epfig", in "Annuaire de la société d'histoire de Dambach-Barr-Obernai", 1974, p. 128-30
-
[PMSAEA69] Pie Meyer-Siat : "Les orgues d'Antoine Herbuté", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 27., éditions de la société Haguenau, 1969, p. 191-2
A compléter avec la source précédente (DBO), plus récente.
- [PMSRHW] Pie Meyer-Siat : "Valentin Rinkenbach, François Ignace Hérisé, les fils Wetzel, facteurs d'orgues", éditions Istra, p. 18
- [ArchSilb] Marc Schaefer : "Das Silbermann Archiv", éditions Winterthur, 1994, p. 122,310
![]() Localisation :
Localisation :