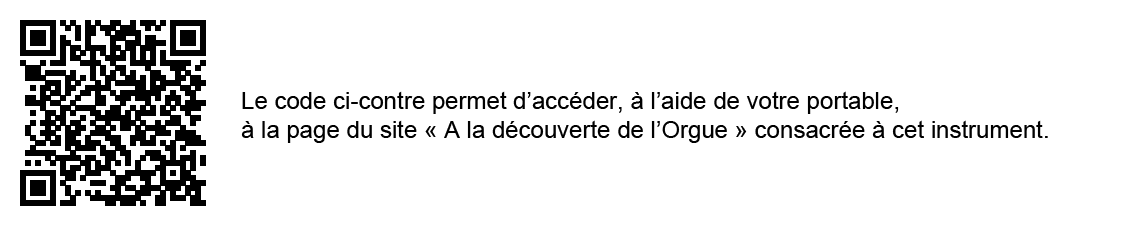Orgue Martin Rinckenbach, 1898, authentique ; un des trésors de l'orgue alsacien
 L'orgue Martin Rinckenbach de Niedernai, dans son buffet d'Andreas Bender (1712).
L'orgue Martin Rinckenbach de Niedernai, dans son buffet d'Andreas Bender (1712).A part celle-ci, prise par l'auteur du site le 26/07/2015,
toutes les autres photos de la page sont de Martin Foisset, 22/07/2015 et 07/07/2021.
On trouve à Niedernai un orgue d'exception, construit en 1898 par celui qui fut probablement le plus grand facteur d'orgues alsacien : Martin Rinckenbach. Son fils Joseph, qui s'impliquait de plus en plus dans l'entreprise d'Ammerschwihr, a aussi activement participé à la genèse de cet orgue, comme en témoigne la plaque d'adresse "Martin et Joseph Rinckenbach" qui orne sa console. Résolument et absolument romantique, créé à l'apogée de cette esthétique, cet orgue présente la particularité d'être logé dans un buffet "classique", du 18ème, puisqu'il provient de l'orgue André Silbermann, 1713, d'Obernai. S'il est heureux que ce magnifique buffet ait pu retrouver une seconde vie en 1898, il fut toutefois pendant longtemps la cause de bien des malentendus, certaines personnes mal renseignées allant avec obstination chercher "du Silbermann" à Niedernai. Les couleurs sonores de cet instrument romantique sont idéalement assorties au magnifique édifice néo-gothique (achevé en 1893, dû à l'architecte Hannin de Saverne), et à son mobilier fourni par la maison Boehm. Et de plus, entre les sculptures du style rocaille et le son des Gambes s'opère une délicieuse et rare alchimie, que l'on retrouve à St-Hippolyte par exemple.
L'histoire des orgues de Niedernai commence effectivement au 18 ème siècle, mais seulement quelques années avant la Révolution, sans Silbermann, et dans la chapelle "Sainte-Barbe".
1783
Historique
C'est en 1783 que Sébastien Krämer, de Mutzig, construisit le premier orgue de "Niederehnheim", à la chapelle "Sainte-Barbe". L'instrument fut reçu (et apprécié) par Eppel, de Sélestat. Josias Silbermann en a noté la composition dans les archives de son père : [Barth] [IHOA] [PMSCS68] [ArchSilb]
On sait aussi que le buffet de cet orgue était en chêne. En effet, lorsque Krämer livra en 1824 un orgue à Krautergersheim, les commanditaires furent déçus : l'instrument était censé être le même qu'à Niedernai, or son buffet n'était qu'en sapin, et non en chêne. Il faut dire que la Révolution était passée par là, laissant Krämer, comme de nombreux autres artisans, au bord de la ruine. (Les spéculateurs, eux, s'en étaient bien sortis !) Et, pire, elle avait popularisé parmi les édiles son goût pour la spoliation : bien qu'ayant connaissance de l' "indigence" dans laquelle se trouvait le facteur, le préfet sauta sur le prétexte pour entériner le refus de Krautergersheim de payer à Krämer la gratification prévue pour bon achèvement ! [Niedernai1993] [PMSCS68]
La chapelle Sainte-Barbe resta sans orgue après 1898, et fut détruite en 1920. Elle se situait à l'emplacement de l'école maternelle. Et si l'église actuelle se trouve là où elle est, c'est qu'un grand incendie avait ravagé toute une zone de Niedernai en 1862, et que la commune avait racheté les terrains (encore non reconstruits) en 1869. Avant d'y installer le nouvel orgue, Martin Rinckenbach fit soigneusement démonter le Krämer (qu'il avait acquis "en reprise"), en ménageant les "parties fragiles" : c'est donc qu'il avait l'intention de le replacer ailleurs. On ne sait pas ce qu'il est devenu. [PMSCS68]
Historique
L'orgue de Niedernai fut posé fin septembre 1898 par Martin Rinckenbach, dont ce fut l'opus 59. [LR1907] [IHOA] [Barth] [PMSDBO1972]
En 1884, le curé Aloyse Reys de Niedernai (originaire d'Obernai et installé à Niedernai l'année précédente) avait racheté ce qui restait de l'orgue André Silbermann, 1713, d'Obernai. Cet instrument gisait depuis des années (depuis le 20/08/1867 !), dans un entrepôt, tout simplement parce que personne n'en avait l'usage. [Niedernai1993] [PMSDBO1972]
En 1891 (devis du 10/10/1891), Martin Rinckenbach avait proposé de remonter l'orgue Silbermann, mais il aurait totalement fallu reconstruire la mécanique (à l'évidence dispersée ou non récupérable) et la soufflerie. A l'évidence, le projet n'était pas encore mature. Heureusement, en 1898, quand finalement, grâce à une subvention, le financement était assuré, on eut tout de même la bonne idée de demander à Rinckenbach de loger son instrument dans le buffet de l'orgue d'Obernai. Sa réalisation avait été confiée à Andreas Bender (aussi bien André - à une exception près - que Jean-André Silbermann sous-traitaient leurs buffets et ne les construisaient jamais eux-mêmes), et les sculptures étaient l'oeuvre de Guillaume Le Sage (celles-ci coûtèrent presque la moitié du prix total du buffet). C'est ainsi que ce magnifique buffet fut sauvé, et trouva une seconde vie. Même la façade du positif de dos (inutile puisque le second clavier est un récit), a été accrochée à la balustrade de la tribune, pour respecter l'agencement esthétique. [PMSDBO1972] [Obernai2001]
Avec ses 23 jeux (dont quatre 16'), l'orgue Rinckenbach est, par sa taille, un instrument représentatif de la production de l'époque. Sans laisser de place aux "fioritures", la composition ne fait pas non plus de concession notable. C'est un orgue romantique plutôt "tardif" (on dit parfois "symphonique"), pour lequel les techniques mises en oeuvre étaient parvenues à totale maturité, et parfaitement maîtrisées. Il bénéficie d'une expérience déjà longue dans tous les domaines : tuyauterie à entailles et calottes mobiles, sommiers à gravures, transmission mécanique à équerres, console indépendante "alla Cavaillé-Coll", avec contrôles aux pieds, boîte expressive "continue", etc... Et des grands claviers de 56 notes (allant jusqu'au Sol). C'est un des derniers Rinckenbach muni d'une transmission mécanique (la maison d'Ammerschwihr est "passée" au pneumatique dès 1899). Quelques années plus tard, le modernisme poussera les facteurs à essayer d'autres techniques, et les orgues seront rapidement très différents.
Mais ne nous méprenons pas : c'était pour l'Alsace de l'époque un orgue novateur, et plutôt "progressiste". A peine 20 ans auparavant, Théodore et Auguste Stiehr avaient encore construit à Uhlwiller un instrument avec un positif de dos.
C'était aussi, pour l'Alsace allemande depuis 1871, un orgue très "français". Même si, en même temps, la région s'enrichissait d'instruments de Walcker, Link ou Voit, il n'y avait aucun "impérialisme" culturel : le "romantique français" pratiqué par Koulen, Merklin et Rinckenbach était très apprécié, y-compris par les "allemands de l'intérieur" (Wilhelm Sering). Plus tard, certains ont voulu y voir une marque du "patriotisme" des commanditaires ; en fait, c'était juste du bon goût.
Enfin, un autre cliché auquel on peu tordre le cou est celui de "l'orgue des paysans". L'orgue "de campagne" n'avait absolument rien à envier aux instruments urbains. En campagne, on ne changeait certes pas son orgue tous les 30 ans, mais, quand on le faisait, c'était avec un projet culturel au moins aussi élaboré qu' "en ville".
Les 65 tuyaux de façade (39 au grand-orgue - dont 36 parlants - et 26 au positif ornemental, évidemment tous muets) ont été réquisitionnés par les autorités en 1917. [PMSDBO1972]
C'est Adolphe Blanarsch qui remplaça la façade, en 1930. [PMSDBO1972]
En 1985, Robert Kriess procéda à un nettoyage du grand-orgue et de la pédale. Ensuite, l'entretien passa à la maison Kern (côté Gaston, soit Hattmatt). [AJFHarthong]
L'orgue Rinckenbach était tellement réussi que personne, jamais, ne le modifia pour le "faire évoluer" afin suivre les modes. Il resta entièrement authentique. Il y eut un relevage, en novembre 2009, par la maison Daniel Kern. Au cours de ce relevage, on découvrit que le Bourdon du récit était du 18ème. [Caecilia] [AJFHarthong]
Ledit Bourdon raviva bien sûr quelques fantasmes "Silbermanniens". Mais ce jeu n'a pas été construit par Silbermann : sans qu'il ne soit possible de le prouver, il doit à l'évidence et tout simplement venir de l'orgue Krämer de 1783.
Pour fêter ce relevage, l'orgue a été inauguré par Thomas Kientz (œuvres de Charles-Marie Widor, César Franck et Théodore Dubois), avec Marie de Sèze (flûte) (œuvres de Mozart et de C.P.E. Bach), puis les claviers ont été rendus à René Schultz (Niedernai) pour la fin du concert. [Caecilia]
Le buffet
Le magnifique buffet de style rocaille est d'Andreas Bender, 1712, et avait été construit pour l'orgue André Silbermann, 1713, d'Obernai. Le même dessin a été repris pour celui des Dominicains de Colmar (aujourd'hui à Niedermorschwihr) (1726), qui est donc pratiquement identique. Il est de style classique français (Thierry, Paris), mais fortement apparenté à un instrument "clé" qu'André a connu dans sa jeunesse : celui du Temple-Neuf de Stasbourg (Friedrich Ring / Claude Legros), aujourd'hui à Ribeauvillé. Les tourelles du grand corps comportent ainsi plus de tuyaux (7) que les 5 préférés par le canon esthétique parisien.
Le grand corps est constitué de trois tourelles à entablements, la plus grande au centre, et deux plates faces rectangulaires (le sommet est horizontal). Pour faire écho à ces lignes "retombantes", le petit buffet est constitué de deux tourelles seulement, encadrant deux plates-faces jumelles (donc dessinant un "V"). Par rapport aux standards esthétiques des buffets de l'époque, le positif a été placé un peu bas. Mais il faut dire qu'accroché plus haut, c'est son rapport à la balustrade qui aurait été peu élégant.
L'ornementation est très riche, et fait usage de thèmes végétaux et de feuilles d'acanthe. Les jouées, les claires-voies et les culots des tourelles sont très élaborés, tout comme les imposants rinceaux épaulant les tourelles. Les couronnements sont très ajourés et finissent par des fleurons végétaux (qu'on pourrait prendre pour des fleurs de lys au positif). Même les galbes latéraux du grand corps sont soulignés par des frises sculptées. Détail remarquable : les fleurs ouvertes à quatre pétales sur les cylindres des entablements des tourelles (au-dessus des tuyaux).
Caractéristiques instrumentales
| C | c | c' |
| 2'2/3 | 2'2/3 | 4' |
| 2' | 2' | 2'2/3 |
| - | 1'1/3 | 1'1/3 |
 La console indépendante.
La console indépendante.Console indépendante face à la nef, fermée par un couvercle basculant. Tirants de jeux de section ronde, à pommeaux tournés munis de porcelaines, disposés en trois gradins de part et d'autre des claviers. Selon l'habitude de Martin Rinckenbach, les porcelaines sont blanches et les noms de jeux écrits en noir pour le grand-orgue, en rouge pour le récit, et en bleu pour la pédale. La porcelaine de la Flûte 4' du grand-orgue a été remplacée par une pastille jaune (Kriess ? Elle manquait en 1986 lors de l'inventaire). La porcelaine de la Mixture semble venir d'ailleurs, et elle porte un numéro ("9"). Claviers blancs, touches du récit biseautées (droits au grand-orgue). Commande des tirasses et de l'accouplement par pédales-cuillers à accrocher, repérées par des porcelaines rondes à liséré doré placées au-dessus du second manuel. De gauche à droite : II/P ("Pedale koppel à II.M."), I/P ("Pedale koppel à I.M."), commande de la boîte du récit par pédale basculante (d'origine) ("Expression"), II/I ("Manual koppel"). Les claviers ont été replaqués et le porte-partitions remplacé par un modèle un peu plus grand (l'ancien est conservé) : à part cela et une porcelaine (Flûte 4'), la console est entièrement d'origine.
 La plaque d'adresse signant les orgues des années de l'apogée de la maison Rinckenbach (et de la facture d'orgues en Alsace).
La plaque d'adresse signant les orgues des années de l'apogée de la maison Rinckenbach (et de la facture d'orgues en Alsace).Le numéro d'opus n'y figure pas encore.
Plaque d'adresse noire à lettres dorées disposée sur la traverse de la console, au-dessus du second clavier et au centre, disant :
Orgelbauer in Ammerschweier.
Ober-Elsass.
Le mot "Ammerschweier" ondule sur deux lignes.
Sommiers à gravures, de Rinckenbach.
Deux sommiers diatoniques pour le grand-orgue, basses sur les côtés. Il y a de chaque côté, un ravalement : 2 notes graves (C D et Cis Dis) sont disposées au centre.
 Ordre des jeux (de bas en haut, donc de l'accès vers la façade) :
Ordre des jeux (de bas en haut, donc de l'accès vers la façade) :Trompette, Mixture, Gambe 8', Flûte harmonique 8', Flûte octaviante 4',
Dolce 8', Bourdon 8', Bourdon 16', Principal 4', Montre 8'.
 Sommier du récit diatonique. De l'accès (en bas) vers le fond (en haut) :
Sommier du récit diatonique. De l'accès (en bas) vers le fond (en haut) :Hautbois, Quintaton 16', Flûte traversière 4', Salicional 8', Gemshorn 4',
Bourdon 8' (du 18ème), Voix céleste, et Geigenprincipal 8'.
 La tuyauterie de pédale, avec la Posaune au premier plan.
La tuyauterie de pédale, avec la Posaune au premier plan.Les pieds de la Posaune sont en Spotted : c'est sûrement une des premières fois
que Rinckenbach utilise ce métal, qui aura un grand avenir.
La soufflerie est logée à droite de l'orgue sur la tribune, et complétée par un réservoir additionnel dans le buffet. Un ventilateur électrique alimente un grand réservoir, dont les pompes à pied ont été conservées.
 Une des célèbres entailles de timbre en "trou de serrure".
Une des célèbres entailles de timbre en "trou de serrure".La tuyauterie est de très belle facture, réalisée dans les matériaux les plus nobles : les Principaux, Gambes et anches en 8' sont en étain, y-compris les basses. Bourdons à calottes mobiles, entailles de timbre, aplatissages en triangle. Certains jeux (le Geigenprincipal par exemple) disposent des entailles de timbre en forme de trou de serrure, caractéristiques de la facture de Martin Rinckenbach.

Cette fin du 19ème siècle était décidément une époque exceptionnelle. La richesse de son héritage témoigne de sa capacité à mener - techniquement et artistiquement - ses styles de prédilection à leur apogée. Ses découvertes et ses succès, et surtout l'enthousiasme créatif et l'ouverture d'esprit avec lesquels ils furent accomplis ne laissent absolument pas présager l'état dans lequel se trouvera l'Europe seulement 20 ans après, quand pratiquement tout un monde se fut éteint, victime des nationalismes et de l'esprit revanchard. Avec d'autres témoins de la "Belle époque", l'orgue de Niedernai, en plus de représenter un sommet de la facture d'orgues, est un instrument de musique exceptionnel. Il montre ce dont sont capables les entreprises humaines quand, tournant le dos à la dictature de l' "utile" et du "retour sur investissement", elles trouvent leur motivation dans l'envie de progresser, de dépasser les accomplissements du passé tout en les respectant, et surtout de créer simplement des choses qui seront aimées pas ses contemporains et par leurs successeurs.
![]() Webographie :
Webographie :
- [YouTube] https://youtu.be/XHH_tIo5bT4 : Une présentaion de certains jeux de l'orgue de Niedernai.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
- [Visite] "Visite sur place", 26/07/2015,07/07/2021
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 22/07/2015,08/07/2021,15/09/2021.Document "Niedernai, 07-07-2021.docx"
Photos du 07/07/2021 et données techniques.
- [AJFHarthong] Abbé Jean-François Harthong : e-mail du 20/06/2005,06/11/2009,29/11/2009,06/08/2015.
-
[LR1907] F.X. Mathias : "Die Orgelbaufirma Rinckenbach in Ammerschweier i. E. (liste des travaux de 1872 à 1907)", in "Caecilia", p. 83
"Niederehnheim 23"
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 128b
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 3, p. 439-40
- [ArchSilb] Marc Schaefer : "Das Silbermann Archiv", éditions Winterthur, 1994, p. 101
- [PMSCS68] Pie Meyer-Siat : "Sébastien Kraemer, facteur d'orgues", in "Pays d'Alsace ('Cahiers de Saverne')", vol 68., éditions Société d'histoire et d'archéologie de Saverne et environs, 1969, p. 26,28
- [Niedernai1993] Plaquette 'Saint Maximin - Niedernai' éditée pour le centenaire de l'église
- [Obernai2001] Christine Muller, Gilbert Poinsot, Christian Lutz, Daniel Kern : ""La restauration de l'orgue Merklin". Plaquette de la série "Patrimoine restauré en région Alsace"", vol 6., p. 7-8
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 280
- [Caecilia] "Caecilia, Revue de musique liturgique du diocèse d'Alsace", éditions Union Sainte Cécile, vol. 2010-04, p. 17
- [PMSDBO1972] Pie Meyer-Siat : "Les orgues de Niedernai", in "Annuaire de la société d'histoire de Dambach-Barr-Obernai", 1972, p. 157-66
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im67001602
-
[HOIE] Pie Meyer-Siat : "Historische Orgeln im Elsass", éditions Schnell und Steiner, München - Zürich, 1983, p. 50-1
Cité pour mémoire, car l'article ne parle pratiquement que de l'orgue... d'Obernai. Il est de plus incohérent, puisqu'il attribue l'orgue de Niedernai à Andreas Silbermann, en se contredisant seulement au chapitre "1898" - quand la confusion est établie. Ce genre d'article a malheureusement eu un effet désastreux sur la connaissance des orgues de la fin du 19ème et, probablement, est à l'origine de bien des méprises et des malentendus. Voir des erreurs grossières, commises par des gens mal renseignés qui ont accusé Rinckenbach ou Niedernai d'avoir "démoli" un orgue Silbermann... Du coup, l'organologie "officielle" analysait le moindre détail de "l'affaire", en passant à côté du vrai chef-d'oeuvre, l'orgue de 1898.
![]() Localisation :
Localisation :