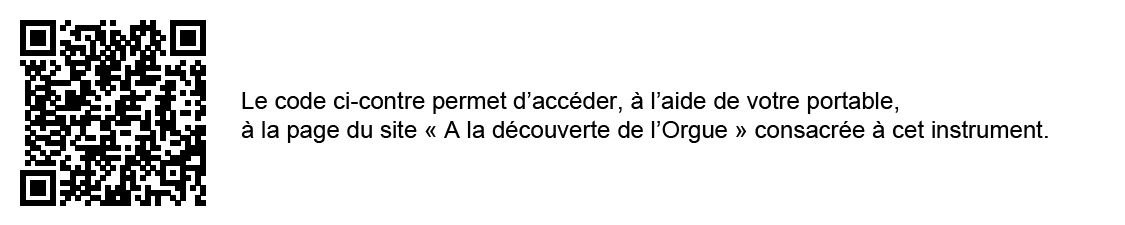Waldolwisheim, le buffet Antoine Ketterer de l'orgue Stiehr.
Waldolwisheim, le buffet Antoine Ketterer de l'orgue Stiehr.Photo Creative Commons, de Rh67, 16/02/2011.
On trouve à Waldolwisheim un orgue Joseph Stiehr, construit en 1863, et logé dans un buffet que son constructeur avait acquis à Rosheim en 1859. L'instrument est caractéristique de la production de la maison de Seltz dans les années 1860 : un attachement au style pré-romantique tel qu'il était pratiqué depuis la sortie du tunnel de la Révolution.
Historique
En 1863, Joseph Stiehr plaça à Waldolwisheim un orgue qu'il logea dans un buffet de l'ancien régime, qu'il avait récupéré à Rosheim. [IHOA] [Barth]
Evidemment, ce fut plus tard source de bien des confusions, mais il aurait été dommage de laisser perdre ce joli buffet, dont - rappelons-le - Rosheim ne voulait plus. L'histoire est la suivante :
En 1859, à l'occasion de la destruction de la tribune de l'église romane de Rosheim (Sts-Pierre-et-Paul ; il s'agissait de retrouver la "sublime pureté minimaliste romane"), on demanda à Joseph Stiehr de déplacer l'orgue du 18ème dans une pièce où il serait tenu hors de vue. L'instrument avait été construit en 1733 par André Silbermann, et logé dans un buffet d'Antoine Ketterer.
Ladite pièce est située en hauteur, au sud du chœur. Elle correspond à un étage de l'ancienne tour de l'église romane. Placé à cet endroit, l'orgue ne peut être vu depuis la nef (c'était l'objectif), et, pour l'acoustique... eh bien on imagine aisément. De plus, le buffet ne serait pas rentré dans l'exigu local. La partie instrumentale fut donc déplacée seule. Stiehr construisit un buffet "minimal" pour ce qui restait de l'orgue Silbermann. Pour une raison inconnue, mais peut-être aussi liée au manque de place, Joseph Stiehr confectionna des sommiers neufs pour le grand-orgue et le positif de ce "cryptorgue".
Stiehr se retrouva donc en possession du magnifique buffet construit par Ketterer pour André Silbermann. Il l'utilisa comme écrin pour son nouvel instrument destiné à Waldolwisheim en 1863. Le marché avait été conclu le 03/12/1861, et la réception fut assurée le 23/11/1863 par Edouard Ignace Andlauer (Haguenau, St-Georges) et Marcel Ungerer (Saverne, N.-D. de la Nativité). Notons qu'à part le couronnement central (disparu), Stiehr a remonté l'intégralité du buffet à Waldolwisheim. Les sommiers manuels du 18ème ont aussi logiquement trouvé place dans le buffet de 1733. Par contre, rien en ce qui concerne la tuyauterie. [Barth] [PMSSTIEHR] [RBornert]
A la fin du 19ème, disons avant 1899, on demanda à Martin Rinckenbach de constituer un récit expressif en déplaçant le sommier du positif à l'arrière de l'instrument. [ITOA]
Il est clair qu'à l'époque, avec la considérable amélioration du niveau technique des organistes alsaciens depuis 1880, le pauvre orgue Stiehr ne devait avoir d'intérêt... que par son buffet. Le pédalier réduit à 18 notes (donc inutilisable en pratique pour autre chose que l'accompagnement du chant) et le positif de dos devaient constituer de graves repoussoirs pour les organistes.
Les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités le 16/06/1917. [IHOA]
En 1928, l'orgue fut confié à Edmond-Alexandre Roethinger pour ce qui est parfois présenté comme une une réparation, mais qui fut bel et bien une transformation, puisque le 4' de pédale a été remplacé par un Violoncelle 8'. Les pavillons de la Trompette du grand-orgue ont été refaits, et les tuyaux de façade évidemment remplacés. Il est probable que la soufflerie ait été dotée d'un ventilateur électrique. [IHOA] [Barth] [PMSSTIEHR]
Puis, en 1948, Adolphe Blanarsch entretint l'instrument, qui, à ce moment, était attribué... à Roethinger. [IHOA] [Barth] [PMSSTIEHR]
En 1962, on demanda à Alfred Kern de faire des réparations. Lors des travaux, Erwin Sattler, travaillant pour Kern, découvrit l'inscription "Orgue Silbermann, Rosheim" (probablement faite par Joseph Stiehr) dans le buffet. Après des recherches en archives, effectuées par le curé G. Georger de Waldolwisheim, la provenance du buffet fut confirmée. [IHOA] [Barth] [PMSSTIEHR]
Evidemment, on imagine que, dans le monde de l'orgue alsacien des années 1960, l'irruption d'un "Silbermann redécouvert" a eu le même effet que l'arrivée d'un nouveau coq dans une basse-cour. Du coup, les modifications apportées par Martin Rinckenbach (à l'orgue Stiehr) devinrent insupportables. (Elles ont d'ailleurs été gravement exagérées : il a même gardé le sommier du positif ! Il semble n'avoir ajouté que des tuyaux de Prestant, ce qui est logique puisque le clavier, une fois intérieur, n'avait plus de tuyaux de façade.)
On demanda donc à Alfred Kern de remettre le positif dans le petit buffet, pour retrouver la "pureté classique". Mais il faut bien noter qu'il s'agissait d'un orgue pré-romantique de 1863. Une époque où, en Europe, les positifs de dos n'avaient plus du tout la cote... D'ailleurs, Joseph Stiehr, la même année qu'il construisit son orgue pour Waldolwisheim, avait réalisé des orgues à positif intérieur à Gingsheim et Willer, et rédigé pour Benfeld un devis avec un positif expressif.
Alfred Kern plaça à ce positif qui avait "retrouvé sa vraie place" une Doublette (on veut bien), mais aussi une basse de Cromorne pour compléter le dessus de Hautbois (pour faire "classique français" ?), et, pour sacrifier à la mode "nordique" alors toute-puissante... une Sesquialtera (!).
On se demande si tout commentaire est superflu, ou s'il est quand même nécessaire d'apporter quelques précisions. Les faits étant quand même révélateurs de ce qui se passait dans les années 1960 dans le monde de l'orgue alsacien, conquis par le "goût classique français", autant les énoncer de façon pragmatique : on se trouvait ici face à un bel orgue qui souffrait de deux vrais défauts : un chemin de vent absurde et une pédale inutilisable, car limitée à 18 notes. Et voilà les experts qui théorisent sur la position du positif/récit, ajoutent une surréaliste Sesquialtera, et jugent que leur répertoire personnel mérite bien une basse de Cromorne... Et on laisse les porte-vents dans leur configuration inefficace, et la pédale à 18 notes, au mépris total de l'usage qui sera fait de l'instrument après l'inauguration.
En 2000, l'orgue a été relevé par Gaston Kern. [IHOA] [RBornert] [Caecilia]
La tuyauterie en bois était gravement vermoulue, souvent au-delà du réparable. Gaston Kern remplaça pratiquement l'intégralité des tuyaux en bois de la pédale (Bourdon 16, Flûte 8, résonateurs de l'Ophicléide 16) et quelques tuyaux des basses du grand orgue. Les résonateurs de la Trompette de pédale ont également été remplacés (tout simplement parce qu'ils étaient de Roethinger). Le chemin de vent a été (enfin !) repensé et redistribué. L'étendue de pédale a été laissée à 18 notes, et la Sesquialtera de 1962 est resté elle aussi. Et bien sûr - incontournable à l'époque - les tuyaux de façade ont été remplacés par des neufs en étain. La pédale a été laissée à 18 notes. [RBornert]
Suite à ces travaux, l'orgue a été inauguré le 27/01/2001 par Julien Storck (Waldolwisheim) et la chorale dirigée par Marc Wintz. Les explications techniques ont été fournies par Robert Pfrimmer avec des illustrations sonores de Marc Baumann. [RBornert] [Caecilia]
Caractéristiques instrumentales
| C | c |
| - | 2'2/3 |
| 1'3/5 | 1'3/5 |
| C | c | c' | c'' | c''' |
| 1'1/3 | 2' | 2'2/3 | 5'1/3 | 8' |
| 1' | 1'1/3 | 2' | 4' | 8' |
| 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2'2/3 | 5'1/3 |
| 2/3' | 1' | 2' | 4' |
 La console en fenêtre.
La console en fenêtre.Photo de Franck Lechêne, 06/03/2012.
Console en fenêtre frontale de Joseph Stiehr. Tirants de jeux de section carrée placés en deux fois deux colonnes de part et d'autre des claviers. Ils sont munis de porcelaines. Claviers blancs.
Mécanique suspendue.
A gravures, d'André Silbermann aux claviers et de Joseph Stiehr pour la pédale (de 18 notes).
Quand on lit ce qui a été écrit sur ce (très bel) instrument, on se dit que rarement un orgue n'a fait l'objet de tant de confusions. Que retenir de ces savantes études d'experts ? Pas grand-chose, sinon qu'il est inutile d'aller à Waldolwisheim pour faire un "pèlerinage Silbermann". On y trouve un orgue Joseph Stiehr, donc un pré-romantique (malgré sa date de construction, 1863), malheureusement altéré alors qu'il avait juste 100 ans, et qui souffre toujours de son seul défaut majeur : sa pédale restreinte à 18 notes.
Il ne faut donc surtout pas limiter cet instrument à son historique, même si c'est ce qui passionne les experts : cela finit par en occulter les qualités. Or, elles sont nombreuses, comme cet impressionnant - et authentique - grand-orgue de 11 jeux, avec quatre fonds de 8', dont un de ces inimitables "Cors des Alpes" de Stiehr ! C'est quand même enthousiasmant, et beaucoup plus intéressant que de savoir quelle rondelle ou quelle cheville est de Silbermann... Il est temps de s'intéresser à cet orgue pour ce qu'il est, et à ceux qui l'ont voulu. Car c'est, avant tout, un très bel instrument de musique, issu d'une époque (les années 1860) où l'orgue était incroyablement populaire, et où toutes les communes voulaient avoir le plus beau. De ce point de vue, Waldolwisheim a quand même très bien joué !
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[FLechene] Franck Lechêne :
Photo de la console du 06/03/2012.
-
[RBornert] e-mail du 12/11/2002.
Données historiques, en particulier sur les travaux de 2000.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 214a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 817
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 377
- [PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 533-4
-
[HOIE] Pie Meyer-Siat : "Historische Orgeln im Elsass", éditions Schnell und Steiner, München - Zürich, 1983, p. 68-9
Le titre de l'article est "1733 Waldolwisheim Andreas Silbermann", tendant à attribuer l'instrument à Silbermann père. Mais le texte lui-même est parfaitement clair sur la provenance Stiehr de la partie instrumentale. D'où, évidemment, pas mal de confusion par la suite. On en finit par ce demander si le sujet de cet ouvrage n'était pas les *buffets* historiques d'Alsace.
-
[Caecilia] "Caecilia, Revue de musique liturgique du diocèse d'Alsace", éditions Union Sainte Cécile, p. 31-2, 2001-3
L'article est titré "Inauguration de l'orgue Silbermann-Stiehr (1733) restauré". Sic. Si on avait souhaité entretenir la confusion, on n'aurait pas pu trouver mieux. Et, en 2000, l'orgue n'a pas (du tout) été "restauré" dans son état de 1733, mais simplement relevé.
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im67003638 ; avec de nombreuses photos du buffet Ketterer et de l'orgue Stiehr.
![]() Localisation :
Localisation :