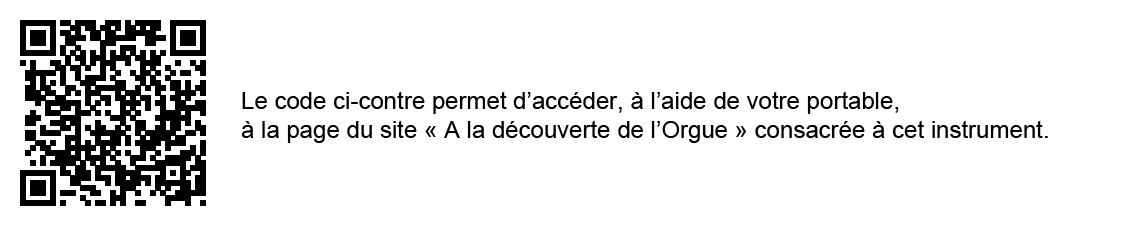L'orgue Link (1912) de Bust,
L'orgue Link (1912) de Bust,
dans son buffet de 1843.
Les photos sont de Martin Foisset, 27/04/2019.
L'église actuelle de Bust a été construite en 1912, et son orgue Gebrüder Link en est totalement contemporain. C'est un instrument d'esthétique post-romantique allemande, idéalement adapté à son édifice.
Historique
Dans l'ancienne église de Bust, Martin Wetzel posa un petit orgue en 1843, selon le devis du 06/05/1842 : [IHOA] [PMSCS77Bust] [PMSSTIEHR]
Le devis précise au sujet du buffet : "Le buffet avec trois tourelles sera fait en bois de chêne et aura 2 m 92 de largeur ; cependant la partie entourant la pédale et les soufflets en sera de sapin." C'est - pour la partie avant - le buffet de l'orgue actuel. [PMSCS77Bust]
Cet instrument fut réparé en 1847, puis en 1864 par les frères Wetzel, et nécessita à nouveau une réparation en 1883, cette fois menée par Théodore Stiehr. Cette dernière intervention fut plutôt lourde, car elle porta sur les sommiers. [IHOA] [PMSCS77Bust] [PMSSTIEHR] [PMSRHW]
Historique
Le grand projet mené par le pasteur Charles Maurer (1874-1950) s'acheva par l'inauguration, le 01/09/1912, de la nouvelle église de Bust, dans laquelle la maison Gebrüder Link avait posé son opus 549. Orgue et édifice sont donc contemporains. [IHOA] [PMSCS77Bust]
En 1912, la maison de Giengen avait déjà placé 40 orgues en Alsace : c'était une "valeur sûre". Et surtout, il y en avait déjà plusieurs en Alsace Bossue. On peut citer ceux d'Ottwiller, Lohr, Struth, Volksberg (tous de 1900), Eschbourg (1904), Drulingen ou Wintersbourg (1909). Un "bouche-à-oreille" fonctionnant aussi bien et aussi longtemps en dit long sur la façon dont ces instruments étaient appréciés.
Avec 14 jeux, l'orgue de Bust se situe dans la moyenne supérieure des instruments construits en dehors des villes. Si, au milieu du 19ème siècle, on n'hésitait pas à faire de fortes concessions pour acquérir un instrument à tuyaux (clavier unique, pédalier réduit interdisant l'accès à une grande partie du répertoire), les orgues de la Belle époque sont "complets". Ils disposent d'une console ergonomique conçue pour ne pas brider les organistes, dont le niveau avait fortement progressé depuis 1880, en particulier grâce à l'effort de formation fourni par les écoles normales. La seule concession porte donc sur le nombre de jeux, mais, grâce aux accouplements à l'octave, un instrument de 14 jeux peut être idéalement proportionné à un édifice de cette taille.
Pour la composition, deux lignes directrices apparaissent clairement : un grand équilibre entre les deux manuels (6 jeux chacun), et une couleur plutôt "Gambée". Après tout, dans une église luthérienne, l'accompagnement du chant choral est une mission incontournable, que l'on peut idéalement confier à un grand chœur de Gambes, très riche en harmoniques, et plus souple d'utilisation qu'un plein-jeu.
Dans la production alsacienne de la maison Link, après les orgues de Drulingen (1909) ou Lingolsheim (1908) qui présentaient des caractéristiques romantiques "françaises" (Trompette de récit et même Flûte traversière à Drulingen), on retrouve une composition résolument plus "rhénane". Il n'y a pas d'anche, mais une grande richesse de Gambes : Salicional et Gambe au grand-orgue... et tout le récit, sauf la Flûte 8'. Ce récit porte une Aeoline pour "adosser" idéalement la Voix céleste, il est fondé sur un Principal étroit (Geigenprincipal), et à la fois son Bourdon (Quintaton) et son 4 pieds (Fugara) sont gambés.
La Mixture-Cornet apporte des harmoniques "explicites" (avec un rang de Quinte et un rang de Tierce complets et continus), sans sans aucun caractère agressif. Dans cette esthétique allemande post-romantique, il s'agit surtout d'un jeu de "couronnement" destiné à finaliser le Tutti. La maison Link plaçait parfois ce jeu au récit expressif (Scharrachbergheim-Irmstett), mais il est ici à sa place "naturelle", au grand orgue.
Restent les deux "stars" de cette composition : face à un pareil chœur de Gambes, la famille des Flûtes se devait d'être dignement représentée en qualité : le grand-orgue se vit doté d'un Bourdon double (à double bouches dans le médium), et le récit d'une Flûte 8' absolument exceptionnelle.
On peut se demander pourquoi le buffet de 1843 a été conservé, vu que tout le reste de l'instrument était totalement neuf, et que cette boiserie peut paraître très exiguë pour un orgue de 14 jeux avec une grande richesse en fonds de 8'. En 1909, la localité de Berstett avait fait pareil : l'opus 568 de la maison Link fut logé dans un buffet récupéré de l'orgue Wetzel, 1843, du lieu. Là-bas, le nouvel orgue était destiné à être placé dans le chœur, donc en pleine vue. C'est donc que l'esthétique visuelle "post-classique" de ces buffets était très appréciée en 1912. Il faut dire que ce buffet s'accorde très bien aux vitraux de V. Saile (Stuttgart) et au style global de l'édifice, inspiré par la renaissance rhénane, et représentant volontiers l'antiquité sous des formes classiques.
D'autre part, et tout simplement, il faut noter que dans la première moitié du 20ème siècle, les gens étaient très attachés au mobilier, et que celui-ci constituait une grande partie de leur richesse. Garder le buffet de l'orgue devait paraître aussi logique que de conserver le vaisselier quand on change de vaisselle.
En 1933, Georges Schwenkedel proposa de placer un ventilateur électrique et de retoucher la composition. Mais heureusement, par décision du 06/07/1936 du conseil presbytéral, aucun changement ne fut apporté à la composition, et le ventilateur fut posé par Frédéric Haerpfer. L'orgue Link resta donc authentique. [PMSCS77Bust]
En 1976, Paul Adam fit un relevage. [ITOA]
L'instrument traversa donc les terribles années 1960-1980 sans encombre. Aucun jeu ne fut altéré, ce qui est remarquable, car un grand nombre d'instruments du début du 20ème siècle ont été gravement altérés au cours de ces deux décennies. (Et ces mutilations, on le sait, sont très rarement réparées.)
L'orgue a été relevé par l'actuelle maison Gebrüder Link en 2014. [Visite]
Cette opération fut exemplaire, et le résultat illustre parfaitement de quoi est capable un orgue Link en bon état et doté de sa composition d'origine. Elle redonne l'espoir que, progressivement, les orgues Links d'Alsace qui ont survécu mais ont été "baroquisés" soient restaurés.
La console a été restaurée en respectant sa disposition d'origine (une commande pour les cloches a été intégrée). Les claviers et le pédalier ont été replaqués, et un banc réglable en hauteur a été ajouté. (Le banc d'origine est bien sûr conservé et sert dans la nef.)
Caractéristiques instrumentales
 La console Link, dirigée vers la nef,
La console Link, dirigée vers la nef,disposition logique dans un édifice où tout est orienté vers l'autel,
la chaire et le chœur.
Console indépendante face à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos, placés en ligne au-dessus du second clavier. Ils sont munis de porcelaines rondes blanches, et le reste est teinté en fonction du plan sonore : blanc pour le grand-orgue, vert pour le récit, et rose pour la pédale. Comme souvent chez Link, le nom des jeux est préfixé par le plan sonore (par exemple "I.M. Gedeckt 8'"). Claviers blancs.
Commande des accouplements et tirasses par pistons à accrocher, disposés au centre sous le premier clavier, et repérés par des porcelaines rondes. Commande du tutti par piston. L'annulateur est un piston rouge, sans porcelaine. Cette disposition est d'origine.
Il n'y a qu'une commande à pied : la pédale basculante de l'expression du récit, toute à droite. Comme souvent sur les orgues Link, la plaque d'adresse est constituée de plusieurs éléments. Il y a deux plaques rectangulaires noires à lettres dorées, en haut et de part et d'autre de la console. L'écriture est italique. A gauche :
Et à droite :
Une porcelaine blanche rectangulaire, placée à droite :
 Les plaques d'adresses Link à Bust.
Les plaques d'adresses Link à Bust.Pneumatique tubulaire (notes et jeux). D'excellente qualité, et très agréable à jouer.
Les sommiers sont à cônes (Kegelladen) et chromatiques. Le grand-orgue est à l'avant, derrière la façade, et le récit logé dans une niche à l'arrière.
La tuyauterie est très belle, et d'excellente qualité. Caractéristiques de la facture de Giengen sont les calottes des bourdons immobilisés avec de grandes feutrines. Jeux ouverts à entailles de timbre. Biseaux à dents. Poinçon au-dessus des bouches, et, pour les Bourdons, au-dessus des calottes. De nombreuses bouches sont arquées, et l'usage d'arcs sur la lèvre supérieure semble suivre une grande recherche : dans la Mixture-Cornet, les rangs de Quinte et de Tierce ont des bouches arquées, alors qu'elles sont droites pour le rang de 2'.
 Une vue sur les aigus du grand-orgue.
Une vue sur les aigus du grand-orgue.La façade est vers le haut de l'image, le fond de l'orgue en bas.
De bas (accès) en haut : la Mixture-Cornet 3 rangs,
le Bourdon double, l'Octave 4', la Gambe, le Salicional,
et le Principal, dont une partie est en façade.
 Une vue sur les aigus du récit.
Une vue sur les aigus du récit.Ces tuyaux sont logés dans une niche voûtée, à l'arrière de du buffet.
L'avant de l'orgue est en bas à droite. (On distingue les jalousies
donnant sur le corps du buffet où se trouve le grand-orgue.)

C'est un instrument extrêmement attachant ! Ces orgues de la Belle époque qui sont restés authentiques constituent décidément des pièces maîtresses de notre patrimoine. Cela confirme l'intérêt qu'il y aurait à disposer d'une action concertée pour redonner leur cohérence à ceux qui ont été victimes la vague "néo-baroque". De nombreux, en effet, ont vu plusieurs de leurs jeux romantiques "recoupés", et il n'est pas simple de trouver les ressources nécessaires pour réparer ces altérations. Mais ici, il n'y a rien eu de tel : l'instrument est resté authentique, et, s'il avait "beaucoup servi" avant 2014 (c'est tout à son honneur), le récent et exemplaire relevage lui a redonné tout son charme.
![]() Activités culturelles :
Activités culturelles :
- : La fanfare de l'église de Bust (Posaunenchor Bust) est très active ; l'orgue participe souvent à ses concerts annuels, et certaines de ses prestations ont contribué aux collectes pour le relevage de 2014.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 27/04/2019
Remerciements à Mme la pasteure Marguerite Niess-Grillet.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 29/04/2019.
Photos du 27/04/2019.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 45a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 3, p. 93
- [PMSLINK] Pie Meyer-Siat : "Die Arbeiten der Firma Gebrüder Link (Giegen/Brenz) im Elsass", in "Mundus Organorum, Festschrift Walter Supper", éditions Merseburger, Berlin, 1978, p. 255
- [PMSCS77Bust] Pie Meyer-Siat : "L'orgue Wetzel de Bust", in "Pays d'Alsace ('Cahiers de Saverne')", vol 98., éditions Société d'histoire et d'archéologie de Saverne et environs, 1977, p. 17
-
[PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 693-4
On peut malheureusement lire dans cet article : "En 1912, l'église fut reconstruite et inaugurée le 1. 9. 1912. On en profita pour faire pneumatiser l'orgue par Link". C'est faux : l'orgue Link était totalement neuf ; seul le buffet de l'ancien orgue a été a été conservé. Une fois de plus, l'utilisation de ce terme péjoratif "pneumatisation", répété à tort et à travers par la vieille organologie de la fin du 20ème siècle, s'accompagne de confusions et d'approximations, et surtout d'une évidente volonté de discréditer le patrimoine issu des années 1871-1918. Regrettable.
- [PMSRHW] Pie Meyer-Siat : "Valentin Rinkenbach, François Ignace Hérisé, les fils Wetzel, facteurs d'orgues", éditions Istra, p. 195
![]() Localisation :
Localisation :