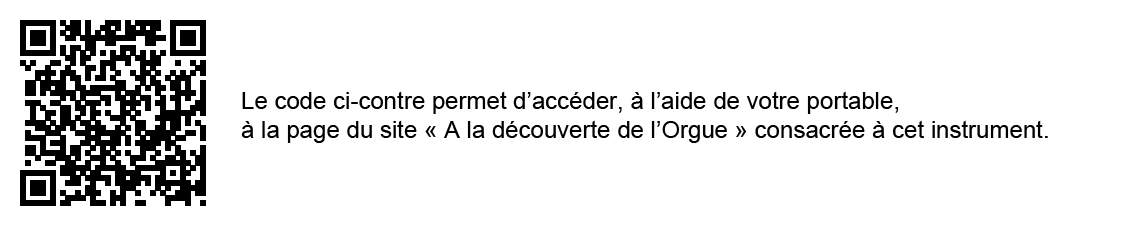Buffet classé Monument Historique, 18/12/1992.
Orgue entièrement authentique.
 Burnhaupt-le-Haut, l'orgue Georges Schwenkedel, le 22/08/2014.
Burnhaupt-le-Haut, l'orgue Georges Schwenkedel, le 22/08/2014.Cet orgue de Georges Schwenkedel, son opus 43, est doublement remarquable. D'abord par son étonnant buffet en forme de lyre, dessiné par Paul Gelis, l'architecte de l'église, en totale harmonie avec l'exceptionnel cadre "années 30" de l'édifice. Ensuite par la remarquable qualité de la partie instrumentale. Tandis que les mouvements économiques et politiques qui allaient faire basculer le monde dans l'horreur se développaient inexorablement, certains artistes, comme Georges Schwenkedel continuaient à exprimer leurs valeurs, avec un talent exceptionnel. Après 1945, survint un grand rejet de tout ce qui avait précédé les années noires. 70 ans plus tard, les conséquences de ce rejet sur notre connaissance du patrimoine des années 30 se font toujours sentir : cette période pourtant féconde de l'histoire de l'orgue est encore très mal connue. Du coup, son étude livre de bien belles surprises. Voici un orgue exceptionnel, atypique, qui est en quelque sorte l'aboutissement d'une pensée esthétique, issue du romantisme, et enrichie de façon talentueuse, et toujours raisonnée.
1805
Historique
Le premier orgue de Burnhaupt-le-Haut a été construit en 1805 par Grégoire II Rabiny. [IHOA]
1858
Historique
Il fut remplacé en 1858 par Claude-Ignace Callinet. [IHOA]
L'instrument était d'un style résolument novateur : le projet comprenait par exemple une tirasse, même si celle-ci n'a sûrement pas été réalisée au final. Le procès-verbal de réception est signé par Jean Chrysostome Dietrich (que l'on retrouve à Rimbach-Zell, Zimmersheim ou Balschwiller) et Charles Kientzl. L'instrument disposait d'une console indépendante en 1858, soit 5 ans avant l'orgue de Moosch. Dans le même procès-verbal, le tempérament utilisé par Claude-Ignace, visiblement plutôt inégal, a été critiqué. L'instrument devait être très fourni en jeux d'anches, car, toujours dans le même texte, on trouve : "L'expérience atteste que les jeux d'anches, vu leur sensibilité aux moindres changements de température, ne peuvent être convenablement employés que les trois quarts de l'année. En conséquence, les experts voient toujours avec peine le [illisible] de ces jeux, et regrettent que leur prix onéreux ne soit consacré à des jeux de tons bien plus dignes et d'un usage perpétuel".
Cette remarque est révélatrice de l'évolution dans les goûts esthétique, et de la frustration des organistes. De fait, dans les années 1850-1870, le monde de l'orgue alsacien souffrait d'un réel atavisme, produit par un conservatisme forcené des facteurs et des commanditaires (et aussi, probablement, par le "confort" d'un marché facile). On continuait à construire des orgues comme dans l'immédiat après-révolution (en gros, des grands Cornets décomposés additionnés d'un étagement de Principaux et d'anches râpeuses). Ceci sans tenir compte ni des évoluions du répertoire, ni des progrès apportés par la facture d'orgues "étrangère", en particulier ceux venus d'Angleterre. Claude-Ignace Callinet semble avoir été parfaitement conscient de la nocivité de ce repli-sur-soi. Mais il y a fort à parier que ses quelques propositions innovantes (tirasse ?) l'ont souvent fait passer pour un dangereux et subversif activiste...
L'orgue Callinet a été réparé en 1893 par Max Klinger de Rorschach. [Barth]
Situé en plein sur la ligne de front dès l'automne 1914, le village entier fut détruit par faits de guerre, et l'église incendiée le 16/07/1915, (deux jours après celle de Burnhaupt-le-Bas). Dans les décombres de l'église, on découvrit quelques statues. Celle de Saint-Sébastien, placée depuis 2006 contre le mur à droite du chœur, provient de l'ancien édifice. Elle date du 17ème. L'église a été reconstruite en 1928, sur les plan du talentueux architecte Paul Gelis, dans un style éclectique alliant le néo-roman et l'Art Déco. Les fonds baptismaux ont été fournis par Klem, les vitraux par la maison Ott, et le chemin de croix par Berger-Rudloff. La première messe a lieu dans la nuit de Noël 1929. Manquait encore un orgue d'exception. Mais pas pour longtemps. [IHOA] [Visite]
Historique
C'est en 1932 que Georges Schwenkedel posa à Burnhaupt-le-Haut son opus 43. [IHOA]
Cet instrument est contemporain de deux autres "figures" de l’œuvre de Georges Schwenkedel : Mutzig (1931-32) et Reiningue (1932, opus 46) (notons que les deux disposent d'une anche de 16' à la pédale). Le "prédécesseur" de cette prestigieuse lignée était probablement l'orgue strasbourgeois de l'église protestante du Stockfeld (1931, opus 42, qui dispose d'une console du même type). Il y a une version "3 claviers", à Durlinsdorf (1932, opus 40), encore plus étonnante puisque cet instrument dispose d'un positif de dos (mais on a peine à le qualifier de "néo-classique" !)
Il y eut une réparation en 1958. [IHOA]
En 1978, Laurent Steinmetz, "successeur" (techniquement) et ancien de la maison Schwenkedel, fit un relevage. [IHOA]
En décembre 1992, l'orgue et le buffet ont été classés monument historique (ils avaient préalablement été inscrits). [Palissy]
En 2001, il y eut un nouveau relevage, mené par Richard Dott. L'orgue était alors tenu par Fabien Schultz, qui avait succédé à son père Joseph. [IHOA] [AORM]
Fabien Schultz était verrier d'art, chef de chœur et organiste. Il œuvrait afin que la tribune du Schwenkedel soit et reste un lieu d'accueil.
Les travaux ont inclus un nettoyage général (tuyauterie, sommiers, buffet), redressement de certains tuyaux de façade qui s'étaient affaissés, le remplacement du moteur (l'ancien est conservé). La transmission pneumatique a été entretenue (remplacement des membranes), et des travaux ont été nécessaires à la charpente. [RDott]
Au printemps 2014, des insectes xylophages ont attaqué le buffet et la partie instrumentale (dans un laps de temps très court). Heureusement, la réactivité a été exemplaire, et un relevage et une mise en sécurité a pu être menée à temps, par Richard Dott. [Visite]
Le buffet
 Un des deux anges monumentaux supportant la lyre.
Un des deux anges monumentaux supportant la lyre.Il faut reconnaître qu'ils font le boulot les atlantes de l'orgue classique avec une certaine élégance !
Dessiné par Paul Gelis, le talentueux architecte de l'édifice, ce buffet exceptionnel a été réalisé par Raphaël Brutschi (Ribeauvillé). On a pu lire dans certaines sources qu'il a été construit par la maison Klem, et que "la plupart des tuyaux de montre sont muets". La seconde affirmation est à coup sûr fausse : seuls les 12 plus petits tuyaux sur les côtés ne sont pas sonores : le reste de la façade parle bel et bien. [AORM] [Palissy] [Visite]
Caractéristiques instrumentales
Schwenkedel a souvent appelé "Occarina" (avec deux "c") sa Flûte conique 2'. On retrouve une pareille dénomination à Grentzingen (1931), Reiningue (1932), Burnhaupt-le-Bas (1934) et le malheureux orgue de Rimbach-près-Guebwiller (1936). Schwenkedel plaça aussi ce jeu à Bettlach en 1942.
 La console, dans sa belle ambiance, un peu "belle voiture anglaise".
La console, dans sa belle ambiance, un peu "belle voiture anglaise".Console indépendante dos à la nef (c'eut été dommage de tourner le dos à ce buffet !), fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos (peu inclinés : ils sont presque horizontaux au repos) munis de pastilles avec un code de couleur repérant le plan sonore : blanc pour le grand-orgue, jaune pour la pédale, et rose pour le récit. Accouplements et tirasses (sauf I/I 4') sont donc bicolores. Chaque domino est surmonté d'un picot rouge permettant de programmer la combinaison libre (les accouplements peuvent donc y être programmés). Claviers blancs à joues galbées. Commande doublée des accouplements (alla "congrès de Vienne"), par pédales-cuillers en fer, à accrocher. Ordre des pédales de gauche à droite :
II
❍
I
❍
I
❍
II-I
❍
II-I
❍
❍
Vient ensuite la pédale basculante du crescendo (sic, à gauche de l'expression) puis la pédale basculante de l'expression du récit, et enfin la cuiller du trémolo du récit.
Commande des accessoires de registration par poussoirs blancs, cylindriques, placés sous le premier clavier:
Jeu à comb
Combinaison [porcelaine décollée]
Crescendo
Anches
P.
MF.
F.
TT.
Annul.
Cadran de crescendo linéaire, gradué jusqu'à 12, situé en haut et au centre de la console.
 Les plaques d'adresse.
Les plaques d'adresse.La "plaque d'adresse" est ici constituée de 3 porcelaines rectangulaires. La première est située à gauche des dominos :
Manufacture de Grandes Orgues
STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN
Les deux autres, situés à droite des dominos, donnent l'année et le numéro d'opus :
Cette console est très voisine de celle de l'église protestante du Stockfeld (opus 42).
 Les dominos, presque horizontaux, comme à Neudorf.
Les dominos, presque horizontaux, comme à Neudorf.Les sommiers, à membranes, sont tous diatoniques (pédale, grand-orgue, récit).
 Le grand-orgue.
Le grand-orgue.(Les 5 tuyaux du Basson n'ont pas été sortis pour la visite : l'orgue était phase finale de relevage et c'étaient, avec certaines jalousies du récit, les seuls éléments non encore remontés ; rappelons que cet orgue est Classé et dispose donc d'une protection légale. Dans le buffet, on "touche avec les yeux", donc. Comme pour les non-classés, d'ailleurs.)
Ordre des chapes, de gauche (accès) à droite (façade) : Basson, Cornet ("sur le vent", i.e. non posté), Nasard, Doublette, Bourdon 8', Bourdon 16', Spillflöte, Prestant, Montre.
Le récit est logé en arrière, environ 1m plus haut que le grand-orgue. La boîte expressive a des "tourelles" latérales. Jalousies frontales.
La pédale est placée sur les côtés, orthogonalement à la façade.
Un grand réservoir à plis dans le soubassement, moteur du côté gauche. Le réservoir est lesté par des briques emballées dans du papier journal, selon une habitude commune dans la première moitié du 20ème.
Tous les journaux ne sont pas d'origine : on y trouve le faire-part de décès d'un administrateur des sources Carola, qui avait rejoint le conseil en 1958.
Le système de pompage a pied, situé sur le flanc gauche de l'instrument, est conservé (mais il n'est pas opérationnel).
 Gros-plan sur les cinq tuyaux du Basson. Ils sont de construction très spécifique.
Gros-plan sur les cinq tuyaux du Basson. Ils sont de construction très spécifique.La tuyauterie est de très belle facture, et clairement romantique de conception. Les Principaux ont des encoches d'accord. Les anches sont plutôt "françaises", sauf le Basson du grand-orgue, qui est très original car couvert par un opercule, et ouvert seulement par une fenêtre horizontale pratiquée dans la partie conique. Il y a du Walcker dans la "Jubalflöete", et l'ensemble est d'une harmonie très distinguée.
 L'église abrite d'autres trésors, comme cette statue de Saint-Sébastien, du 17ème sauvée de la guerre. Bon nombre ont été voulus par Joseph Muller, curé lors de la reconstruction. Les vitraux figurent la vie de Saint Jean-Baptiste, la Vierge Marie, la Nativité, le Christ-Roi, et un saisissant ensemble de trois baies est consacré à la Genèse. Ce patrimoine fut encore enrichi après 1930 : une statue de la Vierge a été sculptée par Erny vers 1970 à la demande du curé Martin Studer, et Fleur Nabert a livré sa statue de Saint-Boniface (auquel l'église est consacrée) en 2009.
L'église abrite d'autres trésors, comme cette statue de Saint-Sébastien, du 17ème sauvée de la guerre. Bon nombre ont été voulus par Joseph Muller, curé lors de la reconstruction. Les vitraux figurent la vie de Saint Jean-Baptiste, la Vierge Marie, la Nativité, le Christ-Roi, et un saisissant ensemble de trois baies est consacré à la Genèse. Ce patrimoine fut encore enrichi après 1930 : une statue de la Vierge a été sculptée par Erny vers 1970 à la demande du curé Martin Studer, et Fleur Nabert a livré sa statue de Saint-Boniface (auquel l'église est consacrée) en 2009.
![]() Webographie :
Webographie :
- http://www.burnhaupt-le-haut.com : La revue "le trait d'union" de Juin 2009, disponible en PDF consacre un article au 80ème anniversaire de l'église et aux festivités correspondantes.
![]() Activités culturelles :
Activités culturelles :
- 05/07/2009 : Fans le cadre du festival de Masevaux "hors murs", concerte avec le choeur mixte du conservatoire de Colmar sous la direction de Catherine Fender et Gilles Oltz aux claviers.
- 29/07/2009 : Concert à plusieurs intervenants, dans le cadre du "80ème anniversaire" de l'église.
- 11/07/2012 : Dans le cadre des "Orgla Owa im Dollerthal", hommage musical à Fabien Schultz, par Vincent Affholder (Burnhaupt). Oeuvres de J.S. Bach, Philip Glass, et improvisation.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 22/08/2014
Remerciements à Vincent Affholder.
-
[RDott] Richard Dott :
Données techniques.
- [VAffolder] Vincent Affholder : e-mail du 07/09/2014.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 44b
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 64-5
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 168
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im68008126
- [AORM] ""A propos d'orgue..." le journal de l'Association des Organistes de la Région de Mulhouse", p. 15-6, 10-11/2001
-
[FComment] François Comment : e-mail du 18/08/2005.
Photos de 2005 (buffet et console).
-
[PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 323-5
Pour mémoire seulement. L'étude de l'orgue actuel a été tellement "survolée" que sa console est dite "électrique".
![]() Localisation :
Localisation :