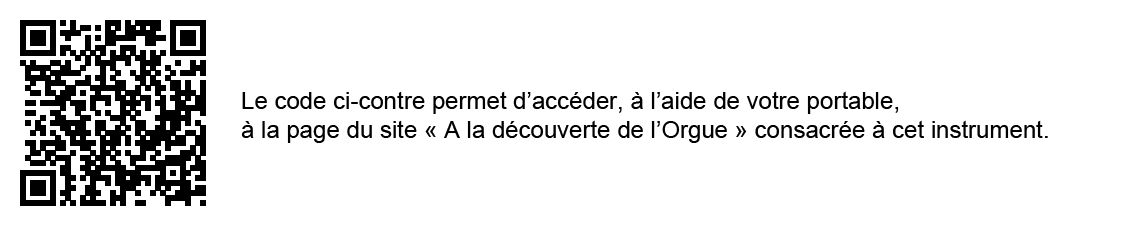L'orgue Claude-Ignace Callinet de Moosch.
L'orgue Claude-Ignace Callinet de Moosch.Les photos sont de Martin Foisset, 14/03/2020.
En quelques années (1860-1863), Claude-Ignace Callinet a complètement changé de style. Dans son buffet néo-gothique réalisé par Jean-Baptiste Klem (le père de Théophile ; c'est une des dernières œuvres), cet orgue ne ressemble déjà pas extérieurement à un Callinet. Mais le buffet n'est qu'une facette de ce renouveau. C'est un Callinet "tardif" (Claude-Ignace posera son dernier instrument neuf en Alsace en 1866), comme il n'y en a que très peu, car l'ouverture au romantisme fut, en Alsace, très tardive.
1863 (instrument actuel)
Historique
C'est en 1863 que Claude-Ignace Callinet posa cet instrument, qui est finalement (et malgré la date tardive de 1863) un des premiers orgues romantiques construits en Alsace. [PMSCALL]
Bien sûr, on distingue "construits en Alsace" (réalisés par des facteurs locaux) et "d'Alsace" : l'acte fondateur du romantisme en Alsace est dû à Eberhard Friedrich Walcker et à son commanditaire, Aimé Philippe Roman, qui, au cours de ses voyages, avait entendu des orgues "différents" et enthousiasmants. Le résultat fut un jalon majeur dans l'histoire de l'Alsace : l'instrument de Husseren-Wesserling, posé en 1857. Et celui-ci avait déjà 6 ans quand Claude-Ignace Callinet posa celui de Moosch.
Le devis est daté du 04/04/1861, et Joseph Heyberger (Mulhouse, St-Etienne) en assura la réception le 01/08/1863. A l'origine, deux chapes n'avaient pas été pourvues de tuyaux, et le récit n'avait pas sa boîte expressive. Mais il y avait une console indépendante. [IHOA] [Barth]
La console indépendante
Ce n'était pas la première console indépendante construite par Claude-Ignace Callinet, puisqu'il en a réalisé une à Burnhaupt-le-Haut en 1858. C'était peut-être même la troisième, car on ne sait plus très bien quand celle de Habsheim a été posée (1859, 1863 ou plus probablement 1935). En tous cas, ce n'est de loin pas la première console indépendante d'Alsace, car Valentin Rinkenbach en avait construite une dès 1842 pour son orgue du Bonhomme.
La facture d'orgues alsacienne sortait de son atavisme, après avoir passé des décennies dans une ère post-classique qui n'en finissait pas - sûrement parce que le marché, énorme, rendait les choses trop faciles pour les facteurs.
Un orgue évalué bien bas... dans les années 1960
Ce qui est intéressant, c'est la façon dont les "commentateurs" des années 1960 ont évalué cet instrument. Pie Meyer-Siat, dans son étude sur les Callinet, n'y va pas par quatre chemins : "[...] cette commune aurait mérité mieux qu'une œuvre aussi décadente sous son masque de progrès - car il est évident que l'orgue de Moosch fut un orgue dernier cri - ; elle aurait mérité mieux que les cinq ans de garantie elle aurait mérité mieux que de servir de cobaye pour un nouvel essai de console ind. ; elle aurait mérité mieux que l'hypocrisie d'un positif qui n'a de positif que le nom." (Suit la composition de l'instrument "décadent".)
Ce que reproche Pie Meyer-Siat à l'orgue de Moosch, ce n'est pas d'être inadapté, fragile, ou mal conçu : ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas être conforme à ses canons à lui. Et donc, seulement le fait d'être différent des orgues de Joseph Callinet, le frère aîné, ultra-conservateur et donc adulé. En fait, il reproche à l'orgue Moosch, construit en 1863, de ne pas être comme ceux de 1830 ! Dans les détails, la "décadence" vient de l'absence de Cornet (ceci étant qualifié d' "impardonnable"), de 4' de pédale, de Mutations, et de Principal au "positif". S'il est vrai que Claude-Ignace Callinet appelle "positif" son second clavier, c'est probablement parce que le mot "récit" risquait d'être mal compris par les intervenants de l'époque. Mais ce second clavier est totalement un récit, complet, avec ses deux Flûtes harmoniques, son Salicional et son Basson-Hautbois. D'ailleurs, c'est bien le clavier du haut.
En fait, l'orgue de 1863 n'était pas de "dernier cri" : il était privé d'expression, de tirasse, avait une Fourniture à 5 rangs, et était surtout gravement limité par une pédale de 20 notes seulement (reliquat de l' "orgue à instituteur" de la première moitié du 19ème, quand le pédalier de 18 notes ne servait qu'à marquer les cadences, le plus lourdement possible). En 1866, Joseph Merklin posa à Dambach-la-Ville un orgue que l'on pourrait peut-être qualifier de "dernier cri" (et encore...), mais il y a un monde entre l'orgue de Dambach - authentiquement symphonique - et celui de Moosch - effort fort louable de Claude-Ignace Callinet pour sortir enfin l'Alsace de l'atavisme. Il est vraiment injuste d'avoir critiqué Claude-Ignace Callinet pour avoir livré un instrument aussi réussi.
Pourquoi est-ce important ? Parce que ces ouvrages des années 60 ont "formaté" l'organologie alsacienne, parfois même jusqu'à aujourd'hui. Un petit nombre de spécialistes auto-proclamés avaient décidé ce qu'était un "bon" orgue (clairement : un orgue classique du 18ème ou y ressemblant), et qualifiaient de "décadent" tout ce qui s'en écartait. Le problème, c'est que ces évaluations complètement arbitraires ont décidé de l'avenir de beaucoup d'instruments, ce qui causa la perte de dizaines d'orgues de grande valeur, remplacés, abandonnés, ou affublés de jeux "baroques" pour se confirmer aux diktats des années 60. Un fait est révélateur : l'orgue de Moosch est aujourd'hui affublé d'un Cornet, parce que son absence avait été déclarée "impardonnable", alors que justement, Claude-Ignace Callinet avait voulu pour Moosch un orgue sans Cornet !
La rhétorique consistant à "victimiser" la commune de Moosch (qui n'en avait pas demandé tant), qui se serait retrouvée prise au piège de quelque complot progressiste est particulièrement étrange. On voit mal ce qui permet à l'auteur de déclarer que Moosch se serait "fait avoir", et que l'orgue est mauvais ou ne donne pas satisfaction. Cela sous-entend que les commanditaires, à l'époque, étaient des idiots. Or, l'instrument actuel est tout à fait réussi ! Il a de plus rempli vaillamment son rôle pendant presque 160 ans, et les quelques défauts qu'on peut lui trouver ne résident pas dans un progressisme acharné, mais plutôt dans un conservatisme mal placé. Il est clair que Claude Ignace Callinet savait qu'il fallait évoluer, mais qu'il n'était pas tout à fait à l'aise avec les nouvelles techniques. Avec un retard aussi considérable, il ne pouvait tout changer à la fois.
Il faut noter que tout ceci était antérieur à 1870. Et pourtant, cela n'empêcha pas le monde de l'orgue de la fin du 20ème de situer le début de la "décadence" de l'orgue alsacien au moment où celle-ci devint allemande... Clichés, mauvaise foi, approximations, lieux communs, le tout allait durablement affecter la facture d'orgue alsacienne, et conduire à un véritable désastre patrimonial.
L'instrument a été complété en 1901 par Joseph Antoine Berger. [IHOA] [ITOA]
Un Dolce (au grand-orgue) et une Voix céleste (au récit), compléments logiques de l'instrument inachevé, prirent place sur les deux chapes laissées libres en 1863. Le récit a été rendu expressif, et le buffet a été reculé de 80cm. [IHOA] [ITOA]
A la tribune se trouve une photo encadrée de René Koenig (1901-1974) qui fut organiste à Moosch de 1927 à 1974. [Visite]
En 1974, c'est Curt Schwenkedel qui ajouta ce qui manquait encore à l'instrument : une tirasse. Il procéda aussi au remplacement du pédalier, pour en placer un plus conventionnel de 30 notes. (Celui d'origine, à 20 notes, devait être impraticable.) Bien entendu, les marches ajoutées (gis-f') ne fonctionnent qu'en tirasse, vu qu'il n'y a pas de complément au sommiers de pédale. [IHOA] [ITOA]
C'est probablement au cours de cette opération que le malheureux Dolce de Berger a été supprimé, pour y placer LE jeu qu'il ne fallait pas dans cet instrument : un Cornet. Rappelons que cet orgue avait été délibérément conçu sans, et qu'il constitue un total contre-sens. De plus, à la console, la porcelaine "Dolce" a été conservée : pour l'organiste non averti, la (mauvaise) surprise est grande... De plus, la commande de la boîte expressive a été supprimée ! Sa pédale commande à présent la tirasse : quel dommage de mutiler un orgue pour économiser les quelques sous d'une pédale à accrocher ! [Visite]
Le buffet
 Les impressionnants couronnements du buffet,
Les impressionnants couronnements du buffet,et la façade d'origine.
Le buffet, de style néo-gothique, est l'œuvre de Jean-Baptiste Klem (1816 - 1863). Il rappelle que c'est bien lui qui a introduit le style néo-gothique à la célèbre maison de Colmar, et non son fils Théophile. Trois tourelles, la plus grande au centre, sont séparées de deux plates-faces doubles. (Comme beaucoup d'orgues Rinckenbach, si bien que celui de Moosch a longtemps été attribué à la grande maison d'Ammerschwihr.) Chaque demi plate-face est munie d'un tympan ajouré et d'un fleuron, et les couronnements des tourelles sont très développés, avec crochets et l'essentiel du langage ornemental du style néo-gothique. La chaire est d'ailleurs du même style (elle est aussi de Jean-Baptiste Klem), et le buffet forme un tout avec sa tribune, ornée de deux anges lisant un rouleau de parchemin. [Barth]
 "On n'entend pas sa voix profonde et solitaire
"On n'entend pas sa voix profonde et solitaireSe mêler, hors du temple, aux vains bruits de la terre"
Les tuyaux de façade sont d'origine.
Ce n'est pas le premier buffet néo-gothique construit pour un orgue Callinet : celui de Riom (Auvergne) date de 1838, celui de Montbrison (Loire) de 1842, celui de Liverdun (Meurthe-et-Moselle) de 1847. En Alsace, il y a celui de Rimbach-près-Masevaux (1851), et bien sûr Rouffach (1855).
Caractéristiques instrumentales
 Voici cette fameuse console indépendante,
Voici cette fameuse console indépendante,qui suscita l'ire des commentateurs du 20ème siècle.
Dans ses proportions, elle s'écarte beaucoup de ce qu'on a l'habitude de trouver.
(Profondeur très importante, largeur peu ergonomique,
tirants de section carrée au lieu de ronde.)
Mais même comme ça, avouons que c'est quand même mieux
que de jouer de l'orgue avec la tête dans une armoire...
Console indépendante face à la nef, fermée par un couvercle basculant. Tirants de jeux de section carrée (sic) à pommeaux munis de porcelaines, disposés en trois gradins de part et d'autre des claviers. Leur disposition est totalement chaotique. Claviers blancs, récents. Les joues des claviers, rectilignes, ont l'air récentes aussi. Pédalier de 1974.

Doublette
Gambe
8
Montre
8
Trompette
8
Flûte
de 4
Prestant
4
Salicional
Flûte
Octaviante
Voix
cèleste
Flûte
16
Violon
8
Ophycléide
16
Accouplage
❍
Flûte
8
❍
Sonnette
Flûte
harmonique
Flûte à
Cheminée
Trombonne
8
Bourdon
8
Dolce
8
Basson
Hautbois
❍
Bourdon
8
Bourdon
16
Fourniture
FLUTE
HARMONIQUE
8'
Le graphisme des porcelaines n'est pas homogène. Les deux tirants de Berger (Voix céleste et Dolce, ce dernier commandant un Cornet...) sont facilement identifiables. Ils sont identiques à ceux de Martin Rinckenbach. Celui de la Flûte harmonique 8' est écrit en majuscules. La "Sonnette" (appel souffleur) figure en vert, comme un jeu de pédale. A noter que Callinet appelle toujours "Ophycléide" sa Posaune.
Pas de plaque d'adresse.
Banc à pieds en "h" (dont les pieds vont en s'élargissant).
Mécanique à équerres.
Sommiers à gravures, de 1863.
 Une vue sur le sommier droit des aigus du grand-orgue.
Une vue sur le sommier droit des aigus du grand-orgue.d'en bas à gauche (accès) vers en haut à droite (revers de la façade) :
la Trompette, la Fourniture à 5 rangs, la Doublette,
le Principal 4', la Flûte 4', le Bourdon 8', la Gambe,
le Bourdon 16', et la Montre 8'.
 Une vue sur la tuyauterie du récit.
Une vue sur la tuyauterie du récit.De bas (avant et accès) en haut (fond de l'orgue) :
le Hautbois, la Voix céleste, la Flûte à cheminée 4',
la Flûte octaviante 4', le Bourdon 8',
le Salicional, et la Flûte harmonique 8'.
 Il s'agit du tirant d'accouplement II/I.
Il s'agit du tirant d'accouplement II/I.Les caractères sont rouges, comme pour un jeu du second clavier,
alors que II/I est plutôt considéré comme entrant dans la composition du I.
C'est tout de même émouvant : il s'agit d'une des premières manifestations du romantisme alsacien ; certes un peu timide, n'osant pas appeler "récit" un récit, tâtonnant un peu pour certains détails. Mais justement, cela confirme que du 18ème siècle aux années 1950, l'Alsace n'a jamais copié, jamais imité, mais a toujours voulu donner une version locale, spécifique, aux grands courants culturels. Dans la forteresse alsacienne de l'orgue des années 1860, des choses aussi simples qu'un accouplement des claviers ou une tirasse, c'était visiblement toute une histoire ! Avec des solutions à imaginer, des nouveaux mots à inventer... "Faire comme ailleurs" oui, mais à sa façon. Reste qu'il n'est pas toujours pertinent de chercher à ré-inventer la roue.
Cet instrument n'a pas été bien vu par les commentateurs "historiques", qui l'ont évalué bien bas suite à un malentendu (et, il faut bien l'avouer, une vision partisane parce que fort lacunaire de l'orgue). Il est donc temps de l'approcher sans a-priori. Ici, Claude-Ignace Callinet "s'est lancé". Il a fait preuve de courage, et a su relever les défis. Finalement, pour lui, il était déjà bien trop tard pour "faire école", et son fils Louis-François n'a sûrement jamais eu l'envergure pour continuer sur cette voie. D'ailleurs, quand celui-ci s'établit officiellement avec son père, ce fut à Vesoul, pas en Alsace.
L'orgue de 1863 est ici complet (au sens que tout ce qui y était à l'origine est toujours là, à l'exception des claviers et du pédalier). Heureusement, il a bénéficié de compléments (Voix céleste, pédalier) qui en font un instrument pleinement exploitable. Il n'est pas dénué de défauts (le plus évident étant le caractère chaotique de la disposition des tirants à la console, cet absurde Cornet... et cette belle pédale qu'on enrage de voir limitée à 20 notes), mais rien que la beauté de ses Flûtes les font vite oublier.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 14/03/2020
Remerciements à Jacques Rahm.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 24/03/2020.
Photos du 14/03/2020.
-
[YMerlin] Yannick Merlin : e-mail du 04/12/2003.
Photo de la console.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 116a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 251
- [PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 338-42
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 264-5
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im68006455
![]() Localisation :
Localisation :