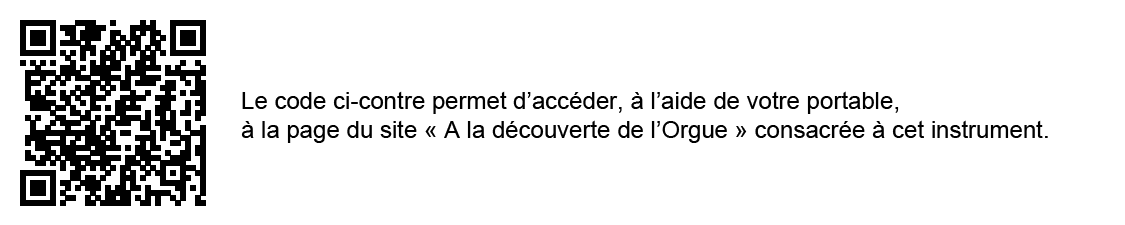Husseren-Wesserling, l'orgue Walcker de l'église catholique.
Husseren-Wesserling, l'orgue Walcker de l'église catholique.Les photos sont de Martin Foisset, 02/08/2019.
L'orgue de Husseren-Wesserling marque une étape fondamentale de l'histoire de l'orgue en Alsace. Son arrivée, en 1857, fut un événement majeur. Un de ceux qui "changent la donne" pour toujours. Depuis la Révolution, le monde de l'orgue alsacien était régi par un petit nombre de facteurs locaux, qui pratiquaient un style "post-classique" (ou "pré-romantique", selon la façon de voir les choses). Les communautés voulant acquérir un orgue s'adressaient naturellement au facteur en charge de leur secteur, qui leur fournissait l'instrument "qu'il leur fallait". L'orgue était alors essentiellement utilitaire, et avait une mission unique : accompagner les offices.
Mais Philippe Roman voyageait, et avait entendu des orgues "différents", qui ne manquaient pas d'allure. Les facteurs alsaciens, à commencer par les Callinet (dont la vallée faisait normalement partie du "périmètre naturel") étaient totalement incapables de réaliser un instrument dans ce style nouveau. Alors, il choisit de s'adresser directement au leader de la facture européenne dans les années 1850 : Walcker, de Ludwigsbourg.
Historique
En 1857, la maison Eberhard Friedrich Walcker plaça à Husseren-Wesserling son opus 124, le premier orgue romantique d'Alsace. [IHOA] [ITOA] [HOIE] [Barth]
Jusqu'à la Révolution, Husseren et Wesserling faisaient partie de la commune de Mollau. En 1762, s'installa à Wesserling une fabrique d'indiennes, initiant par là la future activité textile qui prospéra durant tout le 19 ème siècle. Cette partie de la vallée resta cependant desservie par la paroisse de Mollau jusqu'en 1856, quand, face à l'expansion démographique, fut créée une paroisse indépendante. La famille Gros-Roman, propriétaire de l'usine textile de Wesserling paya une église, dont la construction débuta en 1854 et qui fut consacrée le 19/10/1856. Les plans étaient de Joseph Langenstein (natif de Ranspach). Bien sûr, Aimé Philippe Roman voulut doter cette église neuve d'un orgue adapté. [HOIE] [Palissy] [Barth]
Il voulait un instrument de son temps : avec des jeux compatibles avec le répertoire romantique, des sommiers à cônes, et une console "retournée" (c'est-à-dire indépendante, où l'organiste ne fait plus face à son instrument, mais à son public). Puisque'on s'était adressé à un facteur bâdois, et qu'il n'existait pas encore de style romantique alsacien, il est logique que sur ses quinze jeux, seulement deux étaient à anches. Dont le fameux Basson à anches libres de pédale, ce qui renforçait considérablement le côté "esthétique germanique" de l'ensemble. [YMParisAlsace]
Par rapport à la composition actuelle, on note évidemment la disparition de la Physharmonica. La Trompette était au grand-orgue, qui n'avait quand même que 7 jeux, puisque le Dolce n'était pas là. Le récit n'était pas expressif, mais il y avait sûrement une pédale d'expression à la console, pour la Physharmonica.
En 1860, Edouard Mertké participa à la réception de l'orgue de Ranspach. Pianiste virtuose et professeur de musique à Wesserling, il fut le premier organiste de cet instrument. ("Courrier du Bas-Rhin", 01/11/1860.) [YMParisAlsace] [PMSMERKLIN]
L'impact fut considérable. Pour la maison Walcker en Alsace, cela continua à Mulhouse (église réformée St-Etienne) en 1866. Mais la région de St-Amarin montra dès 1860 que l'orgue de Husseren n'allait pas être un phénomène isolé : à Ranspach, on poursuivit non seulement dans la même voie (s'ouvrir aux facteurs européens majeurs), mais en plus en faisant le choix de la diversité, puisque ce fut Joseph Merklin (Paris) qui fut retenu. La ville de Mulhouse ne pouvait pas rester spectatrice du renouveau culturel survenant dans les vallées : le 24/10/1860 fut inauguré le Cavaillé-Coll alsacien, à St-Etienne.
Les orgues Merklin de Blotzheim et Wintzenheim suivirent de peu (1861), et la même année, Merklin plaça de façon retentissante un orgue à Strasbourg : c'est celui de clinique de la Toussaint (malheureusement supprimé en 1968). En 1870, la chapelle protestante de Husseren-Wesserling reçut aussi son orgue Walcker, un petit bijou de 8 jeux.
Les théoriciens de l'orgue alsacien, complètement obnubilés par l'étayement de plus en plus problématique de leurs hagiographies des Silbermann et des Callinet, méprisèrent évidemment ce renouveau, initié alors de l'Alsace était encore française. Il fut évacué d'un dédaigneux revers de la main, les instruments correspondants étant qualifiés d'orgues élitistes. Or, c'était exactement le contraire ; la véritable portée du phénomène, c'était justement que le public et les acteurs culturels s'étaient intéressés à l'orgue qu'ils avaient payé !
Alors que l'on trouve parfois une encyclopedie en 6 volumes sur la moindre rondelle d'instruments du 18ème construits par des facteurs souvent de seconde zone, 100 fois bricolés depuis (mais quand même "Classés"), l'historique de ces premiers instruments romantiques est lacunaire, et même souvent incohérent : il mériterait pourtant vraiment que les Agrégés et les Docteurs y consacrent un peu de leurs temps, car c'est ici, à Husseren, que s'est écrite l'histoire de l'orgue alsacien. Le vrai, celui du public.
Il y eut une tranformation (au moins de la traction, vu qu'elle était mécanique à l'origine) à une date inconnue, mais probablement vers 1930. [Visite]
Une étiquette, placée dans l'orgue de Husseren en-dessous du revers de la façade indique des travaux par P. Huguin. A nouveau, la date est inconnue, mais on peut estimer qu'elle a dû avoir lieu après 1946. [Visite]
Huguin est intervenu en Alsace de 1947 à 1975. On ne sait pas qui a doté cet instrument d'une transmission pneumatique, et effectué les quelques changements de composition (suppression de la Physharmonica et déplacement de la Trompette au récit.)
Il se peut aussi que la console ait été placée à fleur de tribune à un moment. (En tous cas, elle n'était jamais en fenêtre.) Et comme le revers du panneau frontal actuel du buffet est en contreplaqué, il est probable qu'il y ait eu à un moment un accès frontal (comme à Scharrachbergheim-Irmstett). Dans ce cas, il semble que ce soit Huguin qui soit revenu à la disposition d'origine, remettant la console à sa place et rebouchant l'accès : son étiquette est juste au revers de ce panneau.
L'orgue aurait été nettoyé en 1946. [HOIE]
En 1994, il y eut des travaux, par Richard Dott. [IHOA]
Le buffet

Le buffet, magnifique tant par ses proportions harmonieuses que son ornementation raffinée, est de pur style néo-gothique. Il a dû faire sensation, en 1857, dans le paysage alsacien ! Cela correspondait à une aspiration du public : il est à comparer à celui que Claude-Ignace Callinet posa "chez lui", à Rouffach en 1855 (donc contemporain). La maison Stiehr, elle, en 1857, en était encore au style "Empire", comme à Gunstett, avec positif de dos. (Et pédalier de 18 notes...) Quand elle se mit (timidement) au néo-gothique, le fit avec des dessins très... différents (Urmatt, 1865).
On "admet" généralement que le premier buffet néo-gothique d'Alsace date de 1832, et qu'il est l'œuvre de Martin Wetzel (Walbourg). Mais il y a un monde entre le néo-gothique des années 1860-1890 et ce dessin, conçu à l'origine pour le chœur de la cathédrale de Strasbourg, dont l'architecte est fort probablement l'auteur. D'ailleurs, il ne fit pas "école", même pas dans la production de Wetzel. En fait, cela n'a rien à voir : les premiers "vrais" néo-gothiques de la maison Wetzel datent bien des années 1860 (Westhoffen). Comme la plupart des "dogmes" de l'organologie alsacienne, il serait temps d'examiner celui-ci objectivement.
Sur une tribune plutôt spacieuse, le buffet s'étend généreusement en largeur, sans y être étriqué. Il est constitué de trois groupes : un central et deux latéraux, évidemment symétriques. A son tour, chaque groupe a une structure triple :
- les éléments latéraux sont constitués d'une tourelle haute plate (ou, si l'on veut, une plate-face haute à tympan) flanquée de tourelles plus petites, en tiers-point, donc en léger encorbellement.
- la partie centrale est constituée d'une tourelle plate plus basse, flanquée de plate-faces triples.
Un premier projet (dont le dessin est conservé aux archives Walcker) est un peu plus restreint : chaque plate-face triple intermédiaire y est remplacée par une petite plate-face simple. De plus, une plus-value (acceptée) entre le devis originel et la facture correspond à une boiserie plus haute et des tuyaux de façade plus longs : les proportions ont été revues. [WOB]
Le nombre 3 semble jouer un fort rôle symbolique. Et il y a 13 éléments en tout, et le central (le seul à n'apparaître qu'une fois) porte une croix en couronnement. Fidèles aux canons du style, les couronnements sont constitués de pinacles à crochets, surmontés de fleurons. Les claires-voies, finalement sculptées, sont très ajourées. Une frise à motifs géométriques parcourt la ceinture du buffet.
Les tuyaux de façade sont d'origine, car la réquisition des montres d'orgues n'affecta pas la vallée. Les tuyaux, en étain, sont tous dotés d'un écusson rapporté. Il n'y a pas d'oreilles. Les tuyaux parlants (il y a de nombreux chanoines) ont des évidages arrières en ovales. [WOB]
Caractéristiques instrumentales
 Cette console est du même type que celle de la basilique Sts-Pierre-et-Paul
Cette console est du même type que celle de la basilique Sts-Pierre-et-Paulde Neuhausen auf den Fildern (opus 126, 1854).
Mais la plaque d'adresse est différente.
Elle est également voisine de celles de Loffenau (opus 126, 1856) ou de Wörth, opus 193.
Console indépendante face à la nef, fermée par un couvercle basculant. Intérieur en merisier. Tirants de jeux de section carrée, à pommeaux tournés noirs munis de porcelaines, disposés en deux gradins de part et d'autre de la console. Les porcelaines du grand-orgue sont blanches, celles du récit orange, et celles de la pédale bleu-vert.
Claviers blancs, joues moulurées.
Il y a un triant supplémentaire, en bas à droite, avec une porcelaine blanche. La pédale d'expression semble plus récente que le reste de la console. Elle a peut-être été réalisée par modification de l'expression de la Physharmonica originelle.
La plaque d'adresse, située au centre, entre les deux claviers, est en porcelaine (Ludwigsbourg était également réputée pour sa manufacture de porcelaines). Elle est ovale, blanche. En son centre figurent les armoiries de Walcker (il y a un cygne à la fois sur le blason et en couronnement) en bleu et rouge. Elle dit, en italiques :
op. 124 [Armoiries] 1856
Orgekfabrik in Ludwigsburg
 La plaque Walcker à l'église catholique de Husseren-Wesserling.
La plaque Walcker à l'église catholique de Husseren-Wesserling.Le cygne fait partie des armoiries de la famille Walcker depuis... 1270.
A l'origine mécanique, la transmission a été rendue pneumatique.
Les sommiers sont à cônes, et d'origine. Au fond se trouve la pédale et le récit (diatonique, en hauteur). Le grand-orgue est devant, sur deux étages. En haut, derrière la façade (donc à l'endroit habituel), et devant le récit, il y a la Montre 8', la Fugara 4', le Bourdon 8' et le Dolce 8'. En bas, devant la pédale, la Gambe 8', la Fourniture, et la Flûte conique 2'. Les jeux sont disposés chromatiquement, avec un grand ravalement.
La tuyauterie est de grande qualité, avec les caractéristiques communes aux orgues Walcker : Trompette aux pavillons évasés, bouches volontiers arquées, beaucoup de jeux coniques. Les Gambes ont des freins métalliques.
 Une vue sur la tuyauterie du récit.
Une vue sur la tuyauterie du récit.L'avant de l'orgue est à gauche (où sont les jalousies), le fond à droite.
De gauche à droite : le Nasard, la Flûte 4' en bois, le Salicional,
le Gemshorn 8' (conique), et la Trompette aux pavillons évasés.
La Trompette n'était pas au récit à l'origine.
 Voici le grand-orgue supérieur (4 chapes).
Voici le grand-orgue supérieur (4 chapes).Il est derrière la façade (dont le revers est à gauche), et devant le récit (ici à droite).
Les tuyaux de façade sont d'origine ; ceux qui parlent sont évidés à l'arrière
et munis d'un système d'accord (entaille) ainsi que de postages.
De gauche (façade) à droite : la Montre 8', la Fugara 4',
le Bourdon 8' en bois, le Dolce 8'.
 Voici le grand-orgue inférieur (4 chapes).
Voici le grand-orgue inférieur (4 chapes).A gauche, le revers du soubassement. A droite, la pédale.
De gauche à droite : la Gambe 8', la Mixture, puis le Flageolet 2' (conique).
 A gauche, on retrouve le grand-orgue inférieur, et à droite, la pédale.
A gauche, on retrouve le grand-orgue inférieur, et à droite, la pédale.la Gambe est hors-champ, à gauche, mais on distingue une partie le la Mixture,
puis le Flageolet 2', conique, vu de coté.
A droite, le Tuba 8', en bois, avec ses grands pieds de section carrée
posés sur des supports prismatiques, non tournés.
Au-dessus de certains pieds, on aperçoit deux bouches arquées du Bourdon 16'.
La Flûte 8' n'est pas visible ici.

Pour l'amateur d'orgue, il s'agit d'un sanctuaire. Ça devrait être un lieu de pèlerinage... C'est ici que l'épopée de l'orgue romantique en Alsace a commencé. Et quand on sait tout ce qu'il nous reste encore à apprendre de ces instruments, on ne peut qu'approcher celui-ci avec une sorte de fascination. On hésite à en enlever le moindre grain de poussière, de peur d'effacer quelqu'indice qui pourrait éclairer son histoire.
Et pourtant, il nécessite - au moins - un relevage. Tout ne marche pas ; il y a des notes muettes et le tirage des jeux est plus que capricieux. On ne peut donc pas, musicalement, aujourd'hui (2019) lui rendre l'hommage que mérite sa portée historique. Reste que les timbres sont magnifiques, et l'ambiance - bien que poussiéreuse - extraordinaire.
On l'aura compris, c'est l'un des orgues d'Alsace les plus attachants. Le genre qu'on voudrait avoir près de chez soi (avec la clé dans la poche). Il est incroyable, incompréhensible, que la valeur de cet instrument soit à ce point méconnue. Cela souligne que notre connaissance du patrimoine est encore très lacunaire, car établie par un petit nombre d'acteurs enfermés dans leurs préjugés, qui ont, par dessin ou ignorance, choisi de discréditer la période 1850-1939. Il étaient sûrs de tout savoir, d'avoir tout compris, donnaient des leçons, expliquant ce qu'est un orgue "sain". Aujourd'hui, on en paye le prix. Quand on connaît les dépenses somptuaires englouties dans les projets d'élite, toujours "baroques" ou "pré-romantiques" ("Ah ! Un nouveau Silbermann encore plus authentique que tous les autres !") ("Ah ! Un nouveau Callinet authentique" - dont on ignore la composition d'origine), on ne peut qu'enrager en constatant que cet orgue exceptionnel n'a pas bénéficié des maigres subsides qui auraient permis de laisser intacte la qualité de ses prestations musicales. Cela devrait maintenant être la priorité du monde de l'orgue alsacien, qui devrait vraiment réfléchir à son avenir. Et cet avenir, il est - entre autres - ici, dans cette vallée. Car s'est ici que s'est écrite une page fondamentale de son histoire.
![]() Webographie :
Webographie :
- [SiteWalcker] https://www.walcker.com/ : Photo du buffet, plan de façade, composition d'origine avec Physharmonica ; le numéro d'opus est 145. Le plan de façade porte le numéro d'opus 146, ce qui figure aussi dans la liste d'opus.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 02/08/2019
Remerciements à Patricia Kohler.
-
[ASchreiber] Albert Schreiber : Document "Wesserling.docx"
Interprétation des documents d'archives.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 06/09/2019.
Photos du 02/08/2019.
- [WOB] Maison Walcker : "Archives Walcker (Opus Buch)", vol. 5, p. 33-5,150-1
- [WOB] Maison Walcker : "Archives Walcker (Opus Buch)", vol. 6, p. 86-8
-
[IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 82b
Seule l'intervention de 1994 figure à l'historique.
-
[HOIE] Pie Meyer-Siat : "Historische Orgeln im Elsass", éditions Schnell und Steiner, München - Zürich, 1983, p. 260-1
Avec une photo en noir et blanc, datant probablement du début des années 80. La composition est la même que celle de l'inventaire technique. Aucune modification n'est évoquée. (Il y est même affirmé que l'orgue est totalement authentique).
-
[ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 174
Au sujet de la console, on lit que : "La console indépendante, tournée vers l'autel, aurait été en fenêtre à l'origine et déplacée à une date inconnue par P. HUGUIN de Champs-le-Duc." Mais tout semble indiquer que la console ait été dans cette disposition à l'origine. En tous cas, elle n'a jamais été en fenêtre : le meuble est d'origine. De plus, l'instrument est noté avec une transmission mécanique à équerres (1986), or on voit mal qui aurait placé entre transmission pneumatique entre 1986 et 2019...
- [YMParisAlsace] Yannick Merlin : "Orgues et organistes parisiens en Alsace (1860-1908)", in "L'Orgue, bulletin des Amis de l'Orgue", 2003-IV
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 227
-
[PMSMERKLIN] Pie Meyer-Siat : "Etudes Joseph Merklin, facteur d'orgue", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 46., éditions de la société Haguenau, 1987, p. 296
Pour Edouard Mertké.
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
IM68006320
![]() Localisation :
Localisation :