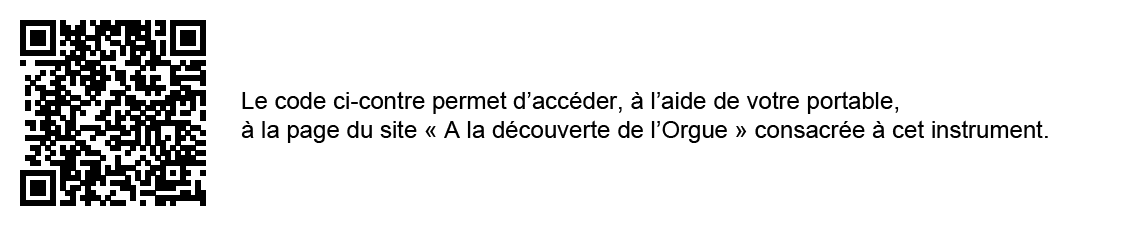Munster, le 04/07/2006, photo de Roland Lopes.
Munster, le 04/07/2006, photo de Roland Lopes.Cet orgue Muhleisen, inauguré le 02/06/1985, est très fortement inspiré par le premier instrument de l'église protestante de Munster. C'était un Walcker de 1873, qui avait été reconstruit en 1927 par Georges Schwenkedel dans un style légèrement néo-classique, puis en 1954 par Curt Schwenkedel dans le style franchement néo-classique.
Historique
Dans les années 1860, Munster décida de construire un édifice spécifiquement dédié au culte protestant. On s'occupa de l'orgue lors de la construction de l'église, si bien que, lorsque celle-ci s'acheva, en 1873, l'instrument fut aussitôt installé. On n'avait pas lésiné : c'était un orgue créé par Eberhard Friedrich Walcker, de Ludwigsburg, et doté de 30 registres. [Barth] [IHOA]
Plusieurs facteurs étaient en concurrence sur ce projet évidemment "très en vue". Il y a avait les deux maisons "historiques" alsaciennes : Léon Stiehr et Claude-Ignace Callinet, et deux prestigieuses maisons de l'apogée de romantisme européen : Merklin (Paris) et Walcker (Ludwigsburg). La maison Dalstein-Haerpfer (fondée en 1863 à Boulay en Moselle) n'avait pas encore posé d'orgue en Alsace et manquait donc de références ; une lettre fut tout de même envoyée, mais on ne peut pas la qualifier de projet). On ne demanda aux facteurs d'orgues que la partie instrumentale : le buffet devait être fourni par une maison spécialisée. Ce fut Blumer, de Strasbourg. Le projet semble avoir été mené, sur le plan technique, par le professeur de musique et organiste Schaefer. (Il resta en poste à Munster jusqu'à sa retraite, en 1886.) [YMParisAlsace] [Barth]
L'histoire du projet d'orgue pour Munster enrichit considérablement notre connaissance du monde de l'orgue alsacien dans les années 1870. Certains faits sont absolument révélateurs, et leur portée a souvent été négligée. (Ou interprétés de façon partiale à la fin du deuxième tiers du 20ème siècle, quand le choix d'un facteur allemand étant encore considéré comme un acte immoral...)
Claude-Ignace Callinet
On sait que le "petit frère" Callinet, dans sa jeunesse, était friand de nouveautés, et promouvait volontiers des évolutions techniques ou esthétiques. Cela fut même source de conflits avec son aîné, le très conservateur Joseph. Pour Munster, alors qu'il était pratiquement à la retraite, Claude-Ignace apposa une "signature tremblante" à son devis, le 16/12/1871 (III/P 31j). Il proposait une console en fenêtre, des sommiers à gravures, et une pédale façon 1830 (6 jeux : Flûtes 16', 8', 4' et batterie d'anches complète). Mais aussi avec trois Flûte harmoniques, et quatre Gambes. Et un pédalier de 27 notes (20 à Moosch). La Clarinette était au récit, et le Basson/Hautbois au positif (avec la Voix céleste, à deux rangs, et qui était donc plutôt une Unda-maris). On peut d'ailleurs se demander si le nom des deux claviers supérieurs n'a pas été échangé quelque part... Il avait "cassé les prix" : 16670 F pour 31 jeux (sans buffet) :
Comme chez Stiehr, par "Jeu céleste", il faut entendre "Salicional" (c'est confirmé dans le texte du devis). [PMSCALL]
Pie Meyer-Siat, dans son ouvrage sur les Callinet, estime que
c'est une "chose étonnante" que Walcker fut retenu (face à son "poulain"
Callinet). Mais avec le recul, on peut surtout se demander qui confierait la
construction d'un 3-claviers à un facteur pratiquement à la retraite, à la
succession pas du tout assurée (de fait, elle ne l'a pas été), et pour pratiquer
un style qu'il ne maîtrisait pas. Meyer-Siat rapporte que Munster demanda à
Callinet des efforts supplémentaires par rapport à son devis (réductions et
économies - e.g. une Soubasse à la place de la Flûte 16' ouverte), alors qu'il
était déjà beaucoup moins cher que Walcker ! Le message était clair... même s'il
manque évidemment de "fair-play". Meyer-Siat interprète que, de toutes façons,
le maire de Munster "était décidé à donner le double à un
facteur allemand".
En fait, ni Stiehr ni Callinet ne semblaient
avoir compris ce qui se passait à l'époque dans la facture d'orgues. Ceci est
parfaitement indépendant de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, à laquelle
on a jusqu'à présent voulu tout ramener.
Léon Stiehr
Le projet Stiehr-Mockers de 1872 a été "appuyé" par Jean-Frédéric Wenning, de Barr (qui avait été en 1852 l'infatigable maître d'oeuvre du plus grand Stiehr). Il rédigea une chaleureuse recommandation pour la maison Stiehr : "Je connais ces facteurs depuis plus de trente ans ; j'ai fait non seulement le plan de notre magnifique orgue, mais encore bien d'autres et je suis sûr que MM. Léon Stiehr et Mockers vous fourniraient un bel et bon instrument à un prix qu'aucun autre *bon* facteur ne pourrait accorder". A coup sûr, Wenning trouvait son orgue de Barr très réussi, mais le projet de 1872 pour Munster, lui, avait 30 ou 40 ans de retard... tout comme la maison Stiehr d'ailleurs, et il devenait de plus en plus difficile de faire semblant de ne pas s'en rendre compte. Pour la vieille maison de Seltz, les choses avaient probablement été trop faciles, de 1820 à 1860, avec cet étourdissant marché de l'orgue alsacien adressant pratiquement toutes les communes, souvent pour deux orgues. Le projet Stiehr/Wenning pour Munster (III/P 32j) était, paradoxalement, plus ambitieux et novateur que celui de Callinet. (Manuels de 56 notes, positif richement doté, pas de Clairon mais deux Flûtes majeures en poirier, grandes Gambes de pédale, Cornet au Sol, grande Fourniture grave en 2'2/3... Mais, avec ses sommiers à gravures et la mécanique "prévisible" de Stiehr (trop dure ; d'ailleurs, elle avait été simplifiée à l'extrême, avec un seul timide accouplement au programme, et pas de tirasse !), même plutôt bon marché, il ne fut pas retenu. Pourtant, dans un effort remarquable, Stiehr allait jusqu'à proposer un pédalier de 27 notes. (Il avait encore l'habitude, héritée de la première moitié du 19ème, et due au manque d'aise des instituteurs-organistes avec le pédalier, de les limiter à 18 notes). Au bout du compte, Stiehr demandait 19200 F pour 32 jeux (sans buffet) : [PMSSTIEHR]
Joseph Merklin
Joseph Merklin envoya quatre lettres à Munster, dont un devis daté du 28/03/1869, avec un dessin de buffet :
 Le dessin du projet de Joseph Merklin pour
Munster, 1869.
Le dessin du projet de Joseph Merklin pour
Munster, 1869.Archives municipales de Munster, photo de Yannick Merlin.
Toutefois, pour Merklin, on ne traite pas une affaire en échangeant du papier, mais en se rendant aux événements mondains : il invite donc les édiles de Munster à l'inauguration de Nancy St-Epvre (29/04/1869). Merklin travaillait à l'époque encore dans le cadre de l'entreprise Merklin-Schütze, mais la quitta vers 1870 (en attendant sa naturalisation pour retourner en France). Cette situation "transitoire" n'encourageait pas vraiment à retenir son projet en 1872. Le montant s'élevait tout de même à 23500 F, pour une partie instrumentale de 23 jeux réels :
C'était une composition adaptée à l'Alsace (que Joseph Merklin connaissait très bien) et à l'usage dans une église protestante : il y a un Cornet (même s'il est au récit), le récit est complet, la pédale est précisée "séparée", et la Fourniture monte à 5 rangs. C'était un projet résolument novateur, avec ce grand-orgue qu'on pouvait "distribuer" sur deux manuels (constituant un positif "acoustique", qu'on appellerait "virtuel" aujourd'hui ; dans ces conditions, un accouplement II/I est inutile). Ces deux manuels inférieurs peuvent tirer le récit.
Eberhard Friedrich Walcker
La maison Walcker avait déjà fourni 5 orgues à l'Alsace (donc avant l'annexion). Le devis pour Munster est daté du 15/12/1871, et se monte à 25958 F pour 30 jeux (mais pour un instrument fort conséquent, doté d'une Montre 16' manuelle et six 16' en tout) :
Le grand-orgue était très "alsacien", et Schaefer a probablement diffusé des consignes. On retrouve le Cornet "en Sol" chez Stiehr et Walcker, tout comme la grande Fourniture grave à 5 rangs. Mais Walcker propose une Montre en 16', et même un positif fondé sur 16'. Il n'y a pas de Voix céleste, et l'anche de récit est une Physharmonica (à anches libres). Bien sûr, les sommiers de Walcker étaient à cônes (Kegelladen), et, cela aussi, faisait une grande différence !
Quelque part, l'orgue Walcker était un instrument "de luxe", mais, puisqu'on en avait les moyens, cela aurait été dommage de s'en priver ! L'instrument fut reçu le 21/12/1873, juste à temps pour Noël, et à temps pour l'inauguration générale de l'édifice, son mobilier et ses cloches, qui eut lieu le 01/01/1874 (pour bien commencer l'année). L'instrument fut apprécié : un des commentaires de l'époque étant "eine allen Ansprüchen des Kunst genügende sehr schöne Orgel".
L'orgue Walcker peut être compté parmi les dégâts de la première Guerre mondiale, mais surtout ceux des lubies des architectes : il a été démonté vers 1914, pour être entreposé à Colmar puis à Illkirch. L'église protestante de Munster fut sérieusement endommagée, rebâtie, et achevée en 1927... avec un plafond en-dessous des voûtes ! L'orgue Walcker était dès lors condamné, à commencer par son magnifique buffet. [IHOA]
Le buffet
Le (magnifique) buffet néo-roman (dont il reste un dessin) a été réalisé par la maison Blumer, de Strasbourg.
Historique
En 1927, Georges Schwenkedel reconstruisit l'instrument, avec des sommiers, une transmission pneumatique et un buffet neufs, et dans une esthétique légèrement néo-classique. Et surtout un manque cruel de place en hauteur. Le positif resta intérieur, et l'orgue, doté de 3 claviers, disposait de 36 jeux. Ce fut l'opus 10 (sur la plaque d'adresse) (ou 11 pour certaines sources) du grand facteur de Strasbourg-Cronenbourg. [IHOA] [ITOA] [Barth] [Panneaux]
Rappelons que l'orgue Walcker avait été démonté pendant la première Guerre mondiale et stocké dans deux endroits différents : on sait ce que cela signifie. Après la quasi reconstruction de l'édifice, on trouva... un plafond sous les voûtes, et, en clair, plus de place pour l'orgue. Les architectes qui se moquent du patrimoine, c'est malheureusement très courant. Georges Schwenkedel réussit tout de même (et grâce à la pneumatique, il faut le souligner) à construire un instrument post-symphonique remarquable, encore assez proche de Walcker.
 La publicité Schwenkedel montrant
l'orgue de Munster.
La publicité Schwenkedel montrant
l'orgue de Munster.Photo de Jonathan Brun, 28/07/2013.
Une publicité Schwenkedel (affichée sur l'un des panneaux présentés sur place) montre un dessin de l'orgue de Munster, avec le libellé "Munster (Haut-Rhin), église protestante, construit en 1927. 3 claviers. 36 jeux." Georges Schwenkedel devait être particulièrement fier de sa réalisation.
Et c'est vrai que sa composition était très belle, encore très "romantique française" avec sa Trompette harmonique au récit expressif et sa façon de partir sur des fondamentales affirmées pour renforcer les aigus à l'aide des Flûtes (dont trois harmoniques). Directement héritées de la tradition du post-romantisme sont la Doublette du grand-orgue et le Plein-jeu au récit. Les couleurs "symphoniques" étaient là, mais l'instrument était aussi - déjà - néo-classique, avec un jeu de Tierce au récit et un Cromorne.
Georges Schwenkedel pratiquait un style post-romantique très personnel, d'une grande distinction. Ses spécificités sont le Cornet complet au grand-orgue (qui devint une Mixture dans les graves), la Trompette de grand-orgue appelée "Cor anglais", et les jeux aux noms poétiques : Musikgedeckt, Flûte suaviale. "Harmonica" est inspiré du romantisme allemand (c'est un jeu à bouche, contrairement à la Physharmonica qui est, en clair, un jeu d'harmonium), et illustre une grande recherche dans la diversité des jeux de fonds. Ce devait être un instrument absolument remarquable.
Caractéristiques instrumentales
 La console Schwenkedel, photo de Jonathan
Brun, 28/07/2013.
La console Schwenkedel, photo de Jonathan
Brun, 28/07/2013.Console indépendante face à la nef, fermée par un rouleau coulissant. Tirage des jeux par dominos à porcelaines de couleur, de fond blanc pour le grand-orgue, bleu pour le récit, gris pour le positif, et vert pour la pédale. Ils sont disposés sur deux gradins à gauche (grand-orgue), trois gradins à droite, et en deux lignes au-dessus du troisième clavier (récit). Claviers blancs à frontons biseautés, joues galbées. Commande générale ou indépendante de la combinaison libre pour chaque plans sonore par 5 pistons placés au-dessus du troisième clavier et au centre. Ils sont surmontés par leur annulateur, qui est un petit taquet à pousser vers le bas. Commande des accouplements et tirasses "en 8'" doublées (on peut y voir l'influence du Congrès de Vienne et de Schweitzer). Les commandes "à main" sont constituées de pistons placés sous le premier clavier, et suivis des pistons de l'annulateur d'anches, et de l'annulateur "jeu à mains" (supprimant l'action des dominos quand la combinaison est active). Les commandes "au pied" se font par des pédales-cuillers à accrocher, repérées par des porcelaines respectant le code de couleur des plans sonores (donc bicolores). De gauche à droite : "Péd. I", "Péd. II", "Péd. III", "II-I", "III-I", "III-II", "Accouplement" (général). Vient ensuite, environ à l'aplomb du second Si (h) du pédalier, la pédale basculante du crescendo général, puis celle de l'expression du récit. Toutes deux sont légèrement tournées vers le centre. Tout à droite, la commande du trémolo ("Trémolo du Récit"). Les accouplements "à l'octave" sont commandés par dominos.
Programmation de la combinaison libre par picots basculants, placés au-dessus de chaque domino. Crescendo à indicateur linéaire, placé en positon centrale, en haut (au-dessus des pistons de la combinaison libre), et gradué "0", "3", "6", "9", "12".
Plaque d'adresse en bakélite blanche, vissée en haut à gauche, à la hauteur des dominos du récit :
Facteur d'Orgues
Strasbourg-Cronenbourg
1927 Opus 10
 Détail de la console Schwenkedel, photo de Jonathan
Brun, 28/07/2013.
Détail de la console Schwenkedel, photo de Jonathan
Brun, 28/07/2013.Quand on connaît les (rares) contemporains de cet orgue dans la production de Georges Schwenkedel (Largitzen, Metzeral), on se doute que ce devait être un instrument remarquable. Il est fort dommage que celui là non plus n'ait pas été préservé.
Historique
En 1954, malheureusement, le monde de l'orgue semble avoir perdu tout repère. On demanda à Curt Schwenkedel d'altérer l'orgue de son père pour en faire un "néo-classique" affirmé, muni d'un positif de dos. Curt Schwenkedel (comme son père) était pourtant généralement résistant à la destruction d'instruments de qualité. Ici, ce fut particulièrement violent : dans le but de placer ce positif de dos (accroché à la tribune et sans buffet), il fallut chambouler totalement ce pauvre instrument post-romantique, qui fut alors affublé d'un lot de "petits jeux" (aigus), totalement incongrus dans le contexte : Larigot, Cymbale, Fourniture aigüe au grand-orgue. [IHOA]
L'orgue perdit son grand-orgue fondé sur 16' (le Walcker avait un 16' ouvert manuel !), mais aussi le Cor anglais du grand-orgue et la Mixture-Cornet qui faisait toute sa spécificité. Il furent remplacés par des tuyaux, provenant, dit-on, "de Callinet" (ce qui ne les rend pas meilleurs en soi... et qui seraient mieux dans un orgue Callinet) : un Cornet posté, une Trompette "standard", et un Clairon, le tout nous ramenant en 1830. Quant au récit, il paya son tribu aux marottes néo-classiques en se retrouvant affublé d'un Sifflet.
La "greffe" d'un positif de dos sur un orgue romantique ou post-romantique est toujours lourde de conséquence pour le reste de l'instrument. En clair, désastreuse. Lorsque le résultat "orgue romantique + positif de dos" est satisfaisant, c'est que l'orgue avait été conçu ainsi dès le début, et c'est extrêmement rare (la "tétralogie" Schwenkedel, Bisel, Seppois-le-Bas, Durlinsdorf et Reiningue est un exemple de réussite, et il y a eu un autre exemple en 2003 à Strasbourg, mais, pour l'Alsace, c'est pratiquement tout). Après cette opération, l'orgue de Munster était devenu un instrument sans style. Il avait été totalement défiguré, et pourtant, ce n'était toujours pas l'idéal pour jouer Couperin... Et l'entretien - nécessaire, bien que sont coût soit souvent exagéré - d'une transmission pneumatique avec ses sommiers à membranes devenait difficile, voir impossible à justifier. Rien que pour le prix de cette transformation calamiteuse, on aurait probablement pu entretenir l'orgue de Georges Schwenkedel pendant des décennies. Au lieu de cela, l' "Opus 10" était perdu.
Caractéristiques instrumentales
Historique
En 1985, Georges Frédéric Walther reconstruisit l'instrument en traction mécanique, et en conservant, pour partie, un côté romantique, et une bonne partie de la tuyauterie. [IHOA]
Nul doute qu'à cette époque, une reconstruction en néo-baroque "de combat" a été envisagée... Mais, au lieu de cela, la maison Muhleisen reconstruisit l'instrument "dans l'esprit Walcker". Evidemment, années 80 obligent, cela n'allait pas sans quelques concessions : un Larigot au positif, et une Sesquialtera (approuvée "Orgue Nordique 2.0") du récit ne sont assurément pas très "esprit Walcker"... Une Cymbale et une Régale au positif non plus. Et avec ses deux Clairons et ses sommiers à gravures, l'orgue aurait tout aussi bien pu être qualifié d'inspiré du Stiehr ou du Callinet projetés en 1872. On peut aussi regretter la perte de la Flûte suaviale et des jolies composantes post-romantiques de 1927 (dont les accouplements à l'octave). N'empêche que pour 1985, cette opération fut absolument remarquable. Elle marque une étape incontournable dans la lutte contre la "pensée unique" néo-baroque des années 60-80 : un orgue avec un Hautbois, une Flûte harmonique 8', une Flûte octaviante 4', et même une Trompette harmonique au récit expressif, c'était exceptionnel !
La reconstruction de l'orgue de Munster avec un positif intérieur et dans un esprit de résistance au néo-baroque est un des moments clé de la fin du 20ème siècle. Cela donne à l'orgue de Munster une importance historique considérable.
L'inauguration, avec Denis Monhardt aux claviers, a eu lieu le 27/10/2002.
En 2002, la maison Muhleisen posa une façade en étain neuve. [AORM]
Munster témoigne d'un grand attachement à son patrimoine : en plus de doter l'Alsace de cet orgue assez exceptionnel, des panneaux retracent l'histoire de ses deux illustres prédécesseurs. Et la console de 1927 est exposée. C'est un précieux témoin de l'âge post-symphonique, un style incomparable et méconnu, doté de moins en mois de représentants, et dans lequel on rêve de revoir construire des orgues neufs. On rêve aussi de revoir cette magnifique console remise, quelque part, en fonction.
Caractéristiques instrumentales
![]() Webographie :
Webographie :
- [Muhleisen] http://www.muhleisen.fr : le site de la maison Muhleisen.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 122a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 293-4
-
[JBrun] Jonathan Brun : e-mail du 04,05/11/2015.
Photos
- [YMParisAlsace] Yannick Merlin : "Orgues et organistes parisiens en Alsace (1860-1908)", in "L'Orgue, bulletin des Amis de l'Orgue", 2003-IV, p. 65-7
-
[Muhleisen] Maison Muhleisen : Document "compofr_rea50.pdf"
Document décrivant la reconstruction de 1985.
- [AORM] ""A propos d'orgue..." le journal de l'Association des Organistes de la Région de Mulhouse", p. 20, 09/2002-02/2003
- [PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 352
- [PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 645-9
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 270
- [Panneaux] Panneaux d'exposition, sur place, relatant l'histoire des orgues
![]() Localisation :
Localisation :