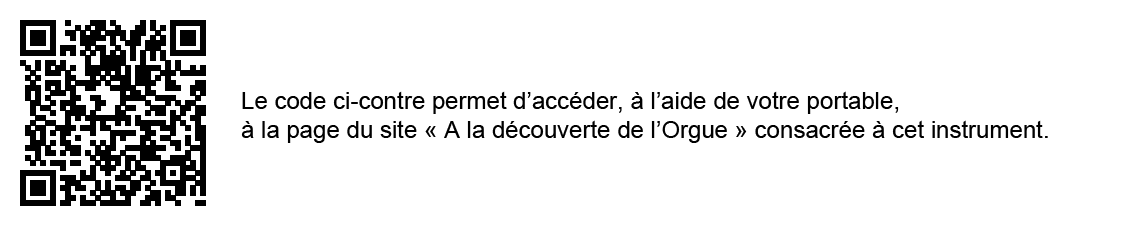L'orgue Schwenkedel du Bischenberg.
L'orgue Schwenkedel du Bischenberg.Le Bischenberg est un lieu de pèlerinage depuis le 15ème siècle au moins. Ce sont d'abord les Franciscains Récollets (de Mutzig / Hermolsheim) qui furent chargés d'encadrer l'afflux de pèlerins. On sait que le chœur de l'église date de la première moitié du 16ème siècle. En 1717, il fallut agrandir l'édifice. Un peu plus tard, un premier orgue entre en scène.
Historique
En 1731, l'abbé l'Atorf, Amand Zimmermann, fit don aux Récollets d'un petit instrument. [IHOA]
1782
Historique
En 1782, les Récollets demandèrent au facteur Sébastien Krämer de construire un orgue neuf, de 14 jeux sur 1 manuel et pédale. [IHOA] [PMSCS68]
C'était à la fois modeste et ambitieux. D'un côté, la vigueur du pèlerinage devait amplement justifier la présence d'un instrument conséquent. D'un autre côté, les Franciscains ne pouvaient pas se montrer dispendieux avec l'argent des dons. S'adresser aux "grands" de la profession pour un instrument de cette taille était probablement hors de portée. S'aventurer chez les autres constituait une prise de risque. On le sait, Jean-André Silbermann, dans ses archives, dressait un bilan calamiteux de la production de ses confrères. Evidemment, il s'agissait de "concurrents", mais comme il rédigeait des notes personnelles, nullement destinées à être publiées ou communiquées, il n'avait aucune raison de forcer le trait. Or, Sébastien Krämer faisait partie des confrères qu'il évaluait vraiment très bas !
De fait, Krämer ne présentait pas de solides références. Il s'était probablement mis à la facture d'orgues, comme bien d'autres artisans, seulement pour bénéficier d'une spécialité à valoriser. Il avait commencé comme vitrier, puis fit un voyage d'études à Paris pour apprendre la facture d'orgues. Quand il en revint, il avait déjà 26 ans. On était en septembre 1777. Après quelques travaux mineurs (Innenheim, censé être un "orgue neuf", mais qui n'était sûrement guère plus qu'un positif), Krämer décida... de se marier. Ce fut le bon choix, car son beau-père avait une excellente situation : négociant en bétail et boucher à Erstein, il était le fournisseur des Franciscains d'Ehl ! Krämer se mit rapidement à réparer au moins 3 orgues des Franciscains. En 1781, il obtint le marché pour un instrument neuf à Hermolsheim. Grâce aux "réseaux" acquis peu à peu, il obtint un peu de travail en dehors des églises franciscaines. En 1782, il y eut le Bischenberg. Comme toutes références, il devait pouvoir montrer 5 orgues, dont 2 positifs. Des 3 autres, le plus ancien devait avoir moins de 3 ans ! [PMSCS68]
Sébastien Krämer était, on peut le dire, un facteur "spécialisé" dans la construction et l'entretien d'orgues pour les Franciscains.
Dès 1782, Krämer demanda aux Franciscains du Bischenberg un payement anticipé. Ils étaient certes des clients particulièrement bienveillants, mais, tout de même, il ne fallait pas exagérer : cette avance lui fut évidemment refusée.
L'orgue du Bischenberg était "achevé" le 02/08/1782, comme en atteste le curé d'Obernai, qui le trouvait réussi. Le mois suivant, la réception devait avoir lieu, assurée par François Joseph Lebché (Obernai) et le Père Placitus. Le matin même, le facteur était encore en train de faire des travaux. Après audition, il réussit à obtenir un mois de délai afin de rendre l'orgue acceptable. Mais Krämer voulait son payement, et demanda une seconde réception anticipée, alors que l'orgue présentait de graves défauts : tuyaux endommagés, notes de pédale restant coincées... La situation devint rapidement extrêmement conflictuelle, et on raconte qu'un Franciscain tira la langue à François Joseph Lebché. Cet épisode est à rapprocher de celui qui survint à Wolxheim en aôut 1780. On ne sait pas comment cela se termina (sûrement par une porte claquée...), mais, sûrement pour mettre fin à cette situation scandaleuse, on préféra signer un procès-verbal attestant de la "parfaite finition" de l'orgue. Krämer en profita pour obtenir le payement, et... le marché pour un orgue neuf à Niedernai, en le présentant comme référence ! [PMSCS68]
François Joseph Lebché formula une solution bien ironique : il proposait aux Franciscains du Bischenberg de limiter la casse en revendant leur orgue Krämer... à Niedernai ! Il n'avait pas perdu son humour, mais était vraiment très vexé, car son "in cauda venenum" fut implacable : il déclara que "c'était une honte de mendier l'argent des pauvres gens pour le donner, grâce à de faux témoignages, à des charlatans". [PMSCS68]
C'est vraiment très sévère, car les Franciscains, sûrement, avaient voulu être bienveillants. Ils ont fourni du travail à un artisan qui leur avait été recommandé, en essayant d'obtenir, pour les offices du pèlerinage, un instrument adapté à prix raisonnable. Leur seule erreur semble avoir été d'avoir cherché à sortir trop tôt du "scandale".
On peut aujourd'hui voir des buffets de Krämer à Wolxheim (1780, - partiellement conservé - il abrite un orgue Callinet/Rinckenbach), Saverne (Notre-Dame de la Nativité, 1784, il abrite un orgue Kern) ou Nordhouse (1792, il abrite un orgue Koenig qu'il faut aller voir). Il ne reste rien d'instrumental, sûrement parce qu'il n'y avait rien à garder.
Ce qui est édifiant, et fondamental pour comprendre l'état actuel de l'Orgue alsacien, c'est la façon dont l'organologie de la fin du 20ème siècle aborda le chapitre Krämer. Dans son article de 7 pages paru en 1969 dans "Pays d'Alsace", Pie Meyer-Sait nous livre un bilan objectivement calamiteux du parcours de Krämer, émaillé de conflits, de joutes administratives (cela continua au début du 19ème, on peut donc imaginer...) et de travaux qui ont dû être refaits. L'introduction justifie l'étude "parce qu'il était sans doute un artisan fort capable, à sa grande époque, de faire du travail convenable. Qu'il fut un organier capable, est prouvé, beaucoup moins par J. A. Silbermann qui cite, en les dénigrant de son mieux, les travaux exécutés par Krämer de 1777 à 1784, pendant la rédaction de son journal, que par le témoignage de Joseph Rabiny qui, en 1787, met Krämer sur le même rang que Conrad Sauer, de Strasbourg, Besançon, de Ste-Ursanne, et Stieffel, de Rastatt". [PMSCS68] [PMSCALL]
La proposition "Krämer était un organier capable" était certes à examiner. Mais la charge de preuve paraît être à celui qui la formule. Cela devrait consister à fournir des exemples de travaux réussis. Surtout que le témoignage de Silbermann (dans des notes personnelles) établissait a priori exactement le contraire. Les faits énoncés dans l'article sont ensuite implacables, tout comme la conclusion "Des gens lui [Krämer] ont voulu du bien [...]. Il n'a pas su faire honneur à leur crédit et à leur confiance". Mais après tout cela, coup de théâtre, la proposition est "prouvée" sur la foi d'un témoignage de... Rabiny. Le fameux Rabiny "précurseur" des Callinet de Rouffach, et forcément génial pour cela. Rabiny, pour lequel on attend toujours, aussi, une liste d'exemples parlants de réalisations réussies... Elle ne contiendrait certes pas "le chef d'œuvre de Guebwiller" (dont il ne reste rien d'instrumental, et pour lequel une once de bon sens rend impossible à admettre que Rabiny ait achevé un 4-claviers d'un coup de baguette magique).
Une fois de plus, c'est Marc Schaefer qui met le doigt sur l'élément déterminant permettant de comprendre tout le reste : le 25/11/1785, Rabiny et Krämer avaient assuré ensemble une expertise à l'orgue de Riquewihr. Et la citation de Rabiny de 1787 doit être remise dans son cadre extrêmement "politique" : il lui fallait trouver un facteur allié... pour une contre-expertise à Cernay, où la réception de son orgue ne s'était pas bien passée ! Fin 18ème comme aujourd'hui, c'est au restaurant que se font les réputations. [PMSCS68]
C'était cela, aussi, l'orgue au 18ème. Tous les facteurs n'étaient pas des génies, et tous les orgues n'étaient pas des chefs d'œuvre. Loin s'en faut.
Et l'orgue du Bischenberg, dans tout cela ? Eh bien, voici sa composition :
Le destin de cet instrument reste à éclaircir. A la Révolution, les Franciscains ont été chassés de leur couvent, et leurs biens volés. D'après Meyer-Siat, l'orgue fut déménagé (lire : mis en vente au profit de spéculateurs), pour atterrir à Wangen. Il y servit jusqu'en 1880, date à laquelle il fut repris par la maison Wetzel, et disparut. [IHOA]
Cette fois, c'est Médard Barth qui relève un point important : lorsque les Rédemptoristes, menés par le Père Joseph Passerat, vinrent s'installer dans ce qui était alors la ruine du couvent du Bischenberg (1821), on découvrit que le Franciscain Venantius Engelmann avait mis un orgue à l'abri. On ne peut être tout à fait sûr qu'il s'agissait du fameux orgue Krämer de 1782 (beaucoup d'orgues ont été baladés durant la Révolution, entiers ou non), mais la présomption était forte. En tous cas, l'instrument n'en était pas devenu meilleur : il était "völlig unbrauchbar" ("totalement inutilisable"). [Barth]
Historique
Cette fois, on ne choisit pas l'aventure, et on s'adressa à Joseph Stiehr, qui dominait le marché bas-rhinois. Un petit orgue à un seul manuel (9 jeux) fut livré en 1854. [Barth] [IHOA] [PMSSTIEHR]
C'est Aloïse Lorentz qui répara les dégâts dus à 20 ans d'abandon, conséquence du "Kulturkampf" de Bismarck. Le couvent fut à nouveau desservi en 1894, et l'orgue réparé en 1897. [IHOA]
Historique
Le Bischenberg a donc certes connu des orgues "historiques", mais, on l'a vu, rien qui fasse rêver. Et le petit orgue Stiehr, qui avait connu 20 ans d'abandon, devait être, malgré sa réparation de 1897, bon à remplacer avant les deux conflits mondiaux... Le nouvel orgue arriva en 1958, et, à nouveau, on s'adressa à un leader de l'orgue alsacien à l'époque : Curt Schwenkedel. [IHOA] [PMSSTIEHR]
L'orgue a été installé "en nid d'hirondelle", sur le mur gauche de l'édifice, et touchant la tribune (fournissant un accès aisé). La console a été placée sur la tribune, face à la nef. Il s'agit encore d'un instrument de style néo-classique, mais dans la forme la plus tardive, qui se caractérise par une totale absence de buffet (un simple soubassement portant les tuyaux), des traits "classisants" qui pouvaient aller - comme ici - jusqu'à la perte de la boîte expressive du second clavier, et surtout un usage intensif des emprunts et extensions. Ainsi, 7 jeux réels, éventuellement étendus vers l'aigu, permettent de "simuler" un orgue de 16 jeux. L'instrument est en outre doté d'octaves aiguës (II/I 4'), qui lui permettent de produire des couleurs post-romantiques. [Visite]
L'orgue néo-classique, dans cette évolution finale, connut le même défaut organique que l'orgue néo-baroque, son successeur : à force de courir vers l'aigu, on manquait cruellement de fondamentales. Mais en 1958, Curt Schwenkedel avait encore gardé certaines belles habitudes héritées de son père Georges (mort en mars 1958), harmoniste de grand talent. Il a su harmoniser les rangs de 8' (et la Soubasse) dans un grand esprit d'équilibre. Il a fallu 228 ans, mais, enfin, le Bischenberg était doté d'un orgue très réussi et parfaitement adapté à son usage.
Caractéristiques instrumentales
 Belle ambiance pour cette console typiquement "années 50".
Belle ambiance pour cette console typiquement "années 50".Console indépendante face à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos plats aux coins arrondis, disposés en ligne au-dessus du second clavier. Le nom des jeux est gravé en noir pour le grand-orgue, en vert pour la pédale, et en rouge pour le récit. Claviers blancs. Commande des tirasses et accouplements par pédales-cuillers à accrocher, disposées au-dessus de la deuxième octave du pédalier : "I/PED 8'", "II/PED 8'", "II/I 8'", "II/I 4'". L'accouplement à l'octave aiguë n'est pas doté d'un complément sur la dernière octave, et n'agit pas sur les jeux du récit empruntés au grand-orgue (Bourdon 8', Flûte 2').
Appel de la combinaison fixe par un poussoir placé sous le h' du premier clavier. Il semble y avoir eu une modification : bien que désigné par les lettres "T.T.", ce poussoir n'appelle pas le tutti mais une registration médiane. Voltmètre, placé en haut à gauche. Plaque d'adresse en matière plastique noire à lettres gravées blanches, vissée en haut à droite de la console, et disant :
G. SCHWENKEDEL & FILS
STRASBOURG - KOENIGSHOFFEN
OPUS 146 1958
 La plaque Schwenkedel au Bischenberg.
La plaque Schwenkedel au Bischenberg.Georges Schwenkedel étant décédé en mars 1958, il est peu probable qu'il ait beaucoup contribué à cet instrument. On comprend que retirer son nom à ce moment était inconcevable... Cette plaque attribue donc l'orgue au père et au fils Schwenkedel, mais il est probable qu'il soit le premier orgue réalisé entièrement par Curt sans son père.
 Tout à gauche, contre le mur du fond, il y a les longs tuyaux étroits du Salicional.
Tout à gauche, contre le mur du fond, il y a les longs tuyaux étroits du Salicional.On voit ensuite les tuyaux à cheminées de la Flûte 4' du récit, puis le Nasard,
et enfin la Trompette (dessus en spotted, basses en cuivre).
Ces jeux sont disposés diatoniquement, basses au centre.
Tout au fond, des tuyaux de Flûtes et les Bourdons du grand-orgue et de la pédale ; il y a une seconde façade côté chœur.
Dans la partie droite, il y a d'abord la Mixture (à trois rangs),
puis le rang de Principaux constituant le Prestant et la Montre.
Enfin, le revers de la façade.
Certains tuyaux semblent provenir du 19ème (Stiehr). Mais le Salicional est poinçonné, et les tuyaux à cheminée ont été munis de calottes mobiles. Certains principaux, du côté grand-orgue, ont également l'air d'être anciens. Même s'il y a des tuyaux de 1854, ils ont été totalement ré-harmonisés.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 02/05/2018
Remerciements au diacre Pierre.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 37b,215a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 3, p. 59
- [PMSCS68] Pie Meyer-Siat : "Sébastien Kraemer, facteur d'orgues", in "Pays d'Alsace ('Cahiers de Saverne')", vol 68., éditions Société d'histoire et d'archéologie de Saverne et environs, 1969, p. 23-9
- [PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 90,92
- [PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 442-3
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 154
![]() Localisation :
Localisation :