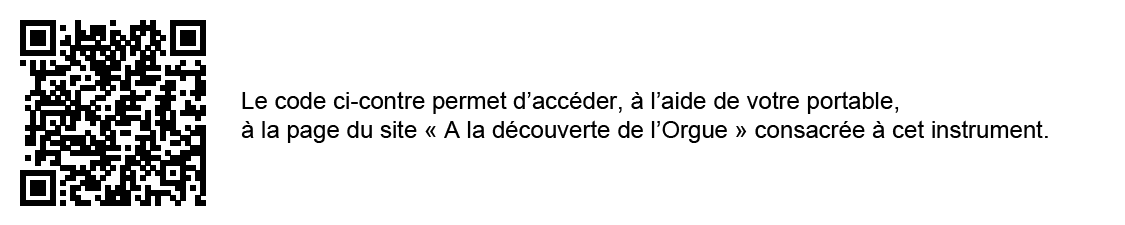L'orgue de Jebsheim.
L'orgue de Jebsheim.Les photos sont de Victor Weller, 16/06/2021.
L'opus 134 de Georges et Curt Schwenkedel est un instrument dont la lecture de la composition pourrait faire croire qu'il date des années 1970. Mais on n'est même pas encore dans les années 60. La traction reste électrique et le récit est expressif : cet instrument est encore résolument néo-classique.
1741
Historique
Le premier orgue de Jebsheim datait de 1741 : c'était l'œuvre de (Jean-) Daniel Cräner (1689-1747), le fils de Jean Michel Cräner, décédé vers 1725. Etablis à Ribeauvillé, les Cräner construisirent plusieurs orgues en Haute-Alsace, mais aussi jusque dans le Bas-Rhin. Cet instrument nécessita vraiment beaucoup de réparations : [IHOA] [PMSRHW]
En 1749 par Georg Friederich Merckel. [IHOA]
En 1798 par Martin Bergäntzel. [IHOA]
En 1800 par François Callinet. [IHOA]
En 1842 (et sûrement en 1849) par Antoine Herbuté. [IHOA] [PMSRHW]
Et en 1864 par les frères Wetzel, qui, en 1874, proposèrent un orgue neuf. [IHOA] [PMSRHW]
Un relevé, effectué en 1935 par Georges Schwenkedel, précise que l'unique manuel n'a que 48 notes (CD-c''') avec 6 jeux, et la pédale 17 notes (CD-f), avec 3 jeux. [PMSRHW]
De fait, les orgues (mécaniques) du 18ème n'étaient pas tous aussi fiables que le veut la légende ; ce n'étaient assurément pas tous des chefs-d’œuvre non-plus. Il fallut attendre la fin des années 1930 pour pouvoir enfin remplacer ce vieil instrument.
Historique
En 1939, Georges Schwenkedel plaça à Jebsheim son opus 70, logé dans l'ancien buffet. L'instrument avait 12 jeux. [IHOA]
Malheureusement, l'orgue Schwenkedel (qui avait à peine 1 an) fut détruit, par faits de guerre, dès juin 1940. L'église (dont certaines parties sont authentiquement romanes) fut fortement endommagée par deux incendies successifs. [IHOA]
Historique
En 1957, Curt Schwenkedel plaça à Jebsheim l'opus 134 de la maison, pour remplacer l'orgue de son père. [IHOA]
Le buffet
Il n'y a pas proprement parlé de buffet et l'instrument est situé sur la tribune à gauche. Façade libre, composée de la Montre et de la 1ère octave de la Soubasse pour les tuyaux en bois.
Caractéristiques instrumentales

Console indépendante latérale (flanc droit face à la nef, presque à fleur de tribune), fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos blancs, rectangulaires aux coins arrondis, disposés en ligne au-dessus du second clavier, et groupés par plan sonore. Le nom des jeux est sérigraphié sur les dominos (pas de porcelaines), en vert pour la pédale, en noir pour le grand-orgue, et en rouge pour le récit. Il n'y a pas de dominos pour les accouplements. Claviers blancs.
Programmation de la combinaison libre par picots basculants placés au-dessus de chaque domino. Les accouplements ne sont donc pas programmables. Il y a une double commande pour les accouplements : à main par 5 poussoirs placés à gauche sous le premier clavier : "II/P 4'", "II/P 8'", "I/P 8'", "II/I 4'", "II/I 8'". A leur droite, le poussoir d'appel de la registration par dominos ("J.M.", pour "jeux à mains"), et celui de la combinaison libre ("COMB L"). Appel des combinaisons fixes par poussoirs situés sous le premier clavier : de gauche à droite : l'annulateur "0", puis "I", "II" et "III".
Les 5 accouplements sont commandés au pied par des pédales à accrocher, à gauche, en bois recouvertes de métal gaufré, et repérées par des étiquettes en plastique à fond noir. Vient ensuite la pédale basculante d'expression du récit "EXPR. RECIT.", et les annulateurs : "SUPPR. FOURNITURE", "SUPPR. CYMBALE", "SUPPR. TROMPETTE 8'", "SUPPR. BOMBARDE 16'". Pas de crescendo. Voltmètre, placé en haut à gauche, gradué jusqu'à 15V.
Plaque d'adresse placée en haut à droite (symétriquement au voltmètre), constituée d'une plaque en plastique noire aux lettres blanches :
G. SCHWENKEDEL & FILS
STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN
OPUS 134 1957
Ce modèle de console a été construit à plusieurs reprises. Par exemple la même année (1957) à Witternheim et à l'hôpital départemental de Colmar, ou l'année suivante au couvent des Rédemptoristes de Bischoffsheim. Il en existe une version plus "cossue" à Elsenheim (1959). Ce sont les dernières, car déjà à l'église protestante d'Uhrwiller (1958, opus 145) ou à l'église protestante St-Jean de La Montagne-Verte (1958, opus 147) on trouve une console "néo-baroque" en fenêtre, mécanique, commandant des sommiers à gravures.
Electrique.
A cônes. Disposition chromatique pour le grand-orgue, diatonique en "M" (basses aux extrémités) pour le récit, et chromatique pour la pédale.
A charge flottante, dans le soubassement.
 Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue et de la pédale.
Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue et de la pédale.De gauche (avant de l'orgue) à droite :
(Grand-orgue) la Montre 8' (dessus), le Bourdon, le Prestant,
la Doublette et la Fourniture.
A droite, la pédale, avec la Bombarde 16' en avant.
 La tuyauterie du récit. De bas (avant) en haut (fond) :
La tuyauterie du récit. De bas (avant) en haut (fond) :la Trompette, la Tierce, la Doublette,
la Quinte 2'2/3, la Flûte 4', et le Bourdon 8'.
![]() Les Cräner
Les Cräner
(Jean-) Daniel Cräner (1689-1747), et son père Jean-Michel Cräner (décédé vers 1725) étaient établis à Ribeauvillé. Ils construisirent plusieurs orgues, en Haute-Alsace, mais aussi dans le Bas-Rhin :
- A Soultzbach-les-Bains, c'est probablement Jean Michel Cräner qui construisit le premier orgue. Daniel en construisit un autre vers 1738.
- En 1723, c'est probablement ensemble que les Cräner posèrent un orgue à Soultzmatt.
- 1731 : construction d'un petit orgue, réalisé d'après un projet d'André Silbermann non réalisé pour Boersch. Le "Silbermann de Boersch" est, comme en de nombreux endroits, une simple légende.
- En 1736, Daniel Cräner construisit probablement l'orgue de Kientzheim (Obere Kirch) qui fut réparé par Bergäntzel en 1782. L'instrument disparut en 1845.
- En 1739 (donc juste après Soultzbach), Daniel Cräner travailla au Couvent de Ribeauvillé.
- Il y a aussi une réparation de Cräner à Eguisheim en 1740.
- Le buffet de l'orgue Daniel Cräner de Jebsheim existait encore en 1940, mais disparut alors par faits de guerre.
- En 1748 l'orgue que Daniel Cräner avait construit pour Ribeauvillé fut transféré à Kertzfeld (sûrement par Jean-Casimir Kuhlwein). L'instrument, qui fut réparé par Chaxel en 1801, disparut en 1832. [AS1975]
Il semble donc qu'il ne reste rien de leur production.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[VWeller] Victor Weller : e-mail du 18/01/2022,03/02/2022.
Photos du 16/06/2021.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 87a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 182
- [PMSRHW] Pie Meyer-Siat : "Valentin Rinkenbach, François Ignace Hérisé, les fils Wetzel, facteurs d'orgues", éditions Istra, p. 207
- [AS1975] , p. 142-8
![]() Localisation :
Localisation :