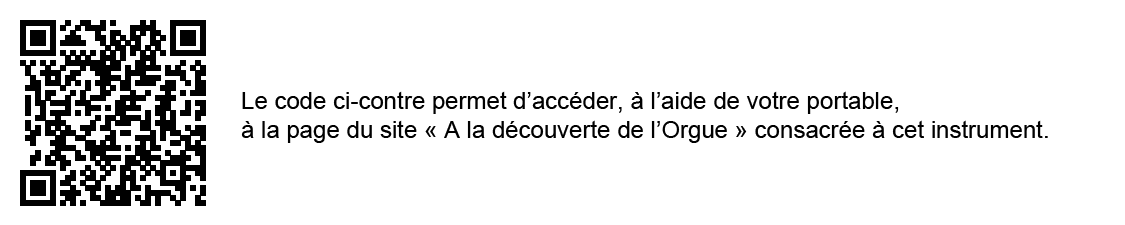Koenigshoffen, l'orgue Muhleisen de l'église St-Joseph,
Koenigshoffen, l'orgue Muhleisen de l'église St-Joseph,le 19/05/2024.
Koenigshoffen était une terre de facteurs d'orgues : Georges Schwenkedel y installa son entreprise en 1924 (1, chemin du Cuivre, Tramway N°7, arrêt Brasserie Gruber) ; l'Alsace lui doit certains de ses plus beaux instruments. Et bien sûr, dans le monde de l'orgue, le nom de Koenigshoffen évoque surtout le fabuleux Walcker de l'église protestante St-Paul.
L'église St-Joseph, conçue par les architectes Lütcke et Backes, a été consacrée le 25/08/1901. Elle a aussitôt dotée d'un orgue : à l'époque, on ne pouvait pas s'en passer ! Certaines pièces de cet instrument viennent de Strasbourg, St-Jean. L'orgue actuel a été construit en 1988 par la maison Muhleisen, en s'inspirant de la facture de Michel Stiehr.
Historique
C'est en 1901 que l'ancien orgue (Michel Stiehr, 1825) de Strasbourg, St-Jean a été installé à Koenigshoffen. [IHOA]
En fait, Koenigshoffen faillit recevoir un orgue Voit ! La célèbre maison de Durlach avait fait une proposition le 09/04/1900. Malheureusement, l'affaire ne se fit pas, et on préféra acquérir un orgue d'occasion. [IHOA]
Un article du journal "Der Elsässer", daté du 18/10/1906, relate les faits : il manquait 4000 Marks dans les caisses pour acquérir l'orgue neuf. [NAlsacien]
C'était clairement une déception, mais à l'époque, on ne plaisantait pas avec les déficits ! C'était donc un choix "raisonnable", au moins à court terme. D'ailleurs, en lisant l'article entre les lignes, on croit comprendre qu'un orgue d'occasion était bien suffisant, vu que ce n'était "que" Koenigshoffen. Mais finalement, ce choix trop raisonnable ne fut pas pertinent : l'instrument, on le verra, ne donna pas satisfaction, puisqu'il fut remplacé dès 1915.
On ne peut pas non plus écarter le fait que "placer" le vieil orgue de St-Jean devait arranger beaucoup de monde. Il faut rappeler que si cet orgue a été mis en vente, c'est que la paroisse St-Jean s'est dotée à l'époque d'une des "7 Merveilles" du monde de l'orgue alsacien, l'opus 68 (III/P 38j) de Martin et Joseph Rinckenbach, l'orgue de Marie-Joseph Erb. Comme la plupart des Merveilles, celui-ci n'existe plus : il a péri sons les bombes en 1944, sans que personne, apparemment, n'ait pensé à prendre une photo de son buffet.
Avant son déménagement, l'orgue Stiehr de St-Jean avait déjà "beaucoup vécu". Il semble avoir été construit en 1824, et livré en 1825 sans positif de dos. Le positif lui a été greffé en 1848 par la maison Stiehr. En 1835, son entretien passa à Martin Wetzel, et en 1870, les frères Wetzel y travaillèrent, sûrement suite à des dégâts de guerre. Et, en 1878, Heinrich Koulen fit une transformation, qui fut probablement d'envergure. [CMAVS98] [ITOA]
Historique
Dès 1915, le conseil de fabrique décida de faire totalement reconstruire l'instrument, par Edmond-Alexandre Roethinger. C'était l'opus 75 de la grande maison strasbourgeoise. [IHOA] [ITOA] [Barth] [Mathias]
 Le magnifique buffet éclectique de 1915.
Le magnifique buffet éclectique de 1915.La composition visuelle, avec son triangle équilatéral en arrière-plan
et ses deux jouées/pilastres qui semblent le supporter
est extraordinaire. Quelle dommage qu'un buffet pareil ait été perdu !
Il faut se souvenir qu'en 1914, l'église protestante St-Paul se dota d'un orgue Eberhard Friedrich Walcker. Là, on jouait dans la cour des grands, à mille lieues du "ça suffira bien pour une banlieue" ! Il est clair que l'arrivée d'un pareil instrument de musique à Koenigshoffen a changé la donne, et induit une forte motivation dans la communauté catholique.
Cette fois-ci, plus question d'être trop "raisonnable". Pour commencer, l'orgue devait être beau. Le buffet a été redessiné. De style éclectique, avec ogives et couronnements en pilastres, il était - contrairement aux rectangulaires buffets des années 1820 de Stiehr - merveilleusement assorti à l'édifice, et en particulier au mobilier des frères Moroder, et à l'exceptionnelle voûte en bois. (Qui, on le rappelle, figurait un ciel étoilé jusqu'en 1941.)
Ce buffet était très de couleur acajou, avec des petits piliers et chapiteaux dorés, l'ensemble très élégant, le tout couronné par un gâble de style gothique champenois. Comme il y avait la trace de la console en fenêtre, on peut en déduire que l'ossature (ou au moins le soubassement) du buffet de 1824 avait été conservée. [GRitz]
Cet orgue Roethinger était donc beaucoup plus conforme aux aspirations musicales du début du 20ème siècle. Il était presque contemporain de celui d'Erstein, le "Flagship" de la Réforme alsacienne de l'orgue. Et pour être alsacien, celui de Koenigshoffen l'était vraiment : quatre fonds de 8' au grand-orgue, Voix céleste, Hautbois ET Clarinette au récit expressif (un récit qui avait "mangé" son positif"). Gambes de pédale en 16' et 8', mais aussi... une Posaune 16' à anches libres, sûrement héritée de Koulen. (Ce devait être un de ces fameux et regrettés "Tuba", impitoyablement éliminés à l'époque néo-baroque, sûrement parce que trop "germaniques".) Il y avait une Fourniture grave (2'2/3) au grand-orgue, et - surtout pas - de Mixture au second clavier. En 1915, cet orgue était déjà totalement néo-classique, avec sa Tierce au récit : celle-ci avait été construite neuve, ce n'était pas une ré-utilisation d'un jeu antérieur. Ces couleurs néo-classiques pouvaient bénéficier de l'accouplement à l'octave aiguë. A l'époque, la facture alsacienne était leader - même face à Walcker, qui assumait s'en inspirer. Elle n'imitait pas. Et il y avait un Cornet et une Doublette au grand-orgue, hérités de l'orgue Stiehr, mais dont le statut est tout à coup passé d'atavisme (les Alsaciens sont conservateurs...) à celui de nouveauté !
Sa composition était un vrai cas d'école ; elle est représentative de la magnifique facture post-romantique alsacienne, aujourd'hui tellement méconnue :
Bien sûr, la console était indépendante. (Qui a envie de jouer de la musique avec la tête enfermée dans une armoire ?) Elle était placée sur le côté gauche, tournée vers le centre. [GRitz]
En 1932, l'inventaire de François-Xavier Mathias attribue logiquement l'orgue à Roethinger, et précise que la soufflerie est électrique. Même attribution pour Médard Barth dans les années 60. Ce n'est que plus tard, après une nouvelle reconstruction, qu'on a "ré-attribué" l'orgue à la maison Stiehr. [Mathias] [Barth]
Bien que neufs, les tuyaux de façade ont été réquisitionnés par les autorités le 12/07/1917. [IHOA]
L'instrument parait avoir donné toute satisfaction, puis qu'on ne note qu'un entretien, effectué par Curt Schwenkedel, en 1957, soit après le second conflit mondial. Alors qu'il été voisin, et installé depuis 1924, Georges Schwenkedel n'a jamais rien modifié à cet orgue Roethinger. [IHOA]
Curt Schwenkedel nota la composition complète en 1957, ainsi que quelques tailles. Et nota aussi qu'il voulait renforcer les Principaux (!). [SchwenkedelDO]
Historique
En 1988, l'instrument a été reconstruit par la maison Muhleisen, dans l'esprit Stiehr. [IHOA]
Si l'instrument neuf présente des qualités indiscutables, on ne peut que regretter la perte de l'orgue Roethinger de 1915. Faire du neuf, c'est bien, mais pourquoi au détriment de ce que l'Alsace a produit de mieux ? Et avait-on absolument besoin d'un Stiehr de plus ?
Dans les années 1980, ce sont les instruments "post-classiques" qui avaient la cote. C'était surtout une époque où la transmission pneumatique était "diabolisée". D'abord en raison d'une perte de compétence évidente des facteurs dans le domaine. Ensuite parce qu'une transmission pneumatique représentait le prétexte idéal pour discréditer puis démolir le "vieil" orgue, volontiers déclaré irréparable. Le problème, c'est qu'en plus de détruire des sommiers qu'on ne savait pas refaire, on supprimait les plus belles choses issues de la facture romantique : Clarinette, Flûte harmonique 8', Voix céleste, Quintaton, Gambes de pédale... et l'anche 16' de pédale. Tous les tuyaux ajoutés par Roethinger (à l'exception peut-être de certains de la Soubasse) ont été impitoyablement éliminés, comme la belle console de 1915, qui était encore en parfait état en 1975. [GRitz]
Cet orgue fut longtemps servi par un organiste de grand talent, très actif dans le monde musical pendant des décennies : Joseph Bridonneau. Ancien professeur de musique au collège Saint-Étienne, il se mobilisait pour que l'orgue alsacien ait un avenir, notamment aux côtés de l'association des Amis de l'Orgue Roethinger de Bischheim. Il a été le dernier organiste de l'orgue Weigle de St-Maurice avant les années noires de l'électronique américaine. Il avait tout fait pour essayer de le faire relever, et éviter ces années d'errements. Joseph Bridonneau est décédé en mai 2024. Il va beaucoup nous manquer.
Le buffet
Le buffet est de 1988 (sic), et n'est PAS celui de St-Jean. Même si certaines planches ont probablement fait le voyage. Le fait de savoir pourquoi il a été décidé de supprimer la merveille de 1916, idéalement assortie à l'édifice, reste un total mystère. (Comme tant d'autres "choix d'experts".) C'est d'autant plus aberrant que ces imitations brouillent complètement l'interprétation de notre patrimoine. Elles ne seraient aujourd'hui plus commises : quand on restaure, on identifie le complément. On peut en effet croire que le buffet actuel est celui de l'orgue Stiehr de St-Jean, ce qui n'est pas le cas. A priori, on ne sait pas à quoi ressemblait le buffet de l'orgue Stiehr de St-Jean.
Caractéristiques instrumentales
 La console de 1988.
La console de 1988.Il y a la télé.
Console en fenêtre frontale, fortement inspirée des consoles Stiehr (bien que les cliquetis, couinements et grincements lors des manipulations n'aient pas été reproduits.) Tirants de jeux de section carrée à pommeaux noirs, disposés en deux fois deux colonnes de part et d'autre des claviers. Claviers noirs. Aucune commande à pied. Pédalier plat à feintes courtes, idéales pour jouer en Do Majeur.
Les commandes du moteur sont sous la table de la console, à gauche.
Plaque d'adresse blanche à lettres manuscrites noires, placée au centre au-dessus du deuxième clavier, et disant :
reconstruit par la
Manufacture d'Orgues Muhleisen
Strasbourg 1988
Disposition des tirants à la console : (Note : le Basson est également appelé par le tirant noté "Hautbois / Dessus".)
16 pieds
❍
4 pieds
❍
❍
16 pieds
❍
8 pieds
❍
❍
8 pieds
❍
2 pieds
❍
❍
8 pieds
❍
❍
positif
❍
8 pieds
❍
8 pieds
❍
Dessus 8 pieds
❍
8 pieds
❍
à cheminée 4 pieds
❍
III rangs
❍
8 pieds
❍
3 pieds
❍
8 pieds
❍
8 pieds
❍
4 pieds
❍
2 pieds
❍
Mécanique, notes et jeux.
C'est probablement un des meilleurs orgues construits en Alsace dans les années 1980. Heureusement, la maison Muhleisen n'a jamais pratiqué le néo-baroque "hard-core", sur-aigu et intégriste, que l'on vit sévir ailleurs. Pas de Sesquialtera ou d'autres marottes "nordiques" caractérisant la "cuisine internationale" (comme l'appelait un de ses plus célèbres harmonistes) de l'époque. Ici, l'orgue a gardé une grande distinction, un Hautbois (il faut dire qu'il était "compatible Stiehr"), et deux Salicionaux, qui amènent de belles couleurs gambées. Il reste finalement encore un peu de Réforme alsacienne de l'orgue dans ce bel édifice !
Il est aussi clair, vu l'irréprochable qualité de la transmission, qu'on ne peut décemment pas attribuer cet orgue à la maison de Seltz...
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
- [Visite] "Visite sur place", 19/05/2024
-
[APlatz] Alexis Platz : Document "St-Joseph Koenigshoffen.doc"
Composition, et photos du buffet et de la console, datant du 12/05/2009.
-
[GRitz] Gilles Ritz : e-mail du 04/07/2005.
Avec un croquis du buffet de 1916
-
[JBridonneau] e-mail du 19/11/2004.
Composition et données historiques.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 189a-b
-
[ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 698
Il manque le Violoncelle 8' de pédale dans la composition
-
[PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 217
Le déménagement de l'orgue de St-Jean vers Koenigshoffen n'y figure pas.
- [CMAVS98] Claude Muller : "Louis Hebenstreit, curé de Saint-Jean à Strasbourg (1843 - 1859)", in "Annuaire de la Société des amis du Vieux Strasbourg", 1998, p. 108-12
- [SchwenkedelDO] C. Schwenkedel : "'Descriptions d'orgues', aux Archives Municipales de Strasbourg (189 Z 96)", vol. 4, p. 3335-6,3346-9
- [NAlsacien] "Der Elsässer / Le Nouvel Alsacien", 18/10/1906
-
[Mathias] F.X. Mathias : "Compte rendu du Congrès d'orgue tenu à l'Université de Strasbourg, 5-8 mai 1932.", éditions Sostralib, p. 34
15. Koenigshoffen, Saint-Joseph Roethinger, 27 Jeux, 2 Clav. Péd., à soufflets, tubulaire, électr.
-
[Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 361
Strasbourg-Koenigshoffen. - Kathol. Pfrki. St. Joseph, seit 1900. - Roethinger, O. mit 27 Reg., 2 Clav., Ped., tract. tub. Liste Roethinger, u. MATHIAS 34, beide ohne Datum.
![]() Localisation :
Localisation :