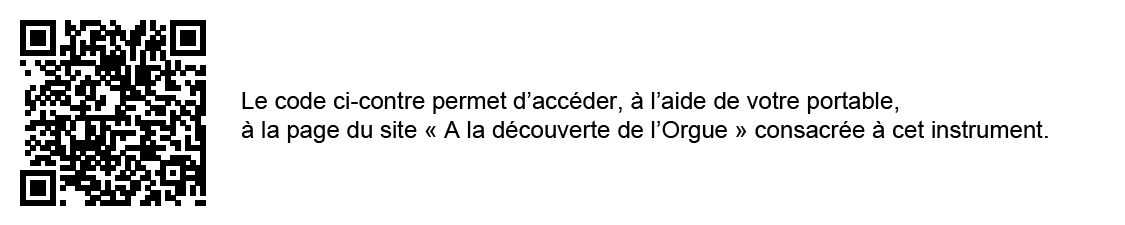Morschwiller, le buffet Klem de l'orgue Roethinger.
Morschwiller, le buffet Klem de l'orgue Roethinger.Toutes les photos sont de Martin Foisset, 21/10/2018.
L'église de Morschwiller-le-Bas abrite un instrument construit par Edmond-Alexandre Roethinger en 1924, qui est assurément d'un très grand intérêt historique et musical. Il s'agit d'un témoin remarquable des spécificités de la facture d'orgues alsacienne des années 1920-1930. Ceci est vrai tant sur le plan esthétique que technique : sa console était une des rares à être dotée d'une transmission mécanique jusqu'au buffet, où un système pneumatique prenait le relais. Cela permettait d'avoir à la fois le "toucher" mécanique et la souplesse d'utilisation de la pneumatique. Mais les innovations, on le verra, ne s'arrêtèrent pas là. Jusqu'à la fin du 20ème siècle, l'instrument avait été fort bien conservé, et n'avait subi aucune modification. Même le très néo-classique Larigot est parfaitement d'origine ! De fait, Morschwiller-le-Bas avait dans les années 20 pas mal d'avance sur le monde de l'orgue. Et, comme en témoignent les photos et trophées exposés à la tribune, la chorale était extrêmement dynamique, et la vie musicale avait l'air très intense. Ce qui justifiait d'acquérir un orgue "différent".
1833
Historique
Le premier orgue de Morschwiller-le-Bas (près de Mulhouse, "Niedermorschwiller" dans beaucoup des sources, à ne pas confondre avec Morschwiller près de Haguenau) a été construit en 1833 par Joseph Callinet. [IHOA]
![]() L'orgue "Silbermann" de Morschwiller n'a jamais existé. Beaucoup ont cherché un (Jean-André) Silbermann ici en raison d'une erreur figurant dans l'ouvrage fondamental de Martin Vogeleis : [Barth]
L'orgue "Silbermann" de Morschwiller n'a jamais existé. Beaucoup ont cherché un (Jean-André) Silbermann ici en raison d'une erreur figurant dans l'ouvrage fondamental de Martin Vogeleis : [Barth]
 Extrait de la page 592 de "Quellen un Bausteine zu einer Geschichte der Musik und Theaters im Elsass 500-1800".
Extrait de la page 592 de "Quellen un Bausteine zu einer Geschichte der Musik und Theaters im Elsass 500-1800".On peut y lire que l'ancien orgue Jean-André Silbermann du couvent des Dominicaines de Ste-Catherine (Catherinettes) de Colmar a été déménagé à Morschwiller-le-Bas. [Vogeleis]
Mais l'orgue des Catherinettes de Colmar, achevé le 29/09/1771, fut en fait racheté à la Révolution par la commune d'Altkirch, et installé dans l'ancienne l'église Notre-Dame de l'Assomption. Reconstruit par Heinrich Koulen en 1884 et victime de graves dégâts en 1914-18, il a été remplacé par l'opus 167 de Joseph Rinckenbach. Une partie du grand buffet actuel provient de l'orgue Silbermann.
En 1878 fut achevée la nouvelle église (munie d'un clocher hexagonal très élancé ; Charles Winkler en a été l'architecte). L'orgue y a été installé la même année. [IHOA]
L'instrument fut victime d'un pillage vers 1918 : Morschwiller-le-Bas avait été évacué en juin 1917, et lors du retour du curé, en 1919, l'église était très endommagée (durant le conflit, les clochers servaient soit de tour de guet, soit de mire pour l'artillerie). Il ne restait de l'orgue de 1833... que deux caisses de tuyaux. [IHOA]
Historique
En 1924, Edmond-Alexandre Roethinger posa à Morschwiller-le-Bas son opus 93, un instrument issu de la "Réforme Alsacienne de l'orgue", mais surtout doté de nombreuses innovations et spécificités. [IHOA] [Barth]
Dans l'œuvre de Roethinger, cet orgue est pratiquement contemporain de l'extraordinaire instrument qu'il construisit pour l'ancienne Synagogue (place des Halles) de Strasbourg (1925). C'était un orgue légendaire, unique (III/P 62j, 16' ouvert, 32' de pédale), le préféré d'Emile Rupp : "On chantait du Naumbourg, du Lewandowski, du Sulzer, le tout accompagné à l'orgue par Emile Rupp. Il jouait tellement fort qu'on se croyait ailleurs. C'était formidable." (Jacques Rosenzweig, in "La Synagogue du quai Kléber" de Jean Daltroff). Ces chants, cet orgue, ce magnifique édifice et ces gens qui ne sont jamais revenus manqueront toujours à Strasbourg et à l'Alsace. Ils ne manquent pas tout à fait, cependant, si on garde précieusement leur souvenir.
Quand on se donne de la peine de s'y intéresser, on découvre des années 20 illuminées par l'ouverture, la tolérance, et un enthousiasme fécond. On en déduit aussi qu'il suffit de 10-15 ans pour basculer d'un monde réjouissant au comble de l'horreur.
 Le centre du papier à entête Roethinger en 1923.
Le centre du papier à entête Roethinger en 1923.L'orgue de Morschwiller-le-Bas est déjà "néo-classique", et nettement en avance sur son temps, alliant une Fourniture progressive très grave avec des Mutations très aiguës, comme un Larigot.
Culturellement, les années 20 ont d'abord été marquées par un rejet de l'héritage "d'avant guerre", coupable, bien sûr, d'avoir conduit au conflit. (S'ils avaient su...) Pour l'orgue, cela se manifesta par un "retour aux sources" (le 18ème siècle) déjà évoqué par Schweitzer dans les années 1900. Les arguments avancés étaient souvent douteux, voir fallacieux, car issus de querelles entre "grands" organistes : l'intérêt personnel prévalait souvent sur les réelles motivations culturelles. Il y eut des expérimentations : par exemple à Strasbourg, St-Paul, au cours des modifications de 1899, 1907, 1912. Puis, pour Roethinger, il y eut le marché pour l'orgue d'Erstein, voulu par Victor Dusch, un organiste visionnaire. C'était la "Réforme alsacienne de l'orgue". En 1924, tout cela datait déjà un peu. En gros, cela avait consisté à ajouter des Mutations et quelques Mixtures à un orgue symphonique, pour "donner accès" au répertoire des maîtres anciens. Rapidement, les expérimentations portèrent leurs fruits, et cela engendra un style post-symphonique alsacien spécifique, surtout à partir de 1919, quand Joseph Rinckenbach put mettre en pratique les idées accumulées pendant le conflit mondial : Cornet et Doublette au grand-orgue, Plein-jeu au récit.
Il est "communément admis" de situer le commencement de l'époque néo-classique, à l'orgue, en 1932. Cette année-là, Victor Gonzalez achevait son 3 claviers pour l'église abbatiale de Solesmes. La simple lecture de la composition de l'orgue de Morschwiller-le-Bas prouve que 8 ans plus tôt, la facture "néo-classique" était déjà bien adulte en Alsace. Il n'y a pas de confusion : les chapes sont tamponnées avec le nom des jeux, et c'est donc bien une composition de 1924.
La base de l'instrument est issue du symphonisme allemand. C'est l'orgue pour lequel écrivit Rheinberger, qui inspira Reger, mené par Walcker, et popularisé en Alsace par des facteurs de talent comme les frères Link. Le fondement de l'instrument est un grand chœur de fonds, puissant et coloré. La Trompette est au grand-orgue. Sur les 12 jeux du récit, la plupart sont les "alter-ego" des jeux constituant le grand-orgue. Ils constituent des couples homogènes, mais de caractère différent : Quintaton 16'/Bourdon 16', Diapason 8'/Montre 8', Salicional 8' et Voix céleste/Gambe 8', Flûte harmonique 8'/Dulciane 8', Flûte 4'/Flûte à cheminée 4', Flageolet/Doublette, Larigot/Plein-jeu et Trompette/Hautbois. La Quinte-flûte et la Clarinette n'ont pas d'alter-ego : il s'agit justement d'une Mutation et d'un jeu typiquement symphonique. La Mixture ("Plein-jeu") du grand-orgue est dotée d'un rang gambé : ceci aussi fait très "Walcker".
Le Larigot
Pour constituer le "pendant" de cette Mixture au récit, au lieu d'y placer un petit Plein-jeu, Roethinger a choisi cet incroyable Larigot. En 1924, ce jeu fait un peu figure d'extra-terrestre. En tous cas, il n'a rien à voir avec les Larigots "de combat" que l'on trouvera dans les années 1970 dans les orgues "néo-baroques". En fait, c'est un rang de Mixture, conçu pour un récit expressif, et évidemment harmonisé en conséquence. Roethinger construisit au moins deux autres Larigots "post-symphoniques" : à Marlenheim (1925, où il est plus flûté) et Saint-Bernard (1927). Celui de Morschwiller-le-Bas fut probablement le premier. Loin d'être un jeu "isolé" issu de quelque idée à la mode, ce Larigot signe un véritable changement d'esprit lors de la conception de cet instrument.
Zinc et spotted
Le monde de l'orgue de la fin du 20ème discréditait systématiquement tout usage du zinc, ou de ce que l'on appelait les "mélanges pauvres" (lire : alliages à faible teneur d'étain). Le principal argument était que la facture du 18ème ne faisait pas usage de zinc. En fait, le zinc avait surtout l'inconvénient... d'être trop bon marché. On parlait de tuyauterie "au rabais", on considérait que son choix n'était justifié que par des raisons économiques. Il est vrai que parfois, dans un contexte où on "tirait les prix vers le bas", on n'apportait pas le soin nécessaire à son harmonisation (qui est difficile). Réciproquement, quand on cassait la tirelire pour se payer de l'étain, on y faisait attention... Un exemple est frappant : de nombreuses façades remplaçant celles réquisitionnées en 1917 ont été réalisées en zinc, mais surtout dans l'idée d'une solution "provisoire". Ce provisoire ayant été amené à durer, la réputation du zinc en souffrit. Le problème, toutefois, n'était pas dans le matériau utilisé pour ces façades, mais plutôt dans la façon dont elles étaient harmonisées.
Or, force est de constater que le zinc peut parfaitement être bien harmonisé, et donner des résultats sonores au moins à niveau des métaux dits "nobles" en facture d'orgues (étain, étoffe). De nombreux jeux Rinckenbach, Schwenkedel ou Roethinger ont des basses en zinc, et des dessus en étain ; or, il est impossible, juste à l'oreille, de trouver où se fait la transition. De plus, à performances égales, le zinc est plus léger et plus résistant : il ne s'écrase pas aussi facilement que l'étain trop pur ou trop usiné, et permet de réduire les contraintes sur les structures.
A Morschwiller-le-Bas, il n'y a presque pas d'étain, même pour les dessus. Les deux Bourdons 8' manuels (du grand-orgue et du récit), à l'harmonisation tellement fine, ont des dessus entièrement en zinc (ce qui est très rare). L'argument économique ne tient pas : pour les petits tuyaux, le coût de la matière devient négligeable par rapport à la façon. L'usage du zinc est donc à coup sûr, ici, un choix esthétique, parfaitement assumé, et réussi. Décidément, cet instrument a beaucoup à nous apprendre.

L'orgue a été relevé en 1993 par Christian Guerrier. [IHOA]
Malheureusement, cet instrument remarquable a été victime vers 2000 d'une regrettable "électrification" qui lui coûta une bonne partie de son authenticité. [Visite]
A la visite, la triste réalité s'impose : l'intéressante transmission mécano-pneumatique décrite par l'inventaire de 1986 (et qui y était donc encore à ce moment) a été supprimée, et remplacée par un système électrique acheté chez chez un sous-traitant. Des électro-aimants tirent à présent les cônes des sommiers. La solution mécano-pneumatique est très rare (c'était très "haut de gamme"), mais on en trouve un exemple, réalisé par Joseph Rinckenbach à Scherwiller en 1921. Comme à Hindisheim, la disposition est analogue à celle que l'on trouvait à Morschwiller-le-Bas : les touches actionnent des balanciers qui tirent des vergettes placées sous le plancher, en direction de l'orgue. A l'entrée du buffet, un relais pneumatique permet de réaliser une transmission avec des tubulures courtes (donc moins sujettes aux retards - qui ont d'ailleurs été fortement exagérés -). Pour l'organiste, le jeu est très agréable. Dans la console, les éléments pneumatiques sont limités au tirage de jeux et aux accessoires, et l'ensemble facile à maintenir.
La belle console de l'orgue Roethinger (une photo figure dans l'inventaire) a malheureusement été considérablement modifiée :
- Les claviers ont été remplacés par un modèle très "plastique" d'un blanc "éclatant" et au toucher "mort".
- La rangée de dominos a été interrompue, pour grouper les jeux par plans sonores. Les porcelaines étant déjà dotées d'un code de couleur permettant de se repérer aisément, l'intérêt est très douteux. S'il s'agissait d'un problème d'accessibilité visuelle, un repérage en braille aurait été préférable. Le regroupement des dominos était certes pratiqué par Schwenkedel sur ce genre de console, mais pas par Roethinger. Cette modification fait donc perdre son identité à la console. Mais le plus grave, c'est qu'avec l'espacement, il n'y avait plus de place pour la superbe plaque d'adresse Roethinger (qui était placée à l'origine à gauche des dominos). De façon incroyable, ce fait n'a pas empêché la modification, et la plaque a été déplacée... en bas à gauche de la console (au niveau des pieds) !
- Une plaque "crescendo général" a été réalisée avec du plastique rouge (solution à l'époque beaucoup utilisée pour les écriteaux), avec un mépris total pour l'esthétique de cette belle console.
Il s'agit du plus visible. Dans le buffet, il y a plus grave : les relais pneumatiques ont été supprimés, ainsi que les tubulures, et le tout remplacé par des câbles électriques et des électro-aimants. Outre la perte d'authenticité, ce choix désastreux se paye dès aujourd'hui. L'instrument souffre (2018) de graves problèmes d'alimentation en vent et de transmission - un comble pour une opération qui, probablement, était censée l' "améliorer". Dire que certains continuent à discréditer les transmissions pneumatiques (sûrement parce qu'ils ne savent pas les entretenir), et encensent des système mécaniques ou électriques dont on constate pourtant qu'il en existe des très mauvais, à la fiabilité très douteuse.
De plus, si ces nombreuses modifications ont été aussi inutiles que préjudiciables, l'entretien nécessaire n'a visiblement pas été effectué à l'époque : le nettoyage en profondeur des sommiers et de la tuyauterie attend toujours.
Aujourd'hui, l'orgue Roethinger est abandonné. On le comprend : il faut bien avouer que cet instrument "électrifié", a perdu beaucoup de son charme et de son authenticité, et souffre aujourd'hui de nombreux inconvénients (toucher flasque, fiabilité aléatoire) qu'aucun avantage ne vient compenser. Pour être conscient de sa valeur, il faut une part d'imagination.
Du coup, il y a une chose électronique dans le chœur... Revenir sur les errements de la dernière modification serait probablement fort coûteux. Mais ce serait également fort profitable, du point de vue des compétences et de l'impact culturel. Peut-être que dans l'avenir, lorsque l'intérêt de ce style d'orgues sera enfin reconnu, la prise de conscience de sa valeur patrimoniale rendra-t-elle sa restauration possible ?
Le buffet

Le buffet de l'orgue Roethinger est en chêne, et a été réalisé par la maison Klem. Il a été est conçu pour dégager la baie centrale (dans la tour). Ces rosaces "ouest", placées en fond de tribune, sont un atout architectural majeur, car elles amènent aux églises une lumière spécifique, et soulignent les volumes en renforçant l'impression de profondeur. Pour les facteurs d'orgues, elles ont souvent constitué des défis, voire des contraintes ennuyeuses. (On se rappelle la triste histoire de Pfaffenhoffen.) Ici, c'est tout le contraire : la rosace a été source d'inspiration, et a servi d'idée directrice pour le dessin.
Il y a deux corps, réunis par une rangée de tuyaux, venant souligner la courbure de la rosace. L'influence stylistique semble revenir au "maître" d'Edmond-Alexandre Roethinger, Heinrich Koulen, et en particulier à son buffet pour Strasbourg, St-Pierre-le-Jeune cath. (1894).

En 1910, Roethinger avait justement reconstruit cet instrument, en conservant son magnifique buffet. Ce dernier ne fut éliminé qu'en 1945, lors d'une nouvelle reconstruction. (C'est un orgue de ville !). Ce devait être un des derniers projets auxquels Edmond-Alexandre participa. Cette fois, visiblement, et peut-être avec une certaine nostalgie, c'est Morschwiller-le-Bas qui servit d'inspiration :
 Photo prise par Alexis Platz en 2011 ; l'orgue n'existe plus.
Photo prise par Alexis Platz en 2011 ; l'orgue n'existe plus.Les éléments latéraux sont composés de deux plates-faces, encadrant un élément prismatique (basé sur un demi-hexagone), et une plate-face sur le côté interne. Ces deux éléments sont reliés par une rangée de tuyaux, en "U", dont 18 parlent.
Le style se caractérise par une boiserie qui s'efface un peu au profit des tuyaux, ainsi qu'un dépassement de ces derniers au-delà d'une "ceinture" placée aux 4/5 de la hauteur. Cela donne un petit air "symphonique anglais" au buffet (cette ceinture aux 4/5 de la hauteur des tuyaux y était déjà pratiquée à la fin du 19ème). La tendance à l'effacement de la boiserie va s'accentuer au fil des années (Gueberschwihr, 1943), pour aboutir à sa totale absence au-dessus du soubassement (à la "vraie" époque néo-classique : les années 1950).
Mais ici, le buffet ne s'excuse pas d'exister, au contraire. Il y a des ornements en tri-lobes, et surtout ces six grandes fleurs de lys, qui sont la "signature visuelle" du buffet de Morschwiller-le-Bas. Notons que le lys n'est pas forcément associé à la royauté : il est aussi un symbole de miséricorde.
Caractéristiques instrumentales
 La belle console Roethinger, malheureusement altérée.
La belle console Roethinger, malheureusement altérée.Les claviers modernes sont en plastique blanc brillant.
La plaque d'adresse a été déplacée... en bas, au niveau des pieds.
Et le crescendo est désigné par une plaque rouge style "extincteur".
Console indépendante dos à la nef, fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par dominos, placés en ligne au-dessus du second clavier. Ils étaient à l'origine disposés sans séparation, comme c'est l'usage chez Roethinger (voir à Saint-Bernard). Ils sont repérés par des porcelaines centrales, rondes, à fond blanc pour le grand-orgue, orange pour le récit, et jaune pour la pédale. Tirasses et accouplements sont aussi commandés par dominos (commande double). Claviers blancs (récents, et dont le brillant ruine malheureusement l'ambiance de cette magnifique console).
Il s'agissait à l'origine de l'une de ces trop rares consoles mécaniques actionnant une transmission pneumatique (à l'entrée du buffet). Elle a été altérée à une époque indéterminée (vers 2000 ?) pour en faire une console entièrement électrique !
Commandes des tirasses et accouplements doublées par pédales-cuillers à accrocher, en bois recouvert de métal, et repérées par des porcelaines rondes, séparées en diagonale et colorées selon le code de couleur des plans sonores. De gauche à droite : "Oct. grav. Réc. Grd. Orgue" (II/I 16'), "Oct. aig. Réc. Grd. Orgue" (II/I 4') (la séparation en couleurs se fait dans l'autre sens), "Récit Pédale" (II/P), "Grd. Orgue Pédale" (I/P) et "Récit Grd. Orgue". Viennent ensuite les deux pédales basculantes : celle du crescendo (repérée par un énorme écriteau en plastique rouge : comment peut-on utiliser une chose pareille pour un instrument de musique ?) puis celle de la commande de la boîte "Expression Récit" (porcelaine à fond orange). Le trémolo du récit ne peut pas être commandé au pied (c'est un domino).
Commande des combinaisons fixes par pistons, situés au centre sous le premier clavier : "P.", "MF.", "F.", "Plein-jeu", "Grd. jeu", et "A." pour l'annulateur, qui est noir alors que les autres sont blancs. (Le terme "Grand-jeu" pour désigner le Tutti est courant chez Roethinger. Cela n'a bien entendu rien à voir avec le "Grand jeu" de l'époque classique française.) A droite de l'annulateur, le piston d'appel de la combinaison libre ("Comb. enreg."). Programmation de la combinaison libre par mini-tirants en bois tourné, disposés au-dessus de chaque domino. Le trémolo du récit et les accouplements sont donc programmables. Banc à pieds en forme de lyre.
La plaque d'adresse, noire à lettres dorées, était placée en haut à gauche, comme en atteste la photo de l'inventaire de 1986. Elle est aujourd'hui... au-dessus du pédalier. Elle dit au pied gauche de l'organiste :
FACTEUR DE GRANDES ORGUES
STRASBOURG
OPUS 93 1924
 La plaque Roethinger à Morschwiller-le-Bas.
La plaque Roethinger à Morschwiller-le-Bas.A l'origine : pneumatique sur console mécanique : des vergettes actionnaient les valves commandant la dépression des tubulures, à l'entrée du buffet.
Depuis la malheureuse modification : électrique (avec de temps en temps une part de pneumatique). Les éléments ont été fournis par un équipementier allemand.
Les sommiers sont d'origine, à cônes ("pneumatische Kegelladen"). Mais ils ont été modifiés lors de l'électrification de la traction.
C'est un instrument à l'architecture très intéressante et élaborée. Cette disposition résulte du choix de conserver la valeur architecturale de la rosace, et l'occasion était belle de profiter d'un intéressant contexte acoustique (clocher / tribune). Le schéma suivant, montrant l'orgue avec un buffet transparent, indique la disposition des plans sonores :
 En rouge, le volume occupé par le grand-orgue,
En rouge, le volume occupé par le grand-orgue,en marron, celui du récit, en bleu, la pédale. En vert, la soufflerie.
La partie droite abrite les basses du grand-orgue (C-h, chromatique, basses à droite) et l'essentiel de la pédale (diatonique, en mitre). Celle de gauche le récit expressif, qui est chromatique (basses à gauche). Certains des tuyaux faisant la jonction entre les deux buffets (sous la rosace) parlent : ce sont les basses du Prestant du grand-orgue. Le dessus du grand-orgue (c'-g'''), également chromatique, est placé au centre, derrière cette rangée de tuyaux, basses à l'arrière.

Cette vue plongeante montre la disposition des éléments en profondeur, et en particulier la situation privilégiée des dessus du grand-orgue, en avant de l'arc.
Entailles de timbre quasi systématiques. Bourdons à calottes mobiles, Gambes à freins harmoniques. Biseaux à dents. La tuyauterie métallique est soit en zinc, soit en spotted.
 Les dessus (c'-g''') du grand-orgue.
Les dessus (c'-g''') du grand-orgue.Vue prise en direction du fond de l'instrument.
Le récit est à gauche, la pédale à droite (on en aperçoit quelques tuyaux).
A l'avant des chapes, le système de tirage des jeux. De gauche à droite :
La Trompette, le Plein-jeu (à 3 rangs), la Doublette,
la Flûte à cheminée 4' (dont les dessus sont ouverts et coniques),
le Principal 4', le Bourdon 8', la Dulciane, la Gambe,
la Montre 8' et le Bourdon 16'.
 Les basses (C-h) du grand-orgue.
Les basses (C-h) du grand-orgue.Vue prise depuis le centre de l'instrument, vers la droite.
La façade est à droite. (On en voit le revers.)
Les tuyaux à l'extrême gauche font partie de la pédale.
Puis, de gauche à droite : la Trompette, le Plein-jeu,
la Doublette, la Flûte à cheminée 4' (dont les 12 premiers tuyaux sont bouchés),
le Bourdon 8', la Dulciane, la Gambe, le Bourdon 16',
et la Montre 8, dont une partie est en façade.
En bas à droite, on aperçoit deux tuyaux du Prestant,
constituant l'amorce de la rangée de tuyaux centrale.
 Une vue de la tuyauterie du récit, vers la gauche,
Une vue de la tuyauterie du récit, vers la gauche,prise depuis la passerelle arrière du récit (entre ses tuyaux et l'arrière de l'orgue).
Ce sont donc les jeux placés tout à l'arrière de l'orgue.
Si l'on fait abstraction des tuyaux au tout premier plan en bas à gauche,
on a ici l'octave grave (C-H) des "petits jeux" et des anches.
Les 6 tuyaux du bas sont les "H" (Si de la première octave).
De gauche à droite : le Quintaton 16' (en bois), qui masque les jeux non visibles sur cette vue,
la Flûte 4' (ici bouchée), la Quinte-flûte 2'2/3 (conique), le Flageolet 2',
le fameux Larigot, le Basson, et la Clarinette.
En encart à droite, les jeux de construction spécifique.
En haut, la Flûte 4', avec sa lèvre supérieure retroussée.
En bas, le curieux pied à noyau en bois (noir) tourné du Basson.
Le Quintaton du récit a donc une position centrale. Derrière lui, se trouvent les "petits jeux" et les anches (côté accès). En avant du Quintaton se trouvent : la Flûte 8', le Salicional, le Bourdon, le Diapason, et la Voix céleste.
A la pédale, la Bombarde est bien sûr sur la chape avant (la plus accessible). Derrière elle se trouve la Soubasse 16' (bouches vers l'avant), puis le Violoncelle 8', la Basse douce 8', la Flûte 4', et, tout au fond, la grande Flûte ouverte de 16'.

Il s'agit d'un instrument passionnant, impressionnant, plein de spécificités. Quel dommage qu'il ait été ainsi altéré il y a une vingtaine d'années seulement... Il témoigne pourtant d'une époque fondamentale - mais encore méconnue - de la facture d'orgues alsacienne : les années 1920. Les orgues de cette époque ne sont pas très nombreux a être restés authentiques, la plupart ayant été victimes de la vague "simili-nordique" et "néo-baroque" de la fin du 20ème siècle. Si, à Morschwiller-le-Bas, l'instrument a payé un lourd tribut à ces modes absurdes, puisqu'il y a laissé sa transmission originale pour un système douteux, au moins sa composition a-t-elle été laissée intacte. C'est vraiment un atout majeur : la tuyauterie est certes empoussiérée, mais elle a été laissée dans l'état d'origine, avec ses originalités. Les biseaux n'ont pas été grattés, les entailles sont restées préservées.
Cet instrument démontre avec brio qu'il n'y a pas de "solution unique" en facture d'orgues : on peut échapper aux sommiers à gravures et aux tuyaux en étain. Bien harmonisés, bien disposés, des tuyaux en zinc ou en spotted donnent des résultats excellents, et sont beaucoup moins sensibles à l'écrasement et aux déformations. Pour preuve : la magnifique Flûte pastorale 4' du récit, étroite et bouchée, qui tend vers le Quintaton. Cela semble tout à fait spécifique à Roethinger.
Quand on connaît les sommes considérables que le monde de l'orgue dépense chaque année dans des "restaurations" débouchant sur des "Silbermann retrouvés" ou des "Callinet reconstitués", on se dit qu'on pourrait, pour une fois, consacrer quelques ressources à sauvegarder un orgue réellement alsacien et original. Cet instrument est à l'évidence déjà historique (bien plus que certains "fantômes" du 18ème), et le retour à sa configuration d'origine est aussi souhaitable que possible. Au passage, de nombreuses compétences seraient acquises ou sauvegardées, permettant au monde de l'orgue avenir de préserver une nécessaire diversité.

![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 21/10/2018
Remerciements à Mme Beck.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 17/11/2018.
Photos du 13/10/2018 et données techniques.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 116b-117a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 252-3
- [Vogeleis] Martin Vogeleis : "Quellen un Bausteine zu einer Geschichte der Musik und Theaters im Elsass 500-1800", éditions F.X. Leroux, Strasbourg, 1911, p. 592
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 280
![]() Localisation :
Localisation :