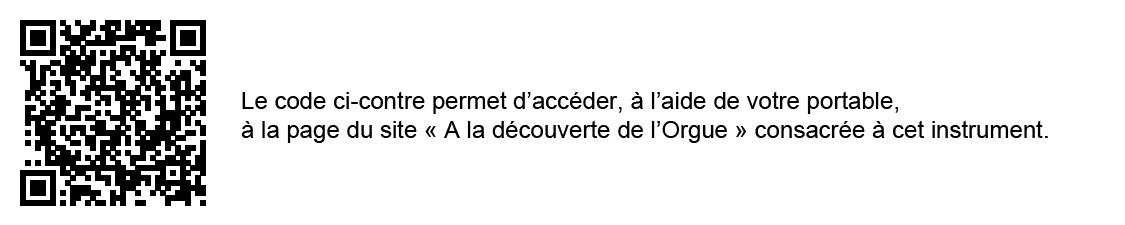Buffet inscrit à l'Inventaire Supplémentaire, 05/11/1981.
 Heiteren, l'orgue Martin Rinckenbach dans son buffet d'Antoine Herbuté.
Heiteren, l'orgue Martin Rinckenbach dans son buffet d'Antoine Herbuté.Les photos sont de Martin Foisset, 03/06/2018.
Il est d'usage d'attribuer l'orgue de Heiteren à Antoine Herbuté, de Marckolsheim. Parce que l'histoire de cet aubergiste, devenu facteur d'orgues par passion, est belle à raconter. Mais, évidemment, on ne devient pas facteur d'orgues en recopiant quelques devis, et il est clair que la réalité est un peu plus complexe que l'image d'Epinal. L'orgue de Heiteren est un instrument exceptionnel. Mais il ne doit pas grand chose à Herbuté. Car, après "l'aventure Herbuté" - qui dura tout de même en tout 30 ans -, Heiteren s'adressa à un homme de l'art - un vrai - et choisit le meilleur : Martin Rinckenbach. Ce dernier eut pour tâche de faire réellement fonctionner cet instrument. Et avec discrétion. Ce qui se comprend, car nul commanditaire ne souhaite faire trop de publicité d'une opération plus que chaotique. Après tout, c'est le résultat qui compte : Rinckenbach reconstruisit l'instrument en 1875, et dota Heiteren de l'orgue dont tout le monde rêvait.
Historique
L'histoire des orgues à Heiteren est déjà ancienne, car un premier instrument est attesté dès 1731. C'était certes un tout petit orgue, de 6 registres seulement (disposition relevée en 1776). [IHOA] [HOIE]
L'instrument a été réparé en 1762 par Christian Langes. [IHOA] [HOIE]
Une nouvelle réparation a été nécessaire en 1776, menée par Weinbert Bussy. [IHOA] [HOIE]
Et après la Révolution, en 1801, c'est à Andreas Bernauer que l'on confia l'instrument. [IHOA] [HOIE]
On retrouve un Blasius Bernauer (1740-1818) au couvent de Luppach, où il construisit un orgue en 1770 (son buffet est aujourd'hui à Grentzingen). Son fils s'appelait Xaver.
La nouvelle église a été achevée en 1843. En 1844, Antoine Herbuté reprit le petit orgue à l'occasion de la fourniture d'un instrument neuf. [PMSAEA69]
1844
Historique
En 1844, Antoine Herbuté construisit un orgue en s'inspirant d'un des fameux devis imprimés des frères Callinet. C'est le maire Blanchard de Heiteren qui le lui avait fourni. [IHOA] [HOIE] [ITOA]
Avec 3 claviers et 30 jeux donnés par le devis du 04/08/1842, c'était un très grand projet. Un effort considérable pour une localité qui comptait, à l'époque, environ 1100 habitants. La composition, "calquée" sur les Callinet, était évidemment classique pour l'époque. Martin Vogt avait servi de conseiller. Le traité fut conclu le 10/08/1842.
Herbuté s'était, à l'évidence, positionné comme une alternative aux Callinet en Haute-Alsace. Nous sommes au cœur de l'époque "pré-romantique", un temps de transition entre l'orgue classique hérité du 18ème (mais finalement peu adapté à ce que demandaient les paroisses rurales) et l'orgue romantique, qui s'épanouira à partir de 1850.
Les ateliers des maisons Stiehr à Seltz, Wetzel à Strasbourg, des frères Callinet à Rouffach, et celui de Valentin Rinkenbach à Ammerschwihr tournaient à plein régime, car même les plus petites localités voulaient un orgue. Sûrement grâce à l'influence d'Abbey, relayée par les Verschneider, les progrès techniques avaient rendu le rêve accessible. Tous ces facteurs s'étaient donc fait une spécialité de fournir de petits orgues "de campagne" à un prix raisonnable, mais sans faire aucune concession à la qualité.
Dans ces conditions, les innovations (autres que celles permettant de tirer les prix vers le bas) n'étaient pas une priorité. L'orgue alsacien, entre 1820 et 1860 ne sortait que rarement des sentiers battus. Ce n'est pas pour rien que les frères Callinet avaient fait imprimer les devis de leurs modèles "standards". Il y avait, du coup, une place pour des facteurs imaginatifs, motivés, capables de "faire rêver" en échappant à un certain conservatisme, qui, déjà, s'installait. Antoine Herbuté, aubergiste de formation, vouait une passion aux orgues. Il réalisait son rêve en devenant facteur. Car, vu depuis la cuisine et à la lecture de devis, construire un orgue n'avait pas l'air si compliqué que cela.
Le devis présente, pour de nombreux jeux, le caractère que son harmonisation devra lui donner. Les qualificatifs sont directement inspirés des devis Callinet. Ainsi, Montre et Prestant seront "d'une harmonie flûtée dans les dessus et tranchante vers les basses", le Cornet "d'une harmonie vive", la Flûte 4' du grand-orgue "d'une harmonie douce", la Doublette et la Fourniture "d'une harmonie argentine", la Gambe "d'une harmonie tranchante", et la Trompette du grand-orgue "d'une harmonie ronde et agréable". Chez les Callinet, pour la Trompette manuelle, on retrouve soit cette même description, soit "prompte et éclatante".
Outre l'aspect purement "publicitaire" de la chose, on devine chez Herbuté une réelle passion pour le sujet. On relève en passant que la Gambe "tranchante" est bien conçue comme une "gambe d'attaque", pré-romantique dans sa conception, comme on en trouve chez les Callinet, qui utilisaient là aussi le même qualificatif dans leurs devis. Elles sont fort différentes des Gambes "cordes" de l'orgue symphonique.
Le Basson doit être "d'une harmonie ronde et moelleuse". A la pédale, le Bourdon 16' sera "d'une harmonie forte et pleine", et pour les anches, pas de doute : elles seront "françaises", excepté l'orthographe : la Trompette "d'une harmonie éclatante" et la "Pombard 16" "d'une harmonie forte et tranchante". L'objectif était donc clairement de faire comme les Callinet, l'orgue idéal d'Herbuté devait ressembler à celui de Ste-Croix-en-Plaine (Callinet frères, 1840, à quelques kilomètres de Heiteren).
Le devis était enthousiasmant, et Herbuté avait l'air motivé. Mais il manquait quand même sérieusement de références pour se voir confier la réalisation d'un 3-claviers. Que pouvait-il montrer en 1842 ? Sur le papier, 8 des 11 instruments qu'il a construit durant sa courte carrière :
- En 1831, Schoenau, 1 clavier et pédale de 13 notes.
- En 1831 Reichsfeld, un tout petit orgue, arrangé par la maison Stiehr dès 1843, et que l'on cherchait à remplacer dès 1864.
- En 1834, Bootzheim, 1 clavier et pédale de 13 notes, qualifié de "misérable" en 1892.
- En 1836, Durrenentzen, encore un tout petit orgue, construit par Herbuté en atelier sans savoir où il allait le placer, et placé à Durrenentzen, où il fut remplacé dès 1900. Notons que, sur cet orgue, le Basson ne comportait qu'une seule octave.
- En 1837, Artolsheim, réalisé avec 10 jeux de l'orgue précédent du lieu, et qui nécessita déjà des réparations en 1845. Il est fort probable que ce soit Valentin Rinkenbach qui l'ait réellement achevé, en 1851.
- En 1837, Uffheim, II/P 22j, pédale de 13 notes. En 1892, l'instrument était noté comme "nécessitant une réparation". Sa reconstruction, en 1996, a été présentée comme une restauration, mais il est clair que l'orgue actuel ne doit pas grand-chose à Herbuté.
- En 1841, Marckolsheim, où Herbuté jouait à domicile et devait passer tout son temps libre, s'il lui en restait. L'instrument nécessita des réparations, qui furent faites dès 1854. En 1858, on appela la maison Stiehr. En 1914, on demanda à Martin et Joseph Rinckenbach de le reconstruire totalement.
- En 1842, Steinbrunn-le-Bas, 1 clavier et pédale de 13 notes.
- L'orgue de Baltzenheim (1843) devait être en construction, puisqu'il a été commandé en mai 42. C'était également un orgue à un seul manuel. Après Heiteren, il y eut encore Fessenheim, qui fut le dernier orgue neuf d'Herbuté. De fait, dans toute sa production, essentiellement limitée à des instruments à un seul manuel et une pédale de 13 notes, il ne pouvait probablement faire valoir qu'Uffheim et Marckolsheim. [PMSAEA69] [PMSAEA70]
Avec raison, le maire Blanchard devait avoir de sérieux doutes sur la capacité d'Herbuté à livrer à temps un orgue de qualité : il rédigea un contrat compliqué, cherchant à le "border" de tous côtés, à grand renfort de clauses impitoyables. Le positif devait être achevé le 25/07/1843 (la St-Jacques, patron de l'église) et le reste l'année suivante (toujours à la St-Jacques).
Les ennuis commencèrent rapidement. Réaliser un orgue de cette importance sans l'expérience nécessaire est probablement faisable avec beaucoup de motivation et tâtonnements (et quelques ouvriers qualifiés recrutés à l'occasion). Mais le faire en temps et en heure, aux coûts prévus, c'est une toute autre histoire. Le positif qui devait être achevé à la St-Jacques 1843 était "en pleine voie de construction" le... 10/12/1843. Si rien n'était fini, beaucoup était commencé : les sommiers et la mécanique du grand-orgue, les soufflets. Si bien que le maire Blanchard fut encore - pour un moment - indulgent : "le zèle du constructeur ne se démentait pas dans cette grande entreprise". Le 22/04/1844, le successeur de Blanchard, le maire Bollecker, affirma que les travaux étaient "avancés à moitié", et accepta de payer un deuxième acompte. Evidemment, usant d'une méthode bien connue, Herbuté présenta un "mémoire de travaux supplémentaires", pour une somme conséquente (7%). Il avait sous-estimé les coûts ; erreur probablement due au manque d'expérience. Ce qui est extraordinaire, c'est que la commune accepta la plus-value, le 30/10/1844. [PMSAEA69]
La réception eut lieu le 08/11/1844 (donc, bien après la St-Jacques...), par Martin Vogt (Colmar) et Théodore I Thurner, organiste à Soultz (il s'agit donc du père du compositeur Théodore Thurner, ce dernier n'ayant que 11 ans à l'époque ; père et fils s'appelaient Théodore). Les deux experts ne relevèrent... absolument aucun défaut : tout était réalisé selon les règles de l'art, et l'harmonie était "douce, admirable et tranchante". [PMSAEA69]
Un miracle, en quelque sorte. Antoine Herbuté était donc, quelque part, l'abbé Larroque alsacien.
Voici la composition en 1844
Malgré le procès-verbal de réception, vraiment trop beau pour être vrai, tout n'était pas si parfait que cela. En effet, à court d'argent, Herbuté fit ce que de nombreux entrepreneurs aux abois sont obligés de faire : revendre les créances. Dès le 15/02/1844, il avait cédé sa créance pour Heiteren à la Caisse d'épargne, évidemment contre une belle avance. Le problème, c'est qu'apparemment il le fit deux fois, puisque le 03/09/1847, il y eut un second acte de cession, pour un certain Mequillet, de Colmar. La seconde avance servit - en partie - à rembourser la première... On n'est quand même pas loin d'un système de Ponzi. L'ancien maire Blanchard eut vent de la chose, et bientôt, ce sont les notaires et les huissiers qui entrèrent en scène. Herbuté s'enfuit avant 1851 : "Herbuté de Marckolsheim" était devenu "Herbuté ... autrefois à Marckolsheim". [PMSAEA69]
Malgré les clauses précautionneuses du maire Blanchard (qui ne peuvent pas grand chose quand une partie disparaît sans laisser d'adresse), le grand projet avait bien mal tourné. L'instrument fonctionnait-il aussi bien que la réception de 1844 le laisse croire ? Probablement pas : l'analyse de l'existant montre un orgue construit, dans les moindres détails, selon les standards de 1875. Comment expliquer cela si l'orgue avait réellement donné satisfaction en 1844 ? L'hypothèse la plus plausible est la plus simple : lors de la réception, la consigne a probablement été de "ne surtout pas faire de vagues". On s'arrangerait plus tard. Ce qui fut fait, on le verra, et de fort belle façon. Transformer une quasi-déconfiture en un pareil succès, c'est encore plus difficile que de mener un projet à bout comme prévu. Ce fut donc une seconde aventure pour Heiteren, qui dura de 1844 à 1925, et qui a été jusqu'ici soigneusement passée sous silence.
En 1865, François Antoine Berger fit "des réparations". [IHOA] [HOIE] [ITOA]
Ces travaux consistèrent en un époussetage, un nettoyage, et une réparation (4 soufflets), ainsi que l'accord des 32 registres. Rien de surprenant pour un orgue de 10 ans. [PMSAEA69]
En 1875, c'est Martin Rinckenbach qui fit, aussi, "des réparations". [IHOA] [HOIE] [ITOA]
Ces travaux consistèrent officiellement en un nettoyage (des 32 registres), à poser une Trompette neuve, de grosse taille, à la place de l'ancienne (qui ne devait pas être d'une harmonie si "ronde et agréable" que ça), à décaler la Gambe d'un demi-ton (pour corriger les tailles). Le prix annoncé (1022 Marks) est cohérent avec cette description. [PMSAEA69]
Sur place, on est d'abord impressionné par la qualité de l'entretien de l'église, la hauteur de la tribune (presque 8 mètres), ainsi que par la belle acoustique du lieu. Puis par le buffet de l'orgue, qui est totalement atypique, et ne manque pas d'originalités, comme ces lignes obliques dans les plates-faces. Une fois à la console, et même quand on s'attend à trouver un bel orgue, la surprise est de taille. Et c'est une bonne surprise. Pour qui connaît les orgues de Martin Rinckenbach, le commentaire est alors : "Mais... ça sonne exactement comme un Martin Rinckenbach !". Extraordinaire : cet Antoine Herbuté, aubergiste de formation, aurait donc réussi à égaler le plus grand facteur alsacien, formé chez Cavaillé-Coll et Haas... 30 ans avant lui ? Puis, tout à son enthousiasme, on entrouvre les buffets, et on peut voir la mécanique de Martin Rinckenbach, des entailles de timbre en forme de trous de serrure, des biseaux à dents... Bref, un orgue romantique que l'on daterait à coup sûr entre 1870 et 1890. Il ne reste que deux possibilités : soit Antoine Herbuté a appris son métier à Martin Rinckenbach, soit l'orgue de Heiteren a été construit par Martin Rinckenbach...
Historique
En 1875, Martin Rinckenbach reconstruisit l'instrument, dans sa quasi-totalité. [Visite]
Que doit l'orgue actuel à Herbuté ? Les buffets, assurément. Et Herbuté a finalement fourni un service... de tuyautier. Si une bonne part de la tuyauterie date effectivement de 1844, il faut plutôt comprendre que cela concerne le façonnage et l'assemblage. Les techniques de facture et d'harmonisation sont clairement romantiques, et n'étaient pas employées en Alsace en 1844. Si l'histoire d'Herbuté est intéressante à raconter, il ne faut surtout pas qu'elle masque l'essentiel : l'orgue de Heiteren est (vraiment) très réussi, et on le doit à Martin Rinckenbach.
L'orgue a été entretenu en 1899 et 1911. Le 31/03/1917, les tuyaux de façade en étain ont été réquisitionnés par les autorités. [IHOA] [HOIE]
En 1925, Joseph Rinckenbach remplaça des tuyaux de façade, et compléta l'instrument : la pédale reçut une étendue normale (27 notes), et le dessus d'écho fut agrandi à 54 notes, rendu expressif, et doté des jeux nécessaires à un récit. [ITOA] [HOIE] [ITOA]
Pour compléter cet instrument construit par son père sur la base d'une architecture héritée de l'orgue pré-romantique, Joseph Rinckenbach eut une excellente idée : il disposait de tuyaux Callinet, qui étaient parfaits pour compléter l'orgue de Heiteren de façon homogène. Il s'agit du Salicional et du Hautbois du récit, de tuyaux de Flûte (marqués "nazard cornet") ayant servi pour la Flûte amabile 4' du récit, ainsi que de tuyaux d'un Basson qui ont pris place au complément de pédale. [ITOA]
Où Joseph Rinckenbach s'était-il procuré ces jeux ? On ne peut que faire des hypothèses :
- A Hirsingue, Joseph Rinckenbach a reconstruit en 1923 l'orgue Joseph Callinet de 1825, qui avait été rendu inutilisable par des infiltrations d'eau durant la guerre. Il y avait là-bas deux Cornets, mais ni Salicional, ni Hautbois, ni Basson.
- A Thannenkirch, l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach de 1913 a remplacé un petit Claude-Ignace Callinet de 1836. Le Salicional pourrait provenir de cet instrument.
- A Hégenheim, l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach de 1913 a remplacé un orgue de Joseph Callinet de 1846.
Bien entendu, ces tuyaux pourraient venir d'ailleurs, par exemple de Lapoutroie (mais là bas, de nombreux tuyaux Callinet sont restés lors de la reconstruction de 1913). En tous cas, l'utilisation de ces tuyaux a grandement contribué à conserver l'ambiance 19ème de l'instrument.
Reste que ce récit expressif complet était exactement l'élément manquant à l'instrument de 1875. Les deux Flûtes harmoniques, le Geigenprincipal, le Bourdon et la Voix céleste du Récit sont de Joseph Rinckenbach. [ITOA]
En 1980, l'orgue a été réparé par Alfred Kern. [IHOA] [HOIE] [ITOA]
En 2011, il y eut un relevage, par Antoine Bois. Le concert inaugural a clôturé le 5ème festival Callinet (devenu depuis : "Saison Internationale de Musique Sacrée d'Alsace") (octobre 2012). [Visite]
Le buffet
 Le couronnement de la tourelle centrale.
Le couronnement de la tourelle centrale.Le buffet, en chêne, est d'Antoine Herbuté (1844). Il présente pas mal de spécificités, ce qui est logique pour la production d'un "outsider" de la facture l'orgue, peu familier avec les proportions canoniques. Le positif de dos est très grand, et les plates-faces du grand-orgue sont très hautes par rapport aux tourelles.
Le grand corps, avec ses 5 tourelles, semble directement inspiré de l'orgue classique parisien. Cela se confirme par un soubassement plus étroit que la superstructure (pas de soubassement sous les tourelles latérales). Un partie de l'ornementation (culots, couronnements des tourelles latérales, claires-voies) est cohérente avec cette esthétique. Par contre, la disposition oblique des places-faces ainsi que les rinceaux indiquent clairement un dessin du mi-19ème, particulièrement original.
Le positif est également très "19ème", puisqu'il est inscrit dans un rectangle, avec une seule tourelle centrale et deux plates-faces retombantes. Herbuté avait clairement peur de manquer de place, et c'était une sage décision de "prévoir large".
Il y a un angelot qui joue de la flûte au sommet de la tourelle centrale. Les mauvaises langues y ont vu une allégorie d'Herbuté enjôlant le maire Blanchard. (Mais il ne faut pas les croire.) Le couronnement du positif est une lyre. Si le dessin général du buffet ne doit rien aux Callinet (qui préféraient les 4 tourelles "haut-rhinoises"), l'ornementation est clairement inspirée par la production de Rouffach. Il y a aussi trois angelots en haut des tourelles latérales et de la centrale (où les frères Callinet auraient pu les mettre), et deux en pendentif du positif. Ces derniers jouent un luth et un psaltérion, autour d'un phylactère doré disant "SOLI DEO GLORIA", évoquant une signature chère au cœur des organistes.
Caractéristiques instrumentales
 La console en fenêtre.
La console en fenêtre.Console en fenêtre frontale. Tirants de jeux de section carrée, à pommeaux munis de porcelaines (1875 et 1925), disposés en deux fois deux colonnes de part et d'autre des claviers. Les porcelaines des jeux du positif de dos ont un fond rose, celles des jeux du récit un fond bleu ; elles sont blanches pour le grand-orgue et la pédale, mais le nom des jeux de pédale apparaît en bleu. Il y a des traces d'anciennes étiquettes entre les tirants. (En 1844, comme à l'époque classique, les pommeaux étaient dépourvus de porcelaines et repérés par des étiquettes en papier.) Claviers blancs (replaquage récent).
Commande de la tirasse et des accouplements par pédales-cuillers à accrocher (1875). Elles sont repérées par des porcelaines blanches et rondes disposées au-dessus du 3ème clavier, et donnant leur ordre : de gauche à droite : I/II ("Koppel II. a I.", sic), III/II ("Koppel III. a I", sic, un petit patch blanc corrige la porcelaine, qui devait indiquer "II" au lieu de "I" sur la porcelaine). Du côté droit, la pédale basculante d'expression du récit (1925, "Expression"), et la tirasse II/P ("Koppel I. ped.", sic).
Il est aujourd'hui d'usage de numéroter les claviers de bas en haut, indépendamment de leur rôle. Ainsi, un positif de dos, clavier inférieur, sera noté "I", et son grand-orgue, placé au-dessus, sera le "II". L'écho ou le récit, situé au-dessus du grand-orgue, devient "III". Mais il existe une autre logique, qui présente l'intérêt d'être indépendante de l'ordre des claviers : "I" veut dire "grand-orgue", "II" signifie "positif", et "III" récit. Cela permet, sur les partitions, de faire des notes qui ne dépendent pas de l'orgue sur lequel on joue. Un instrument à deux manuels, grand-orgue et récit, aura donc "I" et "III", sans avoir de "II". C'est cette seconde logique qui a été adoptée ici. "I/P" signifie "tirasse grand-orgue", même si le grand-orgue est le deuxième clavier.
Pédalier et banc de Joseph Rinckenbach (dont les flancs figurent une lyre), de 1925.
8'
❍
céleste
8'
❍
amabile
4'
❍
principal
8'
❍
chalumeaux
8'
❍
2 2/3'
❍
8'
❍
2'
❍
4'
❍
2'
❍
4'
❍
8'
❍
4'
❍
8'
❍
16'
❍
4'
❍
16'
❍
❍
harm.
8'
❍
8'
❍
16'
❍
❍
8'
❍
8'
❍
8'
❍
8'
❍
harm.
8'
❍
8'
❍
8'
❍
8'
❍
8'
❍
8'
❍
4'
❍
Mécanique pour les manuels (1875 et 1925), pneumatique pour la pédale (1925). Tirasse mécanique et transitive : le pédalier joue le positif quand la tirasse et l'accouplement positif/grand-orgue sont actifs. Le pédalier joue le récit quand la tirasse et les deux accouplements sont actifs (car c'est le positif, et non le grand-orgue, qui tire le récit).
La mécanique du récit est de Joseph Rinckenbach (et elle est excellente). Ce fait prouve qu'il maîtrisait totalement la transmission mécanique, contrairement à ce que certains ont pu laisser croire. Dans son ensemble, la transmission de cet orgue est très souple et précise, même claviers accouplés.
A gravures. Les sommiers du grand-orgue, du positif et des 18 notes graves de la pédale (2 fois 9, ils sont diatoniques) sont du 19ème. Au récit, ils sont de Joseph Rinckenbach (1925), comme le complément de pédale (fis-d').
 De gauche à droite et de haut en bas :
De gauche à droite et de haut en bas :La tuyauterie du positif, avec ses Bourdons à calottes mobiles, ses entailles de timbre,
et les biseaux à dents. La Gambe de pédale, de Martin Rinckenbach.
Le tampon de laye du positif, avec clavettes ovales et écrou en bois.
Une bouche arquée avec un biseau à dents.
On ne peut pas, décemment, dater cette tuyauterie de 1844. Si bon nombre de tuyaux ont effectivement été construits par Herbuté, ils ont été entièrement repris et remis en harmonie.

Il faut bien sûr continuer à raconter l'histoire d'Antoine Herbuté, cet aubergiste devenu facteur d'orgues par passion, qui a réalisé onze orgues en Alsace, avant de devoir prendre la fuite avec les huissiers aux trousses. Ces événements, survenus dans les années 1840, sont au cœur d'une époque qui fit la spécificité alsacienne en matière d'orgue : chaque commune en voulait un, le plus beau possible, et c'était quelque chose qui faisait rêver même les aubergistes. C'était "l'orgue à tout prix". Et, il faut le dire, parfois un peu n'importe comment.
Reste que l'anecdote ne doit pas masquer l'essentiel : l'instrument de Heiteren est l'un des plus beaux de la région. Et l'histoire, si elle est belle à raconter, ne doit jamais devenir un mensonge : l'orgue de Heiteren ne peut pas être attribué à Antoine Herbuté. Cela serait source de confusions, et peut laisser croire que les techniques de facture ici employées étaient pratiquées dans les années 1840, ou qu'une harmonisation d'une telle virtuosité est à la portée d'un semi-amateur. Ce serait surtout commettre une réelle injustice : c'est à Martin, et à Joseph Rinckenbach que l'on doit cet orgue exceptionnel.
Pour l'enseignement ou l'organisation de master-classes, l'endroit est idéal : tribune spacieuse, acoustique généreuse, et bien sûr la qualité de l'orgue, l'immense répertoire accessible, la qualité de la transmission et du vent. Avec son positif de dos et son récit expressif, cet instrument permet de raconter l'histoire de l'orgue alsacien depuis l'époque classique jusqu'aux années 1930. Il illustre l'évolution de l'orgue depuis sa forme "ancien régime" jusqu'au post-romantisme, en passant par cette époque de transition (celle qu'a connu Herbuté) et, bien sûr, par l'âge d'or du romantisme alsacien. Une fois de plus, la rencontre avec l'orgue alsacien, sur le terrain, apporte son lot de bonnes surprises et confirme l'éclatant intérêt patrimonial de l'héritage des années 1870-1930.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 03/06/2018
Remerciements à Camille Dahinden.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 04/06/2018,05/06/2018.
Photos du 03/06/2018, et données techniques.
-
[RLopes] Roland Lopes : e-mail du 11/09/2012.
Photo du 11/09/2012.
-
[FLechene] Franck Lechêne :
Photos du 29/08/2007.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 75b
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 149-50
- [HOIE] Pie Meyer-Siat : "Historische Orgeln im Elsass", éditions Schnell und Steiner, München - Zürich, 1983, p. 232-3
-
[PMSAEA69] Pie Meyer-Siat : "Les orgues d'Antoine Herbuté", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 27., éditions de la société Haguenau, 1969, p. 219-29
L'histoire de l'orgue Herbuté est très bien racontée, et elle est tellement savoureuse que... l'orgue passe au second plan. En particulier, l'article ne relève même pas l'exceptionnelle qualité de l'instrument, et n'explique en aucune façon comment un semi-amateur aurait pu réaliser un orgue pareil. Le "miracle" était, en 1969, encore facile à vendre, tout comme le mythe de l'artisan génial du milieu du 19ème, qui, à force de motivation, est tout à coup capable de rivaliser avec les plus grands...
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im68008545
- [PMSAEA70] Pie Meyer-Siat : "Les orgues d'Antoine Herbuté (Complément)", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 28., éditions de la société Haguenau, 1970, p. 350-5
![]() Localisation :
Localisation :