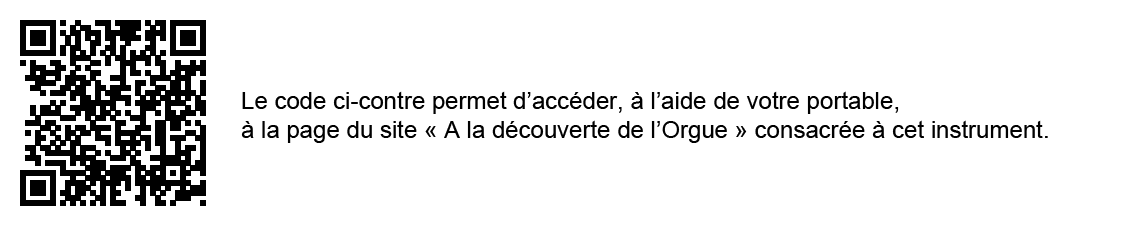Ostwald, l'orgue Roethinger.
Ostwald, l'orgue Roethinger.Photo d'Ivan Bajcsa, 06/10/2011, après rénovation de l'édifice.
L'histoire des orgues à Ostwald commence avant 1825, donc dans l'ancien édifice, dont le choeur est aujourd'hui la chapelle du cimetière. L'instrument actuel est déjà le cinquième du lieu.
Historique
Un orgue est attesté à Ostwald en 1825 par la présence d'un organiste : Materne Geistel. [IHOA]
Chronologie
Historique
En 1833, toujours dans l'ancienne église, fut posé un orgue Martin Wetzel. [PMSWETZEL75]
L'orgue était "tout fait" (déjà achevé, et disponible en atelier). Cela ne signifie pas forcément qu'il ait été d'occasion. Wetzel avait peut-être construit cet instrument "en avance" avant même de savoir où il pourrait le vendre. La pratique était assez courante au cours de la première moitié du 19ème siècle.
La nouvelle église d'Ostwald a été achevée en 1848, et l'orgue Wetzel y a été déménagé en 1849 ; on ne sait pas par qui. [PMSWETZEL75]
Historique
En 1878, Ostwald se dota d'un instrument "à la pointe du progrès", puisque construit par le très innovant Heinrich Koulen. [IHOA]
Koulen était en concurrence avec les frères Wetzel, qui proposèrent 3 instruments d'une vingtaine de jeux. [PMSWETZEL75]
Malheureusement l'orgue cessa de fonctionner vers 1911, probablement victime d'une transmission difficile à entretenir. [IHOA] [PMSWETZEL75]
Historique
C'est l'ancien élève de Koulen, Edmond-Alexandre Roethinger, qui renouvela l'orgue, vers 1919. [IHOA] [PMSWETZEL75]
Malgré la guerre qui le priva d'une main d'oeuvre précieuse (ce qui explique que ce renouvellement de l'orgue Koulen ait pris pas mal de temps), Roethinger était alors dans sa phase ascendante qui allait faire de lui le facteur alsacien le plus en vue de l'époque néo-classique. L'orgue d'Ostwald était bien entendu à transmission pneumatique, mais on n'en sait malheureusement pas beaucoup plus.
Le premier orgue Roethinger d'Ostwald fut détruit par faits de guerre le 25/09/1944. [IHOA] [PMSWETZEL75]
Historique
Pour remplacer l'orgue perdu, Max Roethinger posa en 1948 un orgue neuf, tout d'abord limité à un récit et une pédale. [ITOA] [PMSWETZEL75]
Le 11/12/1960, fut inauguré l'instrument complété par son grand-orgue, construit par Max Roethinger. [ITOA]
Evidemment, au cours de ces 12 ans, la facture d'orgues avait pris
un virage déterminant : le passage de l'ère néo-classique (des orgues de
conception et d'architecture romantiques, mais dotés de jeux plus classiques
destinés à élargir le répertoire) à la pensée "néo-baroque" (où il s'agit de
reprendre les techniques issues du 18ème siècle) (et d'envoyer à la chaudière
tout ce qui fait de près ou de loin penser à l'esthétique
romantique...).
Mais à Ostwald, puisqu'à ce moment on était "au milieu du
gué" (avec le récit et la pédale posés), l'orgue a été achevé comme il a été
commencé : néo-classique jusqu'au bout de sa Cymbale à 4 rangs. L'orgue
d'Ostwald, avec ses célèbres contemporains de Rhinau
et Strasbourg, St-Pierre-le-Vieux (et
dans une moindre mesure celui de Munchhouse), comptent
donc parmi les plus tardifs des orgues purement néo-classiques : les autres
instruments des années 60 (marquées en Alsace par Curt Schwenkedel) seront
radicalement différents. Cette évolution, la maison Roethinger aura de toutes
façon du mal à l'assumer (Bourgheim,
Ostheim, Ottrott) et,
malgré de beaux succès et l'estime des grands de l'orgue alsacien, comme Michel
Chapuis et Robert Pfrimmer (Strasbourg,
Ste-Madeleine), l'aventure de la maison Roethinger
s'achèvera le 24/11/1968, à Schiltigheim.
D'un point
de vue historique, l'orgue d'Ostwald est donc particulièrement important.
En 1985, l'orgue Roethinger fut relevé et légèrement transformé par la maison Muhleisen. C'est de cette époque que datent les originaux dominos noirs. [IBajcsa] [VWeller] [IHOA]
En 2000, l'orgue fut victime d'un orage violent, qui endommagea la partie électrique de la transmission et le moteur du ventilateur. [IBajcsa]
En 2003, la sécheresse provoqua des dégâts aux sommiers et à la partie pneumatique de la transmission. [IBajcsa]
En juin 2004 fut créée "Mikrokosmos", association des amis de l’orgue Roethinger d’Ostwald, avec pour but d'effectuer un relevage en profondeur.
En 2013-2014, l'orgue a été relevé par la maison Muhleisen. [IBajcsa]
Avec les conseils de Marc Schaefer, les travaux ont été les suivants (un peu moins de 2000 h):
- - Réparations et remises en état : câbles des volets sur les soufflets, tremblant.
- - Révision de la console ; les dominos noirs ont été conservés.
- - Remplacement intégral des faisceaux électriques et des équipements de combinaison/crescendo, à l'identique.
- - Remplacement de l'alimentation électrique, le redresseur passant de 12V à 24V.
- - Remplacement des électro-aimants, avec les diodes anti-retours intégrés (suppression de la "boite à diodes" dans la console qui a grillé en 2000).
- - Réfection des membranes.
- - Réparation par colmatage des fuites sur les gros soufflets.
- - Nettoyage de toute la tuyauterie, sans remplacement.
- - Harmonisation et accord général.
 Durant le week-end de l'inauguration
(08-09/03/2014), les anciens éléments ont été exposés :
Durant le week-end de l'inauguration
(08-09/03/2014), les anciens éléments ont été exposés :visibles ici, les contacts du pédalier, ceux du grand-orgue, le relais primaire du récit (supprimé).
Le buffet
 Photo d'Ivan Bajcsa, 06/10/2011.
Photo d'Ivan Bajcsa, 06/10/2011.L'affleurement à la rambarde n'est pas l'arrière de la console.
Comme la plupart des orgues néo-classiques construits après les années 1930 (les exceptions étant ceux qui onr été installés dans des buffets plus anciens, voir par exemple Mackenheim), l'orgue d'Ostwald est dépourvu de buffet : un simple soubassement supporte un alignement de tuyaux de façade. Le buffet de l'orgue Koulen ne devait probablement pas être récupérable après la guerre.
Les lignes dessinées par ces alignements "novateurs" (on parle à présent de "style palissade" sans que cela ne soit forcément péjoratif) semblent issues d'élans spontanés et rarement reliés à un fonds stylistique. Parfois, cela paraît juste être le fruit du hasard, et le résultat est plus que discutable (Pfettisheim). A Ostwald, toutefois, les trois arcs supérieurs semblent trouver leur origine dans les buffets "modern style" (Wasselonne, Gueberschwihr). Ces arcs avaient été abandonnés sur les premiers orgues "sans buffet" (Fellering, 1948), pour revenir en 1950 à Niederschaeffolsheim qui est un orgue très voisin de celui d'Ostwald. A de nombreuses reprises, Roethinger préférera une forme "en mitre" (Rossfeld, Diebolsheim, Ottrott).
Caractéristiques instrumentales
 La console Roethinger (09/2000).
La console Roethinger (09/2000).A droite, le cadran linéaire du crescendo.
Console indépendante dos à la nef, fermée par un couvercle incliné. Tirage des jeux par dominos noirs (1985). Expression et crescendo par pédales basculantes. Tirasses et accouplements par cuillers à accrocher. Commande des combinaisons par 5 pistons blancs situés sous le premier clavier, et un annulateur noir. Voltmètre à gauche, flanqué des boutons marche et arrêt. Cadran linéaire du crescendo à droite.
Un éclairage neuf, à led et à 3 positions, a été installé à l'occasion du relevage.
 L'équipement réalisant le crescendo (ancien
modèle, aujourd'hui déposé).
L'équipement réalisant le crescendo (ancien
modèle, aujourd'hui déposé).Une barrette mobile en laiton, équipée de tiges conductrices dont chacune correspond à un jeu ou un accouplement, est commandée mécaniquement par la pédale.
Elle peut coulisser, mettant en contact les tiges avec contacts électriques, selon leur longueur et sa position.
Selon la longueur "utile" (celle du bas) de chaque tige, le jeu correspondant "entre" plus ou moins tôt dans le crescendo.
 Vue sur la
tuyauterie du grand-orgue (sauf le Clairon, non encore posé).
Vue sur la
tuyauterie du grand-orgue (sauf le Clairon, non encore posé).Au second plan, des tuyaux aigus de la montre de pédale, dont une partie se trouve en façade.
Photo de Victor Weller, 02/12/2013, pendant le remontage.
Le grand-orgue est disposé derrière la façade, sur le côté gauche. La boîte expressive du récit (chromatique, basses à droite) est à droite. La pédale est en deux parties : les fonds se trouvent du coté gauche et les anches sur le flanc droit, le long du clocher.
 Autre vue sur (le dessus de) la tuyauterie du
grand-orgue (08/03/2014),
Autre vue sur (le dessus de) la tuyauterie du
grand-orgue (08/03/2014),avec le Cor de nuit très particulier (on n'en voit ici que 4 tuyaux graves), et l'impressionnant Plein-jeu à 7 rangs.
Ordre des chapes du grand-orgue, du fond (accès) vers la façade : Clairon, Trompette, Doublette, Plein-jeu 7 rgs, Cor de nuit, Bourdon 8, Prestant 4, Montre 8.
 Vue sur la tuyauterie du récit
(08/03/2014).
Vue sur la tuyauterie du récit
(08/03/2014).La forme du Hautbois est bien connue chez Roethinger.
Ordre des chapes du récit (nom du jeu tamponné les chapes d'origine, en acajou), de gauche (fond) à droite (façade) : Principal 8', Flûte conique 4' (chape plus récente), Salicional 8' (idem), Principal 4, Nasard, Bourdon, Doublette, Cymbale, Tierce, Hautbois, Cromorne.
![]() Webographie :
Webographie :
- http://mikrokosmos.perso.sfr.fr/ : Le site de l'association Mikrokosmos
![]() Activités culturelles :
Activités culturelles :
- 09/03/2014 : Inauguration : messe solennelle, avec la chorale Ste-Cécile, et Sébastien Hulard à l'orgue. Récital d'Antonio Buschiazzo et Michael Bartek (Grieg, Brahms et Dvorak).
- 08/03/2014 : Journée portes ouvertes avec visite de l'instrument. Moments musicaux avec François Fuchs, Alexis Platz, Guillaume Martin, Dominique Barth, François Régis Derrendinger, Jules Kaufmann et Nicolas Kieffer.
- 07/06/2013 : Visite de l'orgue, avec explications et exemples sonores, par Alexis Platz.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
- [Visite] "Visite sur place", 09/2000,08/03/2014
- [IBajcsa] Ivan Bajcsa : e-mail du 14/10/2004,11/10/2011,15/09/2013.
-
[VWeller] Victor Weller : e-mail du 01/03/2014.
Photos durant le remontage.
- [Muhleisen] Maison Muhleisen : e-mail du 04/03/2014.
-
[Ostwald2014] "Plquette sur l'orgue Roethinger d'Ostwald, éditée à l'occasion du relevage de 2013-2014"
Plaquette éditée à l'occasion de l'inauguration.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 41a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 3, p. 485
- [PMSWETZEL75] Pie Meyer-Siat : "L'orgue de Wetzel à Ostwald", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 22., éditions de la société Haguenau, 1975, p. 252
![]() Localisation :
Localisation :