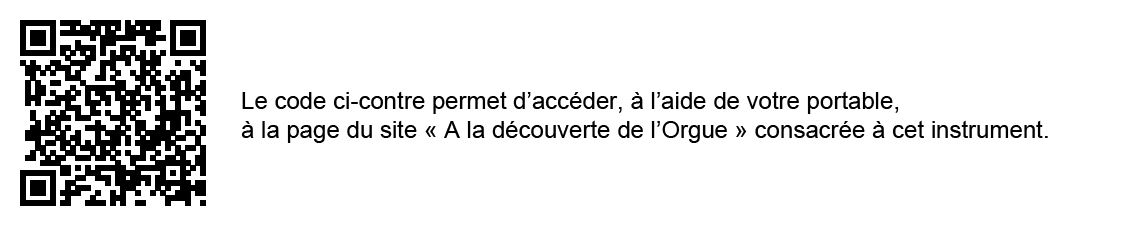La signature de Joseph Chaxel, facteur à Benfeld.
La signature de Joseph Chaxel, facteur à Benfeld.Nous somme ici dans la jolie vallée qui servait de cadre, jadis, au fameux "Rêve d'une nuit d'été". L'église St-Gilles, avec ses éléments en grès, remonte pour partie au 18 ème. Son orgue permet de rappeler l'histoire d'un facteur assez méconnu ; l'instrument actuel a été construit par Martin et Joseph Rinckenbach en 1907 : c'était donc un instrument de valeur qui métrite l'attention, malgré les graves altérations qu'il a subis dans les années 1960, et et qu'il faut de tout cœur souhaiter qu'elles soient réparées.
1823
Historique
Le facteur qui construisit le buffet de cet instrument en 1823 n'est pas très connu : il s'agit de Joseph Chaxel. [PMSSHVV79]
Chaxel (nommé ici "Jacksel") fit aussi une proposition pour Barr en 1825, mais il ne "faisait pas de poids" face à Stiehr. Fait significatif : pour évaluer Chaxel, les édiles de Barr vinrent à cette occasion écouter l'orgue de St-Pierre-Bois. Et ils choisirent Stiehr. [PMSSTIEHR]
Blaise Chaxel (1765-1843), le père de Joseph, est venu de Fraize en passant par le Pays de Bade, où son nom s'orthographiait "Schaxel". Il s'installa à Herboltzheim (avec une succursale à Benfeld). Son fils (François) Joseph (1797-1858) devint lui aussi facteur d'orgues, et travailla à Benfeld entre 1820 et 1829. Bernd Sultzmann pense que c'est lui qui initia Antoine Herbuté à la facture d'orgues. En Alsace, les travaux des Chaxel se situent entre 1801 (Kertzfeld) à 1829 (Achenheim). Voici une liste d'autres travaux Chaxel (il y en a environ 300 en tout, inventoriés par Sultzmann). Y figurent 4 orgues neuf, dont 3 ont été conservés : [PMSSTIEHR]
- Kertzfeld, 1801 (travail sur l'orgue Daniel Cräner ?).
- Peut-être fit il aussi un travail à Schwobsheim.
- Bolsenheim, 1811 (où Chaxel installe l'orgue Silbermann d'Altenheim).
- Reichstett, 1821 (travail sur l'orgue Michel Stiehr de 1792).
- St-Pierre-Bois, 1823 (orgue neuf).
- Baldenheim, 1826 (travail sur l'orgue Bergäntzel de 1813).
- Andlau, 1825 (réparation de l'orgue Toussaint de 1780).
- Fréland, 1826 (orgue neuf, transféré en 1877 à Bischwiller par François Antoine Berger, où il se trouve encore).
- Friesen, 1827 (remplacé par Rinckenbach en 1902).
- Altenach, 1827 (orgue neuf, sûrement le mieux conservé des Chaxel d'Alsace).
- Achenheim, 1829 (remontage d'un orgue d'origine inconnue, acheté en 1851 par le vicaire Ignace Gander.)
Il ne reste donc pas grand-chose des travaux de ces facteurs, marqués par le contexte "post-Révolutionnaire". La priorité, on le comprend, était au "pragmatique", et les ambitions fort limitées. Le devis de Chaxel pour l'orgue de St-Pierre-Bois date de 1822. Il porte sur un orgue "de 4 pieds" en Montre, sur 2 claviers et pédale, avec : Le "dessus" d"écho étant donné pour 42 notes, il est donc probable qu'il ne lui manquait que l'octave grave (c-f'''). Le clavier principal avait donc certainement 54 notes (C-f''').
Une fois achevé, l'orgue était vraisemblablement plus près du bord de la tribune qu'aujourd'hui, et le clavier d'écho avait probablement été disposé en positif de dos (le positif actuel est postiche et muni d'une façade muette).
En 1868, les frères Wetzel firent un devis pour une réparation, mais proposèrent aussi un orgue neuf : visiblement, l'instrument ne donnait déjà plus satisfaction. [PMSSHVV79]
Ensuite, dans un premier devis, datant du 02/08/1898, Martin Rinckenbach prévoyait de refaire la soufflerie, reconstruire les sommiers de la pédale, remplacer le Nasard par une Flûte à cheminée 8', la Flûte 4' de Pédale par une Soubasse, et de poser un récit neuf, pour remplacer l'écho/positif (s'il existait encore): [PMSSHVV79]
Il est à noter que Rinckenbach a noté la nouvelle composition en regard de l'ancienne. On retrouve rarement cette honnêteté consistant à citer aussi ce que l'on enlève. Lors de sa visite de 1898, il trouva un Salicional au grand-orgue, ce qui laisse croire qu'il y a eu une intervention entre 1868 et 1898.
Le 20/04/1900, un deuxième devis propose une transformation plus radicale (sommiers et console neufs) : [PMSSHVV79]
| C | g |
| - | 4' |
| 2'2/3 | 2'2/3 |
| 2' | 2' |
| 1'3/5 | 1'3/5 |
Le célèbre Adolphe Gessner intervint comme expert lors de ces travaux. Ses commentaires, apparaissant dans une lettre du 06/09/1901, sont fort curieux, et se bornent surtout à des conseils de matière d'harmonisation et à des corrections orthographiques sur les noms des jeux. Pour Martin Rinckenbach (et son fils Joseph), harmoniste hors pair, ces conseils de Gessner étaient parfaitement inutiles. La tentative de "normaliser" les noms de jeux est encore plus surprenante, puisqu'il demande en particulier "Lieblich Gedekt 8'" au lieu de "Lieblich Gedeckt 8'", "Flauto amabilé" au lieu de "Flauto amabile 4'" ou "Oktavebass" au lieu de "Oktavbass"... La seule contribution de Gessner semble avoir été d'imposer un accouplement des claviers à l'octave grave (II/I 16')
Historique
Finalement, ce n'est qu'en 1907 que Martin et Joseph Rinckenbach reconstruisirent l'instrument, et placèrent (évidemment) une transmission pneumatique. [PMSSHVV79]
Lorsque l'affaire fut enfin conclue et l'orgue neuf achevé, il avait la composition suivante :
Cela devait être un joli petit instrument, qui était de plus doté d'une belle console ergonomique et fonctionnelle.
Le jeu d'"Echobass" consistait normalement à se servir des mêmes tuyaux que la Soubasse, mais en les alimentant différemment. C'était une pratique assez courante dans la facture d'orgues (voir Le Hohwald ou Russ, ainsi que les anciens orgues Rinckenbach d'Allenwiller ou de Gildwiller). Sont conçus de la même façon le "Gedacktbass" Walcker de Lapoutroie / Hachimette, ou le "Lieblichgedecktbass" Gebrüder Link de Furchhausen, et beaucoup de Bourdons 16' de Roethinger (comme par exemple à Petit-Landau). Toutefois, ici, le jeu d'Echobass avait ses propres tuyaux, puisque c'étaient en partie ceux de l'ancienne Flûte 8' de Chaxel.
En 1932, il y eut une réparation par Edmond-Alexandre Roethinger. [PMSSHVV79]
En 1964, comme pratiquement plus personne ne savait régler une traction pneumatique, Robert Kriess, de Molsheim, proposa d'électrifier, alors qu'Alfred Kern proposa de construire une traction mécanique et de revenir (à peu de choses près) à la composition Chaxel. Mais cette restauration dans l'état de 1822 était hors de propos et ne correspondait pas à l'usage de l'instrument. [PMSSHVV79]
Finalement, c'est Curt Schwenkedel, toujours en 1964, qui fit les réparations qui s'imposaient. Malheureusement, il "recomposa" l'instrument, dans un sens "néo-baroque" : [PMSSHVV79]
Schwenkedel, faisant comme à son habitude preuve d'un grand sens de l'éthique, conserva la plaque d'adresse Rinckenbach, qu'il disposa horizontalement, à gauche du premier clavier. Malheureusement et évidemment, l'instrument, à ce point défiguré et baroquisé, n'avait plus grand intérêt. Vu que ce n'était toujours pas l'idéal pour Couperin... En fait, on se demande bien quel était le répertoire visé. Il est probable qu'il n'y en avait pas : la vague "néo-baroque" était un mouvement de pure idéologie et de partis-pris.
En 2005, la maison Steinmetz procéda à une autre modification : le Quintaton 4' a été transformé en Flûte à cheminée, et le Sifflet en Larigot 1'1/3 (par décalage). La boîte expressive a été démolie (!), et le récit n'est depuis plus expressif ! Les mutilations ont donc continué, en dépit de tout bon sens, alourdissant encore la facture pour une future remise en état. [JDolle]
Aujourd'hui, évidemment, cet orgue n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Espérons que dans l'avenir il se trouvera une dynamique pour le restaurer dans son état de 1907, et surtout pas de consacrer des ressources pour finalement le laisser dans son triste état défiguré...
Le buffet
Le buffet, de style néo-classique, comporte 3 tourelles en chevron, la plus petite au centre. Elles comportent de larges pilastres cannelés. Il est apparenté à celui d'Altenach (mais là-bas, la tourelle centrale se termine horizontalement. Les deux plates faces (plutôt petites en proportion) qui font la jonction entre ces tourelles comportent des rinceaux et claires voies sculptés.
Le "positif de dos" est postiche. C'est en fait une simple échancrure dans la balustrade, munie d'une façade muette.
Caractéristiques instrumentales
| C | A | f | c' | c'' | f'' |
| 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2' | 4' |
| 1/2' | 2/3' | 1' | 1'1/3 | 2' | 2'2/3 |
| 1/3' | 1/2' | 2/3' | 1'1/3 | 1'1/3 | 2'2/3 |
| - | - | - | 1' | 1' | 2' |
Console indépendante dos à la nef.
Transmission : Pneumatique tubulaire (1907). Sommiers à membranes.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
- [JDolle] Julie Dollé : e-mail du 17/05/2010.
- [PMSSTIEHR] Pie Meyer-Siat : "Stiehr-Mockers, facteurs d'orgues", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 20., éditions de la société Haguenau, 1972-73, p. 83, 188
-
[PMSSHVV79] Pie Meyer-Siat : "L'orgue Joseph Chaxel de St Pierre-Bois", in "Annuaire de la société d'histoire du Val de Villé", 1979, p. 128-138
A signaler, dans le même numéro de cet Annuaire : un article "généraliste" sur l'orgue, par Louis Gaunand (p. 139)
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 4, p. 570
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 162a
![]() Localisation :
Localisation :