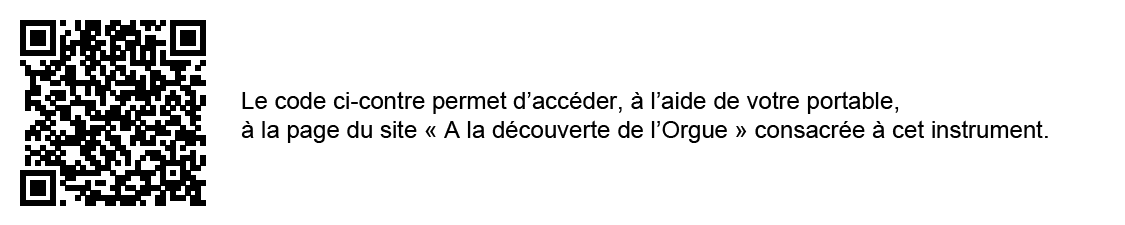Oberschaeffolsheim, l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach,
Oberschaeffolsheim, l'orgue Martin et Joseph Rinckenbach,dans son original buffet de Louis Geib (1826).
Toutes les photos sont de Martin Foisset, 10/13/2019.
A Oberschaeffolsheim se trouve l'opus 105 de Martin et Joseph Rinckenbach, d'Ammerschwihr. Construit en 1908, cet instrument présente de nombreuses spécificités, et il est resté dans un remarquable état d'authenticité. De plus, il vient de bénéfier d'un relevage (2018) qui lui a rendu tout son éclat.
1826
Historique
Un premier orgue - dont il reste le buffet - fut placé ici en 1826 par Louis Geib. [IHOA]
Des tuyaux de Geib ont été intégrés à l'instrument actuel. Ils présentent des marques à la pointe sèche, inventoriées lors du relevage de 2018. Ils portent tous le nom de la note, et sur le plus grave figure le nom du jeu et la localité de destination : "Schaeffolsheim" (avec différentes orthographes) et "Deux ponts". [YKoenig]
Ce "Deux ponts", est sûrement Zweibrücken, à côté de Wissembourg, mais dans le Palatinat (comme Geib a travaillé à Güdingen, ce ne serait pas étonnant). Sûrement la Karlskirche, car l'Alexanderkirche semble avoir commencé avec un Walcker (détruit en 1945), et que la troisième église n'existait pas du temps de Geib. Vu que ces tuyaux ont finalement été utilisés à Oberschaeffolsheim, c'était sûrement un projet interrompu.
Il y eut une réparation d'envergure en 1867, par les frères Wetzel. [PMSRHW]
Leur devis prévoyait "démontage, déplacement, remontage" ce qui laisse supposer que l'instrument a changé de place dans l'église. De plus, on note le remplacement des calottes du Bourdon et de la Flûte "du manuel", ainsi que des réparations à faire à la Montre, au Prestant, au Salicional, au Nasard, à la Doublette, à la Fourniture et au Cornet. On en déduit que l'orgue Geib n'avait qu'un clavier manuel, et semble avoir été dépourvu de jeu d'anche. [PMSRHW]
En 1873, les frères Wetzel firent un autre devis, pour un nettoyage du manuel et de la pédale, ce qui indique qu'il y avait une pédale indépendante. On ne sait pas si les travaux ont été effectués. [PMSRHW]
Le buffet
 L'un des trophées d'instruments de musique.
L'un des trophées d'instruments de musique.Le buffet est d'un dessin fort original. Le soubassement est de même largeur que les superstructures, ce qui lui donne un aspect "19ème" très marqué. Il y a deux tourelles latérales plates, plutôt élancées (4 tuyaux seulement), deux plates-faces doubles, et une tourelle centrale ronde, ornée d'un culot représentant des feuilles, mais aussi de claires-voies en draperies. Elle est surmontée d'une grande coupe, qui est la "signature visuelle" de l'orgue d'Oberschaeffolsheim. Pour compléter l'ornementation, il y a deux trophées d'instruments de musique, au-dessus des plates-faces.
Le buffet a probablement été élargi en 1907.
Historique
En 1908, Martin et Joseph Rinckenbach construisirent une orgue neuf, leur opus 105, logé dans le buffet de 1826. [IHOA]
Le contexte en 1908
L'instrument est pratiquement contemporain de celui de l'église protestante (Horbourg) de Horbourg-Wihr (opus 104), mais aussi du grandiose (et malheureux) opus 108 de St-Hippolyte (aujourd'hui en fort mauvais état). Plusieurs orgues Rinckenbach de cette période ont été victimes des guerres : Stosswihr-Ampfersbach (détruit en 1915), Munchhouse (détruit en 1945), Liederschiedt (57 ; pillé par l'Occupant durant le second conflit mondial). De nombreux autres ont été victimes de la vague néo-baroque, qui exigea un tribut encore plus élevé : Ungersheim (pour "restaurer" un hypothétique Herisé), Gildwiller, Allenwiller, Ribeauvillé (l'opus 100, un orgue d'exception, impitoyablement éliminé en 1966). L'opus 106, suivant immédiatement celui d'Oberschaeffolsheim, existe toujours partiellement, à Schweighouse-Lautenbach, mais sa tuyauterie à été cannibalisée pour réaliser un orgue de chœur néo-baroque ! Les témoins de cette époque pourtant si féconde et intéressante ne sont donc plus légion.
Le suivant dans la liste des Rinckenbach aujourd'hui jouables se trouve à Ettendorf (opus 110). Il est remarquable, et son histoire illustre parfaitement le succès que rencontrèrent Martin et Joseph, même face à leur principal concurrent en Alsace : Edmond-Alexandre Roethinger. Ce dernier avait en effet construit en 1907 un orgue pour Ettendorf, mais il n'y fut jamais posé : on préféra opter pour la maison d'Ammerschwihr, et l'orgue Roethinger trouva finalement preneur à Gumbrechtshoffen (malheureusement, lui aussi fut considérablement altéré dans les années 1960).
Les autres concurrents significatifs venaient de Moselle : Dalstein-Haerpfer (Cronenbourg, 1907) ou d'Allemagne : Eberhard-Friedrich Walcker (Breuschwickersheim, 1906), Gebrüder Link (Scharrachbergheim-Irmstett, 1906).
Tous ces instruments, chacun dans un style personnel, témoignent d'une époque extrêmement féconde, tant pour la facture instrumentale que pour le répertoire : la deuxième suite pour orgue de Max Reger date de 1905, les "poèmes d'automne" de Joseph Bonnet de 1908, tout comme les "Chorals et noëls" d'Alexandre Guilmant. Les "Trois Impressions" ("Harmonies du soir", "Clair de lune", "La nuit") de Karg-Elert datent de 1909. Et à l'époque, sur les tribunes, devaient se trouver de nombreuses pages de pédagogues comme Joseph Rheinberger.
Enfin, 1908 est une date qui compte beaucoup dans l'histoire de l'orgue alsacien, puisque ce fut l'année où fut livré le grand Mutin-Cavaillé-Coll de Guebwiller.
Un instrument spécifique
L'orgue d'Oberschaeffolsheim comprend de nombreuses spécificités. Elles paraissant trouver leur origine dans un choix délibéré, à sa conception, de conserver des tuyaux anciens, mais également de réaliser une composition qui les met en valeur. Une Doublette et un Cornet, ce n'est pas courant dans un orgue des années 1890-1914 : ces jeux reviendront après-guerre, avec les premières tendances (qu'on appellera bien plus tard "néo-classiques") consistant à retrouver des couleurs anciennes et des harmoniques aiguës. Joseph Rinckenbach posa une Doublette et un Cornet (neufs) au grand-orgue de Scherwiller dès 1920. Il y a donc deux façons d'interpréter le caractère "néo-classique" de l'orgue d'Oberschaeffolsheim : soit un "effet d'aubaine" lié à la présence de tuyaux anciens de qualité motivant leur conservation, soit une de premières manifestations - un peu visionnaire - d'une esthétique néo-classique, qui fut de fait le "prolongement" du post-symphonisme. Il ne faut pas non plus exagérer en ce sens, car le terme "néo-classique" ainsi utilisé n'a pas grand chose à voir avec les pratiques de la "vraie" époque néo-classique (1930-1960). De plus, un jeu à beau être ancien, une fois réharmonisé avec des techniques romantiques (entailles de timbres, calottes mobiles), il ne sonne pas du tout comme il le faisait dans l'orgue précédent. On en a, en quelque sorte, produit une autre version, souvent avec le même nom, mais avec un timbre et parfois un rôle fort différents. Loin d'être un "néo-quelque-chose", ce style se nourrit du passé pour s'inventer un avenir. Reste que le Cornet (d'origine Geib) actuellement présent dans cet orgue est bien un "vrai" Cornet, très réussi, et qui trouve toute sa place dans l'exécution des répertoires plus anciens.
Des innovations
Caractéristique de cette époque est l'association de couleurs (supposées) anciennes et de techniques innovantes. En particulier pour tout ce qui concerne l'ergonomie de la console et la dynamique du jeu. Cela se manifeste par la présence de combinaisons fixes, de nombreux accouplements, et cet étonnant système de tirage de jeux (ce ne sont ni des tirants, ni des dominos, mais des taquets à enfoncer, avec une petite palette pour les libérer). On retrouve un système analogue à Ottmarsheim, sur l'orgue Stahlhuth de 1912. La console - très belle - respecte un certain nombre de standards ergonomiques afin que l'organiste puisse se consacrer à sa musique. Cette console était, à l'origine, dos à la nef. [ITOA] [Visite]
Les tuyaux de façade (probablement muets depuis l'origine) ont été réquisitionnés par les autorités en 1917. [ITOA]
En 1927, Joseph Rinckenbach effectua un entretien. [ITOA]
En 1933, on demanda à Georges Schwenkedel de retourner la console, afin de la disposer face à la nef. Il est aussi question du remplacement à cette date des tuyaux de façade. [ITOA]
En 1947, Ernest Muhleisen procéda à des réparations. [ITOA]
En 1980, Paul Adam fit des réparations. L'inventaire technique des orgues d'Alsace signale, au récit, une Gambe de Laukhuff récente (en 1986), qui pourrait donc avoir été posée en 1980. [ITOA]
Pendant plus de 60 ans, l'instrument a été tenu par Augustin Marlier. Pendant toutes ces années, il a contribué à la vie culturelle et à la qualité de la musique jouée à Oberschaeffolsheim, et méticuleusement entretenu l'orgue Rinckenbach. [Visite]
En 2018, la maison Koenig procéda à un relevage complet. [Visite] [YKoenig]
Les travaux ont concerné la tuyauterie (transportée en atelier pour nettoyage et réparation), les relais pneumatiques (rénovation des membranes), les sommiers et le buffet ont été nettoyés et traités contre les insectes xylophages.
Caractéristiques instrumentales

Console indépendante face à la nef (pivotée de 180° en 1933) fermée par un rideau coulissant. Tirage des jeux par taquets à enfoncer, constitués de petits cubes blancs à la face sommitale inclinée (où figure le nom du jeu), et dotés d'une petite palette pour les libérer. Ils sont disposés en ligne au-dessus du second clavier. Le nom des jeux est sérigraphié en noir pour le grand-orgue et en rouge pour le récit. Les plaquettes des deux jeux de pédale étant déposées, il n'a pas été possible de confirmer que le nom de ces jeux apparaît en bleu, selon le code de couleur habituel de Martin et Joseph Rinckenbach (que l'on retrouve d'ailleurs sur les porcelaines des tirasses). Claviers blancs à frontons légèrement inclinés et convexes, joues moulurées.
Commande des accouplements et tirasses par pédales-cuillers à accrocher, en fer forgé, placées au centre de la console, et repérées par des porcelaines adoptant le code de couleur des plans sonores (blanc pour le grand-orgue, rose pour le récit et bleu pour la pédale). De gauche à droite : "Pedal koppel II." (II/P), "Pedal koppel I." (I/P), "Manual koppel II.aI." (II//I), "Suboctav koppel I.zII." (II/I 16'). A leur droite se trouve la pédale basculante commandant l'expression du récit.
Appel des combinaisons fixes par pistons blancs, placés au centre sous le premier clavier, et repérés par de petites porcelaines rondes disposées en regard entre les deux claviers. Le quatrième piston est l'annulateur.
Plaque d'adresse disposée à l'horizontale sur la table de la console, à gauche. Elle est constituée de lettres et d'un cadre en laiton incrusté dans du bois brun foncé :
ORGELBAUER
AMMERSCHWEIER i/ELS.
op.105.
 La plaque d'adresse de l'opus 105.
La plaque d'adresse de l'opus 105.Elle est disposée comme à Murbach (1906) ou Horbourg-Wihr (1907).
Juste un peu plus tard, Martin et Joseph Rinckenbach la placeront en haut à gauche,
dans un plan vertical (Ettendorf, Bourg-Bruche, 1908).
A membranes ("Taschenladen"). Le grand-orgue est pour partie sous le récit.
La façade est entièrement muette. La partie instrumentale n'a donc pas été affectée par la réquisition des tuyaux de façade.
Les calottes des bourdons sont étanchées avec du papier journal « Der Elsässer » de 1907. [YKoenig]
Presque toute la tuyauterie ancienne a été décalée d’un demi-ton, ou deux demi-tons. Les bourdons étaient à calottes soudées. Le diapason était probablement aux alentours de 435 Hz (mesuré sur le Prestant en fermant les entailles sur les tuyaux dont on a encore les traces d’accord au ton). [YKoenig]
 Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.
Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.De haut (accès) en bas (façade) :
la Trompette (le dernier tuyau - g''' - n'est pas d'origine)
ni harmonique, la Mixture à 3 rangs, sans aucune reprise,
le Principal 4' (dont les aigus n'ont pas d'oreilles),
le Bourdon 8' (avec ses grandes dents sur les biseaux),
la Flûte de concert en bois (sans faux-sommier, avec un râtelier),
et, au premier plan, la Dulciane 8'.
hors champ vers le bas, il y a la Gambe et le Principal 8'.
 L'original système de tirage des jeux.
L'original système de tirage des jeux.Il s'agit vraiment d'un instrument attachant et plein d'originalités. Conçu en 1908 en faisant le choix d'y intégrer des tuyaux plus anciens, il est à la fois inscrit dans son style post-symphonique tout en en présentant une déclinaison spécifique... qui serait justement celle qu'adoptera le monde de l'orgue après 1930.
Martin et Joseph Rinckenbach ont ici signé un orgue harmonisé tout en finesse, original et pourtant représentatif du bouillonnement culturel qui a animé la première décennie du 20ème siècle.
![]() Webographie :
Webographie :
- [OrguesKoenig] www.orgues-koenig.com : Le site de la maison Koenig
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 10/03/2019
Remerciements à Jean-Pierre Obergfell.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 17/03/2019.
Photos du 10/03/2019 et données techniques.
-
[YKoenig] Yves Koenig : e-mail du 12/10/2018.
Données techniques, photos des marques sur les tuyaux
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 135a
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. IV, p. 467
- [PMSRHW] Pie Meyer-Siat : "Valentin Rinkenbach, François Ignace Hérisé, les fils Wetzel, facteurs d'orgues", éditions Istra, p. 216
![]() Localisation :
Localisation :