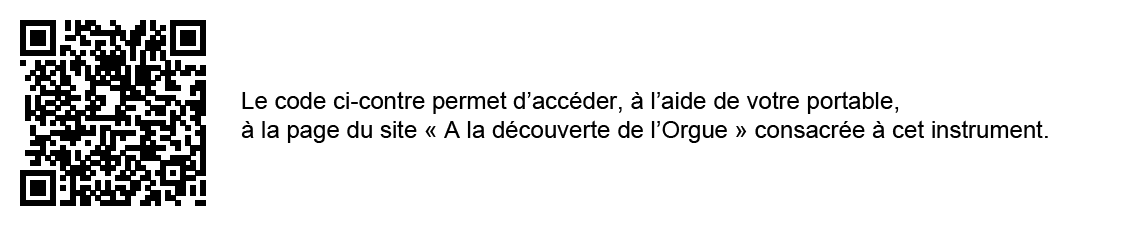Orgue Mutin / Cavaillé-Coll entièrement authentique (sauf la façade).
 Guebwiller, Notre-Dame. Le buffet de Gabriel Ignace Ritter et Joseph Sporer
Guebwiller, Notre-Dame. Le buffet de Gabriel Ignace Ritter et Joseph Sporerabritant l'orgue Mutin - Cavaillé-Coll.
Les photos sont du 19/08/2012 et 01/06/2019.
La tribune de l'église Notre-Dame de Guebwiller est un de ces lieux d'exception, chargé d'histoire, et surtout dotée d'un des orgues les plus marquants et enthousiasmants qui soient. Cet instrument est issu de la Belle époque, et sa conception fut l'objet de débats passionnés : à cette époque, la musique en général, et l'orgue en particulier, occupaient une place sociale très importante ! Il faut souligner que même le grand public s'intéressait à la facture d'orgues, puisque les orgues recevaient des places de choix lors des expositions. L' "instrument-roi" était à la fois connu et en perpétuelle évolution.
L'orgue de Guebwiller n'est pas tout à fait un Cavaillé-Coll : Aristide Cavaillé-Coll est mort en 1899, et son dernier instrument est celui de Paris, St-Ferdinand (à l'origine aux concerts Lamoureux) ; il date de 1898. Mais Charles Mutin en fut le successeur idéal, et sut conserver l'héritage de la prestigieuse maison parisienne. Il y a tellement de Cavaillé-Coll dans ce superbe instrument que son nom apparaît de façon tout-à-fait légitime sur la plaque de console. Il a aussi de nombreuses spécificités. Comme souvent, on n'apprécie jamais autant un instrument que quand on connaît son histoire. Celle-ci est digne des meilleurs scénaristes. D'abord fondée uniquement sur de vagues souvenirs, elle a été complétée avec une bonne dose de "déductions logiques", hypothèses probables, d'intuition, le tout dans le but de la faire cadrer avec une histoire globale de l'orgue alsacien. Celle qui était racontée dans les années 1970. Il faut donc être plutôt prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'elle commence vers 1760, lorsque les Chanoines de Murbach, sûrement excédés par la rigueur des hivers montagneux, décidèrent de se replier dans la vallée. Il firent construire par Gabriel Ignace Ritter un édifice majestueux, de style néo-classique, qui est l'église Notre-Dame de Guebwiller.
1785
Historique
En 1785, Joseph Rabiny aurait construit à Guebwiller un grand instrument de 4 claviers, logé dans un buffet néo-classique de Gabriel Ignace Ritter orné par Joseph Sporer. [IHOA] [HOIE] [PMSCALL]
23500 livres
De cet instrument, on ne connaît que deux choses : sa disposition (IV/P 46j) et son prix (23500 livres). C'est Claus Kientzl qui désigne Rabiny comme facteur. La présence de Rabiny à Guebwiller est attestée indirectement, et une seule fois, lors de l'expertise, le 25/11/1785, de l'orgue de Riquewihr. Rabiny y est présenté comme un facteur d'orgues de Dijon, travaillant actuellement à Guebwiller. La disposition (4 claviers, 46 registres) est un souvenir de F.-A. Goehlinger ; il n'y a pas de trace écrite. La composition est inconnue. L'orgue était un moment attribué à Johann Georg Rohrer (hypothèse rejetée depuis... par son attribution à Rabiny). Le buffet, assurément, est encore là, grandiose ; mais il ne doit rien à Rabiny. Tout le reste, finalement, n'est que conjectures. [PMSCALL]
Il nous faut donc parler de Joseph Rabiny, essentiellement pour tenter d'éliminer ce tenace mythe du "Monumental Chef d'œuvre de Rabiny (1785) de Guebwiller - voyez le buffet - dont la partie instrumentale a malheureusement été remplacée par un orgue tout neuf en 1908". Cela sous-entend que les Guebwillerois de 1908 ne savaient pas reconnaître un orgue de valeur, et qu'ils faisaient n'importe quoi - comme les autres à cette époque - à cause des méchants experts allemands. Personne ne semble s'être demandé pourquoi un "expert allemand" des années 1900 aurait recommandé un orgue on ne peut plus parisien pour éliminer un "chef-d'œuvre" du 18ème. L'histoire était communément admise. Il est donc utile de creuser un peu.
L'histoire de ce Joseph Rabiny reste encore, pour une grande part, à écrire. Elle est même devenue, avec le recul, une des plus savoureuses "libertés" prises par l'organologie alsacienne du dernier tiers du 20ème siècle, obnubilée par son hagiographie des innombrables génies du 18ème. Rabiny était connu pour ses relations avec Sébastien Krämer (voir Bischoffsheim). A travers les quelques témoignages, on devine qu'il s'agissait d'un bon vivant, doué pour tisser des liens et échanger des services. Un homme de réseaux, sachant utiliser les restaurants. Il avait travaillé un peu partout, de Tarbes à Ottobeuren, de Sens à Perpignan, et en particulier avec son oncle Karl Joseph Riepp, ce qui conduisit l'organologie à le promouvoir "détenteur de la tradition Riepp". Mais il avait quelque chose de spécial : il était le "prédécesseur" des Callinet d'Alsace (ayant embauché François comme contremaître ; ce dernier devint plus tard son gendre).
Pour Pie Meyer-Siat, c'était donc le "chaînon manquant" pour compléter son panégyrique des Callinet, en leur assurant les indispensables quartiers de noblesse issus du 18ème. C'était indiscutable : puisqu'il amena les Callinet en Alsace et leur transmit la tradition séculaire, il ne pouvait être que génial. Toutefois, pour juger ses compétences en facture d'orgues, on aurait aimé voir quelques éléments de grande qualité réalisés par lui. Or, force est de constater que partout où il reste quelque chose de ce facteur, la déception est à la mesure des attentes.
Et la prudence de mise, vu le nombre d'instruments qui lui ont été attribués par erreur. Hamel a dressé une liste de travaux de Rabiny : "RABINI, grand-père maternel de Claude-Ignace Callinet, travaillait en Alsace vers le milieu du XVIIIè siècle. Il a construit les orgues de Berviller, département du Haut-Rhin (un clavier et dix-huit jeux); de Cernay, Haut-Rhin (deux claviers et vingt-quatre jeux); de Saint-Maurice, à Besançon (deux claviers et vingt-quatre jeux); de Saint-Amarin, Haut-Rhin (trois claviers, trente jeux); de Sendheim (deux claviers, vingt-deux jeux); de Niderentzen (deux claviers, vingt jeux); de Bergholz-Zell (un clavier, 14 jeux), et d'Oberentzen (un clavier et seize jeux)." Il est aujourd'hui établi que Rabiny n'a jamais construit d'orgue neuf, ni à Berrwiller, ni à Oberentzen, et encore moins à St-Amarin. Probablement pas à Bergholtz-Zell non plus, et à Sentheim, tout reste à prouver : l'orgue de 1808 (dont il ne reste absolument rien) qui se trouvait là-bas reste de provenance inconnue, et les reliquats vus par les frères Callinet avant leur intervention sont très éloignés du 2-claviers/22 jeux évoqué par Hamel. [Hamel]
Dans le domaine de l'anecdote, il faut noter qu'il y a quelques années, le (magnifique) orgue de Sentheim était encore parfois attribué à Rabiny. (Dans le cadre des Journées du Patrimoine, mais aussi dans les pages d'un alsatique reconnu de 1998.) Cet instrument est certes l'un des plus beaux d'Alsace, mais il ne doit absolument rien à Rabiny (même pas une rondelle du buffet), puisqu'il a entièrement été construit par Martin et Joseph Rinckenbach en 1909. (Ce qui en fait un presque contemporain de celui de Guebwiller.) Asseoir la réputation d'un facteur sur des orgues réalisés un siècle après sa mort est quand même douteux... Rebelote à Hirtzfelden : l'instrument, attachant et de grand caractère, porte, au revers de son buffet, la signature de Rabiny. Mais quand on voit l'intérieur, on constate que ce qui avait enthousiasmé les auditeurs et les a assurés du génie de Rabiny est pour l'essentiel, l'œuvre de Martin Rinckenbach (1879).
Les chantiers Rabiny de Hirtzfelden et de Cernay finirent en procès. En fait quelle est la vraie référence de Rabiny ? Guebwiller. Pourquoi s'est-il installé à Rouffach en 1787 ? Suite à son marché pour Guebwiller. On sait que, 6 ans auparavant, il avait construit un orgue à Schuttern. Mais Riepp a dû participer. Et 6 ans, c'est long... On cite des chantiers à Clermont-Ferrand (N.-D. du Port) et Aurillac (Saint-Géraud). Du coup, les questions surgissent : comment un facteur semi-itinérant, sans référence particulière a pu, tout à coup, réaliser un 4-claviers de 46 jeux ? Un orgue aussi monumental est un projet d'une complexité considérable ! Et, une fois réalisé, il aurait dû faire parler de lui, au moins durant les quelques années précédant la Révolution. De plus, un 4-clavier, même en 1908, ça ne disparaît pas comme ça, surtout dans une région où on "recycle" souvent le moindre petit élément de valeur. En 1907, le devis Mutin précise qu'il peut donner 2000 Frs pour les matériaux de l'ancien orgue. Ce qui correspond à une remise de 5% sur le prix de l'instrument neuf : c'est dérisoire. [YMParisAlsace]
Les zones d'ombre sont donc très nombreuses. On suppose que l'instrument a été achevé, car Rabiny s'en servit pour fournir des références ; mais même cela reste à prouver, car il a très bien pu le faire pendant le chantier. Quelle peut être l'explication du mystère du Rabiny de Guebwiller ? Il n'y en a guère que deux. Tout d'abord l'utilisation massive d'une forme de sous-traitance : Rabiny aurait confié la réalisation à des facteurs compétents recrutés pour l'occasion. La seconde est encore plus pragmatique : les 23500 livres correspondent à une commande, jamais totalement honorée. Et on décida de ne "pas faire de vagues". Après tout, une fois le buffet posé, la qualité du ramage peut passer inaperçue pour une grande part de la population. Si cela s'est mal passé, autant ne pas le crier sur les toits... Après la Révolution, quelqu'un a peut-être fait ce qu'il faut pour rendre l'orgue provisoirement acceptable. Ce quelqu'un pourrait très bien être François Callinet. Et le provisoire aurait duré jusqu'en 1908. Quoi qu'il en soit, il y avait bien un orgue - achevé ou non - dans ce buffet, puisqu'on a la trace de trois réparations :
La première réparation a été menée en 1803 par François Callinet. Comme il pourrait très bien s'agir d'une conséquence de dégâts dûs à la Révolution ou a un abandon, cette opération ne nous renseigne pas beaucoup sur l'état d'achèvement de l'orgue Rabiny. [HOIE]
Il y eut une autre réparation en 1860 par Georges et Nicolas Verschneider. [HOIE]
Historique
C'est en 1908 que fut posé l'orgue de Charles Mutin. [IHOA] [HOIE]
Son histoire n'a pas été écrite à la fin du 20ème siècle (qui n'accordait pas grande attention à ces instruments), mais a été publiée en 2003, dans l'article de Yannick Merlin intitulé "Orgues et organistes parisiens en Alsace (1860-1908)".
Un orgue parisien
Le simple fait que Guebwiller ait pu acheter un tel instrument à Paris relativise déjà le prétendu protectionnisme de l'époque. Et, de façon tout à fait cohérente, mais significative, l'instrument a été inauguré le 23/08/1908 par Charles-Marie Widor, ainsi que plusieurs organistes marquants en Alsace. On est bien loin de l'image jaunie d'un "impérialisme culturel allemand". A Obernai (qui avait acquis un orgue de Joseph Merklin dès 1882) on a parlé de "patriotisme" : c'est accorder beaucoup d'importance à la politique. Si effectivement les droits de douane ont l'air d'avoir été élevés (pour tous les produits), force est de constater que les musiciens alsaciens, qu'ils soient d'origine locale ou "allemands de l'intérieur" (en fait, on disait "Altdeutsche") aimaient bien la facture romantique française. La démarche ayant conduit à ce choix est pleine d'enseignements.
Le chanoine Roellinger, Louis Huber, et Charles Hamm
A Guebwiller, le principal commanditaire a été le curé Alphonse Roellinger (1849-1918). Il a siégé au Reichstag de 1898 à 1907, comme député de la 4ème circonscription d'Alsace-Lorraine. Cela devait aider à faire avancer les dossiers. [Rupp] [YMParisAlsace]
L'histoire de ce projet paraît commencer dès le 11/10/1893, quand Martin Rinckenbach a proposé un orgue de 51 jeux. Mais il devait plutôt s'agir d'un "premier contact". Les choses devinrent plus sérieuses le 15/12/1906, jour où Martin et Joseph Rinckenbach signèrent un devis destiné au chanoine Roellinger, proposant un orgue de 3 claviers. L'organiste de Guebwiller, Louis Huber, souhaitait une transmission mécanique, et la maison d'Ammerschwihr proposa donc le choix du système de transmission (alors qu'elle maîtrisait déjà parfaitement la pneumatique depuis 1899). La proposition fut étudiée (successivement : personne ne semble avoir eu envie de les mettre autour d'une même table) par Charles Hamm, François-Xavier Mathias, Marie-Joseph Erb et Adolphe Gessner (ce dernier avait été le professeur de Louis Huber au conservatoire de Strasbourg). A priori, on n'avait oublié personne. [YMParisAlsace]
Si vraiment la construction de l'orgue devait être confiée à Rinckenbach, Mathias pensait qu'une transmission pneumatique serait plus adaptée, vu qu'elles donnaient alors toute satisfaction. Il n'était pas en faveur d'une Machine Barker parce qu'il n'appréciait pas celles de Thann et de Sélestat. Mais Mathias conclut en suggérant de laisser le choix de la transmission... au facteur. [YMParisAlsace]
 François-Xavier Mathias (1871-1939)
François-Xavier Mathias (1871-1939)Arrivée de la concurrence
Jusque là, l'attribution du marché à la maison d'Ammerschwihr ne faisait aucun doute. Celle-ci occupait clairement une position de leader en Alsace. D'ailleurs, on n'avait apparemment pas songé à solliciter d'autres facteurs. Mais, bien entendu, la concurrence ne tarda pas à se manifester, spontanément. Cela commença par la maison Dalstein-Haerpfer, le 13/05/1907, qui avança l'argument d'un prix "défiant toute concurrence". Mais, comme on n'était pas au télé-achat, des références ont été présentées : Nancy St-Sébastien, mais aussi en Alsace : Strasbourg, St-Nicolas, ainsi que l'orgue en cours de construction pour Cronenbourg. Et de plus, la maison Dalstein-Haerpfer faisait valoir sa maîtrise des techniques venant de la maison Cavaillé-Coll, mettant en avant une "filiation". C'était juste, mais constituait un argument commercial pour le moins risqué... qui s'avéra calamiteux : la maison de Boulay fournit un devis dès le 24/05/1907, mais, entre temps, la petite graine "Cavaillé-Coll" semble avoir germé dans l'esprit des commanditaires. Roellinger en parla à son ami Aloÿs Claussmann, qui fut catégorique : il recommandait la transmission mécanique (comme Dalstein-Haerpfer), et ajouta : "Tâchez d'avoir un Cavaillé (Mutin successeur). Cette facture reste la première de France, et sans doute, d'Europe. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux". [YMParisAlsace]
Aloÿs Claussmann, natif d'Uffholtz (1850) et élève de l'école Niedermeyer de 1867 à 1872 était l'intermédiaire idéal entre l'Alsace et le monde de l'orgue parisien.
La réponse de Joseph Rinckenbach
Joseph Rinckenbach, évidemment, sentit la menace, mais commit à son tour une erreur : celle d'affronter frontalement et uniquement la maison lorraine. Et pourtant, il savait que Mutin avait été contacté. Et ses arguments étaient bons : "Ce qui est important, ce n'était pas la traction choisie, mais sa qualité de réalisation, qui exige d'y mettre un bon prix". Mais sur le plan politique, Rinckenbach est moins à l'aise. Il cite Mathias de mémoire (propos tenus à l'expertise de Ribeauvillé): "L'évêché veut que tous les orgues neufs qui se feront dans ses églises soient fait par des facteurs alsaciens qui tous sont capables de livrer aussi bien, sinon mieux que n'importe quelle maison étrangère, soit lorraine, allemande ou française". [YMParisAlsace]
 Joseph Rinckenbach (22/05/1876 - 04/09/1949)
Joseph Rinckenbach (22/05/1876 - 04/09/1949)Cela éclaire de façon nouvelle le supposé "protectionnisme" alsacien, qui, finalement, n'était affaire que de bon sens : à prestation égale, mieux vaut rester dans le diocèse. Notons au passage que, du coup, la Moselle est "à l'étranger"... Et il reste le plus savoureux :
Au détour de son argumentation, pour tenter d'expliquer pourquoi l'orgue français est toujours favorable à la mécanique, Rinckenbach affirme : "Le Français en général est plus conservateur que nous autres." [YMParisAlsace]
Sûrement la seule et unique fois dans l'Histoire où cette affirmation a été osée...
Charles Mutin, et Charles-Marie Widor
Un premier devis de Charles Mutin est daté du 24/06/1907 ; il fut accepté (mais non signé) par le conseil de fabrique le 10/07/1907. On peut peut donc dire que si l'un des orgues d'Alsace les plus marquants est aujourd'hui un Mutin, c'est un peu grâce à la maison Dalstein-Haerpfer, qui la fit entrer dans la partie par mégarde ! Bien sûr, cette décision "qui intéressera le grand public non seulement en Alsace mais encore au-delà de ses frontières" ne plut pas au chanoine Mathias, pour qui la facture de Rinckenbach valait parfaitement celle de Cavaillé-Coll. Mais en fait, l'essentiel de sa frustration semble venir du fait que le conseil de fabrique a pris ses responsabilités tout seul sans tenir compte du "monde de l'art religieux". C'est fort probablement sa réaction excessive qui déclencha l'intervention de Charles-Marie Widor, qui, bien sûr, soutenait tant Mutin que la mécanique à Barker. [YMParisAlsace]
Ce que l'on note, c'est que le choix - technique - du type de transmission est sans cesse instrumentalisé pour faire préférer tel ou tel facteur. Dire que la maison d'Ammerschwihr, à l'origine, avait déclaré que ce choix lui était indifférent !
Face aux maladresses des maisons d'Ammerschwihr et de Boulay, Mutin pouvait laisser libre cours à sa virtuosité commerciale. Roellinger lui commanda 4 jeux supplémentaires (Montre 16' et Bombarde 16' au grand-orgue, Cor de nuit 8' au récit, et une basse acoustique 32' à la pédale), ce qui permit à Mutin d'offrir en cadeau l'expression du positif et une Flûte 4' de pédale. Un appui d'Eugène Gigout arriva fort opportunément. Datée du 30/07/1907, la missive enfonce Mathias par un cinglant : "[Mathias est en] contradiction avec tous les grands organistes de Paris et de l'Etranger". Le devis "entre M. Munsch, Président du conseil de Fabrique de l'Eglise Notre-Dame, M. Thumann, Maire de la Ville de Guebwiller, M.M. les membres du Conseil de Fabrique de l'Eglise Notre-Dame et M. le Chanoine Roellinger, Curé de la dite Eglise, d'une part, et M. Charles Mutin, Facteur de Grandes Orgues, Successeur de Cavaillé-Coll, demeurant à Paris, Avenue du Maine, N° 15, d'autre part", fut signé le 02/08/1907 à Paris et le 10/08/1907 à Guebwiller. Après un nettoyage général de l'église (début mai 1908), l'installation de l'orgue commença, pour s'achever mi juillet. [YMParisAlsace]
 Marie-Joseph Erb (1858-1944)
Marie-Joseph Erb (1858-1944)Réception et inauguration
La réception eut lieu le samedi 22/08/1908, par M.-J. Erb, Adolphe Hamm (Bâle ; natif de Wickersheim et ancien élève d'Ernest Münch), F.-X. Mathias, Emile Rupp, Alphonse Schmitt (Paris, Saint-Philippe-du-Roule, natif de Koetzingue et ancien élève de Widor et de Guilmant), Aloÿs Schmitt (Mulhouse, St-Joseph), C.-M. Widor, le comte de Vallombrosa (Paris, Saint-Sulpice), Louis Huber (titulaire de l'orgue), l'abbé Sigrist (Linthal, USC), et Auguste Stoecklin. [YMParisAlsace]
Puis ce fut la fête. Immédiatement, vu que cela commença dès le 23/08/1908 par un premier concert inaugural :
- Jean-Baptiste Weckerlin (compositeur natif de Guebwiller en 1821) : cantate "Opus namque grande est", pour chœur et orchestre.
- Léon Boëllmann : Suite gothique (par Louis Huber),
- J.S. Bach : prélude et fugue en ré majeur (par Adolphe Hamm),
- Max Reger : "Benedictus et Te Deum" (par Adolphe Hamm),
- M.J. Erb : 2ème et 3ème mouvements de la 1ère sonate (par son auteur),
- Peter Heinrich Thielen : fantaisie et fugue chromatique en la mineur (par Martin Mathias),
- C. Saint-Saëns : fantaisie n° 2 en Réb Majeur (par Emile Rupp),
- J.S. Bach : toccata et fugue en ré mineur (par Charles-Marie Widor),
- Salut solennel (chanté par le chœur paroissial) :
. Adoramus te Christe, Perti.
. Ave Maria, Vittoria.
. Tantum Ergo, Vittoria.
. Schlusslied "Die orgel tönet", Kientzl. (Compositeur Guebwillerois.)
- Sortie, improvisation à l'orgue (a priori par Louis Huber). [YMParisAlsace]
Le 24/08/1908 eut lieu un récital de Charles-Marie Widor :
- J.S. Bach : "Fantaisie en ut Majeur" (en fait, Toccata, adagio et fugue, BWV 564).
- C.M. Widor : 5° symphonie.
- J.S. Bach : Concerto en la mineur. [YMParisAlsace]
Ainsi, dans l'Alsace du Reichsland, quand on voulait un orgue de Paris, on pouvait l'obtenir, et réunir les organistes locaux autour de Widor pour faire une fête de l'orgue à la Cavaillé-Coll.
Mathias pas rancunier
Et Mathias dans tout cela ? Il fit paraître un compte rendu dans "Caecilia" de 1908. L'article est à la fois objectif et élogieux, et souligne les spécificités et les qualités de la "technique française".
De fait, Mathias était plus que bon perdant. Il était peut-être conscient d'un fait marquant : Claussman, Widor et Gigout (souvent de leur propre aveu), bien que spécialistes de l'orgue français, n'avaient pas une bonne connaissance de l'orgue alsacien. Mathias, lui, connaissait les deux mondes. Après la bataille, il conservait la maîtrise du terrain. Tout marin considère cela comme une victoire.
Groteske Zeitungspolemik !
Si, dans le monde musical, tout se passa donc finalement fort bien, c'est - une fois de plus - la Presse qui tenta de "faire l'événement" en lançant une polémique : le choix de la transmission mécanique serait une "französische Propaganda" ! Les sources citées sont "des milieux bien informés" ("gewisser Kreise")... Une technique de transmission érigée en acte politique : il fallait le faire ! Emile Rupp, pourtant familier des polémiques, qualifie le tout de "groteske Zeitungspolemik" ("grotesque polémique de journal"). Quelque nationaliste avait donc tenté de gâcher la fête.
 Emile Rupp (1872-1948)
Emile Rupp (1872-1948)Un instrument apprécié
Mais la fête a bien eu lieu, et tout le monde semble avoir été fort content du résultat. Pour la revue "Le Menestrel", l'orgue de "Gebwiller", "de 50 registres", le premier commandé, depuis 1870, par l'Alsace à "l'industrie française", "a été reconnu pour le plus bel instrument d’Alsace : c’est une victoire pour l'art français". [YMParisAlsace]
C'est sûr, mais elle ne date pas de 1908 : l'orgue alsacien n'avait, tout au long du 19ème, probablement jamais été aussi "français" qu'après 1870 ! Bien plus que dans les années 1830-1860, où la production était pratiquement 100% locale, et régie par Stiehr et les Callinet. L'épisode de Guebwiller démontre - en soi - que le monde de l'orgue alsacien de l'époque allemande était bien plus ouvert aux influences extérieures que ce que l'on a pu croire il y a encore quelques années. Ces savoureuses joutes oratoires (ou épistolaires) étaient bien plus une affaire de réseaux que de politique. Elles étaient loin d'être stériles. Mathias ne s'y était pas trompé : les "parisiens" avaient certes construit un orgue ici. Mais ils avaient avoué au passage "ne rien y connaître" à l'orgue alsacien.
Emile Rupp, lui aussi, avait eu exactement ce qu'il voulait : un orgue "témoin", capable d'infléchir l'esthétique alsacienne dans le sens de sa vision. Il présente d'ailleurs le Mutin / Cavaillé-Coll ainsi : "Als Musterbeispiel einer schön und wirksam disponierten Kirchenorgel zitieren wir das Instrument von Guebwiller." ("Nous estimons que l'orgue de Guebwiller est l'exemple-type d'un orgue d'église joliment et efficacement composé.") [Rupp]
D'ailleurs, en plus d'un siècle, personne n'y a fait la moindre modification. Heureusement !
Les tuyaux de façade (probablement ceux de 1785) ont été réquisitionnés par les autorités le 09/10/1917. Cette façade représentait plus d'1,1 tonne d'étain. [IHOA] [HOIE]
L'entretien fut ensuite assuré par Georges Schwenkedel, qui intervint en 1946. [IHOA] [HOIE]
Puis, logiquement, il passa à son fils Curt Schwenkedel, qui fit une réparation en 1966. En 1973, les soufflets ont été renouvelés et les machines Barker révisées. [IHOA] [GRitz] [HOIE]
L'orgue a été réparé en 1996 par Richard Dott. [IHOA]
Il y eut une réparation en 2016, par la maison Muhleisen [VWeller]
Le buffet

Le buffet est dû à Gabriel Ignace Ritter, de Bregenz, l'architecte de l'édifice, qui avait été mandaté par le prince-abbé Casimir von Rathsamhausen. C'est un des exemples les plus spectaculaires de l'émergence du style néo-classique (esthétique) dans la facture d'orgues. Ses traits marquants sont le grand arc plein-cintre central et les frises crénelées sous les entablements. [OrgueEnAlsace] [PMSCALL]
Une autre caractéristique remarquable est la disposition en 4 tourelles. (On a voulu y voir une influence de Riepp. Pourquoi pas : ce serait sûrement une décision cohérente avec le choix de Rabiny comme facteur. Peut être même un élément d'explication concernant ce choix.) Par la suite, les 4 tourelles deviendront une sorte de signature visuelle des orgues haut-rhinois : elles furent très pratiquées par Joseph Callinet (son dessin préféré). La maison Stiehr les a importées dans le Bas-Rhin suite à son travail à Zillisheim en 1841 : Wisches, 1859). Claude-Ignace Callinet, lui, appréciait beaucoup les plates-faces centrales larges avec un arc plein cintre (par exemple Oberhergheim ou Widensolen).
Le tout était vraiment en avance sur son temps, et eut un grand impact sur l'évolution des buffets alsaciens. A nouveau, il faut rappeler que ce buffet a été conçu et réalisé par Ritter indépendamment de Rabiny, et ne doit donc a priori rien à ce dernier.
Par une curieuse "résonance" des courants esthétiques, ce buffet des années 1780 constitue un écrin idéal pour l'orgue de 1908. Car cette époque a été marquée esthétiquement par un engouement pour le néo-classique, et l'association de ces sonorités, soit au néo-gothique, soit au néo-classique, est à présent bien ancrée dans les traditions.
Caractéristiques instrumentales
 La magnifique console de Mutin,
La magnifique console de Mutin,dans une ambiance unique d'ombres et de rayons de lumière.
Console indépendante dos à la nef, fermée par un couvercle basculant. Tirants de jeux de section ronde à pommeaux tournés et porcelaines, disposés en quatre gradins de part et d'autre des claviers. Les plans sonores sont identifiés par un liséré de couleur entourant la porcelaine : bleu pour le grand-orgue, jaune pour le positif, rose pour le récit, et marron pour la pédale. Ils sont disposés de façon parfaitement rationnelle, un gradin par plan sonore. (La seule exception est le trémolo du récit, qui se situe à l'étage du positif, mais n'est peut-être pas d'origine, le relevé de console de Rupp notant une pédale de trémolo.) Claviers blancs, à frontons biseautés (même le premier).
Le porte-partition est articulé, et se range dans la partie fixe (horizontale) du couvercle de la console. Sortant comme un tiroir, il est muni de petites poignées en laiton (dont celle de droite manque). Il permet même de déployer deux petites tablettes latérales.
Les deux pédales basculantes d'expression sont situées au centre, celle du positif à gauche. De part et d'autre, on trouve les pédales-cuiller à accrocher commandant les accouplements, tirasses, combinaisons et accessoires. Elles sont sur deux niveaux, de façon à être plus accessibles.
 Une vue sur les pédales d'accouplement et de combinaisons.
Une vue sur les pédales d'accouplement et de combinaisons.Dans le groupe de gauche, on trouve, de gauche à droite :
- L'orage.
- Les trois tirasses (toutes à l'unisson), sur fond vert : I/P, II/P et III/P.
- Les appels des jeux de combinaisons, nommés "Anches", sur fond rose : P, I, II, III.
Au-dessus de celles-ci se trouvent les appels Forte pour la pédale ("P.F.") et le "Tutti tirasses" (repéré "TUT", mais il ne s'agit absolument pas d'un appel du Tutti).

Les mots "combinaisons" et "anches" sont ici synonymes, ce qui peut paraître paradoxal, mais est compréhensible si l'on tient compte du vocabulaire usuel des registrations romantiques : "Anches" veut dire "Anches et jeux à bouche forts". Un Octavin 2', par exemple, bien que jeu à bouche, fait partie de la registration "Anches récit". Les jeux de combinaisons sont ceux qui sont attendus quand la partition indique la registration "anches", et il est donc plutôt logique d'appeler "Anches" les pédales d'appels correspondantes. D'ailleurs, Rupp, qui semble avoir eu accès à la dénomination originelle, parle de "Jeux d'Anche et de Combinaison".
Au sujet des jeux de combinaisons, la logique est la suivante : tous les jeux d'anches "de Batterie" (Bombarde, Trompettes, Clairons), toutes les anches 16', tous les jeux à bouche au-dessus du 4' (donc y-compris le Cornet), et les jeux à bouche "forts" de la pédale : le 32', les 16' ouverts, la Basse ouverte 8' et le 4'.
A droite des pédales d'expression se trouve l'autre partie des cuillers, correspondant aux accouplements, sur fond bleu : d'abord les cinq sur le grand-orgue : I/I 16', I/I, II/I, III/I 16', III/I, puis les trois autres : III/III 4', III/II, III/III.

Les appels des claviers (I/I et III/III) sont présents où il y a une Machine Barker (grand-orgue et récit). Ce type d'appel est parfois nommé "Appel Barker" ou "Appel pneumatique". Ici, on a préféré "GO UN" (grand-orgue unisson) et "REC UN" (récit unisson).
Il est donc clair que la "configuration normale" est d'enfoncer les pédales "GO UN"et "REC UN", afin d'éviter toute mauvaise surprise...
Plaque d'adresse en laiton incrusté dans le bois, en haut et au centre de la console. Son style enluminuré est celui des plus prestigieuses plaques Cavaillé-Coll. Elle dit :
à
Paris
 La plaque d'adresse Mutin à Guebwiller.
La plaque d'adresse Mutin à Guebwiller. La Flûte 4' est un cadeau de Mutin.
La Flûte 4' est un cadeau de Mutin.
![]() Charles (Carl) KIENTZL (Autriche 1797, Guebwiller 1874)
Charles (Carl) KIENTZL (Autriche 1797, Guebwiller 1874)
Le compositeur, violoniste et organiste autrichien Charles Kientzl s'est installé à Guebwiller sur le conseil de Jean-Jacques Bourcart. Kientzl participa très activement à la vie musicale, en fondant notamment l'école de musique de Guebwiller, un chœur mixte, un orchestre et une harmonie, tous très réputés. Auteur de nombreuses œuvres musicales religieuses, il tint les orgues de Notre-Dame de Guebwiller.
En 1873, son orgue de salon fut vendu à Brinckheim, où on peut encore le voir.
Kientzl est l'auteur d'un Requiem, de plusieurs Messes, d'une quantité de Cantiques et d'une étude historique sur la musique en Alsace, parue en 1868.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 14/07/2002,01/06/2019
Remerciements à Thierry Mechler.
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 68b
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 129-31
-
[YMerlin] Yannick Merlin : e-mail du 27/03/2003.
Historique de l'instrument, a travers les contributions de Rinckenbach, Mathias, Hamm, Huber, Dalstein-Haerpfer, Claussmann, Mutin, Widor, Gigout, Schmitt.
- [YMParisAlsace] Yannick Merlin : "Orgues et organistes parisiens en Alsace (1860-1908)", in "L'Orgue, bulletin des Amis de l'Orgue", 2003-IV
-
[SCampet] Samuel Campet : e-mail du 29/06/2019.Document "Mutin.ttf"
Fonte de caractères "Mutin".
-
[VWeller] Victor Weller : e-mail du 07/01/2016.
Nettoyage des anches du récit de 2016
-
[NHassle] Nicolas Hasslé : e-mail du 14/08/2003.
Photo du 10/07/2003.
-
[CPallaud] Cyril Pallaud : e-mail du 17/03/2006.
Travaux de 2006
-
[RLopes] Roland Lopes :
Photos du 15/04/2013
-
[GRitz] Gilles Ritz : e-mail du 22/08/2002,24/07/2002,16/07/2002.
Photo du 03/06/2001 ; données sur la composition et les accessoires de console
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 206
- [PMSCALL] Pie Meyer-Siat : "Les Callinet, facteurs d'orgues à Rouffach et leur oeuvre en Alsace", éditions Istra, 1965, p. 89
- [HOIE] Pie Meyer-Siat : "Historische Orgeln im Elsass", éditions Schnell und Steiner, München - Zürich, 1983, p. 162-3
- [Rupp] Emile Rupp : "Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst", éditions Verlagsansalt Benziger, Einsiedeln, 1929, p. 306-7
-
[OrgueEnAlsace] Collectif : ""Images du patrimoine : L'orgue en Alsace". Réalisé par le service régional de l'Inventaire général (Roger Lehni, dir.), avec des articles d'Yves Collot, Christian Lutz, Roger Lehni, et 33 enquêteurs de l'USC.", in "Images du patrimoine", éditions La Maison d'Alsace, p. 41
Dans cette publication de 1988, les orgues sont classé en fonction du buffet, et on le trouve donc ce Mutin sous "Le XVIIè siècle: Silbermann et les autres"... Pour illustrer les propos précédents de cette page, on trouve dans cet article la phrase "Toute la tuyauterie de Rabiny a été remplacée en 1908 par Charles Mutin (1861-1931), élève et successeur de Cavaillé-Coll". La tuyauterie, mais aussi les sommiers, la console, la mécanique, l'alimentation en vent... si ces éléments étaient réellement de Rabiny.
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im68000306 ; avec des plans de tribune, une élévation de la façade, et de nombreuses photos des inventaires de Jean Erfurth et Stamm, y-compris de la tuyauterie et de la mécanique.
- [Hamel] Marie-Pierre Hamel : "Nouveau manuel complet du facteur d'orgues", éditions Manuels Rorer, 1849, p. 470-1
- [RMuller] René Muller : "Anthologie des compositeurs de musique d'Alsace", éditions Fédération des Sociétés Catholiques de Chant et de Musique d'Alsace, 1970
![]() Localisation :
Localisation :