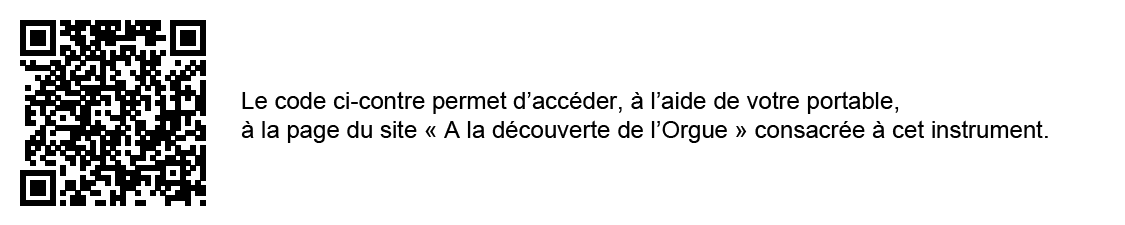L'orgue Martin Rinckenbach de Mulhouse, St-Joseph.
L'orgue Martin Rinckenbach de Mulhouse, St-Joseph.Les photos sont de Martin Foisset, 23/03/2019.
L'édifice est grandiose : c'est l'œuvre de Jules Scherr (1883), qui a réalisé une nef à trois vaisseaux sur une structure métallique. Une grande tribune longe trois des côtés, et l'ensemble, avec ses grandes baies vitrées rendues possibles par la légèreté de la structure, baigne dans une lumière et une ambiance uniques. L'église, inaugurée le 18/03/1883, avait été meublée et décorée par Théophile Klem et Carola Sorg, mais suite à une crise de "pureté" typique des années 50, beaucoup de ces ornements ont disparu. Il reste les fonds baptismaux (de Klem), et bien sûr, l'orgue, monumental, doté par les frères Boehm d'un buffet d'une étourdissante virtuosité. Car, pour cette grande église de Cité ouvrière, au cœur d'un quartier on ne peut plus "populaire" (dans tous les bons sens du mot), c'est - évidemment - un instrument symphonique qui s'est imposé. Un orgue entièrement consacré à charmer son auditoire. Ici, pas une once d'élitisme : tout semble issu d'une réflexion fondamentalement sincère sur ce que la musique peut apporter à la liturgie, et plus généralement au bien-être de la collectivité.
Historique
L'orgue actuel est le premier du lieu : il a été construit en 1887 par Martin Rinckenbach. C'est l'opus 15 de la maison d'Ammerschwihr, logé dans un buffet néo-roman des frères Boehm, de Mulhouse. Il a été inauguré le 01/08/1887. [LR1907] [IHOA] [YMerlin]
Le contexte en Alsace
On peut se demander quelles étaient les options qui se présentaient aux commanditaires chargés de s'occuper de l'achat d'un orgue neuf à Mulhouse vers 1885.
- L'époque pré-romantique était bel et bien révolue : après son départ pour Vesoul en 1872, Louis-François Callinet travaillait certes encore sporadiquement en Alsace (on l'a vu revenir en 1884 pour poser un orgue à Largitzen), mais la vieille maison de Rouffach avait été reprise par François Antoine Berger. Ce dernier mourut en 1883, et faire construire un grand orgue neuf par son fils Joseph Antoine représentait un pari risqué. L'autre maison majeure des deux premiers tiers du 19ème était Stiehr de Seltz. Celle-ci a posé plusieurs orgues dans le Haut-Rhin. Mais, il faut bien le reconnaître, même sous la direction de Louis Mockers, elle restait complètement à la traîne dans les années 80, enfermée dans sa logique "post-classique" (positif de dos, console en fenêtre).
- Si les frères Wetzel, de Strasbourg, ont travaillé pour la Moselle, le Luxembourg, et même à Rougemont-le-Château (90), force est de constater que le marché Haut-Rhinois ne les intéressait pas ou leur était totalement fermé. L'autre Strasbourgeois était Heinrich Koulen. Il effectua trois travaux conséquents dans le Haut-Rhin en 1884 : deux à Altkirch (pour l'église Notre-Dame de l'Assomption et le temple réformé) et un à Guebwiller (église protestante). Puis... plus rien avant 1891 (Ensisheim, église protestante), qui fut suivi par Altkirch, St-Morand et enfin Masevaux, église protestante.
- Les Mosellans Dalstein-Haerpfer avaient déjà fait du chemin "chez eux", mais n'avaient aucune référence alsacienne. Ils ont posé leur premier orgue alsacien en 1886 à Illzach. Pour le projet d'un orgue neuf à Mulhouse, s'adresser à Boulay devait être un pari risqué... qui n'aurait probablement pas été tenté par une communauté catholique. L'autre entreprise mosellane, Verschneider, était très active en Alsace : Zaessingue en 1881, Bruebach en 1885. Jean-Frédéric II Verschneider était certes spécialisé dans les petits instruments, mais il avait une très belle référence dans le Haut-Rhin : Guebwiller, St-Léger (1879). Il est vrai que ce n'était pas un orgue neuf, mais la "base" venait tout de même de Verschneider (1860).
- Il y avait bien sûr l'offre des Allemands "de l'intérieur" : celle-ci était conséquente et crédible : Friedrich Weigle a bien posé un orgue en 1886 à St-Louis. Et, bien sûr, il y avait la maison Eberhard Friedrich Walcker, qui avait déjà posé un orgue à Mulhouse (1866) et plusieurs autres dans le Haut-Rhin entre temps, comme à Pfastatt en 1879.
- Comme à Obernai, on a dû envisager de se doter d'un orgue parisien. L'église St-Etienne avait reçu son Aristide Cavaillé-Coll en 1860 (achevé en 1863). Et il y avait Joseph Merklin. Mais le grand instrument symphonique que posa ce dernier à Obernai en 1882 fut le dernier d'Alsace.
Le plus simple était donc de se tourner vers le Cavaillé-Coll alsacien, installé à Ammerschwihr : Martin Rinckenbach. Il avait déjà de solides références ; il pratiquait un style symphonique "français", mais sans excès, avec des influences germaniques et suisses. Finalement, l'offre locale devait aussi être la plus séduisante !
Le contexte pour Rinckenbach
En 1885, la maison d'Ammerschwihr avait posé son opus 10 à Hoenheim, le n°11 à Koetzingue et le n°12 à Ebersheim. En 1886, ce fut n°13 à Rothau et le n°14 à Ballersdorf. Et nul doute que le grand instrument de Thann (III/P 42j), livré en 1888, devait déjà être en préparation. L'instrument de Mulhouse fut donc le grand chantier de 1887, et il précéda de peu l'autre "grand 16 pieds" très bien conservé de la maison d'Ammerschwihr : Geispolsheim (1888, III/P 34j).
L'orgue Rinckenbach
Avec 37 jeux, 3 manuels et Machine Barker, cet instrument occupe une place importante dans l'œuvre de Martin Rinckenbach, et constitue un jalon majeur de l'orgue symphonique.
Voici sa probable composition d'origine :
Les tuyaux de façade actuels sont d'origine : ils n'ont pas été réquisitionnés par les autorités en 1917. [SBraillon]
 L'orgue Rinckenbach sur sa tribune.
L'orgue Rinckenbach sur sa tribune.Au fond, dans la nef latérale, on ditingue le monument à la mémoire
des paroissiens tombés lors du conflit de 1914-1918.
Certains noms de famille apparaissent jusqu'à cinq fois de suite...
On ne peut s'empêcher de penser que tous ces gens ont dû entendre cet orgue,
au cours des joies et des peines de leur vie finalement fauchée par la guerre.
En 1932, c'est Joseph Rinckenbach qui étendit la pédale de 27 (C-d') à 30 notes (C-f'). [ITOA]
Mais, suite à sa faillite, ce n'est pas lui qui intervint sur l'orgue l'année suivante.
En 1933, l'instrument a été confié à Georges Schwenkedel, qui ajouta 3 jeux, dans un petit récit logé à 7 m de hauteur sur le côté droit : un Quintaton 16', un Plein-jeu de récit et une Trompette 8'. Il transforma aussi, malheureusement, la Clarinette du positif en un Cromorne. [IHOA] [SBraillon] [MFoisset]
Voici la composition après les ajouts de 1932 (complément de pédale) et de 1933 (Schwenkedel) :
 L'ange de droite,
L'ange de droite,devant la boîte expressive du "petit récit".
En 1954, Pierre Huguin, de Bruyères (88) fit un relevage. [IHOA] [YMerlin]
En 1975, Gaston Kern fit une malheureuse transformation, destinée à ajouter des Mixtures. Celle-ci fut assortie d'un calamiteux "jeu de chaises musicales" entre les chapes, visant à en libérer deux au récit pour y placer une petite et une grande Fourniture. [IHOA] [SBraillon] [MFoisset]
- La Voix céleste et la Viole de Gambe (d'origine) furent déplacées au "petit récit", d'où il fallut sortir de Plein-jeu et la Trompette de Schwenkedel (1933). Le Plein-jeu disparut, et la Trompette fut placée sur la chape de la Voix céleste dans le "grand récit". Comme cette chape n'a pas d'octave grave (ce qui est normal pour une Voix céleste), la Trompette a été décalée en 16', à la demande d'Alain Langrée.
Finalement, cette opération ne permit de libérer qu'une chape au grand récit (celle de la Viole de Gambe), et entraîna la perte du Plein-jeu et de l'octave aiguë de la Trompette de récit (les deux de 1933).
- La seconde Fourniture fut placée sur la chape du Dolce (d'origine), qui disparut malheureusement à cette occasion.
Ce Dolce, ainsi que la Clarinette et l'inexplicable transformation de la Flûte harmonique 8' du positif en Flûte 8' simple constituent les seules altérations subies par le matériel d'origine de cet orgue.
En 1982, l'orgue a été réparé par Christian Guerrier. [IHOA]
En 2011, Michel Gaillard et Sébastien Braillon ont effectué des réparations et amélioré la distribution en vent : l'orgue est actuellement doté de trois ventilateurs, l'un alimentant directement la machine Barker. [CPallaud] [Visite]
Le buffet

Le buffet, en chêne et de style néo-roman, est de la maison Boehm, de Mulhouse.
Le plan général est constitué d'une grande tourelle centrale prismatique (sur la base d'un demi hexagone), flanquée de plates-faces, puis de tourelles latérales en tiers-point. Le tout est surmonté de couronnements élaborés, reposant sur une galerie double. Cette disposition aura tant de succès qu'on la retrouvera encore 35 ans plus tard (déclinée en néo-gothique) à Scherwiller par exemple.
Ce buffet se distingue par plusieurs éléments caractéristiques : tout d'abord, les superstructures sont en encorbellement au-dessus du soubassement, comme à Murbach (1906, qui est un autre exemple de buffet néo-roman de Boehm, mais aux tourelles plates). Cela fait aussi penser au buffet de l'orgue Merklin du Temple Neuf à Strasbourg (1877). Parmi les spécificités, il y a aussi les plates-faces latérales : à Mulhouse, elles sont purement décoratives. Peu profondes, elles n'abritent pas de tuyaux intérieurs, et, derrière elles, le buffet a la même largeur que le soubassement. Elles sont originales, mais inscrites dans une tradition déjà ancienne : à l'église protestante de Niederbronn-les-Bains, Louis Geib - qui était décidément fort imaginatif - avait adopté la même solution (purement esthétique) en 1807.
L'encorbellement est souligné d'une frise finement travaillée, et la ceinture du buffet permet d'alterner des panneaux aux motifs végétaux (parties saillantes) et des thèmes plus architecturaux (piliers, arcs, sous les plates-faces). Les arcs plein cintre reçoivent des archivoltes, sculptées comme les bandeaux verticaux. La partie supérieure est constituée de deux galeries, présentant des petits tuyaux (comme à Ensisheim). Ces tuyaux sont muets, et apparaissent à la galerie inférieure au-dessus des tourelles latérales, et à la galerie supérieure pour la centrale.
Les couronnements commencent par de petites tours à créneaux et des frises végétales, puis utilisent un autre motif cher à l'art roman : les damiers de billettes. (Comme sur les fonds baptismaux). Ils constituent la ceinture supérieure de la tourelle centrale, et reprennent le symbolisme de l'échelle, donc de l'élévation. On les retrouve à Andlau (Jean Weyh, 1880 ; ce buffet, qui est une merveille de l'art néo-roman, a malheureusement été relégué dans un transept, où il est caché, suite à un absurde déplacement ; il abrite un orgue abandonné depuis longtemps).
 L'ange de la tourelle gauche.
L'ange de la tourelle gauche.Et, plus bas, les petites tours à créneaux.
Enfin, il y a les deux grands anges musiciens, embouchant des trompettes naturelles. Leurs poses sont symétriques. Le thème des anges est cher au style éclectique : on les retrouvera par exemple à Wangenbourg (orgue Franz Xaver Kriess de 1891) ou Buhl (Heinrich Koulen, 1892). Ils sont en fait familiers des buffets monumentaux depuis l'époque classique (Riquewihr, 1783, mais aussi Guebwiller, dont l'orgue Mutin de 1908 est en fait logé dans un buffet remontant à 1785). Les anges avaient été un peu oubliés lors des deux premiers tiers du 19ème, car on leur préférait les chérubins, plus petits et potelés, parfois limités à des têtes ailées, et volontiers disposés aux culots des tourelles. Par la suite, les "grands" anges retrouveront une place de choix sur le buffet d'un autre orgue de Martin Rinckenbach : celui de Selestat, Ste-Foy. Il sont encore présents au début du 20ème siècle (1912) à la chapelle de l'hôpital de Pairis.
L'ensemble s'inscrit dans un losange dont la console occupe la pointe inférieure, et d'où émergent les deux anges. Par l'équilibre de ses proportions et la virtuosité de son ornementation, il s'agit assurément d'un des plus beaux buffets d'orgue d'Alsace.
Caractéristiques instrumentales

Console indépendante face à la nef, fermée par un couvercle basculant. Tirants de jeux de section ronde à pommeaux tournés noirs munis de porcelaines, placés en trois gradins de part et d'autre des claviers (plus 3 en haut à droite). Le nom des jeux apparaît en rouge pour le positif (qui est le premier clavier), noir pour le grand-orgue (deuxième), vert pour le récit (troisième), et bleu pour la pédale. Claviers blancs. Joues moulurées.
Commande des tirasses et accouplements par pédales-cuillers en fer forgé : de gauche à droite : "Accouplement du g.Orgue à la Pédale." (II/P), "Accouplement du Récit au Positif." (III/I), "Accouplement du Positif au grand Orgue" (I/II). Vient ensuite la pédale basculante "Expression du Récit". Elle est en position centrale, incurvée et avec des rebords, et n'est pas d'origine, car l'expression se faisait par pédale à accrocher (donc avec seulement les positions ouvert et fermé). En continuant vers la droite : "Accouplement du Récit au grand Orgue" (III/II), "Grand-orgue" (II/II, soit l'appel grand-orgue) et "Jeux de Combinaisons du grand Orgue". Les accouplements sur le grand-orgue sont transitifs avec la tirasse (I/II et II/P ensemble donnent aussi I/P ; III/II et II/P ensemble donnent aussi III/P). On pourrait croire que ces repérages, en français, datent de 1932 (Joseph Rinckenbach) ou 1933 (Georges Schwenkedel), mais ils sont exactement dans le même style qu'à Geispolsheim, et donc d'origine.
Le pédalier a l'air de Joseph Rinckenbach (1932 ?).
Plaque d'adresse incrustée directement dans la console, sur un fond de même essence de bois que le reste, avec des lettres en laiton, tout en Français :
Facteur d'Orgues
AMMERSCHWIHR.
 La plaque d'adresse est du même modèle que celle de Geispolsheim.
La plaque d'adresse est du même modèle que celle de Geispolsheim.Mécanique à équerres (notes et jeux), avec assistance Barker (agissant sur le grand-orgue). Le "second récit" est à transmission pneumatique (notes et jeux).
 La machine Barker, dans le soubassement.
La machine Barker, dans le soubassement.L'avant de l'orgue est à gauche. A droite, des tuyaux de la pédale.
Sommiers à gravures, d'origine, sauf pour celui du "second récit" (Schwenkedel, 1933) qui est à membranes, et les 3 notes du complément de pédale (Joseph Rinckenbach).
La pédale est logée dans le soubassement.
Le grand-orgue est à sa place habituelle, derrière la façade. Il y a deux sommiers, diatoniques, en "M" (basses aux extrémités).
Le récit (principal) est derrière le grand-orgue, sous la voûte du clocher. Il y a également deux sommiers, diatoniques, en "M".
Le positif est à l'étage supérieur, à l'aplomb du grand-orgue (donc en avant). Il est également diatonique, mais en mitre (basses au centre).
Le "petit récit" est tout en haut, à droite.
Comme toujours chez Martin Rinckenbach (qui a commencé sa carrière comme tuyautier), la tuyauterie est d'excellente qualité. Les Bourdons sont à calottes mobiles, les jeux ouverts munis d'entailles de timbre, les Gambes de freins harmoniques, et les biseaux de dents, marquées manuellement. L'ensemble est dans un état de conservation remarquable, et ne porte aucune trace d'altération ou de modification.
 Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.
Une vue sur la tuyauterie du grand-orgue.A gauche : l'avant de l'orgue, à droite : le fond et la passerelle.
Il s'agit de la moitié gauche du grand-orgue (les sommiers sont diatoniques).
De gauche (façade) à droite (accès) :
la façade (d'origine ; on voit le revers et les postages d'alimentation en vent),
la partie "sur le vent" de la Montre 8', la Montre 16', le Bourdon 16',
le Prestant, le Bourdon 8', la Gambe, la Flûte harmonique 8',
la Flûte octaviante 4', la Doublette, le Cornet à 5 rangs, posté en hauteur,
la Mixture-tierce à 4 rangs, la Trompette (avec ses ouvertures rondes),
et le Clairon, dons les aigus sont doublement harmoniques (résonateurs en 16').
 Le positif, au-dessus du grand-orgue.
Le positif, au-dessus du grand-orgue.C'est sa partie gauche (il est en mitre, les aigus sont sur les côtés.
Dans le coin supérieur gauche, le haut de quelques tuyaux du grand-orgue.
Depuis en bas à gauche (accès) vers en haut à droite (fond de l'orgue) :
le Cromorne (remplaçant la Clarinette ; le faux-sommier a été remplacé),
le Piccolo, la Flûte 4' (non harmonique, mais le faux-sommier a l'air d'origine),
la Dulciane 4', la Quinte, le Salicional, le Bourdon et la Montre-Viole 8'.
 Le récit de 1887.
Le récit de 1887.De bas (accès) en haut (fond) : le Hautbois, le Flageolet,
puis les deux Fournitures issues de la malheureuse transformation de 1975,
(ce sont les chapes de la Viole et du Dolce),
la Flûte harmonique 4', le Principal 8', le Bourdon 8',
puis, au fond (!), cette Trompette décalée en 16' parce qu'elle occupe
la chape... de la Voix céleste.
Le Quintaton 16', la Viole de Gambe et la Voix céleste sont dans le "petit récit".

Conçu pour une communauté populaire, nourrie de nombreuses influences culturelles, cet instrument raconte d'abord une belle page de l'histoire de Mulhouse. Une époque où Jean Dollfus avait offert un terrain... à la condition qu'on y bâtisse une église en moins de 2 ans ! Une époque qui ne craignait donc pas de relever des défis. Et qui ne craignait pas non plus de concevoir des instruments et des répertoires avant tout destinés à plaire à un large public.
On peut y voir, aussi, un témoin de cette époque où le Romantisme, ayant atteint son âge mûr, évoluait vers une esthétique plus orchestrale, encore plus dynamique, en exploitant la diversité des timbres et des intensités. Cet instrument est resté dans un état d'authenticité remarquable : les travaux de Schwenkedel sont parfaitement inscrits dans la démarche originelle.
Mais c'est avant tout un instrument de musique incomparable, doté de toutes les qualités qu'on attend d'un orgue d'exception. Assurément un des plus beaux d'Alsace, toutes époques confondues.
![]() Activités culturelles :
Activités culturelles :
-
2011 : Le 2ème volume de l'intégrale de l'œuvre d'orgue de Léon Boëllmann (1862-1897) à été enregistré à Mulhouse, St-Joseph par Marie Faucqueur en août 2011, avec une prise de son de François Gauvenet. Analyse des œuvres par Th. Adhumeau – président de l’association Boëllmann-Gigout. Le 1er volume a été enregistré à Ensisheim.

- 28/0/2011 : « Alice au pays de l'orgue », avec Jean Guillou et Brigitte Fossey.
- 27/03/1988 : Concert de Thierry Mechler, à l'occasion du centenaire de l'instrument.
![]() Sources et bibliographie :
Sources et bibliographie :
-
[Visite] "Visite sur place", 25/08/2005,23/03/2019
Remerciements à Sébastien Braillon.
-
[MFoisset] Martin Foisset : e-mail du 24/03/2019,30/03/2019.Document "Mulhouse; St Joseph.pdf"
Données techniques, photos du 23/03/2019.
-
[SBraillon] Sébastien Braillon : , 25/08/2005,23/03/2019
Données techniques et historiques.
-
[LArnold] Luc Arnold : e-mail du 01/03/2017.
Enregistrement effectué un juillet 1984.
-
[FLechene] Franck Lechêne :
Photos du 28/08/2012
- [CPallaud] Cyril Pallaud : e-mail du 22/12/2011.
-
[JGUhlrich] Jean-Georges Uhlrich : e-mail du 09/12/2011.
Photo de la machine Barker, du 04/12/2011
-
[YMerlin] Yannick Merlin : e-mail du 04/12/2003.
Photos du buffet et de la console ; article de presse de 1954 ; allocution de Jean Arnold du 27/03/1988.
-
[LR1907] F.X. Mathias : "Die Orgelbaufirma Rinckenbach in Ammerschweier i. E. (liste des travaux de 1872 à 1907)", in "Caecilia", p. 83
"Mülhausen St. Joseph 37"
- [IHOA] Pie Meyer-Siat : "Inventaire historique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, puis Coprur, 1985 et 2003, p. 119b
- [ITOA] "Inventaire technique des orgues d'Alsace", éditions ARDAM, vol. 2, p. 263-4
- [Barth] Médard Barth : "Elsass, 'Das Land der Orgeln' im 19. Jahrhundert", in "Archives de l'Eglise d'Alsace", vol 15., éditions de la société Haguenau, 1965-66, p. 267
-
[Palissy] Ministère de la Culture : "Base Palissy"
im68002702 ; avec des photos de l'inventaire Menninger
![]() Localisation :
Localisation :